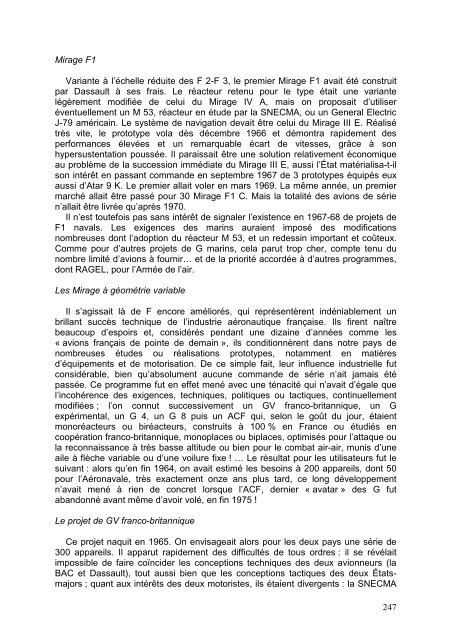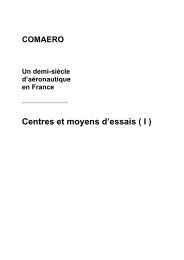LES AVIONS MILITAIRES - EuroSAE
LES AVIONS MILITAIRES - EuroSAE
LES AVIONS MILITAIRES - EuroSAE
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Mirage F1<br />
Variante à l’échelle réduite des F 2-F 3, le premier Mirage F1 avait été construit<br />
par Dassault à ses frais. Le réacteur retenu pour le type était une variante<br />
légèrement modifiée de celui du Mirage IV A, mais on proposait d’utiliser<br />
éventuellement un M 53, réacteur en étude par la SNECMA, ou un General Electric<br />
J-79 américain. Le système de navigation devait être celui du Mirage III E. Réalisé<br />
très vite, le prototype vola dès décembre 1966 et démontra rapidement des<br />
performances élevées et un remarquable écart de vitesses, grâce à son<br />
hypersustentation poussée. Il paraissait être une solution relativement économique<br />
au problème de la succession immédiate du Mirage III E, aussi l’État matérialisa-t-il<br />
son intérêt en passant commande en septembre 1967 de 3 prototypes équipés eux<br />
aussi d’Atar 9 K. Le premier allait voler en mars 1969. La même année, un premier<br />
marché allait être passé pour 30 Mirage F1 C. Mais la totalité des avions de série<br />
n’allait être livrée qu’après 1970.<br />
Il n’est toutefois pas sans intérêt de signaler l’existence en 1967-68 de projets de<br />
F1 navals. Les exigences des marins auraient imposé des modifications<br />
nombreuses dont l’adoption du réacteur M 53, et un redessin important et coûteux.<br />
Comme pour d’autres projets de G marins, cela parut trop cher, compte tenu du<br />
nombre limité d’avions à fournir… et de la priorité accordée à d’autres programmes,<br />
dont RAGEL, pour l’Armée de l’air.<br />
Les Mirage à géométrie variable<br />
Il s’agissait là de F encore améliorés, qui représentèrent indéniablement un<br />
brillant succès technique de l’industrie aéronautique française. Ils firent naître<br />
beaucoup d’espoirs et, considérés pendant une dizaine d’années comme les<br />
« avions français de pointe de demain », ils conditionnèrent dans notre pays de<br />
nombreuses études ou réalisations prototypes, notamment en matières<br />
d’équipements et de motorisation. De ce simple fait, leur influence industrielle fut<br />
considérable, bien qu’absolument aucune commande de série n’ait jamais été<br />
passée. Ce programme fut en effet mené avec une ténacité qui n’avait d’égale que<br />
l’incohérence des exigences, techniques, politiques ou tactiques, continuellement<br />
modifiées ; l’on connut successivement un GV franco-britannique, un G<br />
expérimental, un G 4, un G 8 puis un ACF qui, selon le goût du jour, étaient<br />
monoréacteurs ou biréacteurs, construits à 100 % en France ou étudiés en<br />
coopération franco-britannique, monoplaces ou biplaces, optimisés pour l’attaque ou<br />
la reconnaissance à très basse altitude ou bien pour le combat air-air, munis d’une<br />
aile à flèche variable ou d’une voilure fixe ! … Le résultat pour les utilisateurs fut le<br />
suivant : alors qu’en fin 1964, on avait estimé les besoins à 200 appareils, dont 50<br />
pour l’Aéronavale, très exactement onze ans plus tard, ce long développement<br />
n’avait mené à rien de concret lorsque l’ACF, dernier « avatar » des G fut<br />
abandonné avant même d’avoir volé, en fin 1975 !<br />
Le projet de GV franco-britannique<br />
Ce projet naquit en 1965. On envisageait alors pour les deux pays une série de<br />
300 appareils. Il apparut rapidement des difficultés de tous ordres : il se révélait<br />
impossible de faire coïncider les conceptions techniques des deux avionneurs (la<br />
BAC et Dassault), tout aussi bien que les conceptions tactiques des deux Étatsmajors<br />
; quant aux intérêts des deux motoristes, ils étaient divergents : la SNECMA<br />
247