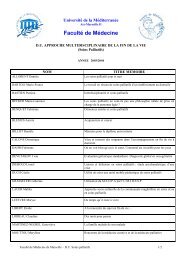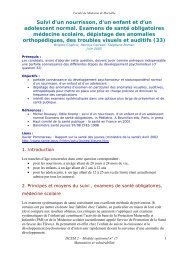chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, hormonothérapie. La ...
chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, hormonothérapie. La ...
chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, hormonothérapie. La ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Faculté de Médecine de Marseille<br />
Traitement des cancers :<strong>chirurgie</strong>,<br />
<strong>radiothérapie</strong>, <strong>chimiothérapie</strong>, <strong>hormonothérapie</strong>.<br />
<strong>La</strong> décision thérapeutique multidisciplinaire et<br />
l’information du malade (141)<br />
Professeurs : D. Maranninchi, G. Houvenaeghel, P. Viens et D. Cowen<br />
Mai 2005<br />
Objectifs :<br />
• Décrire les grands principes des traitements en cancérologie et expliquer la<br />
nécessité d’une décision multidisciplinaire en tenant compte de l’avis du patient.<br />
• Expliquer les effets secondaires les plus fréquents et les plus graves des<br />
traitements, leurs signes d’appel et leur prévention.<br />
1. Introduction<br />
Le traitement des cancers est stratifié en fonction de la dissémination de la maladie, combiné<br />
entre plusieurs armes thérapeutiques (<strong>chirurgie</strong>, <strong>radiothérapie</strong>, traitements médicaux).<br />
Ce traitement doit être organisé, coordonné entre les disciplines et planifié et expliqué au<br />
patient qui suit ce long parcours thérapeutique à l’enjeu vital.<br />
Ce document vise à fournir une base de connaissances sur les grands principes et la<br />
conséquences d’une pratique médicale touchant de plus en plus de patients :<br />
• la concertation pluridisciplinaire<br />
• la <strong>chirurgie</strong> des cancers<br />
• la <strong>radiothérapie</strong> des cancers<br />
• la <strong>chimiothérapie</strong> des cancers<br />
• l’<strong>hormonothérapie</strong><br />
• l’information du patient.<br />
2. Prise en charge et coordination multidisciplinaire<br />
<strong>La</strong> diversité et la complexité de la maladie cancéreuse, sa capacité à envahir les tissus<br />
avoisinants, sa dissémination fréquente à distance via des micro ou macro métastases<br />
imposent l’association constante de plusieurs disciplines pour prendre en charge un patient.<br />
<strong>La</strong> décision d’une stratégie ou d’un plan thérapeutique suppose une confrontation autour du<br />
dossier du patient de médecins émanant obligatoirement de plusieurs disciplines : ce<br />
processus s’appelle la concertation pluridisciplinaire.<br />
2.1. Qui participe à une concertation pluridisciplinaire ?<br />
Les médecins participant à la discussion du dossier avant la mise en œuvre du traitement<br />
sont :<br />
• des <strong>chirurgie</strong>ns<br />
• des radiothérapeutes<br />
• des oncologues médicaux (ou chimiothérapeutes)<br />
• des anatomopathologistes.<br />
Peuvent s’adjoindre d’autres médecins selon le besoin de la pathologie :<br />
• spécialiste « d’organe » médical ou médico-chirurgical (exemples : ORL, urologue,<br />
pneumologue etc…)<br />
• spécialiste en imagerie médicale<br />
• biologistes spécialisés<br />
DCEM 2 – Module 10<br />
1
Faculté de Médecine de Marseille<br />
• psychologue, spécialiste de la douleur.<br />
Idéalement, le médecin traitant du malade participe à cette concertation.<br />
2.2. Pour quels malades une concertation est-elle nécessaire ?<br />
A priori tous, car de la confrontation des compétences présentes, une décision de meilleure<br />
qualité est assurée pour chaque patient et bien sur spécialement dans les cas difficiles et<br />
lorsque existent plusieurs options thérapeutiques.<br />
2.3. Quand une réunion de concertation est-elle nécessaire ?<br />
• Toujours en préthérapeutique<br />
• Toujours lors du traitement d’une récidive.<br />
• Parfois lorsqu’un événement (toxicité ou autre) impose de modifier la thérapeutique.<br />
2.4. Quels sont les principaux impacts de la concertation<br />
pluridisciplinaire ?<br />
Valider le stade de dissémination et le risque pronostique individuel<br />
Proposer un plan de traitement coordonnant dans sa technicité et dans le temps les différentes<br />
disciplines : en effet une mauvaise coordination peut avoir des conséquences graves. A titre<br />
d’exemples : si les marges d’exérèse ne sont pas en tissu sain (information donnée par<br />
l’anapath) on peut être amené à réopérer un malade et différer dans le temps et modifier dans<br />
ses champs et doses une irradiation ; de même une <strong>chimiothérapie</strong> adjuvante sera<br />
généralement plus efficace si elle est réalisée dans les 30 jours suivant l’acte chirurgical : il<br />
faut donc anticiper sa décision de mise en œuvre.<br />
Gérer en commun un dossier médical partagé et auditer sa qualité<br />
Partager la décision et organiser un plan thérapeutique se déroulant fréquemment sur plusieurs<br />
mois<br />
Communiquer ces éléments et ce plan au médecin traitant par écrit<br />
Constituer un « thésaurus » de stratégies pré-établies pour les situations standardisées.<br />
3. Chirurgie carcinologique<br />
Dans la grande majorité des cas, les malades atteints d’une tumeur solide sont confiés au<br />
<strong>chirurgie</strong>n pour qu’il en réalise l’exérèse. Cependant, l’acte chirurgical, s’il reste la « pierre<br />
angulaire » du traitement de la plupart des tumeurs solides, n’est plus la seule arme<br />
thérapeutique et doit s’inscrire dans une stratégie pluridisciplinaire dont l’objectif est double :<br />
assurer la guérison ou augmenter la durée de survie par le contrôle loco-régional mais aussi<br />
général de la maladie,<br />
assurer la bonne qualité de cette survie grâce à une thérapeutique loco-régionale aussi<br />
conservatrice que possible de la fonction et de l’image corporelle.<br />
<strong>La</strong> <strong>chirurgie</strong> est susceptible d’intervenir à diverses étapes du traitement des cancers.<br />
DCEM 2 – Module 10<br />
2
Faculté de Médecine de Marseille<br />
3.1. <strong>La</strong> biopsie et le bilan d’extension tumorale<br />
3.1.1. <strong>La</strong> biopsie :<br />
la mise en œuvre d’un traitement anticancéreux quel qu’il soit, et à fortiori s’il s’agit d’une<br />
exérèse mutilante, exige un diagnostic anatomo-pathologique préalable affirmant la malignité<br />
et précisant le type histologique de la tumeur.<br />
<strong>La</strong> biopsie chirurgicale à ciel ouvert est devenue plus rare grâce au progrès et à la plus grande<br />
utilisation des procédés de biopsie transcutanée guidée ou non par l’imagerie.<br />
Lorsque la biopsie chirurgicale est nécessaire, elle constitue un geste d’une importance<br />
majeure qui engage la responsabilité du <strong>chirurgie</strong>n vis-à-vis de toute l’évolution ultérieure de<br />
la maladie. Le respect de certaines règles apparaît donc très important :<br />
• nécessité d’une collaboration étroite entre l’anatomopathologiste et le <strong>chirurgie</strong>n,<br />
• identification des prélèvements avec précision,<br />
• un examen extemporané peut être nécessaire pour ajuster le geste chirurgical,<br />
• incision de la biopsie chirurgicale la plus directe possible,<br />
• la biopsie doit être suffisamment profonde avec prélèvement d’une quantité suffisante<br />
de<br />
• tissu viable,<br />
• l’utilisation du bistouri à lame froide est recommandé,<br />
• la biopsie chirurgicale doit être la moins traumatique possible.<br />
3.1.2. Bilan d’extension tumorale :<br />
Le deuxième élément capital intervenant dans la décision thérapeutique, et avant la conduite<br />
d’une exérèse chirurgicale, est le bilan d’extension tumorale qui permet la classification en<br />
stade.<br />
L’existence ou la mise en évidence d’un risque élevé d’une dissémination métastatique ainsi<br />
que l’existence d’une extension ganglionnaire majeure doivent faire réviser l’indication d’une<br />
<strong>chirurgie</strong> mutilante. L’extension locale ou loco-régionale peut contre indiquer une <strong>chirurgie</strong><br />
première. L’exploration chirurgicale examine avec rigueur les aires ganglionnaires drainant<br />
l’organe atteint et la zone de dissémination naturelle de la maladie.<br />
Au total l’acte chirurgical cancérologique s’inscrit au sein d’une stratégie thérapeutique qui<br />
nécessite une approche pluridisciplinaire. Cette stratégie tient compte de la sphère de<br />
dissémination de la maladie en cause et de l’efficacité présumée des différentes<br />
thérapeutiques anticancéreuses seules ou en association et de leur risque spécifique et cumulé.<br />
Le diagnostic de cancer est parfois une découverte opératoire. Ceci peut s'observer dans<br />
différentes circonstances :<br />
- une complication chirurgicale révélatrice du cancer, pour lequel le contexte d'urgence n'a pas<br />
permis un diagnostic et un bilan pré-opératoire ( par exemple : perforation d'un cancer<br />
gastrique ou colique; occlusion par cancer colo-rectal ).<br />
- découverte fortuite au cours d'une laparotomie réalisée pour une autre affection d'une<br />
néoplasie intra-abdominale.<br />
3.2. <strong>La</strong> <strong>chirurgie</strong> du cancer<br />
On oppose classiquement:<br />
• l'exérèse curative ou à visée curative (macroscopiquement complète )<br />
• et l'exérèse palliative qui laisse en place du tissu tumoral inextirpable. Cette notion<br />
d'exérèse curative est cependant purement macroscopique; en effet une extension tumorale<br />
DCEM 2 – Module 10<br />
3
Faculté de Médecine de Marseille<br />
microscopique peut toujours échapper à l'opérateur et être précisée secondairement sur les<br />
résultats histologiques de l'analyse de la pièce d'exérèse.<br />
Il s'agit essentiellement d'une <strong>chirurgie</strong> d'exérèse:<br />
• de la tumeur primitive<br />
• et des ganglions, correspondant au territoire de drainage lymphatique de l'organe atteint.<br />
3.2.1. <strong>La</strong> <strong>chirurgie</strong> d’exérèse à visée curative<br />
L’exérèse chirurgicale occupe une place majeure au sein de la stratégie thérapeutique de la<br />
plupart des tumeurs solides, et procure leur guérison dans une forte proportion des cas. Une<br />
<strong>chirurgie</strong> d’exérèse carcinologiquement satisfaisante et, avec une conception conservatrice,<br />
est devenue de plus en plus fréquente.<br />
Trois types de progrès ont favorisé cette conception conservatrice :<br />
• le diagnostic plus précoce grâce au dépistage et aux techniques diagnostiques plus<br />
performantes qui conduisent à traiter des tumeurs de faible volume,<br />
• la meilleure connaissance physiopathologique du mode de dissémination des tumeurs,<br />
en particulier sur le plan loco-régional,<br />
• l’évolution des autres thérapeutiques anticancéreuses.<br />
Cette exérèse localisée doit cependant garder une bonne radicalité, c’est-à-dire que le plan de<br />
coupe chirurgical doit passer en tissu sain avec une marge de sécurité vis-à-vis du tissu<br />
néoplasique. Cette marge de sécurité est la garantie d’un contrôle loco-régional satisfaisant,<br />
elle a pour but de limiter le risque de récidive locale.<br />
<strong>La</strong> largeur de la marge de sécurité est variable en fonction de la localisation tumorale. Elle est<br />
imposée par le caractère habituellement irrégulier des limites des tumeurs malignes et la<br />
possibilité d’envahissements microscopiques en périphérie de la tumeur. Elle est déterminée à<br />
la fois par des études anatomophysiopathologiques et par l’évaluation des résultats.<br />
En marge de la <strong>chirurgie</strong> curative, il faut évoquer la <strong>chirurgie</strong> de réduction tumorale, bien<br />
qu’elle ne permette pas d’obtenir des marges de sécurité saines. Elle entre cependant dans le<br />
cadre d’une stratégie à visée curative et s’applique principalement aux tumeurs solides<br />
chimio-sensibles, son objectif étant de favoriser l’efficacité de la <strong>chimiothérapie</strong><br />
postopératoire. Un bon exemple de cette <strong>chirurgie</strong> est représenté par la réduction tumorale<br />
réalisée pour des cancers de l’ovaire présentant une dissémination tumorale péritonéale.<br />
3.2.2. <strong>La</strong> <strong>chirurgie</strong> des territoires de drainage lymphatique.<br />
Le curage ganglionnaire constitue souvent l’autre volet de la <strong>chirurgie</strong> d’exérèse locorégionale.<br />
<strong>La</strong> lymphadénectomie possède un rôle thérapeutique propre et se justifie par le fait<br />
que la mise en évidence de métastases lymphatiques constitue un facteur pronostique<br />
essentiel, véritable marqueur du risque de métastases à distance.<br />
Ainsi on peut dire que schématiquement la lymphadénectomie peut se concevoir de 2<br />
manières :<br />
• la lymphadénectomie extensive de tous les groupes ganglionnaires drainant l’organe<br />
en cause est réalisée dans un but thérapeutique, et est justifiée si elle est capable<br />
d’améliorer le pronostic des tumeurs pour lesquelles on ne dispose pas de traitement<br />
adjuvant vraiment efficace. Ces interventions sont en contre partie souvent<br />
responsables d’une morbidité lourde comme par exemple le risque de lymphoedème<br />
des membres,<br />
• la lymphadénectomie sélective s’adresse à un ou des groupes ganglionnaires<br />
privilégiés considérés comme les meilleurs témoins de l’extension de la maladie. Elle<br />
a pour but de fournir une information pronostique essentielle pour l’indication du<br />
DCEM 2 – Module 10<br />
4
Faculté de Médecine de Marseille<br />
traitement adjuvant et elle a pour intérêt non négligeable de limiter la morbidité<br />
lymphatique de façon considérable.<br />
L’indication et l’étendue d’une lymphadénectomie dépendent de la lymphophilie, des<br />
territoires de drainage et de l’efficacité des traitements adjuvants de la tumeur en cause. Le<br />
nombre de ganglions enlevés doit être précisé ; il permet d’évaluer la qualité du curage<br />
ganglionnaire.<br />
3.2.3. Chirurgie des masses résiduelles, <strong>chirurgie</strong> des<br />
métastases, <strong>chirurgie</strong> de rattrapage.<br />
Ce chapitre constitue un volet très spécifique de la <strong>chirurgie</strong> des cancers. L’acte chirurgical<br />
prend place ici soit dans l’évolution au cours du traitement (<strong>chirurgie</strong> des masses résiduelles,<br />
<strong>chirurgie</strong> de métastases synchrones), soit dans l’évolution de la maladie c’est-à-dire lors de la<br />
rechute locale ou métastatique.<br />
Le développement de cette <strong>chirurgie</strong> est plus récent et résulte de l’évolution des protocoles<br />
mais aussi des idées car il est apparu que des survies prolongées pouvaient être assurées par<br />
l’exérèse des récidives tumorales localisées ou des métastases, alors que l’on a longtemps<br />
pensé que ces évolutions défavorables étaient au-dessus de toutes possibilités thérapeutiques.<br />
L’indication chirurgicale doit répondre à une décision pluridisciplinaire et à des règles qui ne<br />
permettent de l’envisager qu’avec des chances de survie raisonnables.<br />
3.2.3.1. <strong>La</strong> <strong>chirurgie</strong> des masses résiduelles :<br />
elle s’inscrit spécifiquement dans un protocole thérapeutique bien défini et doit permettre<br />
d’adapter la poursuite du traitement. Le meilleur exemple est celui des dysembryomes<br />
ganglionnaires testiculaires où l’efficacité de la <strong>chimiothérapie</strong> est telle que seule l’exérèse<br />
des masses résiduelles permet d’en connaître la nature évolutive ou non.<br />
3.2.3.2. L’exérèse des métastases<br />
Elle est en principe réservée aux métastases uniques ou peu nombreuses situées<br />
anatomiquement au niveau d’un seul organe (foie, poumon) et apparaissant en dehors de toute<br />
évolution loco-régionale.<br />
Les chances d’efficacité de l’exérèse d’une métastase sont d’autant plus grandes que<br />
l’intervalle libre entre la fin du traitement de la tumeur primitive et l’émergence de la<br />
métastase est long et dépendent aussi de la radicalité de l’exérèse de la métastase nécessitant<br />
un marge de sécurité en tissu sain.<br />
Cette <strong>chirurgie</strong> d'exérèse des métastases se justifie dans certaines maladies cancéreuses<br />
comme par exemple les cancers colo-rectaux et les tumeurs endocrines. Ceci correspond donc<br />
à une sélection rigoureuse des indications de ce type de <strong>chirurgie</strong>.<br />
3.2.3.3. <strong>La</strong> <strong>chirurgie</strong> des récidives<br />
Aussi appelée <strong>chirurgie</strong> de rattrapage, répond à des règles strictes et s’applique à des récidives<br />
localisées en l’absence de toute évolution métastatique à distance. L’intervalle libre écoulé<br />
entre le traitement de la tumeur initiale et la récidive a une grande importance pronostique.<br />
<strong>La</strong> caractéristique de la <strong>chirurgie</strong> de rattrapage est d’être le plus souvent large et mutilante car<br />
les marges d’exérèse doivent être saines si elle veut être curative. A ce titre, il est nécessaire,<br />
avant de l’entreprendre, d’essayer d’obtenir la preuve histologique de la récidive, ce qui est<br />
parfois difficile dans des tissus remaniés par les thérapeutiques initiales.<br />
DCEM 2 – Module 10<br />
5
Faculté de Médecine de Marseille<br />
3.2.4. Chirurgie des complications et des séquelles<br />
3.2.4.1. Chirurgie des séquelles.<br />
Les thérapeutiques anticancéreuses sont par définition agressives pour les tissus et la<br />
recherche d’une efficacité maximum conduit le plus souvent à approcher le seuil de toxicité.<br />
Celui-ci étant variable d’un individu à l’autre, il peut être franchi entraînant des complications<br />
iatrogènes quelquefois lourdes de conséquences pour le patient.<br />
3.2.4.1.1. Les complications de la <strong>chimiothérapie</strong> :<br />
Elles sont rarement chirurgicales.<br />
• L’extravasation de certains cytostatiques hors du site d’injection vasculaire entraînent<br />
des réactions nécrotico-inflammatoires qui peuvent nécessiter des gestes d’excision<br />
larges et secondairement des plasties de recouvrement. <strong>La</strong> reconnaissance précoce de<br />
ces accidents et la réalisation d’une irrigation lavage permet d’éviter les réactions<br />
nécrotiques. Ces accidents sont devenus beaucoup plus rares avec la généralisation des<br />
cathéters veineux centraux et des sites implantables d’accès au système veineux<br />
central et aussi grâce à la meilleure formation des personnels de soins.<br />
• Le <strong>chirurgie</strong>n peut être amené à opérer pour un syndrome chirurgical dans des<br />
conditions hématologiques précaires (thrombopénie, leucopénie, aplasie) induites par<br />
la <strong>chimiothérapie</strong>. L’indication et la technique chirurgicale doivent être adaptées à ces<br />
conditions qui réclament un environnement de soins spécialisé.<br />
3.2.4.1.2. Les complications de la <strong>radiothérapie</strong> :<br />
Elles sont plus fréquemment chirurgicales.<br />
Les radionécroses peuvent atteindre les tissus mous, l’os et les viscères abdominaux, en<br />
particulier le tube digestif. L’intervention en tissu irradié demande une compétence<br />
particulière et fait appel fréquemment à des procédés de <strong>chirurgie</strong> plastique.<br />
3.2.4.2. <strong>La</strong> <strong>chirurgie</strong> de reconstruction.<br />
<strong>La</strong> <strong>chirurgie</strong> reconstructrice proprement dite est un nouveau volet indispensable de la<br />
<strong>chirurgie</strong> cancérologique, surtout quand elle nécessite encore des interventions élargies<br />
délabrantes et mutilantes. Une reconstruction doit donc être envisagée et proposée soit<br />
secondairement soit immédiatement en fonction des localisations et de la stratégie<br />
thérapeutique. ( par exemple reconstruction mammaire après mastectomie soit dans le même<br />
temps opératoire que la mastectomie, soit à distance du premier geste opératoire ).<br />
<strong>La</strong> <strong>chirurgie</strong> reconstructrice fait appel à des techniques spécifiques utilisant le plus souvent du<br />
matériel prothétique, des lambeaux musculo-cutanés voire musculaires purs, le grand<br />
épiploon mobilisé sur un de ses pédicules, ou des transplants libres vascularisés après<br />
anastomoses micro-chirurgicales.<br />
3.2.5. Autres aspects de la <strong>chirurgie</strong> carcinologique.<br />
3.2.5.1. <strong>La</strong> <strong>chirurgie</strong> des lésions infra-cliniques<br />
Elle est de plus en plus fréquente dans le cadre du dépistage. Elle doit assurer la sécurité<br />
carcinologique en respectant l’intégralité et la fonction de l’organe atteint. <strong>La</strong> <strong>chirurgie</strong><br />
préventive s’inscrit dans une stratégie pluridisciplinaire et doit être la moins invalidante<br />
possible. Elle est réalisée dans le cadre de protocoles thérapeutiques permettant l’évaluation et<br />
l’adaptation des techniques chirurgicales et la précision des indications.<br />
<strong>La</strong> <strong>chirurgie</strong> prophylactique<br />
DCEM 2 – Module 10<br />
6
Faculté de Médecine de Marseille<br />
• Le <strong>chirurgie</strong>n peut jouer un rôle important dans le traitement des lésions précancéreuses.<br />
L'exérèse large de ces lésions pré-cancéreuses permet d'obtenir des guérisons définitives au<br />
prix d'une <strong>chirurgie</strong> souvent limitée. Par exemple :<br />
• conisation pour une dysplasie du col utérin<br />
• exérèse d'une mélanose de Dubreuilh, d'une maladie de Bowen ou d'un naevus<br />
• colectomie totale pour polypose recto-colique familiale.<br />
<strong>La</strong> <strong>chirurgie</strong> prophylactique en l’absence de toute lésion cancéreuse ou pré cancéreuse<br />
décelable réponds à des indications extrêmement sélectionnées en fonction des risques de<br />
cancers reconnus, notamment secondaires à des anomalies génétiques lorsqu’elles sont<br />
connues et lorsqu’elles ont été mises en évidence chez le patient concerné. (exemple :<br />
ovariectomie prophylactique, mastectomie prophylactique).<br />
3.2.5.2. <strong>La</strong> <strong>chirurgie</strong> palliative<br />
Elle doit être immédiatement et le plus durablement efficace : elle a pour but de soulager le<br />
patient et de prolonger la survie. Les gestes chirurgicaux doivent être les moins agressifs et les<br />
moins invalidants possible. Elle peut s’adresser dans des indications sélectionnées à des<br />
localisations métastatiques :<br />
= Dans les cas de métastases osseuses :<br />
• la <strong>chirurgie</strong> palliative peut être réalisée pour une fracture pathologique sur métastase,<br />
comme traitement préventif d'une métastase osseuse mécaniquement menaçante<br />
• les principales techniques utilisées sont les ostéosynthèses, la mise en place de<br />
prothèses ou de ciment pour combler des zones d'ostéolyse<br />
• les indications doivent tenir compte du délai de survie probable et du temps de<br />
réadaptation post-opératoire.<br />
= D'autres actes chirurgicaux palliatifs peuvent être réalisés dans le cadre des métastases et de<br />
leurs complications :<br />
• décompression médullaire par laminectomie et stabilisation du rachis;<br />
dérivation ventriculaire dans certaines métastases cérébrales.<br />
3.3. En conclusion :<br />
<strong>La</strong> <strong>chirurgie</strong> oncologique représente un des temps du traitement des cancers, s'intégrant en<br />
fonction du type de tumeur et de son stade, dans la stratégie thérapeutique qui fait intervenir la<br />
<strong>radiothérapie</strong> et/ou la <strong>chimiothérapie</strong> et/ou l'immunothérapie et/ou l'<strong>hormonothérapie</strong>. Ceci<br />
justifie que la prise des décisions thérapeutiques soit réalisé en comité pluridisciplinaire.<br />
4. <strong>La</strong> <strong>radiothérapie</strong><br />
4.1. Introduction<br />
<strong>La</strong> <strong>radiothérapie</strong> est avec la <strong>chirurgie</strong> et la <strong>chimiothérapie</strong>, une des méthodes de traitement les<br />
plus anciennes et les plus utilisées dans la lutte contre le cancer. Née il y à plus de cent ans<br />
avec la découverte de la radioactivité, elle a connu un développement extraordinaire au cours<br />
des 30 dernières années avec l’apparition des rayonnements de haute énergie et des<br />
accélérateurs de particules. Les progrès de l’informatique, de l’imagerie médicale, de la<br />
radiophysique et de la balistique ont permis au cours des 10 dernières années d’accéder à une<br />
<strong>radiothérapie</strong> moderne dont les perfectionnements ont eu une répercussion en allongeant la<br />
survie des patients tout en réduisant les complications à long terme.<br />
DCEM 2 – Module 10<br />
7
Faculté de Médecine de Marseille<br />
Il s’agit d’une spécialité méconnue alors même que deux patients sur trois atteints de cancer<br />
auront recours à la <strong>radiothérapie</strong> au cours de l’évolution de leur maladie, que ce soit à visée<br />
curative de façon exclusive ou en association aux autres méthodes, ou bien à visée<br />
symptomatique à un stade plus avancé de leur maladie. On estime également qu’un patient sur<br />
4 pourrait être guéri par <strong>radiothérapie</strong> exclusive et un sur 7 par l’association <strong>chirurgie</strong><strong>radiothérapie</strong>.<br />
L’avenir de la <strong>radiothérapie</strong> passera par son association avec la biologie tumorale et le<br />
développement de thérapeutiques issues des biotechnologies et du génie génétique.<br />
4.2. Les rayonnements<br />
Les rayonnements les plus utilisés en <strong>radiothérapie</strong> externe sont les rayonnements<br />
électromagnétiques de haute énergie ou photons. Ils sont assimilés à des « grains » d’énergie<br />
de masse nulle, de charge nulle interagissant avec la matière selon leur longueur d’onde. On<br />
distingue deux types de photons selon leur mode de production:<br />
Les photons X sont produits artificiellement par un accélérateur de particules (électrons)<br />
projetées sur une cible en tungstène avec laquelle ils interagissent. Le rayonnement X est<br />
recueilli derrière la cible puis focalisé. L’énergie du rayonnement s’exprime en MV<br />
(mégavolts). Les photons comprennent les rayons X de faible énergie (200 kV) qui ne sont<br />
presque plus utilisés de nos jours, et les photons de très haute énergie comprise entre 4 et 32<br />
MV qui permettent de traiter des tumeurs profondes en épargnant d’autant plus les tissus<br />
superficiels que l’énergie est élevée.<br />
Les photons γ sont d’origine intra-nucléaire, produits naturellement par la désintégration de<br />
l’atome (exemple : cobalt 60). L’énergie du rayonnement s’exprime en MeV (mégaélectronvolts),<br />
il est égal à 1,25 MeV pour le cobalt. De ce fait le maximum de la dose<br />
délivrée par un faisceau de cobalt est situé à 5 mm sous la peau et le rendement en profondeur<br />
des photons ne permet pas de traiter les tumeurs profondes. Les photons du cobalt sont utilisés<br />
quasi-exclusivement pour les cancers du sein, les cancers ORL et certaines irradiations<br />
palliatives.<br />
Hormis les électrons issus des accélérateurs de particules, très utiles pour traiter des tumeurs<br />
superficielles (carcinomes cutanés) ou des chaînes ganglionnaires peu profondes (ganglions<br />
spinaux, sus-claviculaires, inguinaux, etc…), les rayonnements particulaires sont moins<br />
utilisés. Il s’agit de protons et de neutrons pour l’essentiel, et leur intérêt clinique demeure<br />
très limité. L’étude d’ions lourds est réalisée dans quelques centres aux Etats-unis et en<br />
Europe possédant des cyclotrons.<br />
Enfin, l’irradiation peut être délivrée au travers de sources radioactives appliquées au contact<br />
des tumeurs : il s’agit de la curiethérapie. On parle de curiethérapie endocavitaire quand le<br />
matériel radio-actif est déposé dans une cavité (utérus par exemple) et de curiethérapie<br />
interstitielle lorsque ce matériel est introduit dans des aiguilles vectrices transfixiant la<br />
tumeur. Les sources les plus utilisées en France sont l’iridium ^192 dont la demi-vie est de 74<br />
jours et le césium ^137 dont la demi-vie est de 30 ans. Ces deux matériaux sont émetteurs de<br />
photons d’énergie environ égale à 0,6 MeV. Les sources radio-actives sont le plus souvent<br />
laissées en place au contact de la tumeur pendant la durée du traitement, puis retirées. Depuis<br />
quelques années en France l’autorisation d’utiliser des implants permanents a été donnée :<br />
ces sources d’Iode ^125 sont utilisées dans le traitement des cancers de la prostate à un stade<br />
limité.<br />
DCEM 2 – Module 10<br />
8
Faculté de Médecine de Marseille<br />
4.3. Interactions rayonnements-matière et mécanismes<br />
d’action<br />
Les interactions entre les rayonnements et la matière traversée s’étudient à différents niveaux<br />
4.3.1. Interactions physiques :<br />
L’interaction des photons avec la matière concerne en priorité les électrons en orbite autour<br />
des noyaux de matière. Quand ces électrons sont sur une couche externe, ils sont arrachés de<br />
leur orbite (ionisation) tandis que le photon incident perd de l’énergie et voit sa trajectoire<br />
déviée. Ce type d’interaction s’intitule : effet Compton. Lorsque le photon incident interagit<br />
avec un électron des couches internes, il transmet toute son énergie pour arracher cet électron.<br />
Des électrons des couches supérieures viennent alors prendre la place de l’électron arraché et<br />
la réorganisation électronique s’accompagne de l’émission de photons de<br />
fluorescence (excitation): c’est l’effet photo-électrique. Dans les deux cas, ce sont les<br />
électrons secondaires mis en mouvement par le photon incident qui sont les vecteurs de l’effet<br />
biologique, et les paquets d’énergie libérés le long de la trajectoire aboutissent au dommage<br />
biologique.<br />
4.3.2. Phénomènes chimiques :<br />
Les rayonnements provoquent une radiolyse de l’eau avec formation de radicaux libres à<br />
durée de vie courte et très réactifs. Les produits de la radiolyse de l’eau intra-cellulaire<br />
diffusent et détruisent l’ADN ainsi que les protéines membranaires. L’irradiation des lipides<br />
insaturés des membranes cellulaires forme également des réactions radicalaires et une<br />
peroxydation de la double couche lipidique létale. L’activation d’une protéine kinase C<br />
membranaire peut induire une voie apoptotique.<br />
Au niveau de l’ADN, l’irradiation peut entraîner des ruptures simple-brin ou double-brin.<br />
Les ruptures simple-brin sont souvent sublétales, mais leur accumulation peut dépasser les<br />
capacités de réparation cellulaire. Les ruptures double-brin sont peu réparables et représentent<br />
le mécanisme dominant de la mort cellulaire radio-induite. Il est à noter que les lésions<br />
décrites sont identiques que les cellules soient ou non cancéreuses : ce sont les capacités de<br />
réparation plus importantes des cellules normales qui sont à l’origine de l’effet différentiel.<br />
4.3.3. Mort cellulaire :<br />
Il existe deux mécanismes de mort cellulaire radio-induite. <strong>La</strong> mort cellulaire reproductive<br />
est une mort différée : c’est la perte du pouvoir de division cellulaire. L’irradiation entraîne un<br />
arrêt prolongé des cellules en phase G2, proportionnel à la dose délivrée. C’est au cours de<br />
cette phase que sont mises en route les enzymes de réparation cellulaire, et le point d’arrêt<br />
s’appelle un « check-point » ou point de contrôle. Il s’agit d’une mort clonogénique. <strong>La</strong> mort<br />
cellulaire programmée ou apoptose, est sous le contrôle de l’anti-oncogène p53. <strong>La</strong> fonction<br />
normale de p53, gardien du génome, est le contrôle du cycle cellulaire avec un blocage en G1-<br />
S aux fins de réparer les lésions sublétales. Il semble que la surexpression de p53 puisse dans<br />
certains cas obliger la cellule à se suicider. L’apoptose radio-induite passe par l’hydrolyse de<br />
la sphingomyéline et la voie de la céramide. Elle est importante dans certaines lignées<br />
cellulaires (lymphoïde) et ne semble pas dose-dépendante.<br />
DCEM 2 – Module 10<br />
9
Faculté de Médecine de Marseille<br />
4.4. Notions de dose, fractionnement, étalement<br />
<strong>La</strong> dose est exprimée en unité d’énergie absorbée par unité de masse. L’unité utilisée est le<br />
Gray (Gy) qui correspond à une énergie de 1 Joule par Kg. A l’échelon cellulaire, on estime<br />
qu’une dose de 1 Gy produit 200000 ionisations, dont 20000 dans le noyau et 2000 au niveau<br />
de l’ADN. Cet ADN présentera environ 50 ruptures double-brin et 500 ruptures simple-brin.<br />
<strong>La</strong> dose nécessaire à stériliser une tumeur a été déterminée empiriquement. Elle dépend du<br />
type histologique et par ordre décroissant de radio-sensibilité on note : les séminomes (très<br />
radio-sensibles), les lymphomes, les carcinomes épidermoïdes, les adénocarcinomes et les<br />
sarcomes (plus radio-résistants). Elle dépend de la taille tumorale : alors qu’une dose totale<br />
de 70 Gy stérilisera un adénocarcinome T1 de la prostate dans 85 à 90 % des cas, 78 Gy<br />
contrôleront 70% des T2 et 86 Gy stériliseront 30% à 50% des T3. Pour les mêmes raisons, la<br />
dose nécessaire à éliminer la maladie microscopique infra-clinique telle qu’on l’entend en<br />
post-opératoire est plus basse que pour une tumeur en place traitée par irradiation exclusive.<br />
Elle dépend de l’aspect macroscopique de la tumeur : les tumeurs bourgeonnantes sont<br />
beaucoup plus sensibles que les tumeurs infiltrantes. Enfin il existe des facteurs de<br />
radiosensibilité intrinsèques qui expliquent que deux tumeurs apparemment semblables<br />
n’aient pas la même radiosensibilité.<br />
<strong>La</strong> dose est indissociable des notions de fractionnement et d’étalement. <strong>La</strong> même dose<br />
délivrée en une, deux ou « x » fractions n’a pas la même efficacité biologique, ni la même<br />
tolérance au niveau des tissus sains : une dose curative ne peut jamais être délivrée en une<br />
seule fraction pour des raisons de tolérance aiguë. Le but du fractionnement est de faire<br />
apparaître un effet différentiel entre tissus normaux qui répareront les lésions radio-induites<br />
sublétales, et tissus cancéreux qui accumuleront ces lésions sans pouvoir les réparer. Le terme<br />
fractionnement traduit le nombre total de séances d’irradiation ainsi que la dose par séance et<br />
l’étalement est la durée totale du traitement. Le fractionnement de 1,8 à 2 Gy par séance à<br />
raison de 5 séances par semaine, a été déterminé empiriquement et l’immense majorité des<br />
protocoles de <strong>radiothérapie</strong> ont été établis selon ce schéma dit de référence. Ce n’est qu’au<br />
cours des 30 dernières années que des nouveaux fractionnements ont été testés dans des essais<br />
prospectifs randomisés. L’hypofractionnement consiste à délivrer des doses supérieures à<br />
2,25 Gy dans le but de réduire le nombre de jours de traitement. Il existe des schémas dits<br />
semi-concentrés : une dose de 30 Gy en 10 fractions de 3 Gy est un protocole fréquemment<br />
utilisé pour le traitement des métastases osseuses qui permet d’obtenir une efficacité plus<br />
rapide (5 fractions de moins que pour le schéma de référence). Dans la même indication et en<br />
fonction de l’état clinique du malade, on peut avoir recours à des protocoles concentrés : une<br />
dose de 20 Gy en 5 fractions de 4 Gy raccourcira le temps de traitement d’une semaine<br />
supplémentaire au bénéfice de la qualité de vie du patient. Si ces schémas sont à peu près<br />
identiques sur le plan de l’efficacité en terme d’antalgie et d’effet anti-tumoral, il n’en est pas<br />
de même au niveau de la tolérance tardive des tissus sains : plus la dose par fraction est élevée<br />
et le protocole concentré, plus les effets tardifs au niveau des tissus sains traversés par le<br />
faisceau (fibrose pulmonaire, myélite radique, fibrose sous-cutanée, télangiectasies etc…)<br />
sont importants. L’hyperfractionnement consiste à délivrer plusieurs doses d’irradiation par<br />
jour. Ceci permet d’augmenter la dose totale délivrée et dans certaines tumeurs ORL les<br />
protocoles de référence ont changé : il a été démontré qu’une dose de 70 Gy en 35 fractions<br />
de 2 Gy avec un étalement de 7 semaines était moins efficace en terme de contrôle local<br />
qu’une dose de 80,5 Gy en 70 fractions de 1,15 Gy (à raison de 2 séances par jour) avec le<br />
même étalement de 7 semaines. Dans ce dernier cas le traitement est dit bifractionné. A<br />
condition de respecter un intervalle de 6 heures entre chaque fraction, ce protocole permet<br />
d’élever la dose totale de 15% sans augmenter les effets tardifs au niveau des tissus sains.<br />
Enfin, il a été démontré que l’allongement de l’étalement des traitements pouvait être<br />
responsable d’une perte du contrôle local qui peut atteindre 20% par semaine supplémentaire<br />
DCEM 2 – Module 10<br />
10
Faculté de Médecine de Marseille<br />
à dose égale. Cette perte est due à la repopulation tumorale que intervient dès que<br />
l’irradiation est suspendue et pour cette raison, un des grands principes de la <strong>radiothérapie</strong> est<br />
de ne jamais interrompre un traitement en cours comme c’est le cas dans les irradiations<br />
dites en split-course (interruption programmée de l’irradiation). A l’inverse, pour empêcher<br />
la repopulation tumorale qui survient entre les fractions ou le week-end on peut raccourcir<br />
l’étalement: c’est le principe de la <strong>radiothérapie</strong> accélérée qui a cependant des indications<br />
très limitées en raisons d’effets aigus importants.<br />
4.5. Objectifs et place de la <strong>radiothérapie</strong> dans la stratégie<br />
thérapeutique<br />
4.5.1. L’irradiation exclusive à visée curative<br />
<strong>La</strong> <strong>radiothérapie</strong> est utilisée à visée curative dans plus de la moitié des cas. Elle peut être<br />
exclusive dans le cadre du traitement des petites tumeurs. Elle peut faire appel à l’irradiation<br />
externe seule, à la curiethérapie seule, ou à l’association des deux modalités. Pour les<br />
carcinomes épidermoïdes, les grandes indications de la sphère ORL sont les tumeurs T1-T2<br />
du plancher buccal, de l’amygdale, du voile du palais, et du larynx. Au niveau digestif, les<br />
taux de contrôle sont également excellents pour les tumeurs du canal anal et au niveau<br />
gynécologique, les T1 jusqu’au T1b1 sont traités de manière optimale par <strong>radiothérapie</strong><br />
exclusive. Dans toutes ces indications, la guérison intervient dans plus de 80-90% des cas.<br />
Pour les adénocarcinomes, le cancer de la prostate est une excellente indication de<br />
<strong>radiothérapie</strong> exclusive : traité par curiethérapie interstitielle à l’iode 125 pour les T1b, c et<br />
T2a avec des taux de guérison équivalents à ceux de la <strong>chirurgie</strong> exclusive (90%), les T1-T2-<br />
T3 peuvent également être traités par <strong>radiothérapie</strong> externe exclusive avec ou sans escalade<br />
de dose. Les adénocarcinomes du sein sont de moins en moins traités par irradiation<br />
exclusive, même s’il faut savoir y avoir recours chez des patients âgés inopérables avec<br />
quelques bons résultats mais des séquelles esthétiques importantes.<br />
L’irradiation pourra être exclusive dans le cadre de tumeurs radio-sensibles : la maladie de<br />
Hodgkin a longtemps été une indication de <strong>radiothérapie</strong> exclusive dans les stades limités et<br />
formes histologiques favorables. Sa toxicité à long terme dans les grands volumes a fait<br />
évoluer les standards de prise en charge de cette maladie.<br />
Enfin, on pourra faire appel à la <strong>radiothérapie</strong> exclusive dans les tumeurs inopérables. Le<br />
cancer du cavum est un bon exemple de tumeur curable à des doses de l’ordre de 70 Gy. De<br />
même dans les tumeurs évoluées (T3-4) du col de l’utérus traitées par <strong>radiothérapie</strong> exclusive,<br />
les taux de guérison sont toujours compris entre 30% et 40%.<br />
4.5.2. L’association <strong>radiothérapie</strong>-<strong>chirurgie</strong> à visée curative<br />
Dans une optique curative, la <strong>radiothérapie</strong> peut être associée à la <strong>chirurgie</strong> car dans de<br />
nombreuses localisations tumorales elle permet de réduire les taux de récidive locale qu’on<br />
observe après <strong>chirurgie</strong> exclusive. Ce faisant, elle améliore souvent la survie car elle empêche<br />
les ré-ensemencements tumoraux à partir des récidives locales. Selon les cas, cette irradiation<br />
sera délivrée avant, pendant ou après la <strong>chirurgie</strong>.<br />
4.5.2.1. <strong>La</strong> <strong>radiothérapie</strong> pré-opératoire<br />
Elle a plusieurs objectifs. Elle permet de faciliter la <strong>chirurgie</strong> d’exérèse dans les cancers de<br />
l’œsophage par exemple ou dans les cancers du rectum. Elle traite également la maladie<br />
microscopique « à priori », que le <strong>chirurgie</strong>n ne voit pas, mais qui est prévisible sur des<br />
arguments de taille tumorale ou d’histoire naturelle de la tumeur telle que la lymphophilie. On<br />
DCEM 2 – Module 10<br />
11
Faculté de Médecine de Marseille<br />
choisit de réaliser cette irradiation avant le temps chirurgical, souvent pour des raisons de<br />
complications bien moindres qu’en post-opératoire. Les doses nécessaires sont bien<br />
inférieures à celles de la <strong>radiothérapie</strong> exclusive. De manière générale, la dose nécessaire à<br />
éradiquer la maladie microscopique est comprise entre 45 et 50 Gy : l’irradiation se déroule<br />
donc pendant environ 5 semaines. Le patient est opéré entre 2 et 8 semaines plus tard selon la<br />
localisation tumorale. L’efficacité appréciée sur la pièce opératoire varie en fonction du délai<br />
entre la fin de l’irradiation et la <strong>chirurgie</strong> : plus ce délai est grand, plus les taux de stérilisation<br />
semblent importants mais il s’agit la d’un biais d’observation.<br />
4.5.2.2. <strong>La</strong> <strong>radiothérapie</strong> per-opératoire à ventre ouvert,<br />
malade anesthésié<br />
Elle est réservée à certains centres de <strong>radiothérapie</strong> et ses indications sont très limitées. Elle a<br />
pour objectif principal de surdoser le lit tumoral pendant l’intervention lorsque le <strong>chirurgie</strong>n a<br />
des difficultés d’exérèse et qu’une <strong>radiothérapie</strong> post-opératoire est prévue. L’avantage de<br />
cette dose forte (10 à 15 Gy), forcément unique, est que le <strong>chirurgie</strong>n peut écarter du faisceau<br />
tous les organes à risque qui limitent la dose en post-opératoire. Les indications ne sont pas<br />
reconnues de façon unanime, mais les « bons candidats » sont les tumeurs gastriques, les<br />
tumeurs rectales adhérentes à la concavité sacrée et les tumeurs pelviennes adhérentes aux<br />
parois latérales du pelvis. L’inconvénient de la dose unique est son inefficacité relative audelà<br />
de 8 Gy.<br />
4.5.2.3. <strong>La</strong> <strong>radiothérapie</strong> post-opératoire<br />
Elle a pour but de traiter la maladie microscopique prévisible « à posteriori » ou la maladie<br />
résiduelle laissée par le <strong>chirurgie</strong>n. Il peut s’agir de cancers du rectum sous-stadés<br />
initialement dont le risque de récidive est très élevé ou de tumeurs dont les limites d’exérèse<br />
microscopiques sont atteintes, de tumeurs de la sphère ORL à haut risque ganglionnaire dont<br />
l’irradiation permet d’omettre le curage ganglionnaire, de séminomes ganglionnaires très<br />
radio-sensibles dont l’irradiation post-opératoire est non toxique du fait des faibles doses<br />
délivrées et traitant le risque ganglionnaire. Enfin, l’exemple le plus fréquent de <strong>radiothérapie</strong><br />
post-opératoire, et un des meilleurs exemples de l’association à visée curative de deux<br />
modalités thérapeutiques est le cancer du sein. <strong>La</strong> <strong>radiothérapie</strong> adjuvante après tumorectomie<br />
a permis de traiter les cancers du sein de moins de 3 cm de façon conservatrice en réduisant le<br />
risque de récidive locale de 90%. Cette association est devenue une règle générale après<br />
<strong>chirurgie</strong> conservatrice.<br />
4.5.3. Les associations de <strong>chimiothérapie</strong> - <strong>radiothérapie</strong><br />
concomitante à visée curative<br />
Sans revenir sur les indications propres de la <strong>chimiothérapie</strong> dans les cancers, les associations<br />
de radio-<strong>chimiothérapie</strong> concomitante ont été développées dans le cadre du traitement curatif<br />
des cancers. Ces associations sont supérieures à la <strong>radiothérapie</strong> exclusive dans de<br />
nombreuses tumeurs, en particulier le col de l’utérus, les bronches, le canal anal et<br />
l’œsophage. Les bases de l’association reposent sur les concepts suivants :<br />
<strong>La</strong> coopération spatiale, selon laquelle chaque agent agit indépendamment à un niveau<br />
différent de l’espace : la <strong>radiothérapie</strong> s’occupant du problème local, la <strong>chimiothérapie</strong> du<br />
risque métastatique.<br />
<strong>La</strong> coopération temporelle, correspond à l’action concomitante au niveau de la tumeur des<br />
deux modalités thérapeutiques.<br />
DCEM 2 – Module 10<br />
12
Faculté de Médecine de Marseille<br />
<strong>La</strong> coopération cytocinétique est un principe reposant sur la plus grande sensibilité à<br />
l’irradiation selon les phases du cycle cellulaire : certaines drogues (taxoïdes et alcaloïdes de<br />
la pervenche) entraînent un bloc en G2/M phase plus radiosensible.<br />
<strong>La</strong> lutte contre la repopulation : la <strong>chimiothérapie</strong> concomitante permet de lutter contre la<br />
repopulation tumorale qui intervient quelques semaines après le début de l’irradiation. Dans le<br />
même ordre de concept, l’utilisation simultanée et non pas séquentielle des traitements permet<br />
une meilleure lutte contre l’apparition de clones résistants.<br />
<strong>La</strong> toxicité sélective des cellules hypoxiques est un facteur majeur d’efficacité thérapeutique<br />
car l’hypoxie est un facteur de radiorésistance important.<br />
Action au niveau de la réparation de l’ADN : la <strong>chimiothérapie</strong> peut interférer avec les<br />
mécanismes de réparation de l’ADN en transformant des cassures simple-brin en double-brin,<br />
en interférant avec la réparation des cassures double-brin par l’encombrement stérique<br />
provoqué par exemple par la présence d’adduits (sels de platine).<br />
Dernier mécanisme évoqué, l’apoptose chimio-induite qui peut être complémentaire de celle<br />
provoquée par l’irradiation car empruntant des voies de déclenchements distincts.<br />
4.5.4. <strong>La</strong> <strong>radiothérapie</strong> palliative et symptomatique<br />
Un grand nombre d’indications de la <strong>radiothérapie</strong> est à visée purement palliative et<br />
symptomatique. Tantôt l’irradiation est utilisée à visée antalgique : elle agit rapidement en<br />
réduisant la masse tumorale. Ailleurs, elle sera utilisée à visée décompressive et<br />
recalcifiante en présence de métastases rachidiennes, ou décompressive pure dans le cadre<br />
d’un syndrôme cave supérieur. Enfin, elle garde des indications à visée hémostatique dans<br />
les tumeurs pelviennes évoluées. Dans les cas majoritaires où l’objectif n’est pas la guérison,<br />
on utilise des protocoles concentrés avec des fortes doses par fraction. Le choix de la dose est<br />
guidé par l’espérance de vie attendue du patient, en sachant qu’il faut savoir ne pas redouter<br />
une complication tardive chez les patients à espérance de vie limitée et privilégier leur confort<br />
immédiat.<br />
4.6. <strong>La</strong> réalisation pratique des traitements<br />
En pratique, le radiothérapeute commence par recevoir le patient en consultation. Il<br />
s’informe de ses antécédents (notamment l’existence d’une irradiation antérieure), de la<br />
présence de pathologies susceptibles de modifier la sensibilité à l’irradiation (maladies<br />
systémiques, collagénoses, antécédents familiaux…). Il recueille l’ensemble des éléments<br />
indispensables dont le compte-rendu anatomo-pathologique sans lequel toute irradiation est<br />
formellement contre-indiquée. Il prend la décision de l’irradiation après concertation avec les<br />
autres acteurs (<strong>chirurgie</strong>n, oncologue médical, anatomo-pathologiste) du traitement du patient.<br />
Il informe le patient des risques et du déroulement de la <strong>radiothérapie</strong>.<br />
Une fois la décision d’irradiation prise, il faut définir les volumes à irradier et les doses.<br />
Traditionnellement, la définition des volumes se faisait cliniquement et grâce à un appareil<br />
d’électroradiologie par rapport à des repères osseux. Les conditions géométriques de cet<br />
appareil, le simulateur, sont identiques à celles de l’accélérateur de particules. Aujourd’hui,<br />
les volumes sont définis, repérés et contourés sur un examen scannographique réalisé en<br />
position de traitement. Le radiothérapeute contour sur chaque coupe les organes à risque et le<br />
volume cible. Ce dernier comprend le volume tumoral macroscopique ou GTV (« gross tumor<br />
volume »), augmenté des extensions microscopiques probables compte tenu des données<br />
cliniques et anatomiques liées à l’histoire naturelle du cancer : on parle de volume cible<br />
anatomo-clinique ou CTV (« clinical target volume »). Une marge de sécurité est rajoutée à<br />
ce volume pour tenir compte des incertitudes liées au positionnement du patient et à la<br />
mobilité des organes définissant le volume cible prévisionnel ou PTV (« planning target<br />
DCEM 2 – Module 10<br />
13
Faculté de Médecine de Marseille<br />
volume »). Le radiophysicien et le radiothérapeute définissent alors la meilleure balistique<br />
permettant d’irradier le PTV en épargnant les organes critiques. Des histogrammes dosevolume<br />
permettent de calculer le pourcentage de tumeur recevant 95% de la dose prescrite et<br />
donc de prévoir l’efficacité du traitement, ainsi que le pourcentage du volume de chaque<br />
organe critique recevant une dose définie et donc de prévoir la toxicité du traitement.<br />
Il est de la responsabilité du radiophysicien de définir les temps d’exposition pour chaque<br />
faisceau. Lors de la première séance d’irradiation, et au cours du traitement, la géométrie de<br />
chaque faisceau et le respect du plan de traitement sont vérifiés par imagerie en temps réel.<br />
Chaque séance complète d’irradiation dure entre 10 et 30 minutes selon le nombre de<br />
faisceaux prévus. <strong>La</strong> majorité de ce temps est consacrée au bon positionnement du malade<br />
afin d’assurer la reproductibilité du traitement d’une séance à l’autre, tandis que l’exposition<br />
aux rayonnements dure rarement plus de 2 minutes par faisceau. En cours de traitement, le<br />
radiothérapeute reçoit le patient chaque semaine pour vérifier le bon déroulement du plan de<br />
traitement et l’adéquation des réactions observées aux doses délivrées.<br />
L’ensemble des étapes décrites ci-dessus sont regroupées sous le terme de <strong>radiothérapie</strong><br />
conformationnelle, c’est-à-dire « sur mesure », se conformant au mieux géométriquement<br />
avec le PTV. <strong>La</strong> <strong>radiothérapie</strong> conformationnelle née avec les progrès de l’imagerie médicale<br />
et la sophistication des programmes de calculs physiques, a permis de réduire dramatiquement<br />
les effets secondaires de la <strong>radiothérapie</strong>. Dans le même temps les doses d’irradiation ont pu<br />
être augmentées, permettant en cela un meilleur contrôle local de certaines tumeurs dont le<br />
meilleur exemple est la prostate.<br />
4.7. Techniques particulières<br />
Quelques techniques particulières méritent d’être citées bien que relevant le plus souvent de<br />
centres spécialisés. L’irradiation corporelle totale est utilisée avant greffe de moelle osseuse<br />
ou de cellules souches. Elle permet l’immunodéplétion du receveur et l’atteinte des cellules<br />
tumorales dans les sanctuaires de la <strong>chimiothérapie</strong> tels que le système nerveux central. Elle<br />
emploie des doses supra-léthales et ne peut se concevoir qu’en milieu hyper-spécialisé.<br />
L’électronthérapie cutanée totale ou sub-totale anciennement dénommée « bain<br />
d’électrons » est indiquée dans certaines hémopathies cutanées. Sa complexité et la rareté des<br />
indications expliquent qu’elle ne soit pratiquée qu’en milieu hospitalier. <strong>La</strong> <strong>radiothérapie</strong> en<br />
conditions stéréotaxiques ou radio<strong>chirurgie</strong> est utilisée pour irradier des lésions cérébrales<br />
inférieures à 3 cm de diamètre. Elle nécessite le repérage de la tumeur et la mise en place du<br />
patient dans un cadre stéréotaxique relevant là encore d’un centre hyper-spécialisé. <strong>La</strong><br />
<strong>radiothérapie</strong> avec modulation d’intensité est la dernière innovation dans le cadre de la<br />
<strong>radiothérapie</strong> conformationnelle. Elle consiste à faire varier l’intensité de l’irradiation à<br />
l’intérieur même du faisceau, ce qui permet d’améliorer encore la répartition de dose et de<br />
préserver des organes critiques et des fonctions importantes.<br />
5. <strong>La</strong> <strong>chimiothérapie</strong> des cancers<br />
5.1. Introduction<br />
L’accès à des médicaments permettant de traiter des cancers est relativement récent : les<br />
premières études cliniques utilisant les « moutardes à l’azote » datent de 1942 et c’est depuis<br />
les années 60 que des combinaisons de drogues (poly<strong>chimiothérapie</strong>s) ont été démontrées<br />
efficaces pour faire régresser, voire guérir des cancers avancés.<br />
<strong>La</strong> <strong>chimiothérapie</strong> vise à traiter les cellules cancéreuses présentes dans l’ensemble de<br />
l’organisme : initialement utilisée dans les tumeurs solides métastatiques et dans les<br />
DCEM 2 – Module 10<br />
14
Faculté de Médecine de Marseille<br />
néoplasies hématologiques (leucémies et lymphomes disséminés), elle est de plus en plus<br />
utilisée précocement en combinaison aux autres thérapeutiques locorégionales des cancers<br />
pour le plus souvent traiter « préventivement » une maladie micro-métastatique inapparente<br />
(<strong>chimiothérapie</strong>s adjuvantes) ou agir en synergie sur la tumeur primaire avec les autres<br />
thérapeutiques (<strong>chimiothérapie</strong>s néo-adjuvantes, radio-<strong>chimiothérapie</strong>s concomitantes).<br />
Le principe général de la <strong>chimiothérapie</strong> anti-cancéreuse repose sur un traitement systémique<br />
détruisant des tissus tumoraux plus sensibles aux « dommages » introduits par ces drogues<br />
que les cellules normales. Ainsi les <strong>chimiothérapie</strong>s choisies doivent offrir des rapports<br />
efficacité / toxicité et bénéfices / risques positifs à largement positifs selon les drogues<br />
employées et les tumeurs traitées. L’efficacité de ces drogues repose sur des éléments<br />
spécifiques à la Biologie Tumorale et sur des bases cinétiques fondant les principales<br />
stratégies de <strong>chimiothérapie</strong> anticancéreuse.<br />
5.2. Chimiothérapie et biologie tumorale<br />
Une tumeur maligne est composée de cellules capables de croissance « excessive »,<br />
d’invasion des tissus avoisinants et de migration pour se disséminer à distance.<br />
<strong>La</strong> majorité des <strong>chimiothérapie</strong>s anticancéreuses vise à agir sur les facteurs responsables<br />
d’une croissance cellulaire excessive.<br />
<strong>La</strong> croissance tumorale est liée à l’apparition d’anomalies génétiques dans une cellule,<br />
transmissibles clonalement à leurs cellules filles et entraînant la perte de facteurs<br />
homéostatiques fondamentaux : la croissance peut devenir illimitée sans être accompagnée de<br />
différenciation terminale (génératrice physiologiquement de mort cellulaire).<br />
L’apparition dans les cellules tumorales de mutations, amplifications, translocations<br />
d’oncogènes (souvent essentiels dans la croissance de cellules normales) et de délétions,<br />
inactivations d’anti-oncogènes (éléments souvent majeurs de la différenciation et de la mort<br />
cellulaire) débouchent sur une croissance excessive et mal (ou non) contrôlée : il en résulte<br />
des productions excessives de facteurs de croissance, des modifications des récepteurs aux<br />
facteurs de croissance, des anomalies de la transduction (par exemple dans les voies à activité<br />
tyrosine kinase spécifiques), des modifications des protéines nucléaires. A l’inverse et<br />
éventuellement simultanément, les voies permettant d’induire la différenciation et mort<br />
cellulaire sont profondément altérées ou court-circuitées.<br />
<strong>La</strong> majorité des drogues agit en inhibant la progression des cellules à l’intérieur des phases du<br />
cycle cellulaire : cette inhibition de croissance est fréquemment associée à une induction de<br />
différenciation, voire d’apoptose Les multiples anomalies responsables de la croissance<br />
cellulaire tumorale ont donc rapidement invité à utiliser des « poly<strong>chimiothérapie</strong>s »<br />
combinant des drogues aux cibles multiples (exemple : inhibiteurs du fuseau mitotique +<br />
inhibiteurs de synthèse du DNA + alkylateurs et intercalants des bases du DNA + inducteurs<br />
de différenciation).<br />
<strong>La</strong> combinaison de ces drogues aux différents mécanismes d’action permet une addition ou<br />
une synergie d’action d’induction de la mort cellulaire.<br />
Les cellules normales moins « exposées » à cette croissance excessive sont donc moins<br />
sensibles que les cellules tumorales à l’action toxique des drogues cytostatiques (elles le<br />
seront d’autant plus que leur croissance est rapide comme le tissu hématopoïétique par<br />
exemple).<br />
Plusieurs nouvelles drogues non cytostatiques – ou moins cytostatiques – agissent sur des<br />
anomalies moléculaires spécifiques des cellules tumorales (anticorps inhibant un récepteur<br />
facteur de croissance suractivé ; inhibiteurs de la transduction ou inducteurs de différenciation<br />
spécifiques d’une translocation chromosomique entre oncogènes). Ces drogues auront moins<br />
de conséquence sur les cellules normales, du moins à croissance rapide.<br />
DCEM 2 – Module 10<br />
15
Faculté de Médecine de Marseille<br />
Outre la croissance intrinsèque d’un tissu tumoral activé par des oncogènes, des éléments du<br />
micro-environnement de la tumeur sont souvent essentiels pour favoriser cette croissance et<br />
permettre invasion et dissémination métastatique du cancer. Plusieurs drogues de<br />
<strong>chimiothérapie</strong> peuvent agir directement ou indirectement en modifiant son microenvironnement<br />
tumoral : ainsi les inhibiteurs de l’angiogénèse, les drogues modifiant le<br />
stroma et la matrice extra cellulaire, les drogues immunomodulatrices visant à contrôler ou<br />
détruire les cellules tumorales via des effecteurs du système immunitaire.<br />
5.3. Cinétique d’action de la <strong>chimiothérapie</strong><br />
Les mécanismes d’action de la majorité des drogues de <strong>chimiothérapie</strong> étant liés à la division<br />
cellulaire, la réponse anti-tumorale est fonction du pourcentage de cellules engagées dans le<br />
cycle cellulaire. A l’inverse, la toxicité de ces mêmes drogues sur les tissus normaux<br />
prédominera sur ceux à engagés dans le cycle cellulaire (comme le tissu hématopoïétique).<br />
De nombreuses <strong>chimiothérapie</strong>s cytostatiques sont ainsi cycliques, durant 4 à 5 jours suivies<br />
d’un intervalle de 21 jours, permettant la reconstitution des précurseurs hématopoïétiques,<br />
plus rapide que la recroissance tumorale : ainsi les cycles de <strong>chimiothérapie</strong> sont répétés –<br />
tous les 21 jours – 4 à 6 fois généralement pour atteindre une décroissance tumorale<br />
maximale,<br />
<strong>La</strong> régression tumorale obéit en effet idéalement à une décroissance géométrique : selon le<br />
volume tumoral à traiter – et sa sensibilité aux drogues – ,il faudra plusieurs cycles pour avoir<br />
une régression tumorale profonde (une tumeur d’ 1 cm³ contient environ 10 ^9 cellules<br />
tumorales : selon le % de cellules détruites à chaque cycle – par exemple 50 % soit 5 x 10 ^-1<br />
après le 1er cycle, on conçoit qu’au moins 6 cycles soient nécessaires).<br />
Pour de nombreuses drogues cytostatiques, la régression tumorale est proportionnelle à la<br />
dose de la drogue employée (effet-dose) et inversement proportionnelle à la durée entre<br />
chaque cycle de cytostatiques (effet-temps) : un intervalle trop long permettra une<br />
recroissance tumorale) : il est généralement recommandé avec ce type de drogues d’utiliser le<br />
maximum de drogues dans le minimum de temps pour assurer une dose-intensité optimale<br />
(c’est-à-dire un rapport élevé entre le dosage de la drogue / la durée totale du traitement).<br />
L’intensification de la dose intensité de drogues chimiothérapiques peut être utilisée<br />
précocement pour accélérer la régression tumorale et prévenir la survenue de clones chimiorésistants<br />
: les tumeurs installées sont en effet sujettes à des mutations spontanées induisant<br />
progressivement une chimiorésistance qui peut être prévenue par une cytolyse précoce<br />
(hypothèse de Goldie et Coldman).<br />
5.4. Médicaments cytotoxiques<br />
Les drogues utilisées en <strong>chimiothérapie</strong> anti-cancéreuse agissent essentiellement au niveau<br />
des macromolécules cellulaires, soit au niveau de leur production, soit au niveau de leur<br />
fonction. Les cibles moléculaires les plus concernées sont les acides nucléiques (ADN, ARN)<br />
et les protéines.<br />
Ces médicaments sont classés par leur cible d’action et/ou leur nature chimique.<br />
5.4.1. Les alkylants<br />
5.4.1.1. Mode d’action :<br />
L’alkylation induit des lésions du DNA, proches de celles induites par les radiations<br />
ionisantes : ruptures des chaînes d’acides nucléiques, dénaturation. <strong>La</strong> perturbation du cadre<br />
de lecture du DNA entraîne une mort cellulaire.<br />
DCEM 2 – Module 10<br />
16
Faculté de Médecine de Marseille<br />
5.4.1.2. Principales molécules :<br />
a) Moutardes à l’Azote<br />
• Cyclophosphamide : (CTX)<br />
• Ifosfamide : (IFS)<br />
• Phénylalaline Moutarde : (LPAM)<br />
• Chlorambucil : (CLB)<br />
b) Nitrosourées<br />
• Carmustine (BCNU)<br />
• Lomustine (CCNU)<br />
c) Triazènes<br />
• Dacarbazine (DTIC).<br />
5.4.1.3. Principales toxicités<br />
• Hématologiques : prioritairement neutrophiles, puis plaquettes, puis globules rouges.<br />
• Extra-hématologiques : digestives (nausées, vomissements), cutanées (alopécie<br />
souvent majeure).<br />
• Spécifiques : cystite hémorragique (cyclophosphamide, ifosfamide), fibrose<br />
pulmonaire (carmustine).<br />
5.4.1.4. Principales indications<br />
Le plus souvent en association : cancers du sein, sarcomes, lymphomes, mélanomes,<br />
leucémies et myélomes.<br />
5.4.2. Les antimétabolites :<br />
5.4.2.1. Mode d’action :<br />
Ils agissent en inhibant la synthèse des acides nucléiques : il s’agit d’inhibition compétitive<br />
de réactions enzymatiques de leur métabolisme intermédiaire ou utilisant des analogues<br />
inactifs des substrats de ces réactions.<br />
5.4.2.2. Principales molécules<br />
a) analogues de l’acide folique : méthotrexate (MTX)<br />
b) analogues de la pyrimidine :<br />
• 5Fluorouracile (5FU) inhibiteur de la thymidine synthétase<br />
• Cytarabine (ARA-C)<br />
• Gemcitabine. (GMZ)<br />
c) analogues de la purine<br />
• 6mercaptopurine (6MP) qui inhibe la synthèse d’adénine et guanine<br />
• 6thio-guanine (6TG) qui inhibe la synthèse de guanine<br />
• Fludarabine : analogue de l’adénosine inhibant l’adénosine désaminase.<br />
5.4.2.3. Principales toxicités :<br />
• Hématologique : plus modeste et réversible que les alkylants prédominant sur les<br />
neutrophiles et les globules rouges (macrocytose), lymphopénie majeure des<br />
inhibiteurs d’adénosine désaminase.<br />
• Extra-hématologiques : digestives (nausées et vomissements modérés pour MTX, 5-<br />
FU, fludarabine), muqueuses (mucite du MTX et 5-FU)<br />
DCEM 2 – Module 10<br />
17
Faculté de Médecine de Marseille<br />
• Spécifiques : toxicité rénale du MTX à hautes doses, neurotoxicité et toxicités<br />
cardiaques des fortes doses de 5-FU.<br />
5.4.2.4. Principales indications :<br />
Cancers digestifs, cancers ORL, sarcomes, leucémies et lymphomes, leucémie lymphoïde<br />
chronique.<br />
5.4.3. Les poisons du fuseau<br />
5.4.3.1. Mode d’action :<br />
Ils inhibent soit la polymérisation (alcaloides de la pervenche) soit la dépolymérisation du<br />
fuseau mitotique (taxanes). Ils induisent aussi une apoptose par voie mitochondriale.<br />
5.4.3.2. Principales molécules<br />
a) alcaloïdes de la pervenche<br />
• Vincristine (VCR)<br />
• Vinblastine (VLB)<br />
• Navelbine (NVLB)<br />
b) taxanes<br />
• Docétaxel<br />
• Paclitaxel.<br />
• Principales toxicités<br />
• Hématologiques prédominant sur les neutrophiles<br />
• Causticité veineuse, alopécie<br />
• Nerveuses par atteinte du système microtubulaire des neurones périphériques :<br />
paresthésies, polynévrite, multinévrite.<br />
• Spécifiques : réactions allergiques, rétention hydrosodée des taxanes.<br />
5.4.3.3. Principales indications :<br />
• alcaloïdes de la pervenche : leucémies, lymphomes, cancers du testicule, cancer du<br />
poumon, cancer du sein<br />
• taxanes : cancers du sein, cancers de l’ovaires, cancers du poumon.<br />
5.4.4. Les anthracyclines<br />
5.4.4.1. Mécanisme d’action :<br />
Ces antibiotiques sont des intercalants du DNA (il s’insèrent entre les bases du DNA)<br />
modifiant la topographie des sites de liaison avec la RNA polymérase.<br />
5.4.4.2. Principales molécules<br />
• Doxorubicine (Adriamycine, [ADR])<br />
• Daunorubicine (DNR)<br />
• Mitoxantrone (NOV)<br />
• Epirubicine (EPR)<br />
5.4.4.3. Principales toxicités :<br />
• Hématologiques : sévère sur les trois lignées<br />
DCEM 2 – Module 10<br />
18
Faculté de Médecine de Marseille<br />
• Extra-hématologiques : digestives (nausées, vomissements), causticité veineuse,<br />
alopécie majeure (sauf Mitoxantrone)<br />
• Spécifiques : toxicité cardiaque par cardiomyopathie survenant lors de toxicités<br />
cumulatives (Doxorubicine pour doses totales > 300 mg – 500 mg/m²).<br />
5.4.4.4. Principales indications<br />
Cancers du sein, leucémies, lymphomes, sarcomes.<br />
5.4.5. Inhibiteurs de topoisomérase<br />
5.4.5.1. Mécanismes d’action<br />
Ces drogues inhibent des enzymes essentielles de la matrice nucléaire (topoisomérases I et II),<br />
pour assurer notamment la stabilité chromatinienne et la conformation du DNA.<br />
a) inhibiteurs de topoisomérase I<br />
• Irinotecan (CPT 11)<br />
• Topotecan<br />
b) inhibiteurs de topoisomérase II<br />
• Etoposide (VP16)<br />
• Teniposide (VM26).<br />
5.4.5.2. Principales molécules<br />
5.4.5.3. Principales toxicités<br />
• Hématologiques sur les trois lignées.<br />
• Extra-hématologiques : digestives (nausées, vomissements, diarrhée), muqueuses<br />
(mucite), alopécie, causticité veineuse.<br />
5.4.5.4. Principales indications<br />
Cancers du côlon, ORL, ovaires (inhibiteurs topo 1) ; cancers du poumon, lymphomes,<br />
leucémies, cancers du testicule, sarcomes (VP16).<br />
5.4.6. Dérivés du platine<br />
5.4.6.1. Mécanismes d’action<br />
Ces métaux induisent la formation d’ « adduits » dans le DNA provoquant cassures et brins,<br />
aux effets voisins de l’alkylation.<br />
• CisPlatine (CisDDP)<br />
• Carboplatine (CBP)<br />
• Oxaliplatine<br />
5.4.6.2. Principales molécules<br />
5.4.6.3. Principales toxicités<br />
• Hématologique : modérée mais possible, anémie (toxicité rénale des cellules<br />
produisant l’érythropoïétine), thrombopénie.<br />
DCEM 2 – Module 10<br />
19
Faculté de Médecine de Marseille<br />
• Extra-hématologiques : tubulopathie sévère, responsable d’élévations de la<br />
créatinémie, toxicité auditive (atteinte du VIII), neuropathie périphérique, nausées et<br />
vomissements sévères.<br />
5.4.6.4. Principales indications<br />
Cancers du testicule, cancers de l’ovaire, cancers du poumon, sarcomes, lymphomes, cancers<br />
colorectaux (Oxaliplatine).<br />
5.4.7. Autres : Antibiotiques cytostatiques<br />
D’autres antibiotiques (outre les anthracyclines) interfèrent avec le métabolisme du DNA des<br />
cellules tumorales :<br />
• bléomycine : surtout actif dans les lymphomes et les cancers du testicule. Toxicité<br />
pulmonaire spécifique et cumulative.<br />
• Mitomycine.<br />
• la L Asparaginase déplète les protéines précurseurs du DNA « spécifiquement » dans<br />
les leucémies aiguës lymphoblastiques.<br />
5.5. Médicaments non cytostatiques<br />
Ces classes de médicaments anti-cancéreux « bloquent » des fonctions anormales des cellules<br />
cancéreuses et/ou agissent sur leur micro-environnement.<br />
5.5.1. Les anticorps monoclonaux<br />
Produits par génie génétique à partir d’anticorps murins et humanisés sur une partie de la<br />
molécule d’immunoglobuline, ils ciblent un antigène présent à la membrane de la cellule<br />
tumorale bloquant sa fonction et/ou provoquant la mort cellulaire<br />
• Anticorps anti CD20 : dans les lymphomes B<br />
• Anticorps anti CD33 : dans les leucémies aiguës myéloïdes<br />
• Anticorps anti Her2-Neu : dans les cancers du sein « surexprimant Her2-Neu »<br />
Leur efficacité suppose l’identification de la cible à la membrane cellulaire (qui doit être de<br />
plus surexprimée dans certains cas).<br />
Ils ont peu d’effets secondaires, notamment hématologiques, en dehors d’une hypersensibilité<br />
aux protéines. L’anticorps anti Her2-Neu peut induire des insuffisances cardiaques chez les<br />
malades au myocarde altéré.<br />
5.5.2. Les cytokines antitumorales<br />
Elles agissent soit sur la cellule tumorale soit via une activation de l’immunité antitumorale.<br />
• Interféron alpha : leucémies et lymphomes, mélanomes, cancers du rein<br />
• Interleukine 2 : cancers du rein<br />
Elles ont des toxicités spécifiques : asthénie, fièvre, hépatotoxicité, syndrome dépressif,<br />
hypotension et insuffisance rénale (interleukine 2). Ces toxicités sont rapidement régressives à<br />
l’arrêt.<br />
5.5.3. Agents différenciants<br />
Leur but est d’induire une apoptose par activation de la différenciation. Ils appartiennent à la<br />
classe des rétinoïdes, dérivés de la vitamine A.<br />
• Acide cis rétinoïque : en cours d’évaluation<br />
DCEM 2 – Module 10<br />
20
Faculté de Médecine de Marseille<br />
• Acide trans rétinoïque : spécifiquement dans la leucémie aiguë promyélocytaire dont<br />
la translocation associée implique le gène du récepteur à l’acide rétinoïque<br />
5.5.4. Inhibiteurs de l’angiogénèse en développement<br />
De nombreuses drogues ciblent cette action et sont en cours d’évaluation<br />
• le thalidomide est actif dans les myélomes et cancers du rein<br />
5.5.5. Inhibiteurs de la transduction du signal<br />
Il s’agit de petites molécules inhibant spécifiquement des typosines-kinases activées par des<br />
récepteurs de facteur de croissance.<br />
• le gleevec (STI 571) très actif dans la leucémie myéloïde chronique et les sarcomes<br />
exprimant c-kit<br />
• de nombreuses autres molécules sont en cours d’évaluation dont un inhibiteur de la<br />
transduction de l’EGF (Epithelial Growth Factor) (Iressa).<br />
5.6. Limites de la <strong>chimiothérapie</strong> – résistance<br />
Les tumeurs malignes sont hétérogènes : en fonction de la situation des cellules dans le cycle<br />
cellulaire ; en fonction de leur vascularisation ; en fonction de la résistance innée de certaines<br />
cellules aux cytostatiques.<br />
Les tumeurs malignes sont génétiquement instables et peuvent devenir résistantes à des agents<br />
initialement efficaces : on observe alors après une phase de régression une recroissance<br />
tumorale, dite chimiorésistante nécessitant une nouvelle combinaison thérapeutique.<br />
De nombreux mécanismes interviennent dans la chimiorésistance dont l’amplification du gène<br />
MDR (Multi Drug Resistance) induisant un efflux accru par la membrane de nombreux<br />
cytostatiques, la mutation de la p53 inhibant l’apoptose chimio-induite.<br />
Les stratégies de <strong>chimiothérapie</strong> visant à prévenir la chimiorésistance incluent les associations<br />
de drogues aux cibles différentes, l’évaluation de la dose-intensité au début du traitement.<br />
5.7. Différentes stratégies de <strong>chimiothérapie</strong> et cas<br />
particuliers<br />
• Chimiothérapie d’induction : au début du traitement pour induire une réponse<br />
• Chimiothérapie de consolidation : pour consolider une réponse, utilise généralement<br />
des drogues différentes<br />
• Chimiothérapie de maintenance : pour maintenir la maladie stable ou la réponse<br />
complète (dure jusqu’à 2 ans dans les leucémies de l’enfant).<br />
• Chimiothérapie néo-adjuvante : avant un acte chirurgical et/ou radiothérapique pour<br />
diminuer le volume tumoral<br />
• Chimiothérapie adjuvante : pour prévenir l’apparition de métastases après un acte<br />
loco-régional chirurgical<br />
• Chimiothérapie intensive : associée à une autogreffe de cellules souches<br />
hématopoïétiques pour intensifier les doses sans toxicité hématologique léthale.<br />
• Radio<strong>chimiothérapie</strong> : en association à la <strong>radiothérapie</strong> pour « chimio-sensibiliser »<br />
l’effet des radiations ionisantes. Limitée à certains agents (5FU et Platine, taxanes),<br />
elle est très active dans certaines localisations : col utérin, ORL, poumon.<br />
DCEM 2 – Module 10<br />
21
Faculté de Médecine de Marseille<br />
5.8. Critéres de jugement de la <strong>chimiothérapie</strong> et surveillance<br />
L’efficacité de la <strong>chimiothérapie</strong> se juge sur la régression de la masse tumorale observée,<br />
généralement après 3 cycles de traitements : on distingue dans les tumeurs solides :<br />
• la réponse complète, : disparition de toute tumeur visible<br />
• la réponse partielle : diminution de 50% des cibles tumorales initiales (dans deux<br />
diamètres de toutes les lésions)<br />
• la progression : augmentation de 25% des cibles tumorales initiales<br />
• la stabilité : entre la réponse partielle et la progression.<br />
Les patients répondeurs (et stables à un moindre degré) ont un meilleur pronostic.<br />
<strong>La</strong> toxicité est gradée selon le degré d’atteinte des organes selon un codification de l’OMS<br />
(Organisation Mondiale de la Santé) de 1 à 4, les toxicités de grade 3 et 4 étant les plus<br />
sévères.<br />
<strong>La</strong> surveillance de la <strong>chimiothérapie</strong> doit être adaptée au malade, au protocole de traitement,<br />
aux toxicités attendues des drogues utilisées.<br />
Beaucoup de <strong>chimiothérapie</strong>s sont cycliques (généralement tous les 21 jours) et hématotoxiques<br />
: la surveillance de la NFS est impérative avant chaque cycle et la survenue d’une<br />
fièvre entre les cycles peut être reliée à une neutropénie sévère imposant une antibiothérapie<br />
d’urgence.<br />
Les doses doivent être adaptées en fonction des toxicités OMS observées pour la suite du plan<br />
de traitement. <strong>La</strong> survenue de toxicité grade 3-4 invite à changer de drogues.<br />
5.9. Impacts de la <strong>chimiothérapie</strong> sur la pratique clinique<br />
<strong>La</strong> <strong>chimiothérapie</strong> est de plus en plus employée dans le traitement de nombreux cancers : sa<br />
mise en œuvre suppose son insertion dans une concertation pluri-disciplinaire définissant le<br />
plan de traitement du patient.<br />
L’évaluation du patient est essentielle avant traitement : elle comprend l’identification des<br />
cibles tumorales (pour juger l’efficacité), l’appréciation de la performance physique globale<br />
(échelle de Karnofsky par exemple : de 0 à 100%) : en effet, un mauvais état clinique laisse<br />
préjuger d’une <strong>chimiothérapie</strong> mal tolérée et moins efficace, ce qui doit être anticipé.<br />
L’évaluation des risques individuels du patient est essentielle pour contre-indiquer certaines<br />
drogues ou moduler leur emploi : état cardiaque, neuropathie, insuffisance hépatique ou<br />
rénale, état veineux périphérique pour éviter une extravasation d’une drogue caustique<br />
(fréquemment prévenue par l’utilisation d’une voie veineuse centrale) ;<br />
<strong>La</strong> correction avant et pendant le traitement de désordres nutritionnels, le traitement de la<br />
douleur, le traitement de l’anémie sont importants pour assurer une bonne tolérance et donc<br />
une bonne efficacité.<br />
L’information du patient sur les effets bénéfiques et les effets toxiques attendus, ou<br />
simplement possibles est essentielle pour améliorer la tolérance, le vécu et donc l’adhésion au<br />
plan de traitement proposé.<br />
Le profil psychologique du patient doit être pris en compte non seulement initialement mais<br />
aussi dans l’appréciation du besoin de soutien pendant le traitement.<br />
Le patient doit être vu cliniquement – et son traitement adapté si nécessaire – avant chaque<br />
cycle de traitement : la correction des symptômes, parfois individuels, s’impose tout au long<br />
de la thérapeutique. Compte tenu de la survenue possible de complications entre les cycles,<br />
parfois graves quand il s’agit de fièvre associée à une neutropénie, l’intervention médicale<br />
doit être coordonnée avec le médecin de famille et la réhospitalisation en urgence toujours<br />
possible, de préférence dans le lieu où le traitement a été réalisé.<br />
Le suivi clinique à long terme s’impose compte tenu des séquelles possibles :<br />
DCEM 2 – Module 10<br />
22
Faculté de Médecine de Marseille<br />
• psycho-sociales pouvant nécessiter un support adapté<br />
• gonadiques : de nombreuses drogues induisent des perturbations ovariennes et<br />
testiculaires non seulement hormonales (ménopause éventuellement définitive) que sur<br />
les cellules gonadiques (hypofertilité et stérilité). L’information du patient est<br />
essentielle et la réalisation d’une congélation de sperme recommandée chez tous les<br />
hommes jeunes le souhaitant avant tout traitement.<br />
• L’apparition de second cancer est possible du fait de l’effet mutagènes de nombreuses<br />
drogues (surtout lors de traitement combinés radio-chimiothérapiques).<br />
5.10. En conclusion<br />
<strong>La</strong> <strong>chimiothérapie</strong> est une arme essentielle du traitement du cancer, utilisée de plus en plus<br />
fréquemment et précocement pour traiter une maladie systémique potentielle.<br />
<strong>La</strong> <strong>chimiothérapie</strong> adjuvante est devenue un standard dans de nombreuses tumeurs solides<br />
identifiées à haut risque de métastases du fait de la biologie de la tumeur et/ou de<br />
l’envahissement ganglionnaire (cancers du sein, colo-rectaux).<br />
Elle peut être curative dans de nombreuses tumeurs disséminées (néoplasies hématologiques,<br />
cancers du testicule par exemple).<br />
Elle modifie fréquemment l’histoire naturelle de la maladie en synergie avec les autres<br />
thérapeutiques, ralentissant la progression de la maladie vers une forme plus chronique.<br />
6. Hormonothérapie<br />
L’<strong>hormonothérapie</strong> est une des techniques thérapeutiques les plus anciennes en cancérologie.<br />
Il s’agit d’un traitement destiné à lutter contre la maladie générale visible (maladie<br />
métastatique) ou indétectable (situation adjuvante).<br />
Globalement, ces traitements sont dirigés vers un ensemble de patients pour lesquels il existe<br />
une cible biologique permettant l’action de la thérapeutique proposée (par exemple : cancer de<br />
la prostate) ou bien vers une sous-population qui doit spécifiquement porter une cible<br />
biologique, cette sous-population appartenant à la population générale de ce type de tumeur<br />
(par exemple : cancer du sein exprimant des récepteurs hormonaux).<br />
Nous verrons successivement les techniques thérapeutiques les plus utilisées puis les grandes<br />
indications d’<strong>hormonothérapie</strong>.<br />
6.1. Techniques thérapeutiques et drogues utilisées<br />
6.1.1. Castration :<br />
<strong>La</strong> castration est la technique la plus ancienne utilisée.<br />
Elle fonctionne sur le principe suivant : certaines tumeurs utilisent les hormones sexuelles ou<br />
leurs métabolites comme facteur de croissance. Il s’agit des cancers du sein (oestrogènes) et<br />
des cancers de la prostate (androgènes).<br />
Le facteur de croissance agit en se liant à un récepteur présent à la surface de la cellule<br />
tumorale. L’arrêt de la sécrétion doit permettre un contrôle de la maladie tumorale.<br />
Les castrations peuvent être chirurgicale, radiothérapique ou médicale.<br />
6.1.1.1. Chirurgicale :<br />
• Ovariectomie bilatérale chez la femme,<br />
• Orchidectomie bilatérale ou plus couramment utilisée pulpectomie bilatérale chez<br />
l’homme,<br />
DCEM 2 – Module 10<br />
23
Faculté de Médecine de Marseille<br />
• Castration définitive.<br />
Effets secondaires liés à la castration : cf 1-3.<br />
Efffets secondaires spécifiques : risque opératoire.<br />
6.1.1.2. Radiothérapique :<br />
Chez la femme une castration radiothérapique peut être réalisée. Il faut délivrer une dose de 9<br />
à 12 grays après repérage échographique sur les régions ovariennes. Il s’agit d’une castration<br />
définitive.<br />
Effets secondaires liés à la castration : cf 1-3.<br />
Effets secondaires spécifiques : cystite, rectite, risque tumorigène lié à l’irradiation.<br />
6.1.1.3. Médicale :<br />
Les castrations médicales sont réalisées en utilisant des agonistes des LHRH.<br />
Les principales molécules de cette classe sont la Leuproreline, la Triptoreline et la Gosereline.<br />
Ces drogues peuvent s’administrer toutes les quatre semaines ou toutes les douze semaines<br />
dans les formes retards.<br />
Leur effet pharmacologique est le suivant :<br />
diminution de la sécrétion des gonadotrophines ce qui résulte à une absence de sécrétion<br />
d’estrogènes chez la femme et de testostérone chez l’homme (correspondant à une castration).<br />
Les effets secondaires sont les suivants :<br />
• Effets directement dus à la castration (retrouvés dans les castrations chirurgicales et<br />
radiothérapiques) :<br />
o Bouffées de chaleur, réduction de la libido, impuissance, gynécomastie chez<br />
l’homme et douleurs mammaires.<br />
• Effets secondaires spécifiques dus aux drogues :<br />
o Irritation locale au point d’injection, polyurie et polydipsie, modification du<br />
goût, effets gastro-intestinaux tels que nausées, vomissements (très rares),<br />
constipation, œdèmes périphériques, réactions allergiques, exceptionnellement<br />
variation tensionnelle, hypotension, hypertension. arthralgie, sensation de<br />
faiblesse musculaire, paresthésie cutanée.<br />
o Lorsque ces drogues sont utilisées en situation métastatique osseuse, il peut<br />
exister en début de traitement une recrudescence des douleurs osseuses.<br />
o Contrairement aux castrations réalisées par voie chirurgicale ou<br />
radiothérapique, la castration par voie médicale est une castration réversible.<br />
6.1.2. Les anti-androgènes :<br />
Les anti-androgènes sont utilisés pour bloquer au niveau périphérique l’action des<br />
androgènes.<br />
On distingue deux types d’anti-androgènes :<br />
• les anti-androgènes stéroïdiens,<br />
• les anti-androgènes non stéroïdiens.<br />
A l’heure actuelle les anti-androgènes les plus utilisés sont anti-androgènes non stéroïdiens.<br />
6.1.2.1. Anti-androgènes stéroïdiens :<br />
*Acetate de cyproterone utilisé dans les cancers de prostate métastatique.<br />
Effets secondaires :<br />
Gynécomastie, perte de la libido, inhibition de la spermatogénèse.<br />
DCEM 2 – Module 10<br />
24
Faculté de Médecine de Marseille<br />
6.1.2.2. Anti-androgènes non stéroïdiens :<br />
6.1.2.2.1. Nilutamide.<br />
Mode d’action : interaction (blocage) du récepteur aux androgènes sans effet androgène.<br />
Indication : cancer de la prostate métastasé en association à la castration.<br />
Effets secondaires :<br />
En rapport avec le mode d’action :<br />
Impuissance, baisse de la libido, bouffées de chaleur.<br />
Liés à la molécule :<br />
troubles de l’accommodation à l’obscurité et de la vision des couleurs (réversible à l’arrêt du<br />
traitement), syndrome pulmonaire interstitiel, augmentation modérée des transaminases,<br />
possibilité d’hépatite cytolytique ou mixte, nausées, vomissements.<br />
A noter plus particulièrement le syndrome interstitiel pulmonaire (être vigilant en cas<br />
d’apparition de toux chez le patient), les possibilités d’hépatites cytolytiques ainsi que les<br />
troubles de la vision.<br />
6.1.2.2.2. Flutamide.<br />
Indication : cancer de la prostate métastasé<br />
Effets secondaires :<br />
En rapport avec le mode d’action :<br />
Bouffées de chaleur, diminution de la libido, impuissance.<br />
Liés à la molécule :<br />
Diarrhée, nausées, vomissements, douleurs abdominales, augmentation des transaminases<br />
(rare), hépatite grave (exceptionnel), methemoglobinémie, sulfhémoglobinémie,<br />
photosensibilisation (rares), anémie, cancer du sein (exceptionnel).<br />
6.1.2.2.3. Bicalutamide<br />
Indication : Cancer de la prostate métastasé<br />
Effets indésirables :<br />
En rapport avec le mode d’action du produit :<br />
Bouffées de chaleur, prurit, sensibilité mammaire, gynécomastie, asthénie, baisse de la libido.<br />
Liés à la molécule :<br />
Diarrhée, nausées, vomissements, rare élévation des transaminases, exceptionnellement<br />
sévère.<br />
6.1.3. Les oestrogènes :<br />
6.1.3.1. Diéthylstilbestrol<br />
Indication : Cancer de la prostate 2 ème ligne métastatique<br />
Effets secondaires :<br />
Cardio-vasculaires : Accidents thromboemboliques artériels (IDM, AVC…), accidents<br />
thromboemboliques veineux, embolie pulmonaire, hypertension artérielle, coronaropathie.<br />
Métaboliques : Hyperlipidémie, prise de poids.<br />
Céphalées, migraines, adénome hépatique, ictères cholestatiques, lithiase biliaire,<br />
modification de la libido, gynécomastie, atrophie testiculaire, impuissance.<br />
6.1.3.2. Estramustine<br />
Indication : Cancer de prostate hormonorésistant. Traitement de 2 ème ligne.<br />
Effets secondaires :<br />
DCEM 2 – Module 10<br />
25
Faculté de Médecine de Marseille<br />
Accidents thromboemboliques, troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhées),<br />
impuissance, gynécomastie, réactions d’hypersensibilité pouvant aller jusqu’à l’œdème de<br />
Quincke (en particulier si associé à un IEC), leucopénies, œdèmes par rétention hydrosodée.<br />
L’oestrogénothérapie est un traitement de 2 ème ligne des cancers de la prostate métastatiques,<br />
parfois utilisée après un échappement à un traitement standard (castration + anti-androgène).<br />
Cependant, leurs effets secondaires potentiels les font utiliser rarement et avec prudence.<br />
A part se situe l’estramustine qui associe estrogènes et <strong>chimiothérapie</strong>. Cette molécule est<br />
utilisée parfois seule, mais le plus souvent combinée à une <strong>chimiothérapie</strong> dans les essais<br />
concernant les cancers de la prostate hormonorésistants.<br />
6.1.4. Les anti-estrogènes :<br />
L’anti-estrogène de référence est le Tamoxifène.<br />
Il agit en bloquant par liaison les récepteurs aux estrogènes inhibant ainsi l’action des<br />
estrogènes sur la cellule tumorale mammaire.<br />
Ses effets secondaires sont les suivants :<br />
• Liés au mode d’action :<br />
o Augmentation des bouffées de chaleur, sécheresse vaginale, prise de poids.<br />
• Liés à la molécule :<br />
o Augmentation du risque de thrombose veineuse profonde et d’embolie<br />
pulmonaire, hépatite toxique, stéatose, exceptionnel cas d’hépatocarcinome,<br />
augmentation du risque de cancer de l’endomètre, troubles oculaires : opacité<br />
rétinienne, névrite optique.<br />
Le Tamoxifène est un des traitements majeurs du cancer du sein, en particulier en situation<br />
adjuvante chez les femmes dont les tumeurs expriment des récepteurs hormonaux. Il est l’un<br />
des traitements anti-cancéreux les plus prescrits.<br />
Cependant, les effets secondaires, et en particulier des risques veineux thrombo-emboliques<br />
ainsi que l’augmentation de l’incidence du cancer de l’endomètre, rendent ses conditions<br />
d’utilisation très précises.<br />
Il est contre indiqué chez les femmes ayant des antécédents de thrombose veineuse profonde.<br />
Il doit être arrêté si une thrombose veineuse profonde apparaît sous traitement par<br />
Tamoxifène.<br />
Tout saignement utérin en cours de traitement par Tamoxifène doit être exploré par une<br />
échographie et, si nécessaire, une hystéroscopie avec biopsie. <strong>La</strong> plupart du temps, le cancer<br />
de l’endomètre est précédé par une phase d’hyperplasie de la muqueuse utérine<br />
symptomatique. Le risque de survenue d’un cancer de l’endomètre est d’autant plus élevé que<br />
la posologie quotidienne est élevée et que la durée du traitement est importante. Il est donc<br />
impératif de respecter la posologie quotidienne : 20 mg et la durée maximum de traitement :<br />
5 ans en situation adjuvante.<br />
Le Droloxifène est aussi commercialisé pour le traitement du cancer du sein métastatique. Ses<br />
effets secondaires s’apparentent à ceux du Tamoxifène. Il est beaucoup moins utilisé que le<br />
Tamoxifène et n’apporte pas de bénéfice particulier.<br />
Les années à venir verront apparaître des drogues plus spécifiques (modulateur spécifique<br />
des récepteurs aux estrogènes ou SERM) dont les effets secondaires devraient être moins<br />
importants que ceux des anti-estrogènes de première génération avec une efficacité<br />
comparable, voire accrue.<br />
6.1.5. Les anti-aromatases :<br />
L’aromatase est un complexe enzymatique constitué de deux protéines.<br />
DCEM 2 – Module 10<br />
26
Faculté de Médecine de Marseille<br />
Globalement, son rôle est de transformer les androgènes par une réaction d’aromatisation en<br />
estrogènes. Cette réaction est réalisée dans les tissus tels que le tissu graisseux, le muscle, le<br />
foie et les tumeurs du sein.<br />
Cette aromatisation est particulièrement importante après la ménopause.<br />
Le blocage de cet enzyme permet de bloquer une source d’estrogènes.<br />
On distingue deux types d’anti-aromatases : l’ aminoglutethimide qui est l’anti-aromatase le<br />
plus ancien et plus récemment les anti-aromatases de dernière génération qui ont supplanté<br />
l’aminoglutethimide.<br />
6.1.5.1. Aminoglutethimide<br />
L’inconvénient de l’aminoglutethimide est le blocage de la chaîne des hormones corticostéroïdes<br />
nécessitant, lors du traitement par aminoglutethimide un traitement concomitant par<br />
Hydrocortisone 30 mg/jour.<br />
Les effets secondaires d’aminoglutethimide sont :<br />
Somnolence, nausées, rash cutané, crampes musculaires, prise de poids, thrombopénie,<br />
leucopénie, ictère cholestatique et risque d’hypothyroïdie.<br />
6.1.5.2. Anti-aromatases de dernière génération :<br />
On distingue les anti-aromatases stéroïdiens et non-stéroïdiens. A l’heure actuelle, les plus<br />
utilisés sont les anti-aromatases non-stéroïdiens qui ont supplanté, lorsqu’il y a une indication<br />
d’<strong>hormonothérapie</strong>, le Tamoxifène dans le traitement du cancer du sein métastatique.<br />
6.1.5.2.1. Anti-aromatases non-stéroïdiens :<br />
6.1.5.2.1.1. Letrozole<br />
Indication : Traitement du cancer du sein métastatique chez la femme ménopausée avec<br />
récepteurs hormonaux positifs<br />
Effets secondaires : Les effets secondaires, bien que nombreux, sont, la plupart du temps,<br />
discrets ou modérés et n’imposent pas l’arrêt du traitement. Les plus fréquents sont :<br />
Céphalées, nausées, œdèmes périphériques, fatigue, bouffées de chaleur, éruption, troubles<br />
digestifs à type de vomissements-dyspepsie, prise de poids, douleurs osteo-musculaires,<br />
alopécie, anorexie.<br />
6.1.5.2.1.2. Anastrozole<br />
Indication : Cancer du sein métastatique chez la femme ménopausée avec récepteurs<br />
hormonaux positifs.<br />
Effets indésirables : <strong>La</strong> plupart du temps, modérés et ne nécessitant pas l’arrêt du traitement.<br />
Les plus fréquents sont :<br />
Bouffées de chaleur, sécheresse vaginale, alopécie discrète, troubles digestifs, (anorexie,<br />
nausées, vomissements, diarrhée), douleurs osteo-articulaires, asthénie, somnolence,<br />
céphalées, modification du bilan hépatique, augmentation des gamma GT ou phosphatases<br />
alcalines, saignements vaginaux.<br />
• Formestane<br />
6.1.5.2.2. Anti-aromatases stéroïdiens :<br />
Mode d’administration : Intra-musculaire : 1 injection tous les quinze jours.<br />
Indication : cancer du sein métastatique en 2 ème ligne chez les femmes présentant des<br />
récepteurs hormonaux.<br />
Effets indésirables :<br />
DCEM 2 – Module 10<br />
27
Faculté de Médecine de Marseille<br />
Intolérance locale, alopécie, hypertrichose faciale, somnolence, céphalées, bouffées de<br />
chaleur, saignements vaginaux, nausées, vomissements, constipation, douleurs osteoarticulaires.<br />
6.1.5.2.2.1. Exemestane<br />
Indication : Cancer du sein métastatique en 2 ème ligne thérapeutique chez les femmes dont la<br />
tumeur exprime les récepteurs hormonaux.<br />
Effets secondaires : faibles à modérés, nécessitant rarement l’arrêt du traitement, les plus<br />
fréquents étant :<br />
Bouffées de chaleur, nausées, céphalées, insomines, douleurs osteo-articulaires, éruption<br />
cutanée, anorexie, vomissements.<br />
6.1.6. Analogue de la somatostatine :<br />
*Octreotide<br />
Indication très limitée : Tumeurs carcinoïdes sécrétantes.<br />
Permet de diminuer la symptomatologie.<br />
6.2. Les grandes indications.<br />
6.2.1. Cancer de la prostate<br />
6.2.1.1. Cancer de la prostate métastatique :<br />
<strong>hormonothérapie</strong> par blocage androgénique complet associant une castration à un antiandrogène.Traitement<br />
de 1 ère ligne de référence.<br />
Moyenne de durée de l’hormonosensibilité : 12 à 18 mois<br />
L’<strong>hormonothérapie</strong> sera réalisée à tous les cancers de la prostate métastatiques, sans<br />
évaluation de la réceptivité hormonale.<br />
Discuter :<br />
• blocage androgénique incomplet : castration seule sans ajout d’anti-androgène. Pour<br />
certains auteurs, serait aussi efficace.<br />
• blocage androgénique intermittent (alternance de périodes avec <strong>hormonothérapie</strong> et<br />
sans <strong>hormonothérapie</strong>) : permettrait d’allonger la durée d’hormonosensibilité.<br />
• un traitement de 2 ème ligne par oestrogénothérapie après échappement à un traitement<br />
de 1 ère ligne standard peut se discuter. Il doit toujours être précédé d’un arrêt des antiandrogènes,<br />
celui-ci pouvant s’accompagner d’une réponse (amélioration des<br />
symptômes, baisse du PSA) transitoire (effet « wash-out »).<br />
6.2.1.2. Cancer de la prostate non métastatique :<br />
castration médicale après irradiation prostatique (traitement adjuvant) dans les tumeurs de<br />
stade T3-T4 de la classification TNM.<br />
6.2.2. Cancer du sein<br />
L’<strong>hormonothérapie</strong> ne sera réalisée dans les cancers du sein que chez les femmes dont la<br />
tumeur exprime des récepteurs hormonaux (récepteurs estrogènes ou récepteurs à la<br />
progestérone).<br />
<strong>La</strong> mise en évidence des récepteurs aux estrogènes et à la progestérone peut être faite par<br />
deux méthodes, biochimique ou immuno-histochimique.<br />
DCEM 2 – Module 10<br />
28
Faculté de Médecine de Marseille<br />
Seront considérées comme tumeurs exprimant les récepteurs hormonaux les tumeurs qui<br />
expriment soit des récepteurs aux estrogènes, soit des récepteurs à la progestérone, soit les<br />
deux.<br />
Les indications sont :<br />
6.2.2.1. Traitement du cancer du sein non métastatique :<br />
• Hormonothérapie adjuvante chez les femmes dont la tumeur exprime des récepteurs<br />
hormonaux (récepteurs estrogènes et/ou récepteurs progestérone positifs).<br />
• Tamoxifène 20 mg/jour pendant cinq ans.<br />
• L’<strong>hormonothérapie</strong> adjuvante n’exclut pas la <strong>chimiothérapie</strong> adjuvante. <strong>La</strong> plupart du<br />
temps, les deux thérapeutiques sont associées.<br />
6.2.2.2. Cancer du sein métastatique :<br />
L’<strong>hormonothérapie</strong> des cancers du sein métastatiques pourra être réalisée chez les femmes<br />
dont la tumeur initiale exprimait des récepteurs hormonaux (récepteurs estrogènes et/ou<br />
récepteurs progestérone positifs). Le choix de l’<strong>hormonothérapie</strong> sera fait préférentiellement<br />
pour les femmes ménopausées et chez lesquelles il n’existe pas de métastase viscérale<br />
(métastase osseuse exclusive ou localisation cutanée).<br />
Actuellement, le choix préférentiel sera un traitement par anti-aromatase non stéroïdien de<br />
dernière génération en 1 ère ligne (Letrozole ou Anastrozole).<br />
Taux de réponse attendu = 30 % à 40 %.<br />
7. L’information du patient<br />
L’information du patient intègre plusieurs problématiques médicales et sociopsychologiques<br />
:<br />
• l’information sur le cancer<br />
• l’information sur le traitement<br />
• l’information sur la surveillance et le devenir<br />
• la communication et l’accompagnement de l’information<br />
• le droit de savoir et de ne pas savoir.<br />
7.1. L’information sur le cancer<br />
Parfois déniée par certains membres de la famille, son importance est réelle pour la personne<br />
soignée. Il est souvent importent pour comprendre, pour accepter une thérapeutique que<br />
l’affection soit nommée et expliquée globalement dans ses mécanismes. Le but de cette<br />
information est d’anticiper sur des questions anxiogènes, souvent non formulées (n’est-ce pas<br />
héréditaire ? est-ce contagieux ? le cancer est-il un organisme greffé dans mon corps ?).<br />
Cette information doit être rapidement orientée vers le cancer de la personne soignée, pour<br />
éviter des amalgames souvent inévitables avec d’autres personnes éventuellement atteintes du<br />
même cancer à un stade différent.<br />
L’information doit être précise non seulement sur le diagnostic mais aussi sur l’extension en<br />
précisant que cette « cartographie de la maladie » orientera vers un traitement « à la carte ».<br />
Cette information doit être attentive, lors d’une consultation initiale généralement longue,<br />
complétée et répétée lors de consultations ultérieures (un diagnostic de cancer ne s’annonce<br />
pas par lettre ou téléphone).<br />
DCEM 2 – Module 10<br />
29
Faculté de Médecine de Marseille<br />
7.2. L’information sur le traitement<br />
Elle va rapidement compléter l’information sur le diagnostic du cancer en proposant une<br />
stratégie cohérente et adaptée, pour corriger l’histoire naturelle et donc le pronostic du patient.<br />
Cette information doit préciser les étapes du parcours thérapeutique, la nécessité d’être traité<br />
par plusieurs médecins appartenant à différentes disciplines. <strong>La</strong> présentation, éventuellement<br />
par écrit ou par schéma, des différentes étapes et leur planification dans le temps est<br />
importante : elle permet à la personne soignée de moins subir, mais de maîtriser l’avancée<br />
dans son traitement, et donc d’y adhérer.<br />
L’information sur les buts et les inconvénients attendus de chaque étape thérapeutique est<br />
aussi importante pour le patient – souvent peu hospitalisé – lui permettant d’organiser sa vie<br />
et ne pas être surpris et bouleversé par des effets secondaires prévisibles.<br />
Cette information a pour but d’informer le patient et non pas de protéger le médecin. Celui-ci<br />
doit cependant faire éventuellement la preuve qu’il a transmis une information « loyale et<br />
adaptée » sur le traitement et ses conséquences.<br />
Pour toutes ces raisons, la mention dans le dossier médical de l’information permet de suivre<br />
l’information du patient dans ses différentes étapes.<br />
A moment du traitement, l’information doit intégrer l’aspect social de la prise en charge (un<br />
cancer rentre dans les ALD (Affections de Longue Durée – dont la déclaration permet tous les<br />
remboursements de soins à 100%).<br />
7.3. L’information sur la surveillance et le devenir<br />
Elle doit être précoce permettant au malade de se projeter à moyen, long terme après son<br />
traitement et de concevoir sa vie et sa qualité après le traitement.<br />
Elle permet d’expliquer les raisons et les méthodes de surveillance, période souvent<br />
anxiogène après de traitement.<br />
7.4. <strong>La</strong> communication et l’accompagnement de l’information<br />
Cette information doit être transmise par le médecin, répétée et expliquée : car le patient<br />
s’informera auprès de tiers connaissant moins bien le problème éventuellement.<br />
Une information adéquate permettra au malade de formuler des questions qu’il n’oserait<br />
éventuellement pas poser, si son information était trop limitée.<br />
L’accompagnement de l’information, par l’écoute et la compassion est un élément important<br />
pour vérifier l’adhésion du malade : c’est l’information « adaptée » survenant au moment où<br />
le malade est prêt à l’entendre.<br />
<strong>La</strong> communication doit être médicale et orale mais n’interdit pas d’être accompagnée de<br />
supports écrits et/ou d’accès à des sources d’information valides (www : Ligue Contre le<br />
Cancer) idéalement proposés par le médecin lui même.<br />
7.5. Le droit de savoir et de ne pas savoir<br />
L’information se doit d’être loyale et adaptée : un malade a le droit de ne pas vouloir savoir et<br />
il faut le respecter. IL faut le lui demander ou l’anticiper.<br />
De même, l’information donnée à la famille doit être soumise au souhait du patient et<br />
cohérente avec celle qu’il lui a été transmise.<br />
DCEM 2 – Module 10<br />
30
7.6. Cas particuliers<br />
Faculté de Médecine de Marseille<br />
L’accès au dossier médical hospitalier : discuté au Parlement en 2001-2002. A l’heure<br />
actuelle il est possible via le médecin traitant.<br />
L’information dans le cadre d’un essai clinique : elle est écrite et obligatoire (Loi Huriet-<br />
Serusclat) et doit s’assortir d’un consentement signé.<br />
L’information sur les options thérapeutiques, doit être présentée au malade quand dans son<br />
cas plusieurs traitements différents donneront le même résultat : cette information peut<br />
permettre de déboucher sur une prise de décision non seulement informée mais partagée.<br />
7.7. En conclusion<br />
Il faut renforcer le rôle de l’information et le dédramatiser. Toutes les enquêtes montrent que<br />
les patients mieux informés adhèrent mieux au traitement, et ont une meilleure qualité de vie,<br />
voire de meilleurs résultats (grâce à la complétion du traitement).<br />
<strong>La</strong> concertation pluridisciplinaire médicale autour de « standards » permet de partager une<br />
information identique entre les acteurs médicaux et de la présenter de façon cohérente à la<br />
personne soignée dont l’anxiété s’atténuera.<br />
DCEM 2 – Module 10<br />
31