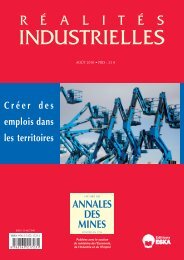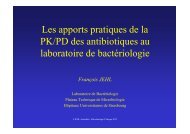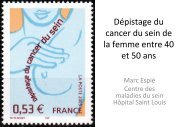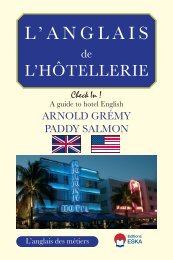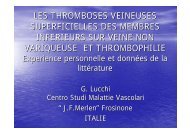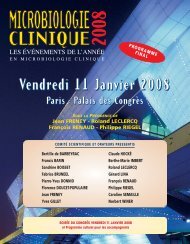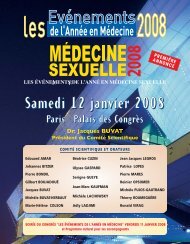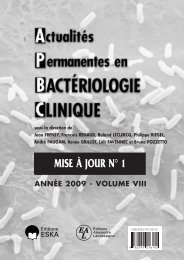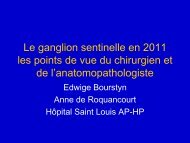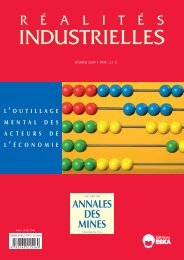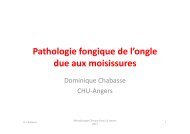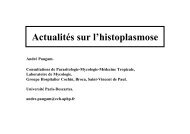mise à jour n° 2 année 2009
mise à jour n° 2 année 2009
mise à jour n° 2 année 2009
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
D’un point de vue éthologique, ces crustacés sont<br />
dulçaquicoles, rhéophiles, et partagent les mêmes biotopes<br />
que les mollusques. Leur déplacement est souvent<br />
nocturne.Les hôtes définitifs sont des carnivores<br />
(Canidae, Felidae, Viverridae, Homme). Ces<br />
Mammifères capturent les crabes la nuit. Dans de<br />
nombreuses régions, l’Homme arrache les pinces et en<br />
mange la chair crue.<br />
Cycle de développement (Figure <strong>n°</strong>2)<br />
Les œufs pondus sont évacués par les expectorations<br />
ou les selles après déglutition. Ils nécessitent<br />
une maturation dans l’eau pendant plusieurs<br />
semaines pour assurer l’embryogénèse. A maturité,<br />
sort par l’opercule de l’œuf un miracidium cilié : il<br />
nage quelques heures et pénètre <strong>à</strong> travers le pied du<br />
mollusque premier hôte intermédiaire. Comme<br />
habituellement chez les Digènes, le parasite va se<br />
développer successivement dans les différents<br />
organes du mollusque (cavité générale, glande digestive)<br />
: la charge parasitaire augmente par polyembryonnie<br />
(sporocyste, rédies, cercaires) pendant 3<br />
mois. Le phénomène s’achève par l’émission des cercaires<br />
microcerques dans l’eau par effraction <strong>à</strong> travers<br />
les tissus du mollusque.<br />
Ces cercaires nagent quelques dizaines de minutes<br />
dans l’eau vers le crustacé deuxième hôte intermédiaire,<br />
et pénètrent probablement par les branchies<br />
dans les viscères (branchies, glande digestive) et les<br />
muscles (thoraciques en particulier). Alors elles s’enkystent<br />
en formant des métacercaires qui survivent<br />
plusieurs semaines dans les tissus du Crustacé (Figure<br />
<strong>n°</strong> 23).<br />
Figure 23 : Métacercaire de Paragonimus<br />
heterotremus dans branchie de Potamon guttus.<br />
Chez l’hôte définitif, les métacercaires subissent un<br />
dékystement dans l’intestin, traversent la muqueuse,<br />
migrent <strong>à</strong> travers l’abdomen, puis traversent le diaphragme,<br />
avant d’atteindre leur localisation pulmo-<br />
LES DISMATOSES<br />
Figure 24 : Œuf de Paragonimus sp<br />
dans une selle.<br />
naire finale (bronches en particulier, parenchyme,<br />
plèvre). Il faut 45 <strong>jour</strong>s pour accomplir cette migration.<br />
Ce comportement favorise les localisations ectopiques<br />
<strong>à</strong> la peau (nodules sous-cutanés pour P.<br />
heterotremus), au cerveau (paragonimose cérébrale), au<br />
rein, … La longévité des adultes serait d’un ou deux<br />
ans, après lesquels les parasites meurent et se calcifient.<br />
Épidémiologie<br />
L’épidémiologie de la paragonimose est la conséquence<br />
d’habitudes alimentaires pratiquées dans certaines<br />
régions tropicales, principalement en zone rurale.<br />
Les conditions de transmission reflètent la présence<br />
du réservoir animal (zoonose), le milieu sauvage (forêt,<br />
carnivores sauvages) ou péridomestique (chien, chat),<br />
le rôle des hôtes paraténiques (porc, rat en Asie). La<br />
paragonimose fonctionne souvent sous forme de foyers<br />
épidémiques localisés (Odermatt et al., 2007).<br />
Les facteurs favorisants sont multiples : le comportement<br />
ethnique, les habitudes alimentaires<br />
(cuisson des crustacés, du porc, préparation de sauces<br />
<strong>à</strong> partir de crustacés séchés). La capture des crabes est<br />
souvent un jeu pour les enfants. Certaines populations<br />
utilisent la chair crue de crabe en thérapeutique<br />
traditionnelle <strong>à</strong> cause de supposées vertus fébrifuges.<br />
Répartition géographique<br />
La répartition géographique concerne la majeure<br />
partie des régions tropicales (Tableau <strong>n°</strong> III).<br />
En Afrique, le réservoir est constitué par des carnivores<br />
sauvages. Les crabes sont souvent pêchés et<br />
vendus sur les marchés (ethnie). Le premier hôte<br />
intermédiaire serait un Prosobranche rhéophile<br />
(Potadoma sp) ou un mollusque terrestre (Achatina sp).<br />
Le second est en particulier le crabe chanteur<br />
(Sudanonautes sp) <strong>à</strong> comportement amphibie.<br />
3Section XIII – Chapitre 3 12 / 16 © ESKA octobre <strong>2009</strong> – M.A.J. <strong>n°</strong> 2