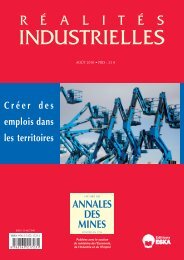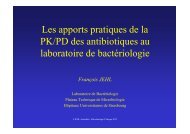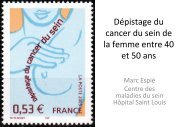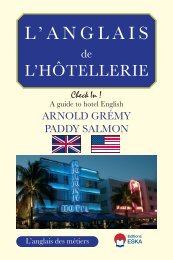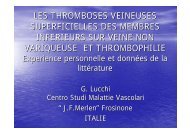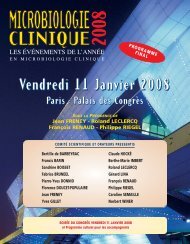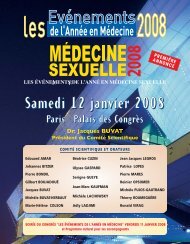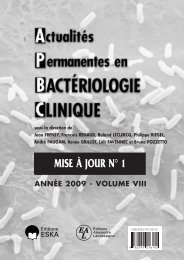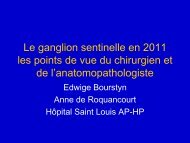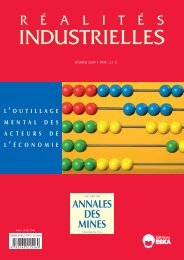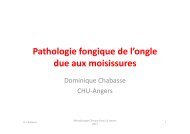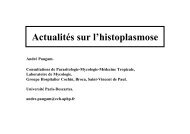mise à jour n° 2 année 2009
mise à jour n° 2 année 2009
mise à jour n° 2 année 2009
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
S E C T I O N X I I : M Y C O L O G I E<br />
TRICHOSPORON SPP. N° 3<br />
Claire LACROIX<br />
HISTORIQUE<br />
Créé en 1890, le genre Trichosporon regroupe alors<br />
uniquement des souches responsables de mycoses<br />
superficielles (en grec, Trichos = poil et Sporon = spores).<br />
L’espèce T. beigelii, fut longtemps reconnue comme un<br />
saprophyte de l’homme pouvant être responsable de la<br />
piedra blanche (voir section Trichosporonoses superficielles).<br />
Le premier cas de trichosporonose systémique<br />
ne fut décrit qu’en 1970 (Watson et Kallichurum,<br />
1970), et depuis, Trichosporon est reconnu comme agent<br />
d’infections fongiques invasives opportunistes essentiellement<br />
chez le patient profondément neutropénique<br />
(Hoy et al., 1986 ; .Walsh et al., 1986 ; Walsh et<br />
al., 1989).<br />
TAXONOMIE<br />
La classification des levures basidiomycètes du<br />
genre Trichosporon a longtemps été mouvante et<br />
controversée. En 1890, Behrend (Behrend, 1890)<br />
décrit le champignon responsable d’une piedra<br />
blanche chez un barbu et le nomme T. ovoides. En<br />
1902, Vuillemin considère que toutes les levures<br />
arthrosporées sont des T. beigelii (Gueho et al., 1992b).<br />
En 1909, Beurmann isole un champignon d’une<br />
lésion cutanée et le nomme Oidium cutaneum, qui sera<br />
renommé T. cutaneum par Ota en 1926 (Chagas-Neto<br />
et al., 2008). Cependant, même si Diddens et Lodder<br />
puis Guého et al. considèrent que T. beigelli et T. cutaneum<br />
ne représentent qu’une seule et même espèce<br />
(Guého et al., 1992a ; Guého et al., 1992b), ces 2 noms<br />
sont alors indifféremment utilisés pour identifier les<br />
Trichosporon isolés de prélèvements humains.<br />
Les études taxonomiques basées sur des critères<br />
phénotypiques n’ont donc permis d’identifier que peu<br />
d’espèces et l’apport des techniques moléculaires a<br />
entrainé une totale reclassification des espèces de<br />
Trichosporon (Gueho et al., 1992a, Sugita et al., 1994,<br />
Sugita et al.,1995). Le taxon T. beigelli a ainsi été remplacé<br />
par 6 espèces pathogènes pour l’homme (Gueho<br />
et al., 1994a) : T. cutaneum, T. asahii, T. asteroides, T.<br />
mucoides, T. inkin et T. ovoides. Puis Sugita proposa une<br />
nouvelle classification avec 17 espèces et 5 variétés de<br />
Trichosporon (Sugita et al., 1995). En 2002, 25 espèces<br />
sont décrites, 8 étant considérées comme des pathogènes<br />
humains avec les 2 nouvelles espèces T. domesticum<br />
et T. montevideense (Sugita et al., 2002).<br />
Actuellement, l’ordre des Trichosporonales est séparé<br />
en 4 clades : Gracile, Porosum, Cutaneum et Ovoides,<br />
et Sugita et al. y incluent le clade Brassicae qui<br />
englobe des espèces appartenant au clade Gracile<br />
d’après Middelhoven (Tableau I) (Middelhoven et al.,<br />
2004 ; Sugita et al., 2004). Trente huit espèces de<br />
Trichosporon sont actuellement répertoriées dont de<br />
nouvelles espèces isolées du tube digestif d’insectes ou<br />
de fromages (Molnar et al., 2004 ; Fuentefria et al.,<br />
2008). D’autres espèces ont été réassignées <strong>à</strong> un nouveau<br />
genre, et T. pullulans est actuellement renommé<br />
Guehomyces pullulans (Fell et Scorzetti, 2004).<br />
HABITAT – POUVOIR<br />
PATHOGÈNE<br />
Habitat<br />
Les Trichosporon spp. sont des levures cosmopolites<br />
isolées du sol, de végétaux, de certains aliments,<br />
d’insectes… Certaines espèces font partie de la flore<br />
cutanée de l’homme en particulier dans la région<br />
inguino-crurale (Ellner et al., 1991 ; Gueho et al.,<br />
1994b ; Rodriguez-Tudela et al., 2005).<br />
Trichosporonoses superficielles<br />
Les trichosporonoses superficielles sont représentées<br />
presque exclusivement par la piedra blanche. Celle-ci se<br />
caractérise par la présence de nodules blanchâtres non<br />
© ESKA octobre <strong>2009</strong> – M.A.J. <strong>n°</strong> 2 1 / 6 Section XII – Chapitre 3