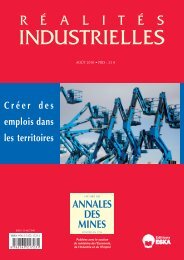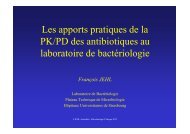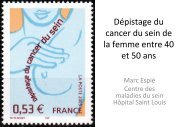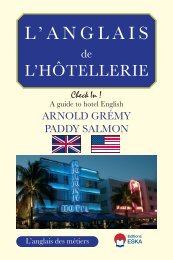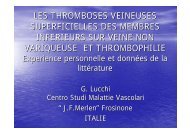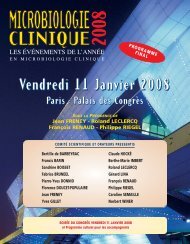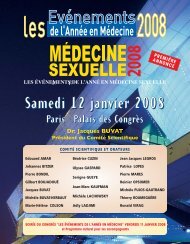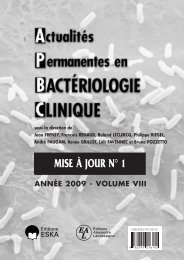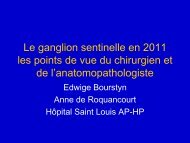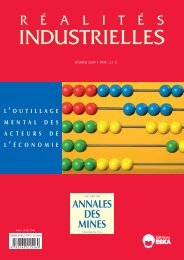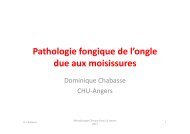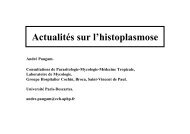Volume XVII/1 - Congrès ESKA
Volume XVII/1 - Congrès ESKA
Volume XVII/1 - Congrès ESKA
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
30 MUSURGIA<br />
organisation du schéma scalaire tritonique de type 2-5 : sol-la-ré). Cette potentialité<br />
de structuration hiérarchique extrinsèque du schéma scalaire par l’action du<br />
principe tonal ouvrirait la possibilité d’une véritable expression du principe modal<br />
dans le domaine des hauteurs discrètes. N’importe quel élément du schéma scalaire<br />
pouvant jouer le rôle de tonique, il en résulterait en effet la possibilité d’un jeu<br />
subtil, porteur d’expressivité potentielle, entre la dynamique propre au schéma tonal<br />
et celle propre à la dynamique scalaire. La dynamique tonale n’aurait pas la même<br />
couleur selon la force de l’élément scalaire sur laquelle elle prendrait appui, comme<br />
le montre la comparaison de ces deux mélodies. Dans la mélodie hawaïenne, la<br />
tonique, sol, élément le plus stable de la dynamique tonale, correspondrait à<br />
l’élément le plus stable du schéma scalaire ; dynamique tonale et dynamique<br />
scalaire se renforceraient donc mutuellement. Dans la mélodie lapone par contre,<br />
cette correspondance n’existerait pas, donnant à la mélodie une expression<br />
particulière du fait de la tension en résultant. Cette potentialité signerait<br />
l’émergence d’une véritable « tonomodalité ».<br />
Niveau 3<br />
Le niveau 3 consisterait dans l’émergence d’une nouvelle dimension de la<br />
progression mélodique : celle de l’enchaînement des unités accordiques entre elles.<br />
Il correspondrait donc à celui de la syntaxe harmonique traditionnelle. Comme il<br />
apparaît dans les analyses proposées précédemment, les schémas accordiques<br />
seraient nécessaires dès les niveaux 1 et 2 pour rendre compte de la possibilité<br />
même de produire des patterns mélodiques appuyés sur des hauteurs discrètes, mais<br />
le processus mélodique ne s’appliquerait pas à l’enchaînement de ces schémas entre<br />
eux, ou alors seulement, au niveau 2, de façon embryonnaire (figure 6). A ces<br />
niveaux, d’un point de vue harmonique, les schémas accordiques seraient utilisés<br />
comme générateurs d’intervalles et de schémas scalaires plutôt que comme unités<br />
syntaxiques inscrites dans un processus.<br />
Pour structurer les enchaînements dans cette nouvelle dimension, le système<br />
pourrait exploiter soit le principe des affinités structurelles (voir infra), soit les<br />
schémas les plus solides et les principes d’enchaînement mélodique déjà à sa<br />
disposition, ces deux possibilités pouvant être librement combinées. Cette<br />
perspective intègre donc l’idée d’une rupture systémique entre les niveaux 1 et 2<br />
d’une part et le niveau 3 d’autre part, mais en considérant qu’il existerait des<br />
principes d’organisation communs à tous les niveaux et que des schémas propres<br />
aux niveaux 1 et 2 seraient largement employés pour régler la dimension émergente<br />
du niveau 3. Ainsi, aux niveaux 1 et 2, les schémas accordiques permettrait la<br />
structuration des patterns mélodiques ; au niveau 3, l’enchaînement de ces schémas<br />
deviendrait lui-même structuré par les schémas développés dans le cadre de cette<br />
fonction première de structuration de ces patterns.<br />
Le principe des affinités structurelles reposerait sur la présence d’éléments<br />
communs à deux unités complexes contiguës. Plus le nombre d’éléments communs<br />
à deux ensembles est important, plus la proximité entre eux serait grande, plus le<br />
passage de l’un à l’autre serait aisé. Ainsi, par exemple, le degré d’affinité