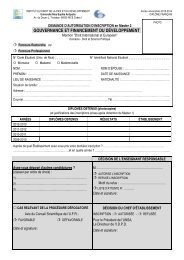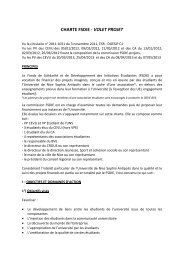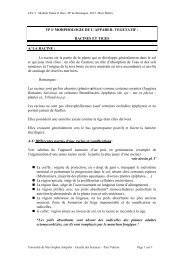Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
exactement à it. pera cotogna, poire de coing où coing équivaut à cognassier. Reste le cas<br />
'périphérique': prë d' velu 'poire à velours', à rapprocher de sic. persicaru pilusu; les deux<br />
expressions mettent en valeur l'aspect duveteux de la peau de ce fruit. Nous mentionnerons encore<br />
les deux périphrases: nois de Saint Grascien et poire de médecine à coing, qui ne contredisent pas<br />
ce que nous avons avancé plus haut.<br />
Le terme désignant le cotignac est d'origine occitane; ce qui fait dire à B-Wartburg que « la<br />
modification de la terminaison (-ac pour pr. -at) est probabl. due au désir de bien marquer l'origine<br />
méridionale du produit en introduisant dans le nom le -ac si caractéristique de l'onomastique du<br />
Midi ».<br />
Pour GDEL, le cotignac est une « Pâte de coings très sucrée (Spécialité d'Orléans, déjà citée sous<br />
Louis XI) ». Lachiver précise « Confiture de coing, conserve de coings au vin blanc ou à l'eau-devie,<br />
qui tirent leur nom de la ville de Cotignac (Var). S'est dit aussi de la pâte ou de la gelée de<br />
quelques autres fruits. Cotignac de groseilles ».<br />
Marmelade, emprunté au portugais marmelada 'cotignac' < port. marmelo 'coing', est en fait assez<br />
tardif: il a été précédé par mermelade qui pourrait être emprunté à esp. mermelada, issu de port.<br />
marmelada; mais la forme normande marmeline (avec une commutation de suffixe) renforce<br />
l'hypothèse d'un emprunt direct au portugais. Le terme marmelade aujourd'hui a pris une<br />
signification plus générale. Selon Lachiver, il s'agit de « Fruits cuits avec du sucre, assez longtemps<br />
pour que le fruit perde sa forme, et que la peau et le reste soient mêlés ensemble et forment un tout<br />
assez consistant ».<br />
En conclusion pour cette partie consacrée au coing, au cognassier et au cotignac, nous rappellerons<br />
que selon A. de Candolle le cognassier [Cydonia vulgaris] est un arbre qui vient du nord de la<br />
Perse, du midi du Caucase et d'Anatolie. Il a été connu très tôt par les Grecs qui « ont greffé sur une<br />
variété commune strution une qualité supérieure venant de Cydon (Crète), d'où le nom kudônion,<br />
traduit en latin par Malum Cotoneum, par Cydonia ». GDEL précise que « le genre cognassier [de<br />
la famille des rosacées] renferme un petit nombre d'espèces, qui sont des arbrisseaux de l'Asie et des<br />
régions moyennes de l'Europe orientale et centrale, dont la plus connue est le cognassier commun<br />
(Cydonia vulgaris) ». Sauvaigo avait distingué deux variétés de cognassier pour nos régions: le<br />
cognassier commun à fruits piriformes ou arrondis et le cognassier du Portugal (ou simplement<br />
portugal pour GDEL) à fruits plus gros, moins acerbes, parfumés « affectant la forme d'une<br />
calebasse de pèlerin ».<br />
Les Latins dénommaient les variétés de coings par quatre termes: COTONEUM MALUM ou<br />
COTONEUM (Caton VII 3, Varron I 59, Pline XV 37), STRUTHEA MALA ou STRUTHEA (Caton<br />
VII 3, Varron I 59, Columelle V 10, Pline XV 38), CYDONIUM MALUM ou CYDONIUM<br />
(Columelle V 10, Pline XV 10), CHRYSOMELUM (Columelle V 10, Pline XV 10).<br />
Dans la langue standard et dans les dialectes ne subsistent plus que les descendants de lat.<br />
COTONEUM que l'on retrouve en Italie et en France et comme emprunt en Catalogne; lat.<br />
CYDONIUM pourrait être à l'origine des formes françaises. Dans les dialectes méridionaux d'Italie,<br />
nous retrouvons les descendants de CHRYSOMELUM dans l'acception d'abricot, mais nous<br />
renvoyons au développement consacré à ce terme dans la partie consacrée à l'abricot.<br />
Traducteurs et scientifiques, français et italiens, recourent à des termes comme fr. crisomele,<br />
struthée/strutée, it. crisomelo, strutie, strutij dans la présentation des variétés de ce fruit.<br />
Espagnols et Portugais vont avoir recours à lat. MELIMELUM 'pomme très douce' (cf. port.<br />
marmelo, esp. membrillo), la forme COTONEUM servant à désigner la pêche.<br />
Nous mentionnons quelques exemples latins dans l'ordre chronologique.<br />
« Poma: mala strutea, cotonea, Scantiana, Quiriniana item alia conditiva, mala mustea et<br />
Punica (Caton VII 3) [arbres fruitiers: pommes struthées, cotonées, Scantianes, Quirinianes, et aussi<br />
d'autres variétés à conserver, pommes mustées et Puniques], cf. LX cotoneum « pommier cotonée ».<br />
Struteum (-thium, Pline 23 103) < gr. STROÙTHION, STROUTHÌON 'coing' < gr. STRUTHEION<br />
'de moineau'. Dans le commentaire de l'éditeur nous lisons: « Col. 5,10, 19 en fait une des trois