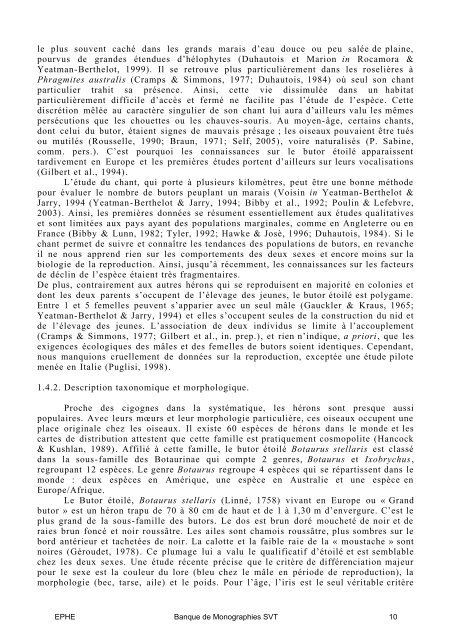Pascal PROVOST - EPHE
Pascal PROVOST - EPHE
Pascal PROVOST - EPHE
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
le plus souvent caché dans les grands marais d’eau douce ou peu salée de plaine,<br />
pourvus de grandes étendues d’hélophytes (Duhautois et Marion in Rocamora &<br />
Yeatman-Berthelot, 1999). Il se retrouve plus particulièrement dans les roselières à<br />
Phragmites australis (Cramps & Simmons, 1977; Duhautois, 1984) où seul son chant<br />
particulier trahit sa présence. Ainsi, cette vie dissimulée dans un habitat<br />
particulièrement difficile d’accès et fermé ne facilite pas l’étude de l’espèce. Cette<br />
discrétion mêlée au caractère singulier de son chant lui aura d’ailleurs valu les mêmes<br />
persécutions que les chouettes ou les chauves-souris. Au moyen-âge, certains chants,<br />
dont celui du butor, étaient signes de mauvais présage ; les oiseaux pouvaient être tués<br />
ou mutilés (Rousselle, 1990; Braun, 1971; Self, 2005), voire naturalisés (P. Sabine,<br />
comm. pers.). C’est pourquoi les connaissances sur le butor étoilé apparaissent<br />
tardivement en Europe et les premières études portent d’ailleurs sur leurs vocalisations<br />
(Gilbert et al., 1994).<br />
L’étude du chant, qui porte à plusieurs kilomètres, peut être une bonne méthode<br />
pour évaluer le nombre de butors peuplant un marais (Voisin in Yeatman-Berthelot &<br />
Jarry, 1994 (Yeatman-Berthelot & Jarry, 1994; Bibby et al., 1992; Poulin & Lefebvre,<br />
2003). Ainsi, les premières données se résument essentiellement aux études qualitatives<br />
et sont limitées aux pays ayant des populations marginales, comme en Angleterre ou en<br />
France (Bibby & Lunn, 1982; Tyler, 1992; Hawke & Josè, 1996; Duhautois, 1984). Si le<br />
chant permet de suivre et connaître les tendances des populations de butors, en revanche<br />
il ne nous apprend rien sur les comportements des deux sexes et encore moins sur la<br />
biologie de la reproduction. Ainsi, jusqu’à récemment, les connaissances sur les facteurs<br />
de déclin de l’espèce étaient très fragmentaires.<br />
De plus, contrairement aux autres hérons qui se reproduisent en majorité en colonies et<br />
dont les deux parents s’occupent de l’élevage des jeunes, le butor étoilé est polygame.<br />
Entre 1 et 5 femelles peuvent s’apparier avec un seul mâle (Gauckler & Kraus, 1965;<br />
Yeatman-Berthelot & Jarry, 1994) et elles s’occupent seules de la construction du nid et<br />
de l’élevage des jeunes. L’association de deux individus se limite à l’accouplement<br />
(Cramps & Simmons, 1977; Gilbert et al., in. prep.), et rien n’indique, a priori, que les<br />
exigences écologiques des mâles et des femelles de butors soient identiques. Cependant,<br />
nous manquions cruellement de données sur la reproduction, exceptée une étude pilote<br />
menée en Italie (Puglisi, 1998).<br />
1.4.2. Description taxonomique et morphologique.<br />
Proche des cigognes dans la systématique, les hérons sont presque aussi<br />
populaires. Avec leurs mœurs et leur morphologie particulière, ces oiseaux occupent une<br />
place originale chez les oiseaux. Il existe 60 espèces de hérons dans le monde et les<br />
cartes de distribution attestent que cette famille est pratiquement cosmopolite (Hancock<br />
& Kushlan, 1989). Affilié à cette famille, le butor étoilé Botaurus stellaris est classé<br />
dans la sous-famille des Botaurinae qui compte 2 genres, Botaurus et Ixobrychus,<br />
regroupant 12 espèces. Le genre Botaurus regroupe 4 espèces qui se répartissent dans le<br />
monde : deux espèces en Amérique, une espèce en Australie et une espèce en<br />
Europe/Afrique.<br />
Le Butor étoilé, Botaurus stellaris (Linné, 1758) vivant en Europe ou « Grand<br />
butor » est un héron trapu de 70 à 80 cm de haut et de 1 à 1,30 m d’envergure. C’est le<br />
plus grand de la sous-famille des butors. Le dos est brun doré moucheté de noir et de<br />
raies brun foncé et noir roussâtre. Les ailes sont chamois roussâtre, plus sombres sur le<br />
bord antérieur et tachetées de noir. La calotte et la faible raie de la « moustache » sont<br />
noires (Géroudet, 1978). Ce plumage lui a valu le qualificatif d’étoilé et est semblable<br />
chez les deux sexes. Une étude récente précise que le critère de différenciation majeur<br />
pour le sexe est la couleur du lore (bleu chez le mâle en période de reproduction), la<br />
morphologie (bec, tarse, aile) et le poids. Pour l’âge, l’iris est le seul véritable critère<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 10