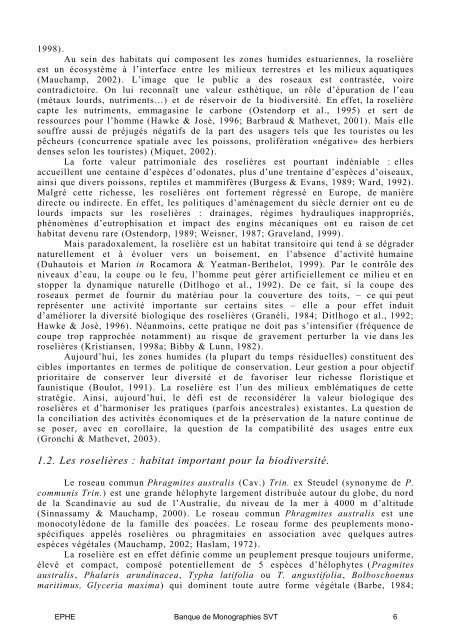Pascal PROVOST - EPHE
Pascal PROVOST - EPHE
Pascal PROVOST - EPHE
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
1998).<br />
Au sein des habitats qui composent les zones humides estuariennes, la roselière<br />
est un écosystème à l’interface entre les milieux terrestres et les milieux aquatiques<br />
(Mauchamp, 2002). L’image que le public a des roseaux est contrastée, voire<br />
contradictoire. On lui reconnaît une valeur esthétique, un rôle d’épuration de l’eau<br />
(métaux lourds, nutriments…) et de réservoir de la biodiversité. En effet, la roselière<br />
capte les nutriments, emmagasine le carbone (Ostendorp et al., 1995) et sert de<br />
ressources pour l’homme (Hawke & Josè, 1996; Barbraud & Mathevet, 2001). Mais elle<br />
souffre aussi de préjugés négatifs de la part des usagers tels que les touristes ou les<br />
pêcheurs (concurrence spatiale avec les poissons, prolifération «négative» des herbiers<br />
denses selon les touristes) (Miquet, 2002).<br />
La forte valeur patrimoniale des roselières est pourtant indéniable : elles<br />
accueillent une centaine d’espèces d’odonates, plus d’une trentaine d’espèces d’oiseaux,<br />
ainsi que divers poissons, reptiles et mammifères (Burgess & Evans, 1989; Ward, 1992).<br />
Malgré cette richesse, les roselières ont fortement régressé en Europe, de manière<br />
directe ou indirecte. En effet, les politiques d’aménagement du siècle dernier ont eu de<br />
lourds impacts sur les roselières : drainages, régimes hydrauliques inappropriés,<br />
phénomènes d’eutrophisation et impact des engins mécaniques ont eu raison de cet<br />
habitat devenu rare (Ostendorp, 1989; Weisner, 1987; Graveland, 1999).<br />
Mais paradoxalement, la roselière est un habitat transitoire qui tend à se dégrader<br />
naturellement et à évoluer vers un boisement, en l’absence d’activité humaine<br />
(Duhautois et Marion in Rocamora & Yeatman-Berthelot, 1999). Par le contrôle des<br />
niveaux d’eau, la coupe ou le feu, l’homme peut gérer artificiellement ce milieu et en<br />
stopper la dynamique naturelle (Ditlhogo et al., 1992). De ce fait, si la coupe des<br />
roseaux permet de fournir du matériau pour la couverture des toits, – ce qui peut<br />
représenter une activité importante sur certains sites – elle a pour effet induit<br />
d’améliorer la diversité biologique des roselières (Granéli, 1984; Ditlhogo et al., 1992;<br />
Hawke & Josè, 1996). Néanmoins, cette pratique ne doit pas s’intensifier (fréquence de<br />
coupe trop rapprochée notamment) au risque de gravement perturber la vie dans les<br />
roselières (Kristiansen, 1998a; Bibby & Lunn, 1982).<br />
Aujourd’hui, les zones humides (la plupart du temps résiduelles) constituent des<br />
cibles importantes en termes de politique de conservation. Leur gestion a pour objectif<br />
prioritaire de conserver leur diversité et de favoriser leur richesse floristique et<br />
faunistique (Boulot, 1991). La roselière est l’un des milieux emblématiques de cette<br />
stratégie. Ainsi, aujourd’hui, le défi est de reconsidérer la valeur biologique des<br />
roselières et d’harmoniser les pratiques (parfois ancestrales) existantes. La question de<br />
la conciliation des activités économiques et de la préservation de la nature continue de<br />
se poser, avec en corollaire, la question de la compatibilité des usages entre eux<br />
(Gronchi & Mathevet, 2003).<br />
1.2. Les roselières : habitat important pour la biodiversité.<br />
Le roseau commun Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel (synonyme de P.<br />
communis Trin.) est une grande hélophyte largement distribuée autour du globe, du nord<br />
de la Scandinavie au sud de l’Australie, du niveau de la mer à 4000 m d’altitude<br />
(Sinnassamy & Mauchamp, 2000). Le roseau commun Phragmites australis est une<br />
monocotylédone de la famille des poacées. Le roseau forme des peuplements monospécifiques<br />
appelés roselières ou phragmitaies en association avec quelques autres<br />
espèces végétales (Mauchamp, 2002; Haslam, 1972).<br />
La roselière est en effet définie comme un peuplement presque toujours uniforme,<br />
élevé et compact, composé potentiellement de 5 espèces d’hélophytes (Pragmites<br />
australis, Phalaris arundinacea, Typha latifolia ou T. angustifolia, Bolboschoenus<br />
maritimus, Glyceria maxima) qui dominent toute autre forme végétale (Barbe, 1984;<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 6