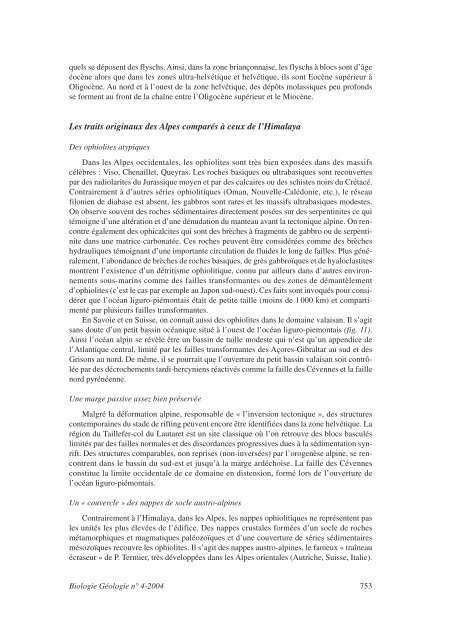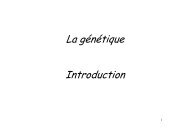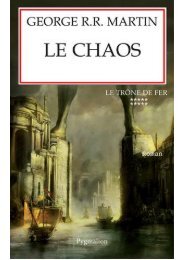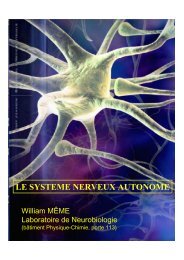La collision continentale
La collision continentale
La collision continentale
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
quels se déposent des flyschs. Ainsi, dans la zone briançonnaise, les flyschs à blocs sont d’âge<br />
éocène alors que dans les zones ultra-helvétique et helvétique, ils sont Eocène supérieur à<br />
Oligocène. Au nord et à l’ouest de la zone helvétique, des dépôts molassiques peu profonds<br />
se forment au front de la chaîne entre l’Oligocène supérieur et le Miocène.<br />
Les traits originaux des Alpes comparés à ceux de l’Himalaya<br />
Des ophiolites atypiques<br />
Dans les Alpes occidentales, les ophiolites sont très bien exposées dans des massifs<br />
célèbres : Viso, Chenaillet, Queyras. Les roches basiques ou ultrabasiques sont recouvertes<br />
par des radiolarites du Jurassique moyen et par des calcaires ou des schistes noirs du Crétacé.<br />
Contrairement à d’autres séries ophiolitiques (Oman, Nouvelle-Calédonie, etc.), le réseau<br />
filonien de diabase est absent, les gabbros sont rares et les massifs ultrabasiques modestes.<br />
On observe souvent des roches sédimentaires directement posées sur des serpentinites ce qui<br />
témoigne d’une altération et d’une dénudation du manteau avant la tectonique alpine. On rencontre<br />
également des ophicalcites qui sont des brèches à fragments de gabbro ou de serpentinite<br />
dans une matrice carbonatée. Ces roches peuvent être considérées comme des brèches<br />
hydrauliques témoignant d’une importante circulation de fluides le long de failles. Plus généralement,<br />
l’abondance de brèches de roches basiques, de grès gabbroïques et de hyaloclastites<br />
montrent l’existence d’un détritisme ophiolitique, connu par ailleurs dans d’autres environnements<br />
sous-marins comme des failles transformantes ou des zones de démantèlement<br />
d’ophiolites (c’est le cas par exemple au Japon sud-ouest). Ces faits sont invoqués pour considérer<br />
que l’océan liguro-piémontais était de petite taille (moins de 1 000 km) et compartimenté<br />
par plusieurs failles transformantes.<br />
En Savoie et en Suisse, on connaît aussi des ophiolites dans le domaine valaisan. Il s’agit<br />
sans doute d’un petit bassin océanique situé à l’ouest de l’océan liguro-piemontais (fig. 11).<br />
Ainsi l’océan alpin se révèle être un bassin de taille modeste qui n’est qu’un appendice de<br />
l’Atlantique central, limité par les failles transformantes des Açores-Gibraltar au sud et des<br />
Grisons au nord. De même, il se pourrait que l’ouverture du petit bassin valaisan soit contrôlée<br />
par des décrochements tardi-hercyniens réactivés comme la faille des Cévennes et la faille<br />
nord pyrénéenne.<br />
Une marge passive assez bien préservée<br />
Malgré la déformation alpine, responsable de « l’inversion tectonique », des structures<br />
contemporaines du stade de rifting peuvent encore être identifiées dans la zone helvétique. <strong>La</strong><br />
région du Taillefer-col du <strong>La</strong>utaret est un site classique où l’on retrouve des blocs basculés<br />
limités par des failles normales et des discordances progressives dues à la sédimentation synrift.<br />
Des structures comparables, non reprises (non-inversées) par l’orogenèse alpine, se rencontrent<br />
dans le bassin du sud-est et jusqu’à la marge ardéchoise. <strong>La</strong> faille des Cévennes<br />
constitue la limite occidentale de ce domaine en distension, formé lors de l’ouverture de<br />
l’océan liguro-piémontais.<br />
Un « couvercle » des nappes de socle austro-alpines<br />
Contrairement à l’Himalaya, dans les Alpes, les nappes ophiolitiques ne représentent pas<br />
les unités les plus élevées de l’édifice. Des nappes crustales formées d’un socle de roches<br />
métamorphiques et magmatiques paléozoïques et d’une couverture de séries sédimentaires<br />
mésozoïques recouvre les ophiolites. Il s’agit des nappes austro-alpines, le fameux « traîneau<br />
écraseur » de P. Termier, très développées dans les Alpes orientales (Autriche, Suisse, Italie).<br />
Biologie Géologie n° 4-2004 753