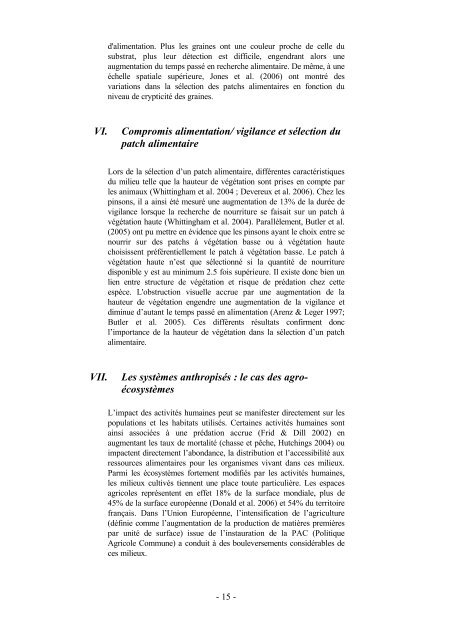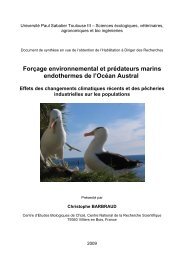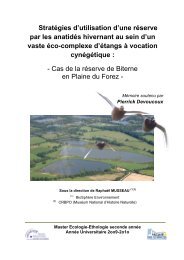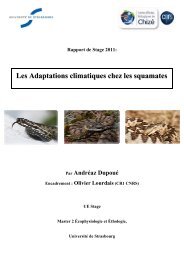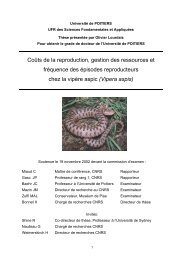You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
d'alimentation. Plus les graines ont une couleur proche de celle du<br />
substrat, plus leur détection est difficile, engendrant alors une<br />
augmentation du temps passé en recherche alimentaire. De même, à une<br />
échelle spatiale supérieure, Jones et al. (2006) ont montré des<br />
variations dans la sélection des patchs alimentaires en fonction du<br />
niveau de crypticité des graines.<br />
VI. Compromis alimentation/ vigilance et sélection du<br />
patch alimentaire<br />
Lors de la sélection d’un patch alimentaire, différentes caractéristiques<br />
du milieu telle que la hauteur de végétation sont prises en compte par<br />
les animaux (Whittingham et al. 2004 ; Devereux et al. 2006). Chez les<br />
pinsons, il a ainsi été mesuré une augmentation de 13% de la durée de<br />
vigilance lorsque la recherche de nourriture se faisait sur un patch à<br />
végétation haute (Whittingham et al. 2004). Parallèlement, Butler et al.<br />
(2005) ont pu mettre en évidence que les pinsons ayant le choix entre se<br />
nourrir sur des patchs à végétation basse ou à végétation haute<br />
choisissent préférentiellement le patch à végétation basse. Le patch à<br />
végétation haute n’est que sélectionné si la quantité de nourriture<br />
disponible y est au minimum 2.5 fois supérieure. Il existe donc bien un<br />
lien entre structure de végétation et risque de prédation chez cette<br />
espèce. L'obstruction visuelle accrue par une augmentation de la<br />
hauteur de végétation engendre une augmentation de la vigilance et<br />
diminue d’autant le temps passé en alimentation (Arenz & Leger 1997;<br />
Butler et al. 2005). Ces différents résultats confirment donc<br />
l’importance de la hauteur de végétation dans la sélection d’un patch<br />
alimentaire.<br />
VII. Les systèmes anthropisés : le cas des agroécosystèmes<br />
L’impact des activités humaines peut se manifester directement sur les<br />
populations et les habitats utilisés. Certaines activités humaines sont<br />
ainsi associées à une prédation accrue (Frid & Dill 2002) en<br />
augmentant les taux de mortalité (chasse et pêche, Hutchings 2004) ou<br />
impactent directement l’abondance, la distribution et l’accessibilité aux<br />
ressources alimentaires pour les organismes vivant dans ces milieux.<br />
Parmi les écosystèmes fortement modifiés par les activités humaines,<br />
les milieux cultivés tiennent une place toute particulière. Les espaces<br />
agricoles représentent en effet 18% de la surface mondiale, plus de<br />
45% de la surface européenne (Donald et al. 2006) et 54% du territoire<br />
français. Dans l’Union Européenne, l’intensification de l’agriculture<br />
(définie comme l’augmentation de la production de matières premières<br />
par unité de surface) issue de l’instauration de la PAC (Politique<br />
Agricole Commune) a conduit à des bouleversements considérables de<br />
ces milieux.<br />
- 15 -