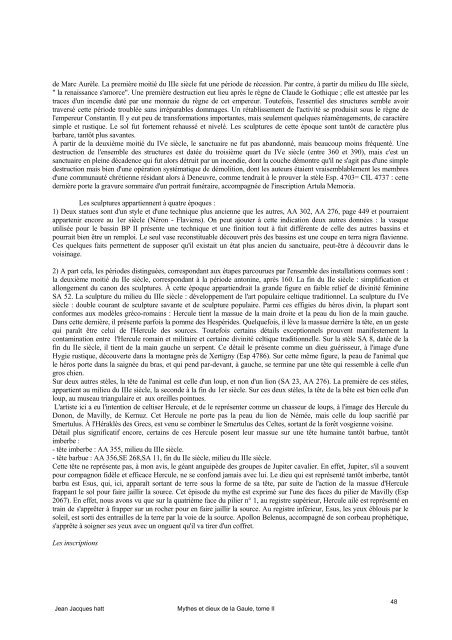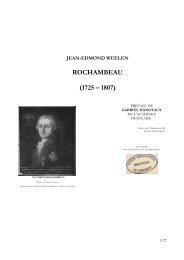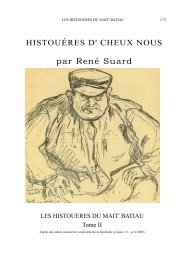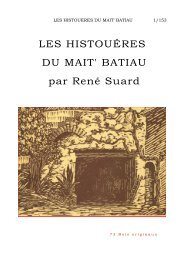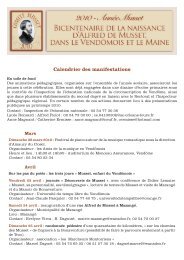Jean Jacques hatt Mythes et dieux de la Gaule, tome II 1
Jean Jacques hatt Mythes et dieux de la Gaule, tome II 1
Jean Jacques hatt Mythes et dieux de la Gaule, tome II 1
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>de</strong> Marc Aurèle. La première moitié du <strong>II</strong>Ie siècle fut une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> récession. Par contre, à partir du milieu du <strong>II</strong>Ie siècle,<br />
" <strong>la</strong> renaissance s'amorce". Une première <strong>de</strong>struction eut lieu après le règne <strong>de</strong> C<strong>la</strong>u<strong>de</strong> le Gothique ; elle est attestée par les<br />
traces d'un incendie daté par une monnaie du règne <strong>de</strong> c<strong>et</strong> empereur. Toutefois, l'essentiel <strong>de</strong>s structures semble avoir<br />
traversé c<strong>et</strong>te pério<strong>de</strong> troublée sans irréparables dommages. Un rétablissement <strong>de</strong> l'activité se produisit sous le règne <strong>de</strong><br />
l'empereur Constantin. Il y eut peu <strong>de</strong> transformations importantes, mais seulement quelques réaménagements, <strong>de</strong> caractère<br />
simple <strong>et</strong> rustique. Le sol fut fortement rehaussé <strong>et</strong> nivelé. Les sculptures <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te époque sont tantôt <strong>de</strong> caractère plus<br />
barbare, tantôt plus savantes.<br />
À partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième moitié du IVe siècle, le sanctuaire ne fut pas abandonné, mais beaucoup moins fréquenté. Une<br />
<strong>de</strong>struction <strong>de</strong> l'ensemble <strong>de</strong>s structures est datée du troisième quart du IVe siècle (entre 360 <strong>et</strong> 390), mais c'est un<br />
sanctuaire en pleine déca<strong>de</strong>nce qui fut alors détruit par un incendie, dont <strong>la</strong> couche démontre qu'il ne s'agit pas d'une simple<br />
<strong>de</strong>struction mais bien d'une opération systématique <strong>de</strong> démolition, dont les auteurs étaient vraisemb<strong>la</strong>blement les membres<br />
d'une communauté chrétienne résidant alors à Deneuvre, comme tendrait à le prouver <strong>la</strong> stèle Esp. 4703= CIL 4737 : c<strong>et</strong>te<br />
<strong>de</strong>rnière porte <strong>la</strong> gravure sommaire d'un portrait funéraire, accompagnée <strong>de</strong> l'inscription Artu<strong>la</strong> Memoria.<br />
Les sculptures appartiennent à quatre époques :<br />
1) Deux statues sont d'un style <strong>et</strong> d'une technique plus ancienne que les autres, AA 302, AA 276, page 449 <strong>et</strong> pourraient<br />
appartenir encore au 1er siècle (Néron - F<strong>la</strong>viens). On peut ajouter à c<strong>et</strong>te indication <strong>de</strong>ux autres données : <strong>la</strong> vasque<br />
utilisée pour le bassin BP <strong>II</strong> présente une technique <strong>et</strong> une finition tout à fait différente <strong>de</strong> celle <strong>de</strong>s autres bassins <strong>et</strong><br />
pourrait bien être un remploi. Le seul vase reconstituable découvert près <strong>de</strong>s bassins est une coupe en terra nigra f<strong>la</strong>vienne.<br />
Ces quelques faits perm<strong>et</strong>tent <strong>de</strong> supposer qu'il existait un état plus ancien du sanctuaire, peut-être à découvrir dans le<br />
voisinage.<br />
2) A part ce<strong>la</strong>, les pério<strong>de</strong>s distinguées, correspondant aux étapes parcourues par l'ensemble <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions connues sont :<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième moitié du <strong>II</strong>e siècle, correspondant à <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> antonine, après 160. La fin du <strong>II</strong>e siècle : simplification <strong>et</strong><br />
allongement du canon <strong>de</strong>s sculptures. À c<strong>et</strong>te époque appartiendrait <strong>la</strong> gran<strong>de</strong> figure en faible relief <strong>de</strong> divinité féminine<br />
SA 52. La sculpture du milieu du <strong>II</strong>Ie siècle : développement <strong>de</strong> l'art popu<strong>la</strong>ire celtique traditionnel. La sculpture du IVe<br />
siècle : double courant <strong>de</strong> sculpture savante <strong>et</strong> <strong>de</strong> sculpture popu<strong>la</strong>ire. Parmi ces effigies du héros divin, <strong>la</strong> plupart sont<br />
conformes aux modèles gréco-romains : Hercule tient <strong>la</strong> massue <strong>de</strong> <strong>la</strong> main droite <strong>et</strong> <strong>la</strong> peau du lion <strong>de</strong> <strong>la</strong> main gauche.<br />
Dans c<strong>et</strong>te <strong>de</strong>rnière, il présente parfois <strong>la</strong> pomme <strong>de</strong>s Hespéri<strong>de</strong>s. Quelquefois, il lève <strong>la</strong> massue <strong>de</strong>rrière <strong>la</strong> tête, en un geste<br />
qui paraît être celui <strong>de</strong> l'Hercule <strong>de</strong>s sources. Toutefois certains détails exceptionnels prouvent manifestement <strong>la</strong><br />
contamination entre l'Hercule romain <strong>et</strong> militaire <strong>et</strong> certaine divinité celtique traditionnelle. Sur <strong>la</strong> stèle SA 8, datée <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
fin du <strong>II</strong>e siècle, il tient <strong>de</strong> <strong>la</strong> main gauche un serpent. Ce détail le présente comme un dieu guérisseur, à l'image d'une<br />
Hygie rustique, découverte dans <strong>la</strong> montagne près <strong>de</strong> Xertigny (Esp 4786). Sur c<strong>et</strong>te même figure, <strong>la</strong> peau <strong>de</strong> l'animal que<br />
le héros porte dans <strong>la</strong> saignée du bras, <strong>et</strong> qui pend par-<strong>de</strong>vant, à gauche, se termine par une tête qui ressemble à celle d'un<br />
gros chien.<br />
Sur <strong>de</strong>ux autres stèles, <strong>la</strong> tête <strong>de</strong> l'animal est celle d'un loup, <strong>et</strong> non d'un lion (SA 23, AA 276). La première <strong>de</strong> ces stèles,<br />
appartient au milieu du <strong>II</strong>Ie siècle, <strong>la</strong> secon<strong>de</strong> à <strong>la</strong> fin du 1er siècle. Sur ces <strong>de</strong>ux stèles, <strong>la</strong> tête <strong>de</strong> <strong>la</strong> bête est bien celle d'un<br />
loup, au museau triangu<strong>la</strong>ire <strong>et</strong> aux oreilles pointues.<br />
L'artiste ici a eu l'intention <strong>de</strong> celtiser Hercule, <strong>et</strong> <strong>de</strong> le représenter comme un chasseur <strong>de</strong> loups, à l'image <strong>de</strong>s Hercule du<br />
Donon, <strong>de</strong> Mavilly, <strong>de</strong> Kernuz. C<strong>et</strong> Hercule ne porte pas <strong>la</strong> peau du lion <strong>de</strong> Némée, mais celle du loup sacrifié par<br />
Smertulus. À l'Héraklès <strong>de</strong>s Grecs, est venu se combiner le Smertulus <strong>de</strong>s Celtes, sortant <strong>de</strong> <strong>la</strong> forêt vosgienne voisine.<br />
Détail plus significatif encore, certains <strong>de</strong> ces Hercule posent leur massue sur une tête humaine tantôt barbue, tantôt<br />
imberbe :<br />
- tête imberbe : AA 355, milieu du <strong>II</strong>Ie siècle.<br />
- tête barbue : AA 356,SE 268,SA 11, fin du <strong>II</strong>e siècle, milieu du <strong>II</strong>Ie siècle.<br />
C<strong>et</strong>te tête ne représente pas, à mon avis, le géant anguipè<strong>de</strong> <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong> Jupiter cavalier. En eff<strong>et</strong>, Jupiter, s'il a souvent<br />
pour compagnon fidèle <strong>et</strong> efficace Hercule, ne se confond jamais avec lui. Le dieu qui est représenté tantôt imberbe, tantôt<br />
barbu est Esus, qui, ici, apparaît sortant <strong>de</strong> terre sous <strong>la</strong> forme <strong>de</strong> sa tête, par suite <strong>de</strong> l'action <strong>de</strong> <strong>la</strong> massue d'Hercule<br />
frappant le sol pour faire jaillir <strong>la</strong> source. C<strong>et</strong> épiso<strong>de</strong> du mythe est exprimé sur l'une <strong>de</strong>s faces du pilier <strong>de</strong> Mavilly (Esp<br />
2067). En eff<strong>et</strong>, nous avons vu que sur <strong>la</strong> quatrième face du pilier n° 1, au registre supérieur, Hercule ailé est représenté en<br />
train <strong>de</strong> s'apprêter à frapper sur un rocher pour en faire jaillir <strong>la</strong> source. Au registre inférieur, Esus, les yeux éblouis par le<br />
soleil, est sorti <strong>de</strong>s entrailles <strong>de</strong> <strong>la</strong> terre par <strong>la</strong> voie <strong>de</strong> <strong>la</strong> source. Apollon Belenus, accompagné <strong>de</strong> son corbeau prophétique,<br />
s'apprête à soigner ses yeux avec un onguent qu'il va tirer d'un coffr<strong>et</strong>.<br />
Les inscriptions<br />
<strong>Jean</strong> <strong>Jacques</strong> <strong>hatt</strong><br />
<strong>Mythes</strong> <strong>et</strong> <strong>dieux</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Gaule</strong>, <strong>tome</strong> <strong>II</strong><br />
48