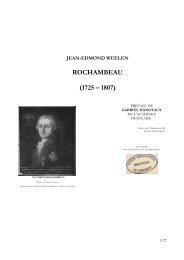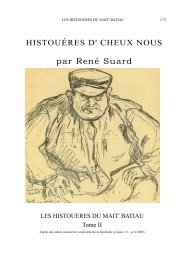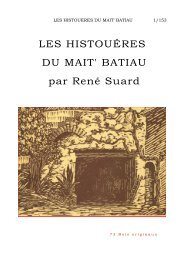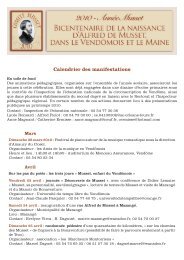Jean Jacques hatt Mythes et dieux de la Gaule, tome II 1
Jean Jacques hatt Mythes et dieux de la Gaule, tome II 1
Jean Jacques hatt Mythes et dieux de la Gaule, tome II 1
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Il s'ensuit que le tableau ainsi dressé est différent <strong>de</strong> celui que présente P.M. Duval dans sa préface : "S'il y a<br />
syncrétisme gallo-romain, il serait donc restreint, assez artificiel, <strong>et</strong> <strong>la</strong> série <strong>de</strong>s <strong>dieux</strong> gaulois s'en serait plutôt<br />
appauvrie".<br />
Ce concept d'appauvrissement <strong>de</strong> <strong>la</strong> religion gauloise après <strong>la</strong> conquête est un a priori, qui n'a pas été vérifié, <strong>et</strong> qui est<br />
d'ailleurs invérifiable. Il suppose que c<strong>et</strong>te religion ait été, avant <strong>la</strong> conquête purement nationale <strong>et</strong> sans mé<strong>la</strong>nge. Or nos<br />
recherches sur <strong>la</strong> formation <strong>et</strong> l'évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> religion <strong>la</strong>ténienne ont prouvé qu'elle était dès son origine, un<br />
syncrétisme, un mé<strong>la</strong>nge entre divers éléments :<br />
1) Une structure indo-européenne en trois parties, correspondant à <strong>la</strong> division <strong>de</strong> <strong>la</strong> société en trois c<strong>la</strong>sses, <strong>et</strong> à <strong>la</strong><br />
répartition <strong>de</strong>s <strong>dieux</strong>, en gros, dans les trois parties <strong>de</strong> l'Univers céleste : le Ciel, <strong>la</strong> surface <strong>de</strong> <strong>la</strong> Terre, les profon<strong>de</strong>urs<br />
<strong>de</strong>s Enfers : le Ciel à Taranis, <strong>la</strong> surface <strong>de</strong> <strong>la</strong> Terre à Teutatès, les profon<strong>de</strong>urs <strong>de</strong>s Enfers à Esus. Quant à <strong>la</strong> déesse<br />
Rigani, sa <strong>de</strong>stinée <strong>et</strong> ses trois fonctions <strong>la</strong> <strong>de</strong>stinaient à passer d'une partie du Mon<strong>de</strong> à l'autre.<br />
2) Des traditions anciennes nombreuses <strong>et</strong> dispersées suivant les régions, antérieures aux invasions celtiques, mais que<br />
les Celtes avaient accueillies <strong>et</strong> assimilées dans <strong>la</strong> cohabitation pacifique qui avait suivi leurs conquêtes.<br />
3) Des éléments provenant, dès <strong>la</strong> fin du VIe <strong>et</strong> le début du Ve siècle, <strong>de</strong> leurs contacts avec les pays méditerranéens,<br />
Grèce, Étrurie, Italie. Ces <strong>de</strong>rniers dérivaient <strong>de</strong> l'interprétation <strong>et</strong> <strong>de</strong> l'assimi<strong>la</strong>tion d'images <strong>et</strong> <strong>de</strong> concepts helléniques,<br />
parvenus à <strong>la</strong> faveur du développement du commerce, <strong>et</strong> <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions avec le mon<strong>de</strong> méditerranéen. Il faut reconnaître<br />
que, d'année en année, l'importance <strong>de</strong> ces re<strong>la</strong>tions avec le mon<strong>de</strong> méditerranéen augmente, au gré <strong>de</strong>s fouilles <strong>et</strong> <strong>de</strong>s<br />
découvertes fortuites.<br />
Ce syncrétisme a évolué entre le Ve siècle <strong>et</strong> <strong>la</strong> conquête romaine, comme les variantes <strong>et</strong> les suppléments apportés aux<br />
signes symboliques <strong>et</strong> les modifications dans leurs groupements l'ont prouvé 3 .<br />
L'ÉVOLUTION APRÈS LA CONQUÊTE<br />
Nous avons étudié l'évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> religion gallo-romaine à travers ses manifestations iconographiques <strong>et</strong> épigraphiques<br />
dans les chapitres V <strong>et</strong> VI du <strong>tome</strong> I, notamment dans les conclusions. Il est toutefois nécessaire <strong>de</strong> revenir ici sur les<br />
conclusions déduites <strong>de</strong>s observations faites également en d'autres chapitres.<br />
Il faut d'abord reconnaître que le dosage entre les éléments gréco-romains importés <strong>et</strong> le fonds indigène est très variable<br />
suivant les époques <strong>et</strong> suivant les régions.<br />
Pério<strong>de</strong> gallo-romaine précoce : les <strong>de</strong>ux séries distinctes d'images<br />
Dès <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> gallo-romaine précoce, <strong>de</strong> <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre <strong>de</strong>s <strong>Gaule</strong>s au règne <strong>de</strong> C<strong>la</strong>u<strong>de</strong>, avec <strong>de</strong>s prolongements<br />
différents suivant les régions, nous avons affaire à <strong>de</strong>ux séries dissemb<strong>la</strong>bles d'images religieuses. Celles qui sont dans<br />
<strong>la</strong> ligne <strong>de</strong>s images celtiques : les idoles <strong>de</strong> Bouray, <strong>de</strong> Broussy, <strong>de</strong> La Tour, présentant encore un caractère indigène<br />
prononcé, <strong>et</strong> se rattachant, par leur facture <strong>et</strong> leur composition, aux antécé<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> indépendante. Il en est <strong>de</strong><br />
même <strong>de</strong>s quatre faces du pilier <strong>de</strong>s Nautes représentant respectivement Esus, le taureau à trois grues, ainsi que<br />
Smertulus <strong>et</strong> Cernunnos. Pour le reste <strong>de</strong>s images, elles sont inspirées <strong>de</strong> l'art gréco-romain, mais interprétées dans leur<br />
groupement pour exprimer <strong>de</strong>s concepts indigènes. Il y a, semble-t-il alors, une sorte <strong>de</strong> dichotomie entre <strong>la</strong> religion<br />
traditionnelle, fidèle à ses mythes, ses rites <strong>et</strong> ses cérémonies d'une part, <strong>et</strong>, d'autre part, un culte d'invocation adressé<br />
aux divinités indigènes romanisées. Ce culte accuse l'assimi<strong>la</strong>tion du système gallo-romain, tout en conservant dans les<br />
groupes <strong>de</strong> divinités par eux-mêmes ainsi qu'en association entre eux certaines références à <strong>la</strong> tradition. Il y a là non pas<br />
une transformation totale, mais une modu<strong>la</strong>tion, dans un système différent, <strong>de</strong>s thèmes provinciaux conservés dans leur<br />
caractère essentiel.<br />
Néron<br />
C<strong>et</strong>te assimi<strong>la</strong>tion-interprétation progresse sous Néron, dans le cadre du patriotisme frontalier rhénan, avec <strong>la</strong> colonne<br />
<strong>de</strong> Mayence 4 . La riche iconographie <strong>de</strong> ce monument se développe dans les <strong>de</strong>ux sens : à <strong>la</strong> fois sur les tambours <strong>de</strong><br />
colonne, un système allégorique orienté vers <strong>la</strong> paix romaine <strong>et</strong> ses avantages matériels ; par contre, sur <strong>la</strong> base <strong>et</strong><br />
l'attique, un mo<strong>de</strong> d'assimi<strong>la</strong>tion sélective <strong>de</strong>s images gréco-romaines <strong>de</strong>stiné à exprimer allusivement les traditions<br />
indigènes.<br />
3 Voir HATT, J.J., <strong>tome</strong> I, ch. <strong>II</strong>I, p. 67 à 70.<br />
4 HATT, J.J., <strong>tome</strong> I, p. 109, 136, 137.<br />
<strong>Jean</strong> <strong>Jacques</strong> <strong>hatt</strong><br />
<strong>Mythes</strong> <strong>et</strong> <strong>dieux</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Gaule</strong>, <strong>tome</strong> <strong>II</strong><br />
8