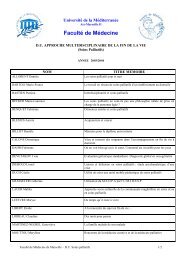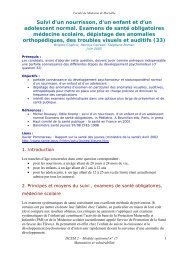Maladies et Grands Syndromes - Algodystrophie (221) - Serveur ...
Maladies et Grands Syndromes - Algodystrophie (221) - Serveur ...
Maladies et Grands Syndromes - Algodystrophie (221) - Serveur ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Faculté de Médecine de Marseille<br />
<strong>Maladies</strong> <strong>et</strong> <strong>Grands</strong> <strong>Syndromes</strong> - <strong>Algodystrophie</strong><br />
(<strong>221</strong>)<br />
Professeur Alain Schiano<br />
Juin 2005<br />
1. Définition<br />
L’algodystrophie (A.D.) est un « syndrome douloureux régional complexe », concernant une ou<br />
plusieurs régions articulaires, caractérisé par une perturbation fonctionnelle durable de la<br />
microcirculation <strong>et</strong> de son contrôle par le système nerveux végétatif sympathique. Il existe de<br />
nombreux synonymes faisant allusion soit à la physiopathologie supposée (algoneurodystrophie,<br />
A.D. « sympathique » ou « réflexe »), soit aux caractères cliniques propres à chaque localisation<br />
(syndrome épaule-main, pied décalcifié douloureux, ostéoporose transitoire de la hanche, <strong>et</strong>c…)<br />
2. Physiopathologie<br />
L’A.D. survient le plus souvent quelques jours ou semaines après un évènement pathologique,<br />
généralement douloureux <strong>et</strong> grossièrement situé dans le même territoire d’innervation. La moitié<br />
des A.D. sont post-traumatiques.<br />
Il n’y a pas de prédominance selon le sexe, <strong>et</strong> l’ A.D. existe à tous âges, y compris chez l’enfant.<br />
Classiquement invoquée, la notion d’un « terrain psychologique » favorisant l’apparition d’une<br />
A.D. ne ressort pas des travaux les plus récents, mais il semble que l’évolution de c<strong>et</strong>te<br />
pathologie soit plus sévère chez certains patients névrotiques ou anxio-dépressifs.<br />
La physiopathologie de l’ A.D. demeure mal connue <strong>et</strong> l’on n’évoquera ici que les points les<br />
moins controversés.<br />
Les anomalies microcirculatoires comportent une vasoconstriction artériolaire <strong>et</strong> peut être surtout<br />
veinulaire avec ouverture des shunts artérioloveinulaires, entraînant un ralentissement<br />
circulatoire <strong>et</strong> une hyperpression dans le système capillaire. L’intervention de l’innervation<br />
sympathique comporte deux aspects : la mise en jeu des fibres effectrices vasomotrices agissant<br />
par l’intermédiaire de la noradrénaline mais aussi d’autres substances vaso-actives, <strong>et</strong> la<br />
stimulation des fibres C afférentes conductrices des influx nociceptifs. On peut détecter dans la<br />
région algodystrophique de nombreuses substances génératrices de ces influx : prostaglandines,<br />
kinines, cytokines, substance P par exemple. Il existe probablement au niveau central, surtout<br />
médullaire, une perturbation des centres neuro-végétatifs recevant les afférences nociceptives,<br />
qui pourrait expliquer à la fois le délai entre facteur déclenchant <strong>et</strong> A.D., <strong>et</strong> l’autoentr<strong>et</strong>ien du<br />
dysfonctionnement neuro-vasculaire.<br />
Les modifications microcirculatoires <strong>et</strong> biochimiques ont pour conséquences :<br />
• la douleur régionale, de type volontiers « inflammatoire »,<br />
• l’œdème à la fois osseux, capsulo-synovial (avec hydarthrose) <strong>et</strong> éventuellement cutané ;<br />
• l’apparition progressive d’une fibrose épaississante <strong>et</strong> rétractile concernant surtout la<br />
capsule articulaire ;<br />
• la résorption osseuse, en fait relevant plus d’une fonte de la fraction minérale que d’une<br />
hyperactivité ostéoclastique.<br />
Classiquement, l’A.D évolue en deux phases :<br />
DCEM3 – Module pluri-disciplinaire n° 13<br />
Rhumatologie, Chirurgie Orthopédique, Chirurgie infantile<br />
1
Faculté de Médecine de Marseille<br />
• phase I « pseudo-inflammatoire » (ou « chaude ») correspondant aux manifestations des<br />
anomalies microcirculatoires, étalées sur plusieurs mois ;<br />
• phase II des « troubles trophiques » (ou « froide ») où les manifestations de la fibrose<br />
sont au premier plan.<br />
En fait le passage d’une phase à l’autre est très progressif, les troubles trophiques s’accentuant <strong>et</strong><br />
se démasquant lentement, au fur <strong>et</strong> à mesure que les anomalies microcirculatoires initiales<br />
régressent.<br />
La durée totale de ces deux phases va de quelques mois à deux ans, voire plus, puis, en principe,<br />
apparaît une phase dite de « récupération », où la région articulaire reprend progressivement un<br />
aspect clinique normal.<br />
Une récidive d’A.D. est possible, pratiquement toujours sur une autre région articulaire <strong>et</strong> sous<br />
l’eff<strong>et</strong> d’un autre facteur déclenchant, mais cela reste rare, <strong>et</strong> il est en particulier exceptionnel<br />
qu’un patient subissant dans son existence plusieurs traumatismes ait, parallèlement, plusieurs<br />
A.D.<br />
3. Signes cliniques<br />
3.1. Caractères généraux<br />
Phase I. : Débutant quelques jours ou quelques semaines après le facteur déclenchant éventuel,<br />
elle associe :<br />
• douleur : diffuse, étendue à l’ensemble des tissus de la région articulaire (os, interligne<br />
articulaire, peau) de type inflammatoire donc persistant au repos <strong>et</strong> notamment la nuit,<br />
d’intensité variable, pouvant adopter des tonalités particulières (allodynies, ou à type de<br />
brûlure : causalgies).<br />
• diminution des amplitudes articulaires : liée à la douleur, à l’œdème articulaire, au début<br />
de la rétraction capsulaire, elle est globale <strong>et</strong> d’importance croissante ; dans certaines<br />
localisations, elle peut s’accompagner d’une attitude vicieuse précoce en flexion (doigts,<br />
genou) :<br />
• signes cutanés : dans les régions articulaires superficielles (main, pied, genou), ils<br />
associent un œdème diffus <strong>et</strong> des signes d’aspect inflammatoire (rougeur, chaleur).<br />
Phase II. : elle succède insensiblement à la précédente <strong>et</strong> associe :<br />
• douleur : de type mécanique, provoquée par la mobilisation active ou passive, la mise en<br />
contrainte, mais disparaissant au repos ;<br />
• diminution des amplitudes articulaires : elle est maximale à ce stade, liée aux rétractions<br />
capsulo-ligamentaires <strong>et</strong> éventuellement musculo-tendineuses, pouvant atteindre le degré<br />
d’articulation « bloquée » ou « gelée » ; l’attitude vicieuse éventuelle persiste ;<br />
• amyotrophie : due à la non-utilisation articulaire elle porte de façon diffuse sur les<br />
muscles moteurs de l’articulation ;<br />
• signes cutanés : la disparition des signes pseudo-inflammatoires <strong>et</strong> de l’oedème laisse<br />
place à un épaississement la peau, qui devient froide <strong>et</strong> s’accompagne quelquefois de<br />
troubles des phanères (chute des poils ou hypertrichose, anomalies des ongles).<br />
3.2. Aspects selon la localisation<br />
3.2.1. Au membre supérieur<br />
L’atteinte est volontiers bifocale réalisant le « syndrome épaule-main ».<br />
DCEM3 – Module pluri-disciplinaire n° 13<br />
Rhumatologie, Chirurgie Orthopédique, Chirurgie infantile<br />
2
Faculté de Médecine de Marseille<br />
3.2.1.1. Phase I.<br />
L’épaule est douloureuse de façon diffuse <strong>et</strong> la mobilité est diminuée dans tous les secteurs<br />
d’amplitude ; il n’y a pas de signes cutanés (articulation profonde). Le poign<strong>et</strong> <strong>et</strong> la main sont<br />
douloureux, avec notamment hyperesthésie <strong>et</strong> allodynies cutanées ; l’œdème est global avec un<br />
aspect « boudiné » des doigts, une augmentation de la rougeur <strong>et</strong> de la chaleur de la peau <strong>et</strong> très<br />
souvent une hypersudation palmaire témoignant du dysfonctionnement du système sympathique.<br />
3.2.1.2. Phase II.<br />
l’épaule est très limitée dans tous ses secteurs d’amplitude (à l’extrême : épaule bloquée, ou<br />
gelée), fixée en adduction ; c<strong>et</strong>te limitation est compensée en partie par le jeu de l’articulation<br />
scapulo-thoracique. Les douleurs sont modérées <strong>et</strong> très mécaniques. L’amyotrophie est visible<br />
surtout sur le deltoïde, le sus- <strong>et</strong> le sous-épineux. Le poign<strong>et</strong> est enraidi, parfois en légère<br />
flexion ; les doigts peuvent être rétractés en flexion irréductible du fait surtout de la fibrose<br />
capsulaire des métacarpo-phalangiennes <strong>et</strong> interphalangiennes. Il peut apparaître dans la paume<br />
de la main des nodules <strong>et</strong> brides rétractiles de l’aponévrose palmaire semblables à la maladie de<br />
Dupuytren. La peau des doigts est sèche, froide, épaissie.<br />
L’atteinte de la main constitue la localisation la plus sévère de l’A.D., avec une évolution plus<br />
longue (jusqu’à 2 ans, voire plus) <strong>et</strong> la persistance fréquentez de séquelles liées à la récupération<br />
incomplète, même à long terme, de la mobilité des doigts.<br />
En dehors du syndrome épaule-main, peuvent s’observer des A.D. localisées soit à l’épaule<br />
(l’aspect clinique <strong>et</strong> l’évolution sont alors ceux d’une « périarthrite scapulo-humérale » par<br />
capsulose rétractile »), soit à la main. Inversement, chez certains patients, peut s’ajouter une<br />
A.D. du coude (alors que l’A.D. isolée du coude ne semble pas exister).<br />
3.2.2. Au membre inférieur<br />
L’A.D. est le plus souvent mono-articulaire, bien que des atteintes bi-voire triarticulaires soient<br />
possibles.<br />
3.2.2.1. L’A.D. du pied<br />
L’A.D. du pied est la plus fréquente. A la phase I, elle associe : des douleurs diffuses de type<br />
inflammatoire, une limitation des amplitudes de la tibio-tarsienne <strong>et</strong> des articulations du tarse, un<br />
oedème diffus pouvant remonter vers le tiers inférieur de la jambe, des signes cutanés pseudoinflammatoires<br />
(rougeur, chaleur) avec une exagération de la rougeur en déclive (« érythème de<br />
déclivité », assez évocateur).<br />
La phase II est dominée par des douleurs mécaniques <strong>et</strong> la persistance de l’enraidissement<br />
articulaire. La rétraction des orteils <strong>et</strong> l’apparition de nodules <strong>et</strong> brides de l’aponévrose plantaire<br />
sont rares.<br />
La durée moyenne de l’A.D. du pied est plus brève que celle du membre supérieur, en moyenne<br />
1 an <strong>et</strong> ne laisse en principe que peu ou pas de séquelles.<br />
3.2.2.2. L’A.D. du genou<br />
L’A.D. du genou s’exprime à la phase I sous la forme d’une arthropathie de type inflammatoire,<br />
avec douleurs globales d’intensité variable, limitation des mouvements de flexion-extension<br />
parfois précocement associée à un flexum, augmentation de volume <strong>et</strong> hydarthrose, signes<br />
DCEM3 – Module pluri-disciplinaire n° 13<br />
Rhumatologie, Chirurgie Orthopédique, Chirurgie infantile<br />
3
Faculté de Médecine de Marseille<br />
cutanés de type inflammatoire. C<strong>et</strong>te phase dure quelques mois, <strong>et</strong> à la phase II vont persister des<br />
douleurs mécaniques, une limitation articulaire avec un déficit d’extension dû à la rétraction<br />
capsulaire <strong>et</strong> musculo-tendineuse (ischio-jambiers). L’amyotrophie du quadriceps est variable,<br />
parfois importante.<br />
La durée globale de l’A.D. du genou est généralement inférieure à un an, <strong>et</strong> une persistance plus<br />
prolongée de l’enraidissement (notamment dans un contexte post-traumatique ou postchirurgical)<br />
doit faire rechercher d’autres mécanismes de perte d’amplitude.<br />
3.2.2.3. L’A.D. de la hanche<br />
L’A.D. de la hanche est plus rare, <strong>et</strong> de diagnostic particulièrement difficile. L’évolution en<br />
deux phases est moins n<strong>et</strong>te que pour les autres localisations. La séméiologie comporte une<br />
douleur plus ou moins inflammatoire au début, puis plus n<strong>et</strong>tement mécanique, pouvant irradier à<br />
la face antérieure de la cuisse jusqu’au genou, responsable d’une boiterie, associée à une<br />
limitation des amplitudes articulaires. Son évolution est relativement brève (quelques mois) <strong>et</strong> se<br />
termine sans séquelle, mais il existe un risque de fracture du col du fémur lié à la<br />
déminéralisation régionale.<br />
3.2.2.4. A.D. du rachis<br />
Les A.D. sont donc des pathologies des régions articulaires des membres, mais l’éventualité<br />
d’A.D. du rachis, essentiellement dorso-lombaire, est discutée. Les rares cas rapportés<br />
comportent des douleurs rachidiennes plus ou moins étendues, avec apparition secondaire<br />
possible de tassements vertébraux ; ces cas accompagnent ou suivent généralement une A.D. des<br />
membres inférieurs.<br />
4. Examens paracliniques<br />
Le diagnostic clinique d’A.D. peut être relativement facile devant un tableau de syndrome<br />
épaule-main typique mais est souvent difficile dans les autres variantes topographiques. Dans<br />
tous les cas des examens complémentaires s’imposent donc.<br />
4.1. Biologie<br />
Il n’y a pas de modifications des paramètres biologiques au cours de l’A.D., en dehors de celles<br />
éventuellement liées à une étiologie précise ou à une affection concomitante. Les tests<br />
d’inflammation (V.S. <strong>et</strong> autres) sont donc normaux <strong>et</strong> ceci a une grande valeur d’orientation,<br />
devant une séméiologie articulaire de type inflammatoire. Le bilan phosphocalcique est<br />
également normal, en dehors de la possible augmentation passagère, au début, des marqueurs de<br />
la résorption osseuse (hydroxyprolinurie ou autres) ; c<strong>et</strong>te augmentation n’est ni sensible, ni<br />
spécifique.<br />
La ponction articulaire ramène un liquide synovial de formule mécanique (moins de 1000<br />
éléments/mm 3 ) malgré l’aspect clinique inflammatoire <strong>et</strong> ceci aussi entraîne une forte<br />
présomption d’A.D. Rappelons que l’examen du liquide synovial, devant une arthropathie de<br />
type inflammatoire, doit comporter aussi une recherche de micro-cristaux <strong>et</strong> un examen<br />
bactériologique ; ces examens seront négatifs en cas d’A.D. sauf en cas d’étiologie particulière<br />
(arthropathie microcristalline, arthrite septique).<br />
DCEM3 – Module pluri-disciplinaire n° 13<br />
Rhumatologie, Chirurgie Orthopédique, Chirurgie infantile<br />
4
Faculté de Médecine de Marseille<br />
4.2. Imagerie<br />
4.2.1. Les radiographies<br />
Les radiographies standard de la région articulaire sont normales pendant plusieurs semaines<br />
(voire mois) a près le début clinique. Les signes radiologiques, une fois apparus, consistent en<br />
une déminéralisation osseuse régionale, souvent plus intense au niveau de l’os sous chondral.<br />
Dans les cas les plus typiques, c<strong>et</strong>te déminéralisation est hétérogène, de nombreuses plages de<br />
déminéralisation de quelques millimètres de diamètre se superposant au fond de<br />
déminéralisation globale, donnant un aspect « mouch<strong>et</strong>é » (surtout à la main, au pied, au genou).<br />
La déminéralisation peut aussi être homogène, surtout à la hanche ou à l’épaule.<br />
La déminéralisation radiologique peut persister longtemps après la guérison clinique, la<br />
reminéralisation peut rester incomplète.<br />
Un signe négatif important est la conservation de l’interligne articulaire, quelle que soit la durée<br />
d’évolution (contrairement à d’autres arthropathies d’aspect inflammatoire).<br />
4.2.2. La tomodensitométrie<br />
Elle montre les mêmes aspects que les radiographies, mais de la façon un peu plus précoce.<br />
4.2.3. La scintigraphie osseuse<br />
Aux bisphosphonates marqués au technétium 99, elle montre généralement une hyperfixation<br />
intense des foyers algodystrophiques <strong>et</strong> ceci dès le début de l’A.D. C’est donc un examen très<br />
sensible, mais non spécifique.<br />
L’hyperfixation peut être limitée à un segment osseux réduit en cas d’A.D. partielle ou<br />
parcellaire. A l’inverse on observe parfois une hyperfixation de région(s) articulaire(s) voisines<br />
cliniquement asymptomatiques.<br />
Exceptionnellement est observée une hypofixation régionale surtout dans les A.D. de l’enfant.<br />
4.2.4. L’I.R.M.<br />
Elle est utile surtout en cas de présomption d’A.D. de la hanche ou du genou, où le diagnostic est<br />
souvent difficile. Elle montre typiquement <strong>et</strong> précocement : un œdème médullaire intra-osseux,<br />
avec hyposignal en T1 (rehaussé après injection de gadolinium) <strong>et</strong> hypersignal en T2, un œdème<br />
<strong>et</strong> un épaississement des partie molles (capsulosynoviales surtout), avec un épanchement intraarticulaire<br />
(hypersignal en T2).<br />
L’I.R.M. confirme l’absence des signes caractéristiques d’une fracture de contrainte ou d’une<br />
ostéonécrose dont la séméiologie clinique peut être très proche voire identique. Paradoxalement,<br />
l’I.R.M. de la main ou du pied est souvent normale ou difficile à interpréter.<br />
5. Formes cliniques<br />
5.1. Formes symptomatiques <strong>et</strong> évolutives<br />
Selon l’intensité des signes (à la phase I surtout), on distingue aux deux extrêmes d’une part des<br />
formes suraiguës, évoquant à priori une pathologie infectieuse ou microcristalline (surtout main,<br />
pied, genou), d’autre part des formes atténuées, ou « froides » d’emblée (surtout syndromes<br />
épaule-main d’origine médicamenteuse)<br />
DCEM3 – Module pluri-disciplinaire n° 13<br />
Rhumatologie, Chirurgie Orthopédique, Chirurgie infantile<br />
5
Faculté de Médecine de Marseille<br />
Selon l’étendue, il existe des formes « partielles » (localisées à un segment de la région<br />
articulaire mais s’étendant secondairement à l’ensemble), des formes « parcellaires » (localisées<br />
à un segment en ne s’étendant pas, mais pouvant migrer à d’autres segments de la région).<br />
Selon l’évolution, il existe des formes « extensives » atteignant avec un décalage dans le temps<br />
deux ou plusieurs localisations, avant la guérison de la localisation précédente) <strong>et</strong> des formes<br />
« récidivantes » (atteignant d’autres régions articulaires plusieurs mois ou années après la<br />
guérison de l’épisode précédent).<br />
5.2. Formes étiologiques<br />
Dans les trois-quarts des cas, l’A.D. apparaît comme la complication d’un évènement<br />
pathologique antérieur ; dans un quart des cas, l’anamnèse ne r<strong>et</strong>rouve aucun facteur<br />
déclenchant <strong>et</strong> l’A.D. apparaît comme primitive. En fait, ces proportions sont variables selon la<br />
localisation, <strong>et</strong> la hanche, surtout, se caractérise par la fréquence des formes primitives (environ<br />
65 %). Le nombre <strong>et</strong> la variété des étiologies possibles d’A.D sont considérables, <strong>et</strong> l’on peut<br />
classer les plus fréquentes sous quatre rubriques.<br />
5.2.1. Les traumatismes<br />
Les traumatismes importants de l’appareil locomoteur (fractures, luxations, entorses), sont suivis<br />
d’une A.D. dans 3 à 5 % des cas. Des traumatismes mineurs (coupure, contusion…) peuvent<br />
aussi être en cause, plus rarement, <strong>et</strong> sont généralement guéris <strong>et</strong> « oubliés » lorsque l’A.D.<br />
débute.<br />
Les traumatismes du rachis pouvent se compliquer d’A.D dans le territoire correspondant<br />
(membre supérieur pour le rachis cervical, membre inférieur pour le rachis lombaire).<br />
On peut rapprocher des traumatismes les interventions chirurgicales (surtout sur l’appareil<br />
locomoteur, mais aussi le thorax ou l’abdomen, avec là aussi une concordance topographique),<br />
ou d’autres actes médicaux comme les arthroscopies.<br />
5.3. Les affections neurologiques<br />
Les pathologiques neurologiques périphériques causes d’A.D. sont représentées surtout par les<br />
plaies ou compressions (radiculaires, tronculaires, plexiques), le zona, les polyradiculonévrites.<br />
Les pathologies neurologiques centrales sont surtout les hémiplégies quelle qu’en soit la cause<br />
(syndrome épaule-main du côté paralysé), la maladie de Parkinson, l’épilepsie, les tumeurs<br />
cérébrales.<br />
5.3.1. Les affections viscérales<br />
Une A.D. du membre supérieur peut compliquer de nombreuses pathologies thoraciques, surtout<br />
l’infarctus du myocarde (syndrome épaule-main, habituellement du côté gauche), plus rarement<br />
une péricardite, un cancer bronchique, une pleurésie.<br />
Une A.D. du membre inférieur peut compliquer une pathologie abdominale, ou surtout,<br />
pelvienne. On en rapproche la grossesse, parfois responsable d’une A.D. de la hanche,<br />
habituellement du côté gauche. L’A.D. survient dans les trois derniers mois de la grossesse ou<br />
après l’accouchement. Rappelons ici le risque de fracture du col du fémur <strong>et</strong> l’intérêt<br />
diagnostique particulier de l’I.R.M. qui n’est pas irradiante.<br />
DCEM3 – Module pluri-disciplinaire n° 13<br />
Rhumatologie, Chirurgie Orthopédique, Chirurgie infantile<br />
6
Faculté de Médecine de Marseille<br />
5.3.2. Les causes iatrogènes<br />
Certaines médicaments augmentent le risque d’A.D. : l’isoniazide <strong>et</strong> surtout les barbituriques<br />
(« rhumatisme gardénalique »), sont à l’origine de syndromes épaule-main, parfois bilatéraux,<br />
avec une phase I atténuée. Des A.D. ont été décrites après traitement de pathologies<br />
thyroïdiennes par l’iode radioactif. Plus récemment, la ciclosporine a été mise en cause dans<br />
certains cas.<br />
En traumatologie, le risque d’A.D. est accru par la confection de plâtres inadaptés (douloureux,<br />
trop serrés), <strong>et</strong> par une masso-kinésithérapie trop « énergique » <strong>et</strong> douloureuse.<br />
6. Diagnostic différentiel<br />
Un tableau clinique de monoarthrite ou oligoarthrite doit faire évoquer une pathologie<br />
infectieuse (arthrite septique), inflammatoire (début de polyarthrite ou spondylarthropathie),<br />
métabolique (goutte, chondrocalcinose). Dans ces cas, les radiographies initiales sont normale<br />
(sauf en cas de chondrocalcinose : calcification des cartilages ou fibrocartilages articulaires)<br />
comme dans l’A.D., mais il existe généralement un syndrome biologique inflammatoire <strong>et</strong><br />
surtout la ponction articulaire ramène un liquide synovial de type inflammatoire (plus de 2000<br />
éléments par mm3) qui sera systématiquement l’obj<strong>et</strong> d’une recherche de cristaux <strong>et</strong> d’un<br />
examen bactériologique.<br />
Les fractures de contrainte <strong>et</strong> les ostéonécroses peuvent avoir un aspect clinique très proche de<br />
l’A.D., surtout à la hanche ou au genou. Les radiographies initiales sont également normales. La<br />
scintigraphie osseuse montre des aspects, d’hyperfixation très proches, voire identiques dans les<br />
trois pathologies. L’I.R.M. est donc l’examen de prédilection.<br />
Si les aspects d’œdème osseux sont semblables, il existe en plus des aspects quasi-spécifiques de<br />
la fracture de contrainte (bande d’hyposignal noir en T1 <strong>et</strong> T2) <strong>et</strong> de l’ostéonécrose (liséré<br />
d’hyposignal noir en T1 <strong>et</strong> T2 cernant la zone nécrosée, dont le signal est variable mais<br />
généralement différent de celui de la zone oedémateuse juxta-nécrotique). Certains cas sont<br />
cependant plus difficiles à interpréter : une fracture de contrainte peut en eff<strong>et</strong> être soit la cause,<br />
soit la conséquence d’une A.D., mais dans ce cas la zone oedémateuse est généralement plus<br />
étendue.<br />
La causalgie est, avec l’A.D., l’autre « syndrome douloureux régional complexe », en fait très<br />
proche sur le plan physiopathologique <strong>et</strong> clinique. Touchant électivement l’extrémité d’un<br />
membre, elle survient après une lésion d’un tronc nerveux riche en fibres sympathiques (médian,<br />
sciatique). La douleur est intense, à type de brûlure ou de constriction profonde, associée à une<br />
allodynie <strong>et</strong> une hyperpathie. Il existe aussi un œdème, des troubles de la microcirculation <strong>et</strong> de<br />
la sudation, mais les troubles trophiques osseux <strong>et</strong> articulaires sont rares <strong>et</strong> discr<strong>et</strong>s.<br />
7. Traitement<br />
Divers moyens thérapeutiques ont pour objectif de raccourcir les phases évolutives de c<strong>et</strong>te<br />
affection spontanément curable.<br />
7.1. Les médicaments<br />
Ils ont pour but de réduire la douleur, les signes pseudo-inflammatoires <strong>et</strong>, pour certains,<br />
l’hyperresorption osseuse. Ils sont donc actifs (<strong>et</strong> indiqués) surtout à la phase I.<br />
DCEM3 – Module pluri-disciplinaire n° 13<br />
Rhumatologie, Chirurgie Orthopédique, Chirurgie infantile<br />
7
Faculté de Médecine de Marseille<br />
7.1.1. Voie générale<br />
La calcitonine reste le traitement de première intention de l’A.D. Ses eff<strong>et</strong>s sont multiples :<br />
vasodilatateur périphérique, antalgique par action centrale, inhibiteur de la résorption<br />
ostéoclastique.<br />
On utilise des posologies quotidiennes de 80 à 100 unités de calcitonine de saumon, ou de 0,50<br />
mg de calcitonine humaine. Les injections (sous-cutanées ou intra-musculaires) seront effectuées<br />
tous les jours pendant trois semaines, puis trois fois par semaine pendant trois à six semaines.<br />
L’amélioration clinique apparaît en moyenne deux semaines après le début du traitement. Les<br />
eff<strong>et</strong>s secondaires sont bénins, mais souvent très inconfortables (nausée, flush, somnolence), <strong>et</strong><br />
peuvent être diminués par l’injection I.M. concomitante d’anti-émétiques (métoclopramide)<br />
Les bisphosphonates par voie intraveineuse peuvent être utilisés en cas d’échec de la calcitonine,<br />
hors A.M.M. En pratique, on utilise le parnidronate (Aredia®), à la dose de 90 à 120 mg répartis<br />
en deux ou trois perfusions lentes, en milieu hospitalier. L’efficacité est r<strong>et</strong>ardée (1 à 2<br />
semaines).<br />
Les autres médicaments sont moins utiles ou controversés. Les antalgiques <strong>et</strong> les antiinflammatoires<br />
non stéroïdiens ont peu d’eff<strong>et</strong> sur la douleur de l’A.D. La corticothérapie à<br />
doses élevées (30 à 60 mg d’équivalent-prednisone par jour) est utilisée dans les pays anglosaxons,<br />
mais non en France (rapport bénéfice-risques peu satisfaisant).<br />
D’autres médicaments ont été essayés, mais ne doivent plus être prescrits (vasodilatateurs<br />
classiques, griséofulvine, béta-bloquants : efficacité plus que douteuse, absence d’A.M.M.).<br />
7.1.2. Voie loco-régionale<br />
Les injections locales de corticoïdes ont souvent un eff<strong>et</strong> intéressant <strong>et</strong> rapide sur la douleur, en<br />
association, si possible, avec un anesthésique local. On pratique une injection intra-articulaire<br />
pour le genou ou l’épaule, une injection canalaire (canal carpien ou tarsien) pour la main ou le<br />
pied. Si nécessaire, l’injection peut être répétée un peu plus souvent que pour d’autres<br />
arthropathies, étant donné l’absence de risque de détérioration articulaire, notamment<br />
cartilagineuse dans l’A.D.<br />
Le bloc régional par voie veineuse consiste à introduire par voie veineuse rétrograde un produit<br />
vasodilatateur dans le membre algodystrophique, en cas d’A.D. de la main ou du pied. Le seul<br />
produit utilisable actuellement est le buflomedil (Fonzylane®). Le bloc doit être réalisé à<br />
proximité d’une structure d’anesthésie-réanimation (risque de collapsus). son efficacité demeure<br />
controversée.<br />
7.2. La rééducation fonctionnelle<br />
Les moyens physiques sont utiles à toutes les phases de l’A.D. en s’adaptant à l’aspect clinique,<br />
<strong>et</strong> doivent absolument rester indolores (sinon, risque de pérennisation de l’A.D.).<br />
7.2.1. A la phase I<br />
il faut d’abord alléger les contraintes mécaniques : mise en décharge (marche avec une paire de<br />
cannes) pour le membre inférieur, écharpe de soutien pour le membre supérieur.<br />
DCEM3 – Module pluri-disciplinaire n° 13<br />
Rhumatologie, Chirurgie Orthopédique, Chirurgie infantile<br />
8
Faculté de Médecine de Marseille<br />
Les massages utilisent les techniques de réduction de l’œdème, <strong>et</strong> de drainage veinolymphatique.<br />
La kinésithérapie active <strong>et</strong> passive réalise des mobilisations douces, lentes <strong>et</strong> progressives.<br />
La balnéothérapie, <strong>et</strong> surtout les « bains écossais » alternant eau chaude <strong>et</strong> froide sont utiles mais<br />
nécessitent un équipement particulier.<br />
7.2.2. A la phase II<br />
l’objectif est surtout de hâter la récupération des amplitudes articulaires <strong>et</strong> de la force <strong>et</strong> de la<br />
trophicité musculaires. La kinésithérapie passive (mobilisations, postures) <strong>et</strong> active (contractions<br />
isométriques contre résistance) constitue l’essentiel de la rééducation. Elle doit être manuelle<br />
(par le kinésithérapeute <strong>et</strong> non par des appareils) <strong>et</strong> rester à c<strong>et</strong>te phase aussi, rigoureusement<br />
indolore.<br />
Durant toute l’évolution de l’A.D., un soutien psychologique <strong>et</strong>, si nécessaire, la prescription de<br />
psychotropes peut être utile chez certains patients.<br />
DCEM3 – Module pluri-disciplinaire n° 13<br />
Rhumatologie, Chirurgie Orthopédique, Chirurgie infantile<br />
9