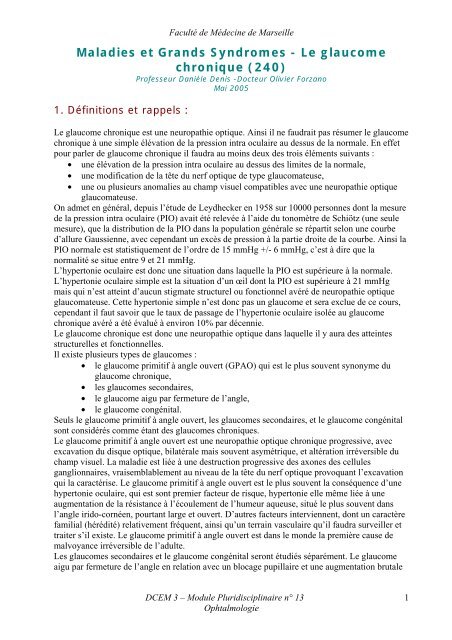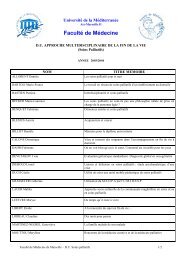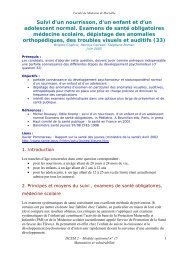Maladies et Grands Syndromes - Le glaucome chronique (240)
Maladies et Grands Syndromes - Le glaucome chronique (240)
Maladies et Grands Syndromes - Le glaucome chronique (240)
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Faculté de Médecine de Marseille<br />
<strong>Maladies</strong> <strong>et</strong> <strong>Grands</strong> <strong>Syndromes</strong> - <strong>Le</strong> <strong>glaucome</strong><br />
<strong>chronique</strong> (<strong>240</strong>)<br />
Professeur Danièle Denis -Docteur Olivier Forzano<br />
Mai 2005<br />
1. Définitions <strong>et</strong> rappels :<br />
<strong>Le</strong> <strong>glaucome</strong> <strong>chronique</strong> est une neuropathie optique. Ainsi il ne faudrait pas résumer le <strong>glaucome</strong><br />
<strong>chronique</strong> à une simple élévation de la pression intra oculaire au dessus de la normale. En eff<strong>et</strong><br />
pour parler de <strong>glaucome</strong> <strong>chronique</strong> il faudra au moins deux des trois éléments suivants :<br />
• une élévation de la pression intra oculaire au dessus des limites de la normale,<br />
• une modification de la tête du nerf optique de type glaucomateuse,<br />
• une ou plusieurs anomalies au champ visuel compatibles avec une neuropathie optique<br />
glaucomateuse.<br />
On adm<strong>et</strong> en général, depuis l’étude de <strong>Le</strong>ydhecker en 1958 sur 10000 personnes dont la mesure<br />
de la pression intra oculaire (PIO) avait été relevée à l’aide du tonomètre de Schiötz (une seule<br />
mesure), que la distribution de la PIO dans la population générale se répartit selon une courbe<br />
d’allure Gaussienne, avec cependant un excès de pression à la partie droite de la courbe. Ainsi la<br />
PIO normale est statistiquement de l’ordre de 15 mmHg +/- 6 mmHg, c’est à dire que la<br />
normalité se situe entre 9 <strong>et</strong> 21 mmHg.<br />
L’hypertonie oculaire est donc une situation dans laquelle la PIO est supérieure à la normale.<br />
L’hypertonie oculaire simple est la situation d’un œil dont la PIO est supérieure à 21 mmHg<br />
mais qui n’est atteint d’aucun stigmate structurel ou fonctionnel avéré de neuropathie optique<br />
glaucomateuse. C<strong>et</strong>te hypertonie simple n’est donc pas un <strong>glaucome</strong> <strong>et</strong> sera exclue de ce cours,<br />
cependant il faut savoir que le taux de passage de l’hypertonie oculaire isolée au <strong>glaucome</strong><br />
<strong>chronique</strong> avéré a été évalué à environ 10% par décennie.<br />
<strong>Le</strong> <strong>glaucome</strong> <strong>chronique</strong> est donc une neuropathie optique dans laquelle il y aura des atteintes<br />
structurelles <strong>et</strong> fonctionnelles.<br />
Il existe plusieurs types de <strong>glaucome</strong>s :<br />
• le <strong>glaucome</strong> primitif à angle ouvert (GPAO) qui est le plus souvent synonyme du<br />
<strong>glaucome</strong> <strong>chronique</strong>,<br />
• les <strong>glaucome</strong>s secondaires,<br />
• le <strong>glaucome</strong> aigu par ferm<strong>et</strong>ure de l’angle,<br />
• le <strong>glaucome</strong> congénital.<br />
Seuls le <strong>glaucome</strong> primitif à angle ouvert, les <strong>glaucome</strong>s secondaires, <strong>et</strong> le <strong>glaucome</strong> congénital<br />
sont considérés comme étant des <strong>glaucome</strong>s <strong>chronique</strong>s.<br />
<strong>Le</strong> <strong>glaucome</strong> primitif à angle ouvert est une neuropathie optique <strong>chronique</strong> progressive, avec<br />
excavation du disque optique, bilatérale mais souvent asymétrique, <strong>et</strong> altération irréversible du<br />
champ visuel. La maladie est liée à une destruction progressive des axones des cellules<br />
ganglionnaires, vraisemblablement au niveau de la tête du nerf optique provoquant l’excavation<br />
qui la caractérise. <strong>Le</strong> <strong>glaucome</strong> primitif à angle ouvert est le plus souvent la conséquence d’une<br />
hypertonie oculaire, qui est sont premier facteur de risque, hypertonie elle même liée à une<br />
augmentation de la résistance à l’écoulement de l’humeur aqueuse, situé le plus souvent dans<br />
l’angle irido-cornéen, pourtant large <strong>et</strong> ouvert. D’autres facteurs interviennent, dont un caractère<br />
familial (hérédité) relativement fréquent, ainsi qu’un terrain vasculaire qu’il faudra surveiller <strong>et</strong><br />
traiter s’il existe. <strong>Le</strong> <strong>glaucome</strong> primitif à angle ouvert est dans le monde la première cause de<br />
malvoyance irréversible de l’adulte.<br />
<strong>Le</strong>s <strong>glaucome</strong>s secondaires <strong>et</strong> le <strong>glaucome</strong> congénital seront étudiés séparément. <strong>Le</strong> <strong>glaucome</strong><br />
aigu par ferm<strong>et</strong>ure de l’angle en relation avec un blocage pupillaire <strong>et</strong> une augmentation brutale<br />
DCEM 3 – Module Pluridisciplinaire n° 13<br />
Ophtalmologie<br />
1
Faculté de Médecine de Marseille<br />
<strong>et</strong> très élevée de la PIO ne sera pas étudié dans c<strong>et</strong>te question puisque n’étant pas par définition<br />
un <strong>glaucome</strong> <strong>chronique</strong>.<br />
2. Physiologie <strong>et</strong> physiopathologie :<br />
Une pression est une force qui se répartit uniformément sur une surface. L’œil est un espace clos<br />
dont la paroi externe, la coque cornéosclérale, n’est ni totalement rigide ni capable de grande<br />
distension sauf au début de la vie. Chez l’adulte où la distension du globe est très limitée, toute<br />
augmentation du contenu se trouve très vite opposée à la résistance pariétale. <strong>Le</strong> facteur essentiel<br />
dans la PIO est la présence <strong>et</strong> la circulation de l’humeur aqueuse dans la chambre antérieure.<br />
C<strong>et</strong>te humeur aqueuse est sécrétée par le corps ciliaire (à chaque minute un peu plus de deux<br />
microlitres pénètre dans l’œil), puis passe à travers les fibres de la zonule, puis à travers la<br />
pupille (entre iris <strong>et</strong> cristallin), pour remplir la chambre antérieure. Elle sera ensuite résorbée<br />
dans le fond de l’angle irido-cornéen au travers du trabéculum, puis drainée dans le canal de<br />
Schlemm qui se j<strong>et</strong>te dans les veines conjonctivales. C<strong>et</strong>te voie trabéculaire qui représente la<br />
voie principale de résorption de l’humeur aqueuse n’est pas la seule, il existe en eff<strong>et</strong> des voies<br />
dites uvéo-sclérales constituées par l’iris, le corps ciliaire, la suprachoroïde <strong>et</strong> la sclère. C<strong>et</strong>te<br />
voie, secondaire à l’état normal, présente un intérêt en thérapeutique hypotensive.<br />
L’hypertonie peut ainsi résulter d’essentiellement trois mécanismes : soit une augmentation de la<br />
sécrétion, soit une diminution de la résorption, soit encore un blocage à l’écoulement.<br />
L’augmentation de la sécrétion est rare est n’est rencontrée que dans les uvéites antérieures<br />
aiguës compliquées d’hypertonie oculaire. Ces uvéites hypertensives posent un véritable<br />
problème de diagnostic différentiel avec la crise de <strong>glaucome</strong> par ferm<strong>et</strong>ure de l’angle.<br />
Un blocage à l’écoulement est représenté par :<br />
<strong>Le</strong> blocage pupillaire par le cristallin essentiellement dans deux circonstances : la cataracte<br />
intumescente, le cristallin opaque <strong>et</strong> « gonflé » peut provoquer un blocage de l’orifice pupillaire ;<br />
des synéchies irido-cristalliniennes, complication des épisodes d’inflammation intraoculaire (<strong>Le</strong><br />
cristallin étant collé sur le rebord irien empêche le passage de l’humeur aqueuse).<br />
<strong>Le</strong> blocage ciliaire du <strong>glaucome</strong> malin qui est une hypertonie oculaire survenant après une<br />
intervention chirurgicale à globe ouvert ; l’humeur aqueuse s’accumulant entre la hyaloïde<br />
antérieure <strong>et</strong> le bloc lenticulaire.<br />
La diminution de l’élimination: qui peut être soit par obstruction, soit par sclérose, soit encore<br />
par ferm<strong>et</strong>ure.<br />
• L’obstruction de l’angle irido-cornéen par une membrane résiduelle (la membrane de<br />
Barkan) embryonnaire est observé dans le <strong>glaucome</strong> congénital.<br />
• La sclérose du trabéculum liée au vieillissement <strong>et</strong> à l’âge représente le mécanisme<br />
principal de la diminution de l’écoulement <strong>et</strong> est le mécanisme rencontré dans le<br />
<strong>glaucome</strong> primitif à angle ouvert.<br />
La ferm<strong>et</strong>ure de l’angle irido-cornéen est observée dans la crise de <strong>glaucome</strong> aigu par ferm<strong>et</strong>ure<br />
de l’angle<br />
<strong>Le</strong>s conséquences de l’augmentation de la PIO seront différentes d’une part selon le degré<br />
d’hypertonie <strong>et</strong> d’autre part selon le terrain sur lequel c<strong>et</strong>te hypertonie r<strong>et</strong>entit.<br />
Cependant d’une manière générale l’hypertonie va provoquer une compression des artères de la<br />
tête du nerf optique, qui aura des conséquences d’autant plus grave que l’hypertonie sera grande<br />
<strong>et</strong> durable. De plus l’hypertonie n’aura pas les mêmes conséquences selon le terrain (toute la<br />
différence entre hypertonie simple <strong>et</strong> neuropathie glaucomateuse) sur lequel elle agit. Ainsi la<br />
qualité de la microcirculation du suj<strong>et</strong> aura une grande importance : cela constitue les facteurs<br />
DCEM 3 – Module Pluridisciplinaire n° 13<br />
Ophtalmologie<br />
2
Faculté de Médecine de Marseille<br />
vasculaires du <strong>glaucome</strong> primitif à angle ouvert. Parmi eux on r<strong>et</strong>rouve les facteurs de risque de<br />
l’athérosclérose (tabac, HTA, diabète, dyslipidémie), mais aussi un terrain dit vasospastique<br />
englobant les suj<strong>et</strong>s migraineux <strong>et</strong> ceux souffrant d’algie vasculaire de la face, ceux souffrant de<br />
vasospasmes des extrémités (acrosyndrome <strong>et</strong> syndrome de Raynaud), <strong>et</strong> enfin les patients<br />
présentant des hypotensions (nocturne <strong>et</strong>/ou orthostatique).<br />
3. Examens cliniques <strong>et</strong> paracliniques<br />
L’examen clinique d’un suj<strong>et</strong> présentant un <strong>glaucome</strong> <strong>chronique</strong> comportera les mêmes étapes<br />
que lors de tout examen ophtalmologique à savoir :<br />
- Mesure de l’acuité visuelle de loin <strong>et</strong> de prés, sans <strong>et</strong> avec correction optique,<br />
- Mesure de la pression intra oculaire soit par tonométrie par aplanissement (instrument<br />
de Goldmann : mesure par aplanation la référence actuelle), soit par tonométrie à<br />
indentation (le tonomètre de Schiötz), enfin il existe un système de mesure non<br />
contact avec les tonomètres à air. <strong>Le</strong>s mesures de PIO devront être répétées <strong>et</strong><br />
réalisées à différents moments de la journée (voire de la nuit : courbe de tonus<br />
nycthémérale) avant de pouvoir conclure à une hypertonie <strong>et</strong> à plus forte raison un<br />
<strong>glaucome</strong>, surtout si elles sont à la limites de la normale supérieure.<br />
- L’examen biomicroscopique à la lampe à fente du segment antérieur <strong>et</strong> du segment<br />
postérieur avec analyse de la tête du nerf optique <strong>et</strong> mesure du rapport Cusp/Disc dit<br />
rapport C/D dont la normale sera de l’ordre de 5à6/10. Dans le cadre du <strong>glaucome</strong><br />
<strong>chronique</strong> il faudra aussi analyser les fibres optiques qui convergent vers la tête du<br />
nerf optique.<br />
Un examen indispensable sera, dans le cas du <strong>glaucome</strong>, l’étude de l’angle irido-cornéen lors de<br />
la gonioscopie réalisée à l’aide d’un verre spécial, angulé, perm<strong>et</strong>tant une étude précise des<br />
structures anatomiques de c<strong>et</strong> angle irido-cornéen. Il sera dans le cadre du <strong>glaucome</strong> <strong>chronique</strong><br />
largement ouvert.<br />
Au niveau paraclinique l’examen princeps sera l’étude du champ visuel des 30° centraux, à la<br />
recherche d’un déficit pouvant être compatible avec une atteinte glaucomateuse, c’est à dire pour<br />
les plus caratéristiques : l’existence d’un ressaut nasal, ou d’un déficit arciforme de type<br />
fasciculaire dont le plus classique est le scotome de Bjérum.<br />
Il faudra aussi savoir faire un bilan cardiovasculaire afin d’évaluer le terrains <strong>et</strong> rechercher<br />
d’éventuelles hypotensions artérielles notamment nocturne (holter TA, échodoppler des TSAO,<br />
avis spécialisé cardiologique, capillaroscopie, échographie cardiaque), ainsi qu’un bilan<br />
biologique (glycémie, bilan lipidique).<br />
Avant de passer aux formes cliniques <strong>et</strong> aux étiologies du <strong>glaucome</strong> <strong>chronique</strong> nous voudrions<br />
aborder les facteurs susceptibles d’entraîner des variations de la PIO <strong>et</strong> ainsi de créer des erreurs<br />
dans la prise de tension oculaire entraînant par la même des faux positifs <strong>et</strong> des faux négatifs.<br />
Tout d’abord nous l’avons déjà dit plus haut avant d’affirmer l’hypertonie oculaire il faudra<br />
plusieurs mesures à des heures différentes dans la journée <strong>et</strong> après avoir éliminer les causes<br />
d’erreurs les plus habituelles qui sont :<br />
• Pour les faux négatifs : les erreurs de mesures entraînant une sous estimation (œil sec,<br />
absence ou insuffisance de fluorescéine, illumination du cône insuffisante, cornée<br />
fine (myopie), astigmatisme conforme, accommodation prolongée, mesures multiples<br />
répétées) ; la prise de certains médicaments systémiques (alpha stimulants, béta<br />
bloquants, dopaminergiques, digitaliques, inhibiteurs calciques, IEC <strong>et</strong> analogues),<br />
certaines substances toxiques (Whisky, cannabis), ou encore par un effort inopiné.<br />
DCEM 3 – Module Pluridisciplinaire n° 13<br />
Ophtalmologie<br />
3
Faculté de Médecine de Marseille<br />
• Pour les faux positifs : les erreurs de mesures responsables de sur-estimation (contact<br />
tonomètre ménisque lacrymal excessif, col de chemise <strong>et</strong>/ou cravate trop serrés,<br />
accommodation aiguë, contact du cône avec les cils, paupières ou un corps étranger,<br />
astigmatisme inverse, décentrement du cône, position de l’œil (hyperthyroïdie),<br />
rétraction de la paupière, le blépharospasme, ou encore la prise de corticostéroïdes<br />
locaux ou généraux.<br />
4. Etiologies <strong>et</strong> formes cliniques<br />
Il existe globalement trois types de <strong>glaucome</strong> <strong>chronique</strong> :<br />
• <strong>Le</strong> <strong>glaucome</strong> primitif à angle ouvert,<br />
• <strong>Le</strong>s <strong>glaucome</strong>s secondaires,<br />
• <strong>Le</strong> <strong>glaucome</strong> congénital.<br />
4.1. <strong>Le</strong> <strong>glaucome</strong> primitif à angle ouvert = <strong>glaucome</strong> <strong>chronique</strong><br />
à angle ouvert = <strong>glaucome</strong> <strong>chronique</strong><br />
4.1.1. Généralités<br />
C’est le <strong>glaucome</strong> le plus fréquent puisqu’il touche 5% de la population française.<br />
Il est en général bilatéral, parfois asymétrique, <strong>et</strong> souvent familial (20% d’hérédité r<strong>et</strong>rouvée,<br />
mode de transmission mal connu mais à rechercher à l’interrogatoire).<br />
Il débute en général vers 40-50 ans, parfois plus tôt dans certaines formes cliniques.<br />
Il est grave, <strong>et</strong> évoluant de façon insidieuse (indolore, sur un œil blanc <strong>et</strong> calme, sans<br />
r<strong>et</strong>entissement sur l’acuité visuelle pendant de nombreuses années). Il est source de dégât<br />
irréversible. <strong>Le</strong> <strong>glaucome</strong> primitif à angle ouvert est dans le monde la première cause de<br />
malvoyance irréversible de l’adulte. Il est donc primordial de le dépister à un stade précoce c’est<br />
à dire avant qu’il n’ait créé de dégâts irréversibles.<br />
4.1.2. Signes cliniques <strong>et</strong> évolution :<br />
Tout comme l’hypertension artérielle le GPAO est strictement mu<strong>et</strong> sur le plan clinique. En eff<strong>et</strong><br />
il n’existe pas de symptomatologie bruyante, <strong>et</strong> le GPAO reste asymptomatique pendant des<br />
dizaines d’années, le malade n’ayant conscience de ces troubles qu’à un stade très évolué de la<br />
maladie qui est alors irréversible. C’est la raison pour laquelle un dépistage précoce par des<br />
mesures systématiques de la PIO doit être réalisé lors de toutes consultations ophtalmologiques.<br />
Ce n’est qu’à un stade évolué de la maladie qu’apparaîtront, <strong>et</strong> encore de manière inconstante,<br />
des signes cliniques tel que la sensation d’une vague amputation du champ visuel (surtout en<br />
nasal), le suj<strong>et</strong> pouvant ressentir une difficulté dans le champs nasal, dans des gestes de la vie<br />
quotidienne. Puis le champ se dégrade de plus en plus, aboutissant à une perte quasi complète de<br />
son champs visuel. Il ne persistent alors au stade préterminal de <strong>glaucome</strong> qu’un îlot de vision<br />
temporale <strong>et</strong> un îlot de vision centrale (rétrécissement concentrique du champ visuel). <strong>Le</strong> suj<strong>et</strong> à<br />
ce stade n’a plus que la vision centrale (avec parfois encore 10/10 e <strong>et</strong> Parinaud 2) mais en<br />
" canon de fusil ". Il sera alors très handicapé avec difficulté dans le moindre déplacement en<br />
relation avec c<strong>et</strong>te vision tubulaire.<br />
Au stade terminal en l’absence de prise en charge thérapeutique adaptée, on aboutira à une cécité<br />
totale par perte complète du champ visuel <strong>et</strong> de l’acuité visuelle centrale.<br />
Il peut exister de façon très inconstante <strong>et</strong> très rarement d’autre p<strong>et</strong>its signes, comme des<br />
épisodes de halos autour des lumières (dus à un léger œdème de cornée) ou de légères douleurs<br />
lors de grandes fluctuations rapides de PIO.<br />
DCEM 3 – Module Pluridisciplinaire n° 13<br />
Ophtalmologie<br />
4
Faculté de Médecine de Marseille<br />
Un mode d’entrée parfois brutal dans le GPAO, mais très rare peut être celui de l’occlusion de la<br />
veine centrale de la rétine, <strong>et</strong> ceci par phénomène mécanique (compression des veines). Sur le<br />
FO les artères écrasent les veines créant des croisements artério-veineux, <strong>et</strong> il y aura un œdème<br />
papillaires avec des hémorragies rétiniennes diffuses s’étendant jusqu’en périphérie. Il y aura<br />
alors une baisse d’acuité visuelle brutale à oeil blanc calme <strong>et</strong> indolore. Ainsi devant toute<br />
OVCR il faudra penser à prendre la PIO.<br />
4.1.3. Diagnostic positif<br />
Il repose sur la présence de :<br />
• 3 signes positifs (au moins deux d’entre eux) <strong>et</strong><br />
• 2 signes négatifs.<br />
Un point important est le fait que ces signes sont en général bilatéraux <strong>et</strong> plus ou moins<br />
symétriques<br />
4.1.3.1. <strong>Le</strong>s signes positifs :<br />
• Augmentation de la PIO au dessus de 21 mmHg r<strong>et</strong>rouvée à plusieurs reprises, <strong>et</strong> à<br />
différents moments dans la journée (une seule mesure ne suffit pas, sauf si très haute,<br />
c’est-à-dire supérieure à 26 mmHg).<br />
• Modification de la tête du nerf optique avec une augmentation du rapport C/D, avec<br />
diminution de l’anneau neurorétinien. <strong>Le</strong> C/D sera supérieur à 6/10 <strong>et</strong> verticalisé à un<br />
stade de début puis à un stade plus évolué apparaîtra l’aspect dramatique de nerf optique<br />
agonique atrophique en chaudron avec C/D égal à 10/10.<br />
• Anomalies du champ visuel : les scotomes. Ces anomalies sont détectées par le relevé du<br />
champ visuel informatisé, qu’il faudra savoir répéter. Au début on pourra r<strong>et</strong>rouver<br />
simple élargissement de tâche aveugle ou encores des scotomes dans certaines aires<br />
(ressaut nasal, aire de Bjérum), puis amputation plus large, nasale puis de quasi tout le<br />
champ visuel. Ainsi au stade préterminale, il reste la vision centrale (vision tubulaire) <strong>et</strong><br />
un p<strong>et</strong>it îlot de vision temporale. On comprend pourquoi en cas d’atteint symétrique il y<br />
aura un comportement de malvoyant malgré la conservation d’une acuité centrale<br />
d’excellente qualité. Enfin au stade terminal il y aura perte du champ visuel central, <strong>et</strong><br />
donc cécité totale.<br />
4.1.3.2. <strong>Le</strong>s signes négatifs :<br />
• conservation d’une acuité visuelle très longtemps normale, contrastant avec l’importance<br />
du handicap affiché par le patient.<br />
• angle iridicornéen largement ouvert sans anomalie visible en gonioscopie, c’est à dire<br />
angle iridocornéen normal.<br />
4.1.4. Formes cliniques<br />
Certaines formes particulières de GPAO existent <strong>et</strong> sont remarquables par certaines de leurs<br />
caractéristiques qui peuvent être : l’âge plus jeune de début (vers l’adolescence pour le <strong>glaucome</strong><br />
juvénile, ou encore vers 30 ou 40 ans), une HTO plus élevée donc plus grave, <strong>et</strong> plus rapidement<br />
opérés (traitement médical souvent insuffisant), <strong>et</strong> certaines caractéristiques de l’angle<br />
iridocornéen.<br />
• le <strong>glaucome</strong> juvénile : qui est un GPAO de début très précoce vers l’adolescence.<br />
• le <strong>glaucome</strong> pigmentaire : plus fréquent dans la race noire <strong>et</strong> au pourtour méditérannéen<br />
(Italie, afrique du nord), il se caractérise par des dépots pigementaires provenant de l’iris<br />
volontiers foncé <strong>et</strong> qui viennent bloquer le trabéculum. <strong>Le</strong>s poussées d’HTO sont parfois<br />
élevées (plus de 30 mm Hg), avec halos <strong>et</strong> p<strong>et</strong>ites douleurs. Son traitement est volontiers<br />
chirurgical.<br />
DCEM 3 – Module Pluridisciplinaire n° 13<br />
Ophtalmologie<br />
5
Faculté de Médecine de Marseille<br />
• le <strong>glaucome</strong> exfoliatif : sortes de dépôts translucides que l’on individualise bien sur la<br />
face antérieure du cristallin, il s’agit d’un GPAO sévère <strong>et</strong> souvent rapidement opéré.<br />
• le <strong>glaucome</strong> à pression normale dans lequel il y a une PIO est normale mais une<br />
neuropathie optique glaucomateuse bien réelle.<br />
4.2. <strong>Le</strong>s <strong>glaucome</strong>s secondaires<br />
<strong>Le</strong> terme <strong>glaucome</strong>s secondaires signifie : hypertonies oculaires secondaire à une maladie<br />
oculaire ou générale connue avec r<strong>et</strong>entissement sur le nerf optique.<br />
4.2.1. <strong>Maladies</strong> oculaires :<br />
l’HTO est souvent forte (25 à 30 mmHg). On r<strong>et</strong>rouve ici :<br />
• <strong>glaucome</strong>s inflammatoires : les uvéites hypertensives: par l’uvéite elle-même ou ses<br />
complications : le blocage pupillaire suite aux synéchies irido-cristalliniennes, la cyclite<br />
hétérochromique de Fuchs.<br />
• <strong>glaucome</strong>s d’origine cristallinienne (anomalie de position, de taille, ou encore une<br />
réaction antigénique : le <strong>glaucome</strong> phakolytique).<br />
• <strong>glaucome</strong>s traumatiques.<br />
• <strong>glaucome</strong>s par cellules fantôme après saignement intra oculaire quel qu’en soit<br />
l’étiologie.<br />
• le <strong>glaucome</strong> néovasculaire.<br />
• <strong>glaucome</strong> des processus tumoraux intra oculaires.<br />
• <strong>glaucome</strong>s d’origine cornéenne.<br />
4.2.2. <strong>Maladies</strong> générales<br />
L’HTO pourra souvent être sévère (40,50, 60 mmHg)<br />
Il peut s’agir :<br />
• du tableau de <strong>glaucome</strong> aigu néovasculaire compliquant une rétinopathie ischémique<br />
proliférative sévère. <strong>Le</strong>s néo-vaisseaux en provenance de la rétine ischémique passent sur<br />
l’iris (" rubéose irienne ") puis vont dans l’angle iridocornéen qu’ils vont alors obstruer,<br />
donnant un tableau aigu avec douleurs violente, rougeur périkératique, buée de<br />
cornée…Il s’agit d’un des diagnostic différentiels du GAFA. Trois éléments sont à ce<br />
titre discriminants : l’œil était en général mal voyant au départ, la chambre antérieure est<br />
de profondeur normale <strong>et</strong> surtout on observe les néovaisseaux sur l’iris ou dans l’angle en<br />
gonioscopie. Ce <strong>glaucome</strong> néovasculaire est de pronostic effroyable, difficile à traiter, <strong>et</strong><br />
les patients finissent souvent pas réclamer d’eux-mêmes l’énucléation de c<strong>et</strong> oeil<br />
douloureux <strong>et</strong> non voyant.<br />
Ses étiologies sont :<br />
• rétinopathie diabétique à forme ischémique proliférante<br />
• complication (« <strong>glaucome</strong> des 90 jours ») d’une occlusion veineuse rétinienne de type<br />
ischémique proliférante.<br />
<strong>Le</strong> meilleur traitement du <strong>glaucome</strong> néovasculaire reste sa prévention par la surveillance des<br />
rétinopathies diabétiques <strong>et</strong> des OVCR par angiographie en fluorescence <strong>et</strong> de traiter les<br />
néovascularisations par photocoagulation.<br />
• d’un <strong>glaucome</strong> d’origine extra-oculaire par hyperpression veineuse épisclérale. On<br />
r<strong>et</strong>rouve ici les causes d’obstructions veineuses (pseudo tumeur ou tumeur orbitaire,<br />
ophtalmopathie thyroïdienne, tumeur médiastinale, insuffisance cardiaque congestive,<br />
thrombose du sinus caverneux, obstruction des veines jugulaires), <strong>et</strong> les causes<br />
DCEM 3 – Module Pluridisciplinaire n° 13<br />
Ophtalmologie<br />
6
Faculté de Médecine de Marseille<br />
d’anomalies artério-veineuses (fistule carotido-caverneuse, varices orbitaires, syndrome<br />
de Sturge-Weber-Krabbe, Shunt orbito-méningé, Shunt jugulocarotidien).<br />
• d’un corticothérapie systémique au long cours.<br />
4.3. <strong>Le</strong> <strong>glaucome</strong> congénital.<br />
C’est une pathologie rare <strong>et</strong> souvent bilatérale mais rare parfois asymétrique, <strong>et</strong> parfois unilatéral<br />
strict. Il est dû à la persistance d’une membrane embryonnaire (membrane de Barkan)<br />
responsable d’une obstruction de l’angle.<br />
La relative plasticité de l’œil de l’enfant fait qu’il se déforme sous l’eff<strong>et</strong> de l’hypertonie<br />
expliquant le signe majeur : l’augmentation du diamètre cornéen <strong>et</strong> la buphtalmie.<br />
Il peut être isolé ou associé à des malformations oculaires (cataracte congénitale le plus souvent,<br />
mais aussi aniridie dans laquelle il faudra rechercher l’association avec une tumeur de Wilms<br />
systématiquement) ou encore une maladie générale, en particulier une phacomatose comme la<br />
maladie de Sturge Weber Krabbe ou angiomatose encéphalo-trigéminale, la maladie de Von<br />
Recklinhausen, <strong>et</strong> plus rarement dans la sclérose tubéreuse de Bourneville <strong>et</strong> le naevus de Ota, ou<br />
des syndromes systémiques congénitaux associés (trisomies 13, 18 ou 21, syndrome d’Ullrich,<br />
syndrome de Prader-Willi, syndrome de Pierre-Robin, maladie des sclérotiques bleues, syndrome<br />
oculo-cérébro-rénal de Lowe, les mucopolysaccharidoses….).<br />
Il est parfois héréditaire avec une transmission autosomique dominante à pénétrance variable<br />
d’où l’intérêt de l’interrogatoire <strong>et</strong> l’enquête génétique.<br />
C’est un <strong>glaucome</strong> grave d’une extrême urgence thérapeutique néonatale sans laquelle l’issue<br />
sera la cécité.<br />
4.3.1. Signes cliniques <strong>et</strong> diagnostique positif :<br />
<strong>Le</strong> <strong>glaucome</strong> congénital devra être évoqué dès la naissance ou dans les premiers mois de la vie<br />
devant les signes suivants :<br />
• un larmoiement clair, à ne pas rattacher à un larmoiement d’origine lacrymale (banal<br />
chez le nourrisson par imperméabilité temporaire du canal lacrymo-nasal).<br />
• une photophobie : le bébé éloigne sa tête si on l’éblouit.<br />
• une augmentation du diamètre cornéen, donnant un aspect de « grands, beaux, yeux ». <strong>Le</strong><br />
diagnostic n'est pas toujours évident si l'augmentation du diamètre est minime, surtout<br />
lorsque l’atteinte est bilatérale <strong>et</strong> sera donc plus facile en cas d’atteinte unilatérale<br />
(asymétrie+++). Au maximum, on aboutira en quelques mois ou années à la buphtalmie<br />
où le diamètre cornéen devient énorme <strong>et</strong> la cornée perd sa transparence (aspect de<br />
sclérocornée).<br />
<strong>Le</strong> diagnostic positif de certitude sera fait par un examen sous anesthésie générale au bloc<br />
opératoire avec mesure de la PIO <strong>et</strong> examen sous microscope.<br />
L’examen sera bilatéral <strong>et</strong> comparatif. La PIO sera mesurée par tonométrie à aplanation (appareil<br />
de Perkins) <strong>et</strong> devra tenir compte de l’AG qui diminue la PIO de prés de 6mmHg. On procèdera<br />
aussi à une mesure des diamètres cornéens dans les sens horizontal <strong>et</strong> vertical, qui seront<br />
augmentées.(normale 10.5mm chez un nouveau-né), à un examen détaillé de la cornée <strong>et</strong> de<br />
l’angle iridocornéen (trabéculum épaissi le plus souvent <strong>et</strong> l’on ne verra qu’exceptionnellement<br />
la classique membrane de Barkan), <strong>et</strong> l’on finira l’examen par l’analyse après dilatation du fond<br />
d’œil <strong>et</strong> du nerf optique.<br />
DCEM 3 – Module Pluridisciplinaire n° 13<br />
Ophtalmologie<br />
7
5. Prise en charge thérapeutique<br />
Faculté de Médecine de Marseille<br />
Nous disposons actuellement de plusieurs modes thérapeutiques pour lutter contre l’hypertonie<br />
oculaire. Il existe en eff<strong>et</strong> des traitements locaux (les collyres), des traitements systémiques, des<br />
traitements faisant appel à la photocoagulation au laser argon, <strong>et</strong> des traitements chirurgicaux.<br />
<strong>Le</strong> but du traitement sera de :<br />
• diminuer la PIO (idéalement en dessous de 14 mmHg) afin de ne plus entraîner<br />
d’altération sur les cellules ganglionnaires,<br />
• lutter contre les facteurs de risque vasculaire éventuels associés : arrêt du tabac,<br />
régulariser la TA, le diabète, <strong>et</strong> la cholestérolémie.<br />
• lutter contre autres facteurs d’atrophie optique : arrêt de toutes les intoxications<br />
(alcool+++).<br />
Nous disposons pour cela de plusieurs moyens :<br />
5.1. Traitement médical :<br />
<strong>Le</strong> plus souvent suffisant (prés de 90% des cas). Ce sont les collyres hypotonisants. Quatre<br />
classes thérapeutiques principales sont à notre disposition plus deux autres beaucoup moins<br />
utilisées actuellement.<br />
• <strong>Le</strong>s collyres bétabloquants : maléate de timolol pour le plus ancien (Timoptol*) qui<br />
restent le traitement de première intention en l’absence de leurs contre-indications<br />
(essentiellement asthme <strong>et</strong> trouble du rythme cardiaque à type de bloc<br />
auriculoventriculaire ou autre syndrome de pouls lents). Ils réduisent la production<br />
d’humeur aqueuse.<br />
• <strong>Le</strong>s collyres analogues des prostaglandines: un seul est commercialisé actuellement le<br />
latanoprost (Xalatan*) : il augmente l’écoulement de l’humeur aqueuse par la voie<br />
uvéosclérale. Ses contre-indications relatives sont essentiellement oculaires<br />
(inflammation intra oculaire type uvéite, aphakie <strong>et</strong> risque de coloration irienne) <strong>et</strong><br />
rarement systémique (asthme grave).<br />
• <strong>Le</strong>s collyres alpha 2 mimétique: deux existent l’Alphagan* <strong>et</strong> la Iopidine* : ils entraînent<br />
une diminution de la sécrétion de l’HA <strong>et</strong> pour l’alphagan* une augmentation de<br />
l’écoulement.<br />
• <strong>Le</strong>s collyres inhibiteurs de l’anhydrase carbonique : deux existent le Trusopt* <strong>et</strong><br />
l’Azopt* : ils sont récents <strong>et</strong> efficace, mais réservé en seconde intention tout comme les<br />
deux précédent sauf existence d’une contre indication aux béta-bloquants. Ils diminuent<br />
la sécrétion d’humeur aqueuse.<br />
<strong>Le</strong>s deux classes beaucoup moins utilisées actuellement sont :<br />
• <strong>Le</strong>s collyres à l’adrénaline : l’adrénaline diminue la circulation sanguine dans le corps<br />
ciliaire <strong>et</strong> par la même sa production d’humeur aqueuse. Elle peut avoir comme eff<strong>et</strong><br />
secondaire la dilatation pupillaire (entraînant photophobie <strong>et</strong> gène l’accommodation) <strong>et</strong><br />
est allergisante au long court.<br />
• <strong>Le</strong>s collyres myotiques : le myosis provoque un étirement du trabéculum <strong>et</strong> par la même<br />
une facilité à l’écoulement de l’humeur aqueuse <strong>et</strong> donc une baisse de la PIO. <strong>Le</strong>s eff<strong>et</strong>s<br />
secondaires gênant ayant entraîner son utilisation beaucoup plus rare sont : la<br />
modification du rayon de courbure du cristallin provocant ainsi une myopie (réversible)<br />
avec vision floue de loin, <strong>et</strong> surtout le myosis qui complique considérablement la<br />
surveillance du nerf optique. Il faudra de plus éviter les myotiques chez les fort myopes<br />
(risque de déchirure de rétine augmenté).<br />
DCEM 3 – Module Pluridisciplinaire n° 13<br />
Ophtalmologie<br />
8
Faculté de Médecine de Marseille<br />
Tous ces collyres sont à instiller de manière quotidienne <strong>et</strong> de façon bien souvent<br />
pluriquotidienne <strong>et</strong> posent donc un grand problème d’observance <strong>et</strong> ceci d’autant plus que ce<br />
sera le traitement d’une vie.<br />
Il existe aussi des hypotonisants utilisables par voie systémique : se sont pour le plus utilisé mais<br />
toujours de façon ponctuelle <strong>et</strong> jamais en <strong>chronique</strong> l’acétazolamide (diamox*) inhibiteur de<br />
l’anhydrase carbonique, utilisable per os ou IV, <strong>et</strong> les agents hyperosmolaires que sont : le sirop<br />
de glycérotone per os, <strong>et</strong> le mannitol en IV.<br />
5.2. Traitement au Laser (dans 5 à 9 % des cas)<br />
C’est la trabéculorétraction ou trabécoluplastie au laser argon : elle est habituellement réalisée si<br />
le traitement médical (les collyres) est un échec ou insuffisant, ou mal toléré, ou si l’observance<br />
mauvaise, ou encore selon l’étiologie du <strong>glaucome</strong>. Sa réalisation pratique est aisée sous simple<br />
anesthésie topique au travers du verre à gonioscopie (on tire dans le trabéculum créant une<br />
cicatrisation qui elle même en engendrant un élargissement des mailles trabéculaires facilite<br />
l’écoulement <strong>et</strong> la résorption d’humeur aqueuse). Ce traitement efficace une fois sur 2, présente<br />
une durée d’efficacité relativement brève (5 ans généralement).<br />
5.3. Traitement chirurgical (1 à 5% des cas) :<br />
• la trabéculectomie : c’est une chirurgie filtrante créant une solution de continuité entre la<br />
chambre antérieure <strong>et</strong> l’espace sous ténonien. Elle est d’une grande efficacité mais peut<br />
présenter des complications parfois dramatiques.<br />
• la sclérectomie profonde : c<strong>et</strong>te intervention consiste à créer une zone de moindre<br />
résistance à l’écoulement de l’humeur aqueuse en dehors du globe sans toutefois être<br />
perforante. C’est donc une intervention filtrante non perforante. Elle présenterait ainsi les<br />
avantages tensionnels de la trabéculectomie sans les inconvénients inhérents à l’ouverture<br />
de la chambre antérieure. C<strong>et</strong>te intervention n’est pour le moment pas complètement<br />
validée (recul insuffisant).<br />
5.4. Indications <strong>et</strong> surveillance :<br />
• En première intention le traitement de référence reste pour le moment les collyres, <strong>et</strong><br />
parmi eux les bétabloquants en l’absence de CI.<br />
• En cas d’intolérance ou de contre indication on pourra librement proposer l’une des trois<br />
autres classes thérapeutiques.<br />
• Si le résultat pressionnel n’est pas satisfaisant avec une monothérapie on pourra proposer<br />
un bithérapie.<br />
• En cas d’évolutivité de la maladie malgré une bithérapie (PIO toujours trop haute,<br />
altération du CV), on pourra :<br />
o soit proposer une trithérapie locale,<br />
o soit proposer une trabéculoplastie en complément,<br />
o soit encore proposer une chirurgie filtrante.<br />
• Si on a pris l’option d’une trithérapie ou d’une trabéculoplastie <strong>et</strong> que ses solutions<br />
s’avèrent inefficaces on proposera de façon tout à fait légitime une chirurgie filtrante.<br />
• On pourra aussi proposer une chirurgie filtrante de manière beaucoup plus précoce dans<br />
les cas manifestes de non observance ou encore « d’intolérance » à toutes les gouttes.<br />
• La place de la trabéculoplastie en première intention n’est pas très bien définie mais elle<br />
peut se discuter en cas de dispersion pigmentaire avec <strong>glaucome</strong> pigmentaire, ou encore<br />
chez les suj<strong>et</strong>s âgés avec GPAO <strong>et</strong> pour lesquels l’instillation de gouttes pourrait être<br />
hasardeuse.<br />
DCEM 3 – Module Pluridisciplinaire n° 13<br />
Ophtalmologie<br />
9
Faculté de Médecine de Marseille<br />
• L’efficacité <strong>et</strong> la surveillance du traitement se feront sur les trois éléments du<br />
diagnostique positif à savoir :<br />
o la surveillance de la PIO <strong>et</strong> sa baisse (idéalement inférieure à 14mmHg, mais<br />
tolérable jusqu'à 20mmHg selon l’évolutivité des deux autres paramètres à<br />
surveiller),<br />
o l’évolutivité du champ visuel <strong>et</strong> des scotomes r<strong>et</strong>rouvés : toute altération<br />
significative du champ visuel devra engendrer une attitude thérapeutique plus<br />
« agressive »,<br />
o l’examen des papilles optiques <strong>et</strong> de la cotation du C/D. De plus l’apparition<br />
d’une hémorragie sur le bord papillaire signe une évolutivité de la maladie <strong>et</strong><br />
devra entraîner une surveillance accrue <strong>et</strong> une augmentation éventuelle du<br />
traitement,<br />
o le rythme de surveillance devra être semestriel, une fois un équilibre pressionnel<br />
satisfaisant atteint, pour les examens de la PIO <strong>et</strong> de la papille optique (ne devant<br />
en aucun cas prendre comme référence l’acuité visuelle), <strong>et</strong> annuel pour l’examen<br />
du champ visuel.<br />
DCEM 3 – Module Pluridisciplinaire n° 13<br />
Ophtalmologie<br />
10