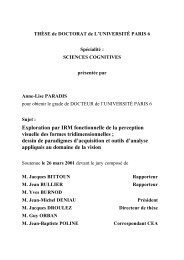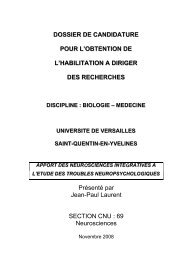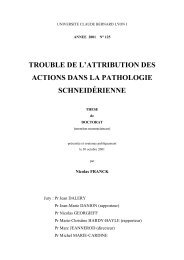Comprendre le fonctionnement de simulations sociales ... - Risc
Comprendre le fonctionnement de simulations sociales ... - Risc
Comprendre le fonctionnement de simulations sociales ... - Risc
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
l’individu comme <strong>le</strong> résultat d’une fonction h i - la fonction d’utilité - qui lui permet d’évaluer <strong>le</strong>s choix qui se<br />
présentent à lui. Ainsi l’individu parfaitement rationnel (hypothèse que prennent Von Neumann, Morgenstern et<br />
Savage) ayant à réaliser un choix (à prendre une décision), optera pour <strong>le</strong> choix qui va maximiser son utilité. Des<br />
versions dans <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s l’individu cherche à optimiser sa stratégie existent éga<strong>le</strong>ment, comme nous l’avons vu,<br />
dans <strong>le</strong> cadre classique du di<strong>le</strong>mme du prisonnier et <strong>de</strong> ses nombreuses variantes (Axelrod, 1992 ; Beaufils,<br />
2000 ; Mathieu et al., 2000).<br />
Un élément important <strong>de</strong>s modè<strong>le</strong>s qui est souvent pris en compte dans la fonction d’utilité concerne <strong>le</strong><br />
fait que l’individu ait une mémoire (tota<strong>le</strong> ou partiel<strong>le</strong>) <strong>de</strong> ses états précé<strong>de</strong>nts. L’individu <strong>de</strong>vient ainsi un<br />
apprenant au regard <strong>de</strong>s résultats <strong>de</strong> ses stratégies précé<strong>de</strong>ntes (Duffy, 2001).<br />
L’influence socia<strong>le</strong> dans ce type <strong>de</strong> modè<strong>le</strong>s est introduite dans la décision par la prise en compte d’une<br />
part <strong>de</strong>s actions passées <strong>de</strong>s autres joueurs et d’autre part dans certains modè<strong>le</strong>s par l’évaluation <strong>de</strong>s actions<br />
possib<strong>le</strong>s <strong>de</strong>s autres joueurs, intégrée au mécanisme <strong>de</strong> décision individuel<strong>le</strong>.<br />
2.2.2.4.2 Le déci<strong>de</strong>ur parieur<br />
L’hypothèse du déci<strong>de</strong>ur idéal a cependant sou<strong>le</strong>vé <strong>de</strong> grosses objections, l’homme ne réalisant pas<br />
toujours <strong>le</strong>s choix optimaux. Parmi <strong>le</strong>s tentatives pour corriger cette théorie, l’hypothèse du déci<strong>de</strong>ur parieur<br />
(Edwards, 1954) propose que l’individu réalise, outre une maximisation <strong>de</strong> sa fonction d’utilité, une évaluation<br />
<strong>de</strong>s probabilités associées à tout ou partie <strong>de</strong>s éléments extérieurs. Il ne peut donc plus évaluer sa fonction<br />
d’utilité <strong>de</strong> manière parfaite, mais <strong>de</strong> manière probabiliste. Le mécanisme <strong>de</strong> décision ne correspond donc plus à<br />
une maximisation <strong>de</strong> l’utilité, mais à une maximisation <strong>de</strong> l’espérance associée à cette utilité. Un exemp<strong>le</strong> en est<br />
la décision d’acheter ou pas un ticket <strong>de</strong> loto, en prenant en compte la probabilité d’avoir un bil<strong>le</strong>t gagnant.<br />
L’introduction <strong>de</strong> l’influence socia<strong>le</strong> dans ce cadre est éga<strong>le</strong>ment fréquemment probabiliste ; <strong>le</strong> joueur peut<br />
associer <strong>de</strong>s probabilités aux comportements <strong>de</strong>s autres joueurs.<br />
Outre <strong>le</strong> cadre théorique du déci<strong>de</strong>ur parieur introduit par Ward Edwards (1954), l’aléatoire peut<br />
éga<strong>le</strong>ment apparaître, dans <strong>le</strong> cadre <strong>de</strong>s modè<strong>le</strong>s <strong>de</strong> l’influence socia<strong>le</strong>, dans la mise à jour <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> l’individu,<br />
soit pour la résolution <strong>de</strong> conflits (la moitié <strong>de</strong> mes voisins pense A, l’autre moitié pense B, je choisis donc<br />
aléatoirement A ou B), soit directement dans la dynamique (je choisis A avec une probabilité éga<strong>le</strong> à la<br />
proportion <strong>de</strong> mon voisinage qui est A). Schweitzer et Holyst (2000) proposent <strong>de</strong> plus, un modè<strong>le</strong> brownien <strong>de</strong><br />
la dynamique <strong>de</strong>s opinions qui introduit une composante aléatoire forte au sein du modè<strong>le</strong> <strong>de</strong> simulation. De<br />
même Nigel Gilbert (1997) dans un modè<strong>le</strong> <strong>de</strong> dynamique <strong>de</strong> l’Académie <strong>de</strong>s sciences choisit <strong>le</strong>s directions <strong>de</strong><br />
l’extension du champ scientifique (qui correspond au choix d’un thème <strong>de</strong> recherche par <strong>le</strong>s « individuschercheurs<br />
» dans ce modè<strong>le</strong>) en partie <strong>de</strong> manière aléatoire.<br />
L’inclusion <strong>de</strong> la perception subjective <strong>de</strong> ces probabilités dans la fonction <strong>de</strong> décision donnera<br />
naissance un peu plus tard à la théorie du prospect (Prospect Theory ou Cumulative Prospect Theory) <strong>de</strong><br />
Tversky et Kahneman (1981 ; 1992). L’idée principa<strong>le</strong> est que l’individu n’évalue pas <strong>le</strong>s probabilités <strong>de</strong> gain <strong>de</strong><br />
manière objective. Des éléments subjectifs participent à la décision et doivent donc être pris en compte. Par<br />
exemp<strong>le</strong>, la différence <strong>de</strong> va<strong>le</strong>ur entre 0 et 10 euros est interprétée subjectivement par l’individu comme étant<br />
plus importante que cel<strong>le</strong> entre 50 et 60 euros. Ainsi, dans <strong>le</strong> cadre <strong>de</strong> la Prospect Theory, l’individu possè<strong>de</strong> une<br />
fonction pour <strong>le</strong>s va<strong>le</strong>urs <strong>de</strong>s utilités et une fonction pour <strong>le</strong>s probabilités subjectives associées, la décision<br />
correspond alors à un couplage <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux fonctions.<br />
23