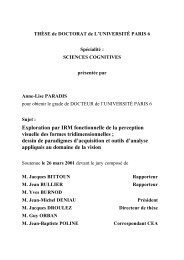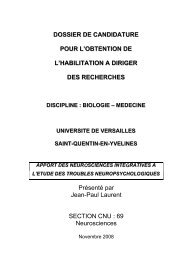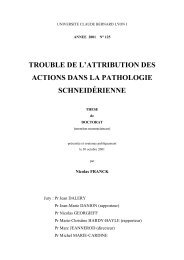Comprendre le fonctionnement de simulations sociales ... - Risc
Comprendre le fonctionnement de simulations sociales ... - Risc
Comprendre le fonctionnement de simulations sociales ... - Risc
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Figure 2-7 : Voisinage <strong>de</strong> Von Neumann (gauche) et <strong>de</strong> Moore (droite) sur un automate cellulaire<br />
Flache et Hegselmann (2001) ont ainsi testé <strong>le</strong>ur modè<strong>le</strong> sur différentes structures <strong>de</strong> ce type ainsi que<br />
sur <strong>de</strong>s structures hexagona<strong>le</strong>s ou <strong>de</strong>s gril<strong>le</strong>s irrégulières déterminées à partir d’un diagramme <strong>de</strong> Voronoi (cf.<br />
Figure 2.8), ce <strong>de</strong>rnier étant équiva<strong>le</strong>nt au choix <strong>de</strong> plus proches voisins pour une certaine distance.<br />
Figure 2-8 : Structure d’interactions déterminée à partir d’un diagramme <strong>de</strong> Voronoi.<br />
Le modè<strong>le</strong> p1 (Holland et Leinhardt, 1981) se situe dans <strong>le</strong> cadre <strong>de</strong> la reconstruction d’un espace social<br />
un peu particulier puisque <strong>le</strong>s attributs <strong>de</strong> l’individu (sa localisation dans cet espace) concernent l’espace. Ces<br />
attributs sont la tendance <strong>de</strong> l’individu à créer <strong>de</strong>s relations avec d’autres individus, à être choisi par d’autres, à<br />
faire <strong>de</strong>s choix mutuels et la tendance moyenne à interagir avec <strong>le</strong>s autres. La probabilité d’existence d’une<br />
relation donnée dépend alors <strong>de</strong> la va<strong>le</strong>ur <strong>de</strong>s attributs <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux individus en jeu.<br />
Les modè<strong>le</strong>s <strong>de</strong> variance <strong>de</strong> <strong>de</strong>gré, quant à eux, dérivent en partie du travail <strong>de</strong> Blau (1967) sur la<br />
théorie <strong>de</strong> l’échange. Ces modè<strong>le</strong>s supposent que <strong>le</strong>s nœuds ou <strong>le</strong>s individus ont <strong>de</strong>s probabilités intrinsèques<br />
différentes <strong>de</strong> créer <strong>de</strong>s liens. Les nœuds qui possè<strong>de</strong>nt un <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> centralité é<strong>le</strong>vé ont tendance à attirer <strong>de</strong><br />
nombreux liens, alors que ceux qui ont un <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> centralité plus faib<strong>le</strong> en attirent moins, comme c’est <strong>le</strong> cas<br />
pour <strong>le</strong>s réseaux à invariance d’échel<strong>le</strong> (Barabasi et Albert, 1999). Les effets caractéristiques <strong>de</strong> polarisation ou<br />
<strong>de</strong> balkanisation décou<strong>le</strong>nt éga<strong>le</strong>ment <strong>de</strong> la notion <strong>de</strong> pouvoir et peuvent être vus comme <strong>de</strong>s variations du<br />
modè<strong>le</strong> <strong>de</strong> variance <strong>de</strong> <strong>de</strong>gré. La polarisation intervient ainsi lorsque la population se sépare en <strong>de</strong>ux groupes,<br />
chacun étant centré sur un nœud spécifique. La balkanisation, quant à el<strong>le</strong>, intervient lorsque la société se scin<strong>de</strong><br />
en un grand nombre <strong>de</strong> groupes, chacun regroupé autour d’un nœud particulier.<br />
27