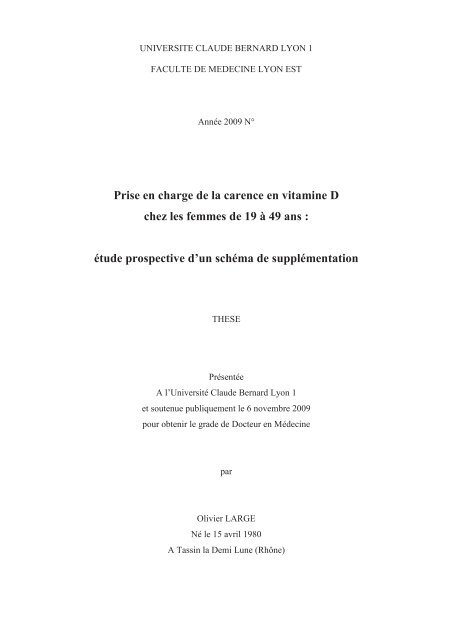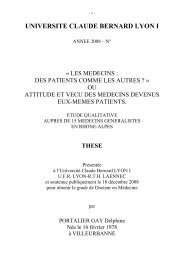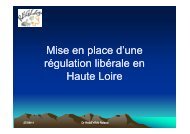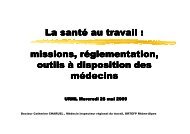Consultez la thèse - L'Union Régionale des Professionnels de santé ...
Consultez la thèse - L'Union Régionale des Professionnels de santé ...
Consultez la thèse - L'Union Régionale des Professionnels de santé ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1<br />
FACULTE DE MEDECINE LYON EST<br />
Année 2009 N°<br />
Prise en charge <strong>de</strong> <strong>la</strong> carence en vitamine D<br />
chez les femmes <strong>de</strong> 19 à 49 ans :<br />
étu<strong>de</strong> prospective d’un schéma <strong>de</strong> supplémentation<br />
THESE<br />
Présentée<br />
A l’Université C<strong>la</strong>u<strong>de</strong> Bernard Lyon 1<br />
et soutenue publiquement le 6 novembre 2009<br />
pour obtenir le gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> Docteur en Mé<strong>de</strong>cine<br />
par<br />
Olivier LARGE<br />
Né le 15 avril 1980<br />
A Tassin <strong>la</strong> Demi Lune (Rhône)
SERMENT D’HIPPOCRATE<br />
« Au moment d’être admis à exercer <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine, je promets et je jure d’être fidèle<br />
aux lois <strong>de</strong> l’honneur et <strong>de</strong> <strong>la</strong> probité.<br />
Mon premier souci sera <strong>de</strong> rétablir, <strong>de</strong> préserver ou <strong>de</strong> promouvoir <strong>la</strong> santé dans tous<br />
ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.<br />
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune<br />
discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles<br />
sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité.<br />
Même sous <strong>la</strong> contrainte, je ne ferai pas usage <strong>de</strong> mes connaissances contre les lois <strong>de</strong><br />
l’humanité.<br />
J’informerai les patients <strong><strong>de</strong>s</strong> décisions envisagées, <strong>de</strong> leurs raisons et <strong>de</strong> leurs<br />
conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
circonstances pour forcer les consciences.<br />
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ra. Je ne me <strong>la</strong>isserai<br />
pas influencer par <strong>la</strong> soif du gain ou <strong>la</strong> recherche <strong>de</strong> <strong>la</strong> gloire.<br />
Admis dans l’intimité <strong><strong>de</strong>s</strong> personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à<br />
l’intérieur <strong><strong>de</strong>s</strong> maisons, je respecterai les secrets <strong><strong>de</strong>s</strong> foyers et ma conduite ne servira pas à<br />
corrompre les mœurs.<br />
Je ferai tout pour sou<strong>la</strong>ger les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les<br />
agonies. Je ne provoquerai jamais <strong>la</strong> mort délibérément.<br />
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement <strong>de</strong> ma mission. Je<br />
n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai<br />
pour assurer au mieux les services qui me seront <strong>de</strong>mandés.<br />
J’apporterai mon ai<strong>de</strong> à mes confrères ainsi qu’à leur famille dans l’adversité.<br />
Que les hommes et mes confrères m’accor<strong>de</strong>nt leur estime si je suis fidèle à mes<br />
promesses ; que je sois déshonoré et méprisé si j’y manque ».
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD – LYON 1<br />
___________________<br />
. Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l'Université Lionel COLLET<br />
. Prési<strong>de</strong>nt du Comité <strong>de</strong> Coordination <strong><strong>de</strong>s</strong> Etu<strong><strong>de</strong>s</strong> Médicales François-Noël GILLY<br />
. Secrétaire Général Gilles GAY<br />
SECTEUR SANTE<br />
UFR DE MEDECINE LYON EST<br />
UFR DE MEDECINE LYONSUD – CHARLES MERIEUX<br />
INSTITUT DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES<br />
ET BIOLOGIQUES (ISPB)<br />
UFR D'ODONTOLOGIE<br />
INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE<br />
READAPTATION<br />
DEPARTEMENT DE FORMATION ET CENTRE<br />
DE RECHERCHE EN BIOLOGIE HUMAINE<br />
Directeur : Jérôme ETIENNE<br />
Directeur : François-Noël GILLY<br />
Directeur : François LOCHER<br />
Directeur : Denis BOURGEOIS<br />
Directeur : Yves MATILLON<br />
Directeur : Pierre FARGE<br />
SECTEUR SCIENCES ET TECHNOLOGIES<br />
UFR DE SCIENCES ET TECHNOLOGIES<br />
UFR DE SCIENCES ET TECHNIQUES DES<br />
ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (STAPS)<br />
INSTITUT DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES<br />
DE L'INGENIEUR DE LYON (ISTIL)<br />
Directeur : François GIERES<br />
Directeur : C<strong>la</strong>u<strong>de</strong> COLLIGNON<br />
Directeur : Joseph LIETO<br />
I.U.T. A<br />
I.U.T. B<br />
INSTITUT DES SCIENCES FINANCIERES<br />
ET ASSURANCES (ISFA)<br />
I.U.F.M.<br />
CPE<br />
Directeur : Christian COULET<br />
Directeur : Roger LAMARTINE<br />
Directeur : Jean-C<strong>la</strong>u<strong>de</strong> AUGROS<br />
Directeur : Régis BERNARD<br />
Directeur : Gérard PIGNAULT<br />
2
Faculté <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine Lyon Est C<strong>la</strong>u<strong>de</strong> Bernard<br />
Liste <strong><strong>de</strong>s</strong> Enseignants<br />
Professeurs <strong><strong>de</strong>s</strong> Universités – Praticiens Hospitaliers<br />
C<strong>la</strong>sse exceptionnelle<br />
Baulieux Jacques Chirurgie générale (surnombre)<br />
Chayvialle Jean-A<strong>la</strong>in Gastroentérologie - hépatologie<br />
Confavreux Christian Neurologie<br />
Cordier Jean-François Pneumologie<br />
Etienne Jérôme Bactériologie-virologie – hygiène hospitalière<br />
Floret Daniel Pédiatrie<br />
Froment Jean-C<strong>la</strong>u<strong>de</strong> Radiologie et imagerie médicale<br />
Guérin Jean-François Biologie et mé<strong>de</strong>cine du développement et <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
reproduction ; gynécologie médicale<br />
Mauguière François Neurologie<br />
Partensky Christian Chirurgie digestive (surnombre)<br />
Petit Paul Anesthésiologie et réanimation chirurgicale ; mé<strong>de</strong>cine<br />
d’urgence (surnombre)<br />
Peyramond Dominique Ma<strong>la</strong>dies infectieuses – ma<strong>la</strong>dies tropicales<br />
Philip Thierry Cancérologie-radiothérapie<br />
Raudrant Daniel Gynécologie<br />
Robert Dominique Réanimation médicale ; mé<strong>de</strong>cine d’urgence (surnombre)<br />
Rousset Bernard Biologie cellu<strong>la</strong>ire<br />
Rudigoz René-Charles Gynécologie<br />
Sindou Marc Neurochirurgie<br />
Tissot Etienne Chirurgie générale<br />
Trepo Christian Gastroentérologie - hépatologie<br />
Professeurs <strong><strong>de</strong>s</strong> Universités – Praticiens Hospitaliers<br />
Première c<strong>la</strong>sse<br />
André-Fouet Xavier Cardiologie<br />
Bastien Olivier Anesthésiologie et réanimation chirurgicale ; mé<strong>de</strong>cine<br />
d’urgence<br />
Baverel Gabriel Physiologie<br />
Beaune Jacques Cardiologie (surnombre)<br />
Béjui-Hugues Jacques Chirurgie orthopédique et traumatologique<br />
Bérard Jérôme Chirurgie infantile<br />
Beziat Jean-Luc Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie<br />
B<strong>la</strong>y Jean-Yves Cancérologie-radiothérapie<br />
Boillot Olivier Chirurgie digestive<br />
Boisson Dominique Mé<strong>de</strong>cine physique et <strong>de</strong> réadaptation (surnombre)<br />
Borson-Chazot Françoise Endocrinologie, diabète et ma<strong>la</strong>dies métaboliques ;<br />
gynécologie médicale<br />
Boulez Jean Chirurgie générale<br />
Bozio André Cardiologie<br />
Chassard Dominique Anesthésiologie et réanimation chirurgicale ; mé<strong>de</strong>cine<br />
d’urgence<br />
Chate<strong>la</strong>in Pierre Pédiatrie<br />
C<strong>la</strong>ris Olivier Pédiatrie<br />
Cochat Pierre Pédiatrie<br />
Colin Cyrille Epidémiologie, économie <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé et prévention<br />
3
Daligand Liliane Mé<strong>de</strong>cine légale et droit <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé (surnombre)<br />
D'Amato Thierry Psychiatrie d’adultes<br />
De<strong>la</strong>haye François Cardiologie<br />
Denis Philippe Ophtalmologie<br />
Derumeaux Geneviève Physiologie<br />
Disant Francois Oto-rhino-<strong>la</strong>ryngologie<br />
Douek Philippe Radiologie et imagerie médicale<br />
Ducerf Christian Chirurgie digestive<br />
Durieu Isabelle Mé<strong>de</strong>cine interne – gériatrie et biologie du vieillissement<br />
Finet Gérard Cardiologie<br />
Fouque Denis Néphrologie<br />
Gaucherand Pascal Gynécologie<br />
Gouil<strong>la</strong>t Christian Chirurgie digestive<br />
Guérin C<strong>la</strong>u<strong>de</strong> Réanimation médicale ; mé<strong>de</strong>cine d’urgence<br />
Honnorat Jérôme Neurologie<br />
Itti Ro<strong>la</strong>nd Biophysique et mé<strong>de</strong>cine nucléaire (surnombre)<br />
Jega<strong>de</strong>n Olivier Chirurgie thoracique et cardio-vascu<strong>la</strong>ire<br />
Kohler Rémy Chirurgie infantile<br />
Laville Maurice Thérapeutique ; mé<strong>de</strong>cine d’urgence<br />
Lehot Jean-Jacques Anesthésiologie et réanimation chirurgicale ; mé<strong>de</strong>cine<br />
d’urgence<br />
Leriche Albert Urologie<br />
Lermusiaux Patrick Chirurgie thoracique et cardio-vascu<strong>la</strong>ire<br />
Lina Bruno Bactériologie-virologie – hygiène hospitalière<br />
Lyonnet Denis Radiologie et imagerie médicale<br />
Madjar Jean-Jacques Biologie cellu<strong>la</strong>ire<br />
Martin Ambroise Nutrition<br />
Martin Xavier Urologie<br />
Mellier Georges Gynécologie<br />
Mertens Patrick Anatomie<br />
Mion François Physiologie<br />
Miossec Pierre Immunologie<br />
Morel Yves Biochimie et biologie molécu<strong>la</strong>ire<br />
Mornex Jean-François Pneumologie<br />
Moulin Philippe Nutrition<br />
Neyret Philippe Chirurgie orthopédique et traumatologique<br />
Nighoghossian Norbert Neurologie<br />
Ninet Jean Chirurgie thoracique et cardio-vascu<strong>la</strong>ire<br />
Ninet Jacques Mé<strong>de</strong>cine interne – gériatrie et biologie du vieillissement<br />
Obadia Jean-François Chirurgie thoracique et cardio-vascu<strong>la</strong>ire<br />
Ovize Michel Physiologie<br />
Perrin Gilles Neurochirurgie<br />
Ponchon Thierry Gastroentérologie - hépatologie<br />
Pugeat Michel Endocrinologie, diabète et ma<strong>la</strong>dies métaboliques ;<br />
gynécologie médicale<br />
Revel Didier Radiologie et imagerie médicale<br />
Rivoire Michel Cancérologie-radiothérapie<br />
Ro<strong>de</strong> Gilles Mé<strong>de</strong>cine physique et <strong>de</strong> réadaptation<br />
Rousson Robert-Marc Biochimie et biologie molécu<strong>la</strong>ire<br />
Scoazec Jean-Yves Anatomie et cytologie pathologiques<br />
Terra Jean-Louis Psychiatrie d’adultes<br />
Thivolet-Bejui Françoise Anatomie et cytologie pathologiques<br />
Thomas Gilles Génétique<br />
Touraine Jean-Louis Néphrologie<br />
4
Trouil<strong>la</strong>s Paul Neurologie<br />
Truy Eric Oto-rhino-<strong>la</strong>ryngologie<br />
Vallée Bernard Anatomie<br />
Van<strong>de</strong>nesch François Bactériologie-virologie – hygiène hospitalière<br />
Vanhems Philippe Epidémiologie, économie <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé et prévention<br />
Viale Jean-Paul Anesthésiologie et réanimation chirurgicale ; mé<strong>de</strong>cine<br />
d’urgence<br />
Zoulim Fabien Gastroentérologie - hépatologie<br />
Professeurs <strong><strong>de</strong>s</strong> Universités – Praticiens Hospitaliers<br />
Secon<strong>de</strong> C<strong>la</strong>sse<br />
Al<strong>la</strong>ouchiche Bernard Anesthésiologie et réanimation chirurgicale ; mé<strong>de</strong>cine<br />
d’urgence<br />
Argaud Laurent Réanimation médicale ; mé<strong>de</strong>cine d’urgence<br />
Ba<strong>de</strong>t Lionel Urologie<br />
Barth Xavier Chirurgie générale<br />
Berthezene Yves Radiologie et imagerie médicale<br />
Bertrand Yves Pédiatrie<br />
Braye Fabienne Chirurgie p<strong>la</strong>stique, reconstructice et esthétique - brûlologie<br />
Breton Pierre Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie<br />
Calen<strong>de</strong>r A<strong>la</strong>in Génétique<br />
Chapet Olivier Cancérologie-radiothérapie<br />
Chapur<strong>la</strong>t Ro<strong>la</strong>nd Rhumatologie<br />
Chevalier Philippe Cardiologie<br />
Chotel Franck Chirurgie infantile<br />
Colombel Marc Urologie<br />
Cottin Vincent Pneumologie<br />
Cotton François Anatomie<br />
Descotes Jacques Pharmacologie fondamentale – pharmacologie clinique<br />
Devouassoux Mojgan Anatomie et cytologie pathologiques<br />
Di Filippo Sylvie Cardiologie<br />
Dumontet Charles Hématologie-transfusion<br />
Dumortier Jérôme Gastroentérologie - hépatologie<br />
E<strong>de</strong>ry Charles Génétique<br />
Elchardus Jean-Marc Mé<strong>de</strong>cine légale et droit <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé<br />
Faure Michel Dermato-vénéréologie<br />
Fauvel Jean-Pierre Thérapeutique ; mé<strong>de</strong>cine d’urgence<br />
Fourneret Pierre Pédopsychiatrie<br />
Froehlich Patrick Oto-rhino-<strong>la</strong>ryngoloie<br />
Guenot Marc Neurochirurgie<br />
Gueyffier Francois Pharmacologie fondamentale – pharmacologie clinique<br />
Guibaud Laurent Radiologie et imagerie médicale<br />
Guyen Olivier Chirurgie orthopédique et traumatologique<br />
Herzberg Guil<strong>la</strong>ume Chirurgie orthopédique et traumatologique<br />
Janier Marc Biophysique et mé<strong>de</strong>cine nucé<strong>la</strong>ire<br />
Jullien Denis Dermato-vénéréologie<br />
Kodjikian Laurent Ophtalmologie<br />
Kro<strong>la</strong>k Salmon Pierre Mé<strong>de</strong>cine interne – gériatrie et biologie du vieillissement<br />
Lachaux A<strong>la</strong>in Pédiatrie<br />
5
Lejeune Hervé Biologie et mé<strong>de</strong>cine du développement et <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
reproduction ; gynécologie médicale<br />
Lina Gérard Bactériologie-virologie – hygiène hospitalière<br />
Mabrut Jean Yves Chirurgie générale<br />
Mathevet Patrice Gynécologie<br />
Merle Philippe Gastroentérologie - hépatologie<br />
Michallet Mauricette Hématologie<br />
Monneuse Olivier Chirurgie générale<br />
Morelon Emmanuel Néphrologie<br />
Mure Pierre Yves Chirurgie infantile<br />
Négrier C<strong>la</strong>u<strong>de</strong> Hématologie<br />
Négrier Marie-Sylvie Cancérologie-radiothérapie<br />
Nicolino Marc Pédiatrie<br />
Picot Stephane Parasitologie et mycologie<br />
Pignat Jean-Christian Oto-rhino-<strong>la</strong>ryngologie<br />
Rossetti Yves Physiologie<br />
Rouvière Olivier Radiologie et imagerie médicale<br />
Roy Pascal Biostatistiques, informatique médicale et technologies <strong>de</strong><br />
communication<br />
Ruffion A<strong>la</strong>in Urologie<br />
Ryvlin Philippe Neurologie<br />
Scheiber Christian Biophysique et mé<strong>de</strong>cine nucléaire<br />
Schott Anne Marie Epidémiologie<br />
Souquet Jean-Christophe Gastroentérologie - hépatologie<br />
Tilikete Caroline Physiologie<br />
Trouil<strong>la</strong>s Jacqueline Cytologie et histologie<br />
Turjman Francis Radiologie et imagerie médicale<br />
Wattel Eric Hématologie-transfusion<br />
Maîtres <strong>de</strong> Conférence – Praticiens Hospitaliers<br />
Hors c<strong>la</strong>sse<br />
Bouvier Raymon<strong>de</strong> Anatomie et cytologie pathologiques<br />
Bui-Xuan Bernard Anesthésiologie et réanimation chirurgicale ; mé<strong>de</strong>cine<br />
d’urgence<br />
Cetre Jean-Charles Epidémiologie, économie <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé et prévention<br />
Davezies Philippe Mé<strong>de</strong>cine et santé au travail<br />
Frappart Lucien Anatomie et cytologie pathologiques<br />
Germain-Pastène Michèle Physiologie<br />
Hadj-Aissa Aoumeur Physiologie<br />
Jouvet Anne Anatomie et cytologie pathologiques<br />
Le Bars Didier Biophysique et mé<strong>de</strong>cine nucléaire<br />
Lièvre Michel Pharmacologie fondamentale – pharmacologie clinique<br />
Pharaboz-Joly Marie-Odile Biochimie et biologie molécu<strong>la</strong>ire<br />
Sabatini Jean Mé<strong>de</strong>cine légale et droit <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé<br />
Timour-Chah Quadiri Pharmacologie fondamentale – pharmacologie clinique<br />
6
Maîtres <strong>de</strong> Conférence – Praticiens Hospitaliers<br />
Première c<strong>la</strong>sse<br />
A<strong>de</strong>r Florence Ma<strong>la</strong>dies infectieuses – ma<strong>la</strong>dies tropicales<br />
Barnoud<br />
Raphaelle<br />
Benchaib<br />
Mehdi<br />
Billotey C<strong>la</strong>ire Biophysique et mé<strong>de</strong>cine nucléaire<br />
Bontemps Laurence Biophysique et mé<strong>de</strong>cine nucléaire<br />
Bricca Giampiero Pharmacologie fondamentale – pharmacologie clinique<br />
Bringuier Pierre-Paul Cytologie et histologie<br />
Cha<strong>la</strong>breysse Lara Anatomie et cytologie pathologiques<br />
Cellier Colette Anatomie et cytologie pathologiques<br />
Chevallier-Queyron Philippe Epidémiologie, économie <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé et prévention<br />
Cozon Gregoire Immunologie<br />
Croisille Pierre Radiologie et imagerie médicale<br />
Dubourg Laurence Physiologie<br />
Francina A<strong>la</strong>in Biochimie et biologie molécu<strong>la</strong>ire<br />
Franco-Gillioen Patricia Physiologie<br />
Genot A<strong>la</strong>in Biochimie et biologie molécu<strong>la</strong>ire<br />
Gonzalo Philippe Biochimie et biologie molécu<strong>la</strong>ire<br />
Hervieu Valerie Anatomie et cytologie pathologiques<br />
Jarraud Sophie Bactériologie-virologie – hygiène hospitalière<br />
Kolopp-Sarda Marie Nathalie Immunologie<br />
Lasset Christine Epidémiologie, économie <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé et prévention<br />
Laurent Fre<strong>de</strong>ric Bactériologie-virologie – hygiène hospitalière<br />
Lesca Gaetan Génétique<br />
Meyronet David Anatomie et cytologie pathologiques<br />
Nataf Serge Cytologie et histologie<br />
Normand Jean-C<strong>la</strong>u<strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine et santé au travail<br />
Peretti Noel Nutrition<br />
Persat Florence Parasitologie et mycologie<br />
Piaton Eric Cytologie et histologie<br />
Pondarre Corinne Pédiatrie<br />
Rabilloud Muriel Biostatistiques, informatique médicale et technologies <strong>de</strong><br />
communication<br />
Rigal Dominique Hématologie-transfusion<br />
Ritouet Danielle Hématologie-transfusion<br />
Ritter Jacques Epidémiologie, économie <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé et prévention<br />
San<strong>la</strong>ville Damien Génétique<br />
Saoud Mohamed Psychiatrie d’adultes<br />
Sappey-Marinier Dominique Biophysique et mé<strong>de</strong>cine nucé<strong>la</strong>ire<br />
Streichenberger Nathalie Anatomie et cytologie pathologiques<br />
Tardy-Guidollet Veronique Biochimie et biologie molécu<strong>la</strong>ire<br />
Voiglio Eric Anatomie<br />
Wallon Martine Parasitologie et mycologie<br />
7
Maîtres <strong>de</strong> Conférence – Praticiens Hospitaliers<br />
Secon<strong>de</strong> c<strong>la</strong>sse<br />
Charbotel Barbara Mé<strong>de</strong>cine et santé au travail<br />
Col<strong>la</strong>r<strong>de</strong>au Frachon Sophie Anatomie et cytologie pathologiques<br />
Conquère <strong>de</strong> Monbrison Frédérique Parasitologie et mycologie<br />
Dargaud Yesim Hématologie-transfusion<br />
Doret Muriel Gynécologie<br />
Raverot Gérald Endocrinologie, diabète et ma<strong>la</strong>dies métaboliques ;<br />
gynécologie médicale<br />
Richard Jean Christophe Réanimation médicale ; mé<strong>de</strong>cine d’urgence<br />
Roman Sabine Physiologie<br />
Tristan Anne Bactériologie-virologie – hygiène hospitalière<br />
V<strong>la</strong>eminck-Guillem Virginie Biochimie et biologie molécu<strong>la</strong>ire<br />
Maîtres <strong>de</strong> Conférence – Praticiens Hospitaliers<br />
Secon<strong>de</strong> c<strong>la</strong>sse - Stagiaires<br />
Escuret Vanessa Bactériologie-virologie – hygiène hospitalière<br />
Maucort Boulch Delphine Biostatistiques, informatique médicale et technologies <strong>de</strong><br />
communication<br />
Professeurs associés <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine Générale<br />
Le Gouaziou<br />
Moreau<br />
Souweine<br />
Marie France<br />
A<strong>la</strong>in<br />
Gilbert<br />
Maîtres <strong>de</strong> Conférence associés <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine Générale<br />
Flori<br />
Laine<br />
Zerbib<br />
Marie<br />
Xavier<br />
Yves<br />
8
REMERCIEMENTS<br />
A notre Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> Jury,<br />
Monsieur le Professeur Ambroise MARTIN<br />
Pour l’honneur que vous me faites en acceptant <strong>de</strong> prési<strong>de</strong>r ce jury <strong>de</strong> thèse.<br />
Je vous remercie <strong>de</strong> l’intérêt que vous portez à mon travail concernant <strong>la</strong> vitamine D.<br />
J’ai bénéficié <strong>de</strong> votre pédagogie et <strong>de</strong> votre disponibilité dès les premières années <strong>de</strong> mes<br />
étu<strong><strong>de</strong>s</strong>.<br />
Veuillez accepter le témoignage <strong>de</strong> mon profond respect.<br />
A notre Directeur <strong>de</strong> Thèse,<br />
Madame le Professeur Marie-France LE GOAZIOU<br />
Vous avez accepté <strong>de</strong> me confier ce sujet.<br />
Vos suggestions et votre réactivité ont guidé <strong>la</strong> rédaction <strong>de</strong> ce travail.<br />
Soyez assuré <strong>de</strong> mon admiration et <strong>de</strong> mon respect pour votre dévouement pour <strong>la</strong> Mé<strong>de</strong>cine<br />
Générale.<br />
Aux Membres du jury,<br />
Madame le Professeur Anne-Marie SCHOTT<br />
Vous me faites l’honneur <strong>de</strong> juger ce travail.<br />
Je vous remercie <strong>de</strong> vos conseils et <strong>de</strong> votre ai<strong>de</strong> pour l’analyse statistique.<br />
Monsieur le Docteur Christian DUPRAZ<br />
Je vous remercie d’avoir participé à ce travail puis <strong>de</strong> l’avoir jugé.<br />
Soyez assuré <strong>de</strong> toute mon estime.<br />
9
Aux mé<strong>de</strong>cins généralistes qui ont participé à cette étu<strong>de</strong><br />
Madame le Docteur Sylviane BIOT-LAPORTE,<br />
Madame le Docteur Michèle BLANC,<br />
Monsieur le Docteur A<strong>la</strong>in CLEMENT,<br />
Madame le Docteur Catherine DEYDIER,<br />
Madame le Docteur Sylvie ERPELDINGER,<br />
Monsieur le Docteur Robert FAUCHE,<br />
Madame le Docteur Sophie FIGON,<br />
Monsieur le Docteur A<strong>la</strong>in MOREAU,<br />
Madame le Docteur Cécile MORIN,<br />
Madame le Docteur Corinne PERDRIX,<br />
Merci pour votre participation à ce travail, malgré mes sollicitations j’ai toujours été bien<br />
accueilli dans vos cabinets.<br />
A Madame Bénédicte GELAS-DORE<br />
Merci pour votre ai<strong>de</strong>, grâce à vous les biostatistiques m’ont paru plus simples.<br />
A Gaëlle CONTARDO<br />
Pour ton ai<strong>de</strong> et tes explications qui m’ont permis d’abor<strong>de</strong>r au mieux ce sujet.<br />
A mes maîtres <strong>de</strong> stage,<br />
Monsieur le Docteur Philippe BERNARD et Monsieur le Docteur Jean-Noël REYBERT,<br />
vous avez été le terrain <strong>de</strong> rencontre avec <strong>la</strong> Mé<strong>de</strong>cine Générale.<br />
Madame le Docteur Sophie FIGON et Monsieur le Docteur Vincent DE LA SALLE, vous<br />
m’avez donné le sens <strong>de</strong> <strong>la</strong> rigueur et <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche.<br />
Monsieur le Docteur Christian BERLY et Monsieur le Docteur Pierre SAUZET, <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
rurale nécessite <strong><strong>de</strong>s</strong> qualités humaines que vous possé<strong>de</strong>z. Merci également à Roselyne et<br />
Charlotte pour votre accueil au sein <strong>de</strong> votre famille.<br />
Merci pour votre pédagogie et votre patience qui m’ont donné confiance et m’ont permis <strong>de</strong><br />
progresser.<br />
10
A mes parents,<br />
Vous avez toujours été là pour moi. Je n’aurais pas pu réussir sans vous. Comment vous<br />
remercier pour tout ce que vous faites pour Elodie et moi…<br />
A Elodie,<br />
Toi, mon amour…<br />
Ce mois <strong>de</strong> novembre est riche en changements pour notre vie à <strong>de</strong>ux. Nous partageons les<br />
mêmes passions et <strong><strong>de</strong>s</strong> moments inoubliables. Vivement <strong>la</strong> suite !<br />
A mon frère et sa famille canadienne,<br />
Yvan, je t’admire pour ton courage. Ton éloignement géographique et mon manque<br />
d’assiduité à te donner <strong>de</strong> mes nouvelles ne m’empêchent pas <strong>de</strong> penser à toi tous les jours !<br />
Ryoko, tu m’as toujours accueilli à bras ouverts. Merci <strong>de</strong> prendre soin <strong>de</strong> mon frère. J’espère<br />
bientôt découvrir ton pays et ta culture.<br />
Léo, Hugo et Thomas vous êtes présents au fond <strong>de</strong> moi.<br />
A ma Mémée et toute ma famille<br />
oncles et tantes : Michèle et C<strong>la</strong>u<strong>de</strong>, René et Janine, Paul et Geneviève<br />
cousins et cousines : Franky et Patricia, Pascale et Eric, Carole et David, Virginie, Jean,<br />
Audrey, Jordane, Sébastien, Jérémie , Antonin, Fiorel<strong>la</strong>, Maxime, Marion, Virgile, Hélène et<br />
Yves, Christelle et Eric.<br />
Merci pour tous ces bons moments et ces grands repas <strong>de</strong> famille.<br />
A <strong>la</strong> famille Boasis,<br />
Martine et Michel, Marlène et Pierre-Alexandre, Romain<br />
Merci pour l’accueil que vous me réservez au sein <strong>de</strong> votre famille. J’espère ne jamais<br />
décevoir votre confiance.<br />
A <strong>la</strong> famille Col<strong>la</strong>nge, Mr et Mme Coyat, merci pour ces moments conviviaux.<br />
Aux Martins 1 ère , 2 ème et 3 ème générations,<br />
Michèle et Jo, MarieThé et Jacques, Françoise, René, Pierre-Emmanuel et Mé<strong>la</strong>nie,<br />
Guil<strong>la</strong>ume, Jacques et Magali, Pilou, Matthieu et Alexandra,<br />
Hier, c’était le temps <strong><strong>de</strong>s</strong> parties <strong>de</strong> foot dans le garage et <strong><strong>de</strong>s</strong> petites voitures. Aujourd’hui,<br />
c’est le temps <strong><strong>de</strong>s</strong> parties <strong>de</strong> pétanque et <strong><strong>de</strong>s</strong> belles bouteilles…<br />
Aux Brindasiens,<br />
Brice et Myriam, David et Marjo<strong>la</strong>ine, Filipe, Julien et Mé<strong>la</strong>, Pascal, Paulo et Nelly, Philippe,<br />
Ponpon, Romain et Aurélie.<br />
L’indécision nous caractérise parfois mais le p<strong>la</strong>isir <strong>de</strong> nous voir est toujours présent. Que <strong>de</strong><br />
soirées passées dans <strong><strong>de</strong>s</strong> lieux « mythiques » comme le sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> Brindas, le garage <strong>de</strong> Ponpon,<br />
l’ex-grange <strong>de</strong> Pascal, Samoëns ou Bourg St Maurice…<br />
Aux amis <strong>de</strong> <strong>la</strong> fac et à mes co-internes<br />
Pierre et Aurélie, Laurent, Serge et Cécile, Mathil<strong>de</strong> et Mehdi, Hervé et Laure, Cécile,<br />
Clémence, Emilie, Diane, Sabine, Kim, Omid, Aurélien… et tous les autres<br />
L’internat nous éloigne ou nous fait rencontrer <strong>de</strong> nouvelles personnes... Merci pour votre<br />
amitié.<br />
11
TABLES DES MATIERES<br />
INTRODUCTION .................................................................................................................... 15<br />
DONNEES GENERALES ....................................................................................................... 17<br />
A / LA VITAMINE D .......................................................................................................... 17<br />
I / DEFINITION ............................................................................................................... 17<br />
II / METABOLISME ....................................................................................................... 17<br />
a ) Origine ..................................................................................................................... 17<br />
b ) Activation ................................................................................................................ 18<br />
c ) Stockage .................................................................................................................. 19<br />
d ) Catabolisme ............................................................................................................. 19<br />
e ) Régu<strong>la</strong>tion ............................................................................................................... 19<br />
III / ACTION .................................................................................................................... 19<br />
a ) Effets ostéo-muscu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D .............................................................. 20<br />
1 ) Métabolisme phosphocalcique et remo<strong>de</strong><strong>la</strong>ge osseux ........................................ 20<br />
2 ) Métabolisme muscu<strong>la</strong>ire et force muscu<strong>la</strong>ire ..................................................... 21<br />
b ) Effets extra-osseux <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D ...................................................................... 22<br />
1 ) Psoriasis .............................................................................................................. 22<br />
2 ) Cancers ................................................................................................................ 22<br />
3 ) Ma<strong>la</strong>dies Auto-Immunes ..................................................................................... 23<br />
4 ) Pathologies cardiovascu<strong>la</strong>ires ............................................................................. 24<br />
5 ) Autres .................................................................................................................. 24<br />
B / L’HYPOVITAMINOSE D ............................................................................................. 25<br />
I / Définition ..................................................................................................................... 25<br />
II / Prévalence ................................................................................................................... 26<br />
III / Facteurs <strong>de</strong> risque ...................................................................................................... 27<br />
a ) Causes intrinsèques ................................................................................................. 27<br />
1 ) Synthèse cutanée ................................................................................................. 27<br />
2 ) Absorption digestive ........................................................................................... 28<br />
3 ) Activation hépatique ........................................................................................... 28<br />
4 ) Activation rénale ................................................................................................. 28<br />
5 ) Stockage .............................................................................................................. 29<br />
6 ) Catabolisme ......................................................................................................... 29<br />
b ) Causes extrinsèques ................................................................................................ 29<br />
1 ) Géographie .......................................................................................................... 29<br />
2 ) Mo<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong> vie ....................................................................................................... 30<br />
IV / Sémiologie et diagnostics ......................................................................................... 31<br />
a ) Diagnostic clinique .................................................................................................. 31<br />
b ) Diagnostic biologique ............................................................................................. 32<br />
c ) Retard diagnostic ..................................................................................................... 32<br />
V / Besoin nutritionnel ..................................................................................................... 33<br />
a ) Définition ................................................................................................................ 33<br />
b ) Des apports insuffisants .......................................................................................... 33<br />
VI / Traitement ................................................................................................................. 34<br />
a ) Apport <strong>de</strong> <strong>la</strong> synthèse cutanée ................................................................................. 34<br />
b ) Apport pharmacologique <strong>de</strong> vitamine D ................................................................. 35<br />
12
1 ) Vitamine D2 versus vitamine D3 ........................................................................ 35<br />
2 ) Posologie ............................................................................................................. 36<br />
3 ) Dose toxique et effets secondaires ...................................................................... 37<br />
4 ) Association avec le calcium ................................................................................ 38<br />
MATERIEL ET METHODE ................................................................................................... 40<br />
A / JUSTIFICATIF DE L’ETUDE ...................................................................................... 40<br />
B / HYPOTHESE ET OBJECTIFS ..................................................................................... 42<br />
I / Hypothèse .................................................................................................................... 42<br />
II / Objectifs ..................................................................................................................... 42<br />
a ) Principal : ................................................................................................................ 42<br />
b ) Secondaire : ............................................................................................................. 42<br />
C / TYPE D’ETUDE ............................................................................................................ 42<br />
D / POPULATION ETUDIEE ............................................................................................. 43<br />
E / RECUEIL DES DONNEES ........................................................................................... 43<br />
I / Dosage sanguin ............................................................................................................ 43<br />
II / Base <strong>de</strong> données ......................................................................................................... 44<br />
III / Fiche <strong>de</strong> recueil ......................................................................................................... 44<br />
I ......................................................................................................................... 45<br />
F / DEROULEMENT DE L’ETUDE .................................................................................. 45<br />
G / SAISIE ET ANALYSE DES DONNEES ...................................................................... 47<br />
H / RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE ........................................................................... 48<br />
RESULTATS ........................................................................................................................... 49<br />
A / Echantillon initial ........................................................................................................... 49<br />
I / Répartition en fonction <strong>de</strong> facteurs socio-économiques : ............................................ 49<br />
a ) Vêtement couvrant : ................................................................................................ 49<br />
b ) Phototype : .............................................................................................................. 51<br />
c ) CMU : ...................................................................................................................... 51<br />
B / Evolution <strong>de</strong> l’échantillon .............................................................................................. 51<br />
I / Liée à différentes situations <strong>de</strong> mauvaise observance ................................................. 52<br />
a ) Situation liée à l’investigateur ................................................................................. 52<br />
b ) Situation liée aux patientes ..................................................................................... 52<br />
II / Liée à un critère d’exclusion ...................................................................................... 52<br />
III / Liée aux perdues <strong>de</strong> vue ............................................................................................ 52<br />
C / Echantillon final ............................................................................................................. 53<br />
I / Taux <strong>de</strong> participation aux dosages sanguins ................................................................ 53<br />
II / Taux <strong>de</strong> participation au questionnaire final .............................................................. 54<br />
III / Description <strong>de</strong> l’échantillon final .............................................................................. 54<br />
D / Evolution <strong><strong>de</strong>s</strong> critères étudiés ......................................................................................... 55<br />
I / Le taux <strong>de</strong> vitamine D .................................................................................................. 55<br />
II / Le taux <strong>de</strong> PTH ........................................................................................................... 60<br />
III / L’EVA douleur et l’EVA fatigue ............................................................................. 62<br />
IV / La qualité <strong>de</strong> vie et le SF 12 ...................................................................................... 62<br />
E / Evolution en fonction du facteur <strong>de</strong> risque : port d’un vêtement couvrant .................... 63<br />
I / Représentation <strong>de</strong> l’effectif <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes portant un vêtement couvrant .................... 63<br />
II / Evolution du taux <strong>de</strong> vitamine D chez ces patientes à risque ..................................... 64<br />
a ) Avec 53 nmol/l comme valeur seuil ........................................................................ 64<br />
b ) Avec 75 nmol/l comme valeur seuil ....................................................................... 66<br />
III / Nombre moyen d’ampoules consommées................................................................. 69<br />
13
IV / /Evolution <strong>de</strong> l’EVA chez ces patientes à risque ...................................................... 69<br />
V / Evolution du taux <strong>de</strong> PTH chez ces patientes à risque ............................................... 71<br />
F / Evolution en fonction du facteur <strong>de</strong> risque : phototype .................................................. 71<br />
I / Evolution du taux moyen <strong>de</strong> vitamine D en fonction du phototype ............................ 72<br />
G / Evolution en fonction d’un facteur socio-économique : <strong>la</strong> CMU .................................. 73<br />
DISCUSSION .......................................................................................................................... 74<br />
A / LIMITES ........................................................................................................................ 74<br />
I / Evolution <strong>de</strong> l’échantillon ............................................................................................ 74<br />
II / Evaluation <strong><strong>de</strong>s</strong> signes cliniques .................................................................................. 76<br />
a ) La douleur et l’asthénie ........................................................................................... 76<br />
b ) La qualité <strong>de</strong> vie ...................................................................................................... 76<br />
B / BIAIS .............................................................................................................................. 77<br />
I / Biais <strong>de</strong> sélection ......................................................................................................... 77<br />
II / Biais <strong>de</strong> mémoire ........................................................................................................ 77<br />
III / Biais <strong>de</strong> c<strong>la</strong>ssement ................................................................................................... 77<br />
C / Traitement d’une hypovitaminose D .............................................................................. 78<br />
D / Traitement d’une hypovitaminose dans une popu<strong>la</strong>tion à risque ................................... 81<br />
E / Surdosage et toxicité ....................................................................................................... 82<br />
F / Traitement <strong>de</strong> l’hypovitaminose D et amélioration <strong><strong>de</strong>s</strong> signes cliniques ....................... 84<br />
G / Traitement <strong>de</strong> l’hypovitaminose D et amélioration du taux sérique <strong>de</strong> PTH ................. 85<br />
H / Valeur normale du taux sérique <strong>de</strong> vitamine D : 50 nmol/l ou 75 nmol/l ................... 86<br />
CONCLUSIONS ...................................................................................................................... 88<br />
BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................... 91<br />
ANNEXES ............................................................................................................................... 96<br />
Questionnaire <strong>de</strong> fin d’étu<strong>de</strong> : .............................................................................................. 96<br />
Document distribué lors <strong>de</strong> l’inclusion à l’étu<strong>de</strong> VESTAL avec Schéma <strong>de</strong><br />
supplémentation : ............................................................................................................... 100<br />
Fiche <strong>de</strong> recueil <strong><strong>de</strong>s</strong> résultats .............................................................................................. 105<br />
Fiche <strong>de</strong> conseil distribué aux patientes par les mé<strong>de</strong>cins ................................................. 106<br />
14
INTRODUCTION<br />
La vitamine D est une vitamine liposoluble possédant une double origine au niveau du<br />
corps humain. Une partie est apportée par l’alimentation, l’autre provient <strong>de</strong> <strong>la</strong> photosynthèse<br />
cutanée. Etant donné le faible apport alimentaire <strong>de</strong> vitamine D, l’apport endogène est<br />
important afin <strong>de</strong> constituer les besoins nécessaires.<br />
Le rôle principal connu <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D est son implication dans le métabolisme phosphocalcique.<br />
Elle intervient dans <strong>la</strong> minéralisation du tissu osseux. Ainsi, une hypovitaminose D<br />
provoque chez le nourrisson et le jeune enfant un rachitisme, favorise chez <strong>la</strong> personne adulte<br />
une ostéoma<strong>la</strong>cie et chez <strong>la</strong> personne âgée une ostéopénie et une ostéoporose.<br />
Des recommandations existent pour les nourrissons, les enfants et les personnes âgées en<br />
institutions.<br />
Par contre, le déficit en vitamine D chez <strong>la</strong> femme non ménopausée est encore source<br />
d’inconnu alors que <strong><strong>de</strong>s</strong> travaux récents ont montré son caractère endémique. En effet le<br />
travail du Docteur BELAID montre que 99 % <strong><strong>de</strong>s</strong> femmes portant un vêtement couvrant ont<br />
un taux sérique inférieur à 75 nmol/l et que 72,6 % d’entre elles sont symptomatiques. Ces<br />
chiffres ont été confirmés par l’étu<strong>de</strong> VESTAL du Docteur CONTARDO puisque 98,4 % <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
femmes portant un vêtement couvrant et 94,8 % <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion contrôle sont en <strong><strong>de</strong>s</strong>sous du<br />
seuil <strong>de</strong> 75 nmol/l.<br />
A cette forte prévalence, il faut opposer <strong>la</strong> méconnaissance du tableau clinique (facteurs <strong>de</strong><br />
risque, douleurs musculo-squelettiques diffuses et asthénie) <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong><strong>de</strong>s</strong> cliniciens, le retard<br />
diagnostic et le surcoût engendré par <strong>la</strong> multiplication <strong><strong>de</strong>s</strong> examens complémentaires. Le<br />
Docteur MARTINAND a ainsi mis en évi<strong>de</strong>nce, lors d’une étu<strong>de</strong> médico-économique<br />
comparant avant et après le diagnostic et le traitement <strong>de</strong> <strong>la</strong> carence en vitamine D, que <strong>la</strong><br />
consommation médicale <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes était moindre avec un coût divisé par <strong>de</strong>ux.<br />
La localisation tissu<strong>la</strong>ire variée <strong>de</strong> récepteurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D suggère son implication au<br />
niveau d’autres pathologies comme les cancers, les ma<strong>la</strong>dies auto-immunes, infectieuses ou<br />
cardiovascu<strong>la</strong>ires.<br />
15
Il n’existe pas <strong>de</strong> recommandations <strong>de</strong> prise en charge thérapeutique <strong>de</strong> <strong>la</strong> carence en vitamine<br />
D chez <strong>la</strong> femme non ménopausée en France. Il nous a paru intéressant <strong>de</strong> tester un schéma <strong>de</strong><br />
supplémentation afin <strong>de</strong> déterminer <strong>la</strong> dose nécessaire pour ramener le taux sérique <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
femmes carencées à un taux normal et le maintenir sur une année, et également <strong>de</strong> mesurer si<br />
un traitement par apport <strong>de</strong> vitamine D à <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes carencées améliorerait leur qualité <strong>de</strong><br />
vie sociale et diminuerait leurs douleurs et leur fatigue.<br />
16
DONNEES GENERALES<br />
A / LA VITAMINE D<br />
I / DEFINITION<br />
La vitamine D ou 1,25-dihydroxyvitamine D ou calcitriol est une vitamine liposoluble<br />
appartenant au groupe <strong><strong>de</strong>s</strong> sécostéroï<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong> par sa structure et ses fonctions (1).<br />
Elle est <strong>la</strong> forme active <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux précurseurs différents : <strong>la</strong> vitamine D2 ou ergocalciférol et <strong>la</strong><br />
vitamine D3 ou cholécalciférol.<br />
Son unité <strong>de</strong> mesure est exprimée en Unité Internationale (UI) ou en microgramme (µg) dans<br />
les médicaments ou l’alimentation, en nanomol par litre (nmol/l) ou nanogramme par<br />
millilitre (ng/ml) dans les résultats sanguins.<br />
Les équivalences entre les différentes mesures sont : 100 UI = 2,5 µg et 1 nmol/l = 0,4 ng/ml.<br />
II / METABOLISME<br />
a ) Origine<br />
La vitamine D2 se trouve :<br />
- soit dans certains végétaux non consommés par l’Homme<br />
- soit dans certaines formes médicamenteuses comme Stérogyl® ou Uvestérol®.<br />
La vitamine D3 a également <strong>de</strong>ux origines :<br />
Origine exogène ou alimentaire :<br />
Elle est rare, elle existe surtout dans les poissons <strong>de</strong> mer dits gras (saumon, sardine, thon,<br />
hareng, anguille) ainsi que dans les huîtres et l’huile <strong>de</strong> foie <strong>de</strong> morue qui contiennent <strong>de</strong> 10 à<br />
20 µg/100g. Les autres aliments plus pauvres en vitamine D sont les jaunes d’œuf, les<br />
17
préparations culinaires à base d’œufs et les abats (2). L’autre apport exogène est<br />
médicamenteux avec par exemple le ZymaD® ou Uvedose®.<br />
A noter que l’apport exogène <strong>de</strong> vitamine D est faible.<br />
Origine endogène ou synthèse cutanée :<br />
Elle constitue donc <strong>la</strong> voie majoritaire <strong><strong>de</strong>s</strong> apports en vitamine D pour l’organisme (3, 4). Lors<br />
d’une exposition so<strong>la</strong>ire, sous l’action <strong><strong>de</strong>s</strong> UVB <strong>de</strong> longueur d’on<strong>de</strong> <strong>de</strong> 290 à 320 nm, dans les<br />
couches basale et muqueuse <strong>de</strong> l’épi<strong>de</strong>rme le 7-déhydrocholestérol est transformé en prévitamine<br />
D3.<br />
Cette voie <strong>de</strong> synthèse est donc liée à <strong>la</strong> qualité <strong><strong>de</strong>s</strong> UVB et à <strong>la</strong> <strong>la</strong>titu<strong>de</strong> géographique. Ainsi<br />
en France, on les retrouve uniquement sur une pério<strong>de</strong> al<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> juin à octobre.<br />
Cette synthèse cutanée ne peut pas être à l’origine d’un surdosage en vitamine D car en cas<br />
d’atteinte <strong>de</strong> <strong>la</strong> limite supérieure <strong>de</strong> pré-vitamine D3, le surplus est détruit par les UVB en<br />
composé isomérique inactif (4, 5).<br />
La pré-vitamine D3 est rapi<strong>de</strong>ment isomérisée en vitamine D3.<br />
b ) Activation<br />
La vitamine D provenant <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau ou <strong>de</strong> l’alimentation (ergocalciférol et cholécalciférol)<br />
subira une première hydroxy<strong>la</strong>tion au niveau hépatique en position C25 afin <strong>de</strong> former le<br />
25-hydroxyvitamine D ou 25(OH)D ou calcifédiol. Ce <strong>de</strong>rnier repasse dans <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>tion<br />
générale avec une <strong>de</strong>mi-vie <strong>de</strong> 30 jours.<br />
Le dosage sanguin <strong>de</strong> 25(OH)D est pratiqué pour déterminer l’état <strong>de</strong> déplétion ou <strong>de</strong><br />
réplétion du patient en vitamine D car le calcifédiol possè<strong>de</strong> une <strong>de</strong>mi-vie plus longue que les<br />
autres éléments (vitamine D et 1,25(OH)²D). Ainsi il constitue une bonne indication <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
réserves obtenues par l’apport alimentaire et l’irradiation cutanée. De plus, <strong>la</strong> production<br />
hépatique est peu régulée, elle dépend essentiellement <strong>de</strong> l’apport <strong>de</strong> substrat (6).<br />
La <strong>de</strong>uxième hydroxy<strong>la</strong>tion se produit au niveau rénal grâce à une enzyme : <strong>la</strong><br />
1α-hydroxy<strong>la</strong>se. Elle permet <strong>la</strong> formation du métabolite actif : <strong>la</strong> 1,25-dihydroxyvitamine D<br />
ou 1,25(OH)²D ou calcitriol (2, 7).<br />
Une production extra-rénale <strong>de</strong> 1,25-dihydroxyvitamine D a pu être mise en évi<strong>de</strong>nce.<br />
La 25(OH)D et <strong>la</strong> 1,25(OH)²D sont transportées pour 80-90 % liées à <strong>la</strong> vitamin D Binding<br />
Protein, pour 10-20 % liées à l’albumine, une très petite fraction <strong>de</strong>meurant libre (6).<br />
18
c ) Stockage<br />
La vitamine D est une vitamine liposoluble stockée majoritairement dans le tissu adipeux et<br />
dans les muscles. En cas <strong>de</strong> baisse d’apport (modification du régime alimentaire ou<br />
diminution <strong>de</strong> <strong>la</strong> synthèse cutanée en pério<strong>de</strong> hivernale), une libération <strong>de</strong> vitamine D stockée<br />
sera possible.<br />
d ) Catabolisme<br />
La 1,25-dihydroxyvitamine a une <strong>de</strong>mi-vie courte d’environ 12 heures. Elle est dégradée en<br />
24,25-dihydroxyvitamine D ou 24,25(OH)²D au niveau <strong>de</strong> différents organes notamment le<br />
foie et le rein. Le produit formé est ensuite éliminé par <strong>la</strong> bile (2, 7).<br />
e ) Régu<strong>la</strong>tion<br />
Le contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> concentration <strong>de</strong> <strong>la</strong> 1,25(OH)²D s’effectue au niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> 1 α-hydroxy<strong>la</strong>se<br />
rénale.<br />
Certaines hormones vont agir <strong>de</strong> manière directe. Ainsi <strong>la</strong> parathormone ou PTH va agir pour<br />
augmenter le taux sérique. D’autres agiront <strong>de</strong> manière indirecte, ce<strong>la</strong> pourrait être le cas <strong>de</strong><br />
l’hormone <strong>de</strong> croissance et <strong>de</strong> l’insuline.<br />
De plus, il existe un mécanisme d’autorégu<strong>la</strong>tion avec rétrocontrôle en fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
calcémie et <strong>de</strong> <strong>la</strong> phosphorémie. Ainsi une calcémie élevée inhibe <strong>la</strong> production <strong>de</strong><br />
1,25(OH)²D et inversement une calcémie basse <strong>la</strong> stimulera.<br />
Enfin, <strong>la</strong> 1,25(OH)²D s’autorégule puisqu’elle inhibe <strong>la</strong> 1 α-hydroxy<strong>la</strong>se et <strong>la</strong> production <strong>de</strong><br />
PTH et qu’elle favorise <strong>la</strong> production <strong>de</strong> l’enzyme responsable <strong>de</strong> <strong>la</strong> transformation en<br />
24,25-dihydroxyvitamine D (2).<br />
III / ACTION<br />
La vitamine D est indispensable dans le métabolisme phosphocalcique et dans <strong>la</strong><br />
minéralisation du squelette mais <strong><strong>de</strong>s</strong> recherches récentes sur <strong>la</strong> distribution du récepteur <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
1,25(OH)²D ont montré sa présence dans d’autres tissus ou cellules que le tissu osseux. Ainsi<br />
<strong>la</strong> vitamine D n’aurait pas un rôle unique.<br />
19
a ) Effets ostéo-muscu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D<br />
1 ) Métabolisme phosphocalcique et remo<strong>de</strong><strong>la</strong>ge osseux<br />
La vitamine D agit sur le métabolisme phosphocalcique soit <strong>de</strong> manière indirecte soit <strong>de</strong><br />
manière directe afin <strong>de</strong> maintenir l’homéostasie calcique.<br />
Elle est un puissant facteur pour stimuler l’absorption du calcium au niveau du duodénum et<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> phosphates au niveau du jéjunum (8). En effet une étu<strong>de</strong> comparant l’apport <strong>de</strong> calcium<br />
sous différentes formes (soit trois comprimés contenant 1 000 mg <strong>de</strong> carbonate <strong>de</strong> calcium,<br />
soit trois comprimés contenant 1 000 mg <strong>de</strong> carbonate <strong>de</strong> calcium associé à 200 UI <strong>de</strong><br />
vitamine D, soit 1 litre <strong>de</strong> <strong>la</strong>it <strong>de</strong> plus que dans le régime c<strong>la</strong>ssique, soit trois comprimés <strong>de</strong><br />
p<strong>la</strong>cebo) a montré une augmentation du calcium urinaire chez les patientes recevant les<br />
comprimés <strong>de</strong> calcium associé à <strong>la</strong> vitamine D. Cette majoration significative <strong>de</strong> l’excrétion<br />
traduit donc une majoration <strong>de</strong> l’absorption au niveau intestinal (9).<br />
Elle agirait également au niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> résorption <strong>de</strong> ces ions dans le tubule rénal.<br />
La 1,25(OH)²D agit directement sur <strong>la</strong> prolifération <strong><strong>de</strong>s</strong> cellules du carti<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> croissance et<br />
sur leur capacité à synthétiser les protéines <strong>de</strong> <strong>la</strong> matrice carti<strong>la</strong>gineuse.<br />
Elle stimule les ostéob<strong>la</strong>stes utiles pour <strong>la</strong> formation et <strong>la</strong> minéralisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> matrice osseuse.<br />
La 1,25(OH)²D entraîne aussi <strong>la</strong> résorption osseuse en augmentant les précurseurs <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
ostéoc<strong>la</strong>stes et leur différenciation ce qui provoque une augmentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> calcémie (10).<br />
Enfin <strong>de</strong> manière indirecte, en diminuant <strong>la</strong> sécrétion d’hormone parathyroïdienne, elle<br />
diminue <strong>la</strong> résorption <strong>de</strong> l’os. Un taux <strong>de</strong> 25(OH)D inférieur à 75 nmol/l provoque donc une<br />
augmentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> PTH (8).<br />
Ainsi on comprend qu’une carence en vitamine D est à l’origine d’une fragilité osseuse.<br />
Premièrement une ostéoma<strong>la</strong>cie est due à un défaut <strong>de</strong> minéralisation du tissu osseux. Une<br />
baisse <strong><strong>de</strong>s</strong> concentrations extra-cellu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong> calcium et phosphates produit un retard <strong>de</strong><br />
minéralisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> matrice ce qui conduit à un excès <strong>de</strong> tissu ostéoï<strong>de</strong> et va diminuer <strong>la</strong><br />
résistance mécanique et provoquer <strong><strong>de</strong>s</strong> douleurs osseuses.<br />
20
Ensuite l’hyperparathyroïdie secondaire, induite par <strong>la</strong> carence en 1,25(OH)²D, déséquilibre le<br />
remo<strong>de</strong><strong>la</strong>ge osseux en faveur <strong>de</strong> <strong>la</strong> résorption osseuse. Il se produit alors une perte <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>nsité osseuse ce qui correspond à l’ostéoporose (11). Une étu<strong>de</strong> à partir <strong>de</strong> sujets issus <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion américaine NHANES III (N = 13 432) a montré qu’il existait un lien significatif<br />
entre <strong><strong>de</strong>s</strong> valeurs hautes <strong>de</strong> vitamine D et une <strong>de</strong>nsité osseuse élevée. L’apport en vitamine D<br />
diminuerait <strong>la</strong> perte osseuse à <strong>la</strong> hanche <strong>de</strong> 0,54 % et au rachis lombaire <strong>de</strong> 1,19 % (8, 11).<br />
Une revue d’articles récente conclut qu’il existe <strong><strong>de</strong>s</strong> preuves acceptables d’un lien entre <strong>la</strong><br />
vitamine D et <strong>la</strong> <strong>de</strong>nsité osseuse. Une prise quotidienne supérieure à 700 UI associée à du<br />
calcium (500 – 1 200 mg/j) prévient <strong>la</strong> perte osseuse au niveau du rachis lombaire et du col<br />
fémoral comparé au p<strong>la</strong>cebo (12).<br />
L’effet anti-fracturaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine a été étudié à <strong>de</strong> nombreuses reprises. Selon les étu<strong><strong>de</strong>s</strong>,<br />
il existerait un lien significatif plus important si <strong>la</strong> vitamine D est prise à haute dose et en<br />
association avec du calcium. Dans <strong>la</strong> méta-analyse Cochrane, <strong>la</strong> vitamine D associée au<br />
calcium permet <strong>de</strong> réduire le risque <strong>de</strong> fracture du col fémoral (8 essais, 46 658 participants<br />
RR 0,84 ; IC 95 % 0,73-0,96) (13).<br />
Une autre méta-analyse réalisée par Bischoff-Ferrari et al. confirme l’intérêt d’une prise <strong>de</strong><br />
vitamine supérieure à 700 UI/j. Elle permet <strong>de</strong> réduire le risque re<strong>la</strong>tif <strong>de</strong> fracture du col<br />
fémoral <strong>de</strong> 26 % (3 essais, 5 572 patients, RR 0,74 ; IC 95 % 0,61-0,88) et celui <strong>de</strong> fracture<br />
non vertébrale <strong>de</strong> 23 % (5 essais, 6 098 patients, RR 0,77 ; IC 95 % 0,68-0,87) versus p<strong>la</strong>cebo<br />
ou calcium. Par contre <strong>la</strong> prise <strong>de</strong> 400 UI /j ne présente pas d’effet bénéfique significatif (2<br />
essais, 3 722 patients) (14).<br />
2 ) Métabolisme muscu<strong>la</strong>ire et force muscu<strong>la</strong>ire<br />
Il existe une réduction significative du risque <strong>de</strong> chute chez les personnes ayant un taux <strong>de</strong><br />
vitamine D normal.<br />
Une étu<strong>de</strong> a démontré que le risque <strong>de</strong> chute chez les personnes institutionnalisées ayant reçu<br />
800 UI/j diminuait <strong>de</strong> 60 % par rapport aux groupes <strong>de</strong> personnes ayant reçu 200, 400 et 600<br />
unités par jour pendant 5 mois (15).<br />
De même, Dhesi JK et al. ont montré qu’une injection <strong>de</strong> 600 000 UI a permis d’améliorer<br />
certains paramètres muscu<strong>la</strong>ires comme le temps <strong>de</strong> réaction et d’équilibre par rapport au<br />
groupe recevant un p<strong>la</strong>cebo (16).<br />
21
La vitamine D agirait soit <strong>de</strong> manière directe sur <strong>la</strong> taille <strong><strong>de</strong>s</strong> fibres muscu<strong>la</strong>ires soit <strong>de</strong><br />
manière indirecte en augmentant le pool calcique intracellu<strong>la</strong>ire afin <strong>de</strong> favoriser <strong>la</strong><br />
contraction muscu<strong>la</strong>ire (17).<br />
b ) Effets extra-osseux <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D<br />
L’étu<strong>de</strong> du récepteur spécifique <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D (Vitamine D Receptor ou VDR) a permis <strong>de</strong><br />
prouver sa présence dans d’autres tissus tel que <strong>la</strong> prostate, le colon, le sein et bien d’autres<br />
encore comme les cellules du système immunitaire.<br />
L’enzyme 1α-hydroxy<strong>la</strong>se est aussi présente ailleurs que dans les cellules rénales. La<br />
vitamine D agit alors directement ou indirectement sur <strong>de</strong> nombreux gènes impliqués dans <strong>la</strong><br />
différenciation cellu<strong>la</strong>ire, <strong>la</strong> prolifération, l’apoptose ou encore l’angiogénèse (2). Depuis, <strong>la</strong><br />
possible implication <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D dans d’autres pathologies est étudiée.<br />
1 ) Psoriasis<br />
La vitamine D ou ses analogues sont utilisés comme traitement topique <strong>de</strong> par leur rôle<br />
diminuant <strong>la</strong> prolifération cellu<strong>la</strong>ire (2).<br />
2 ) Cancers<br />
Il a été régulièrement démontré que les personnes vivant à <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>la</strong>titu<strong><strong>de</strong>s</strong> hautes ont une<br />
augmentation du risque <strong>de</strong> décès par cancer (8, 18).<br />
De plus <strong>de</strong> nombreuses étu<strong><strong>de</strong>s</strong> épidémiologiques ont prouvé le lien entre un taux <strong>de</strong> vitamine<br />
D bas et un risque d’apparition <strong>de</strong> cancer colorectal, <strong>de</strong> <strong>la</strong> prostate, <strong><strong>de</strong>s</strong> poumons, <strong><strong>de</strong>s</strong> ovaires<br />
et <strong><strong>de</strong>s</strong> lymphomes.<br />
Un essai randomisé chez <strong><strong>de</strong>s</strong> femmes ménopausées, recevant soit un p<strong>la</strong>cebo soit du calcium<br />
seul soit du calcium avec 1 100 UI <strong>de</strong> vitamine D par jour, a montré que les groupes ayant du<br />
calcium ou l’association calcium-vitamine D présentaient une réduction significative du<br />
risque <strong>de</strong> cancer (19).<br />
Ainsi une étu<strong>de</strong> montre que <strong><strong>de</strong>s</strong> femmes ayant un taux <strong>de</strong> vitamine inférieur à 30nmol/l ont un<br />
risque <strong>de</strong> développer un cancer colorectal majoré <strong>de</strong> 253 % sur les 8 prochaines années <strong>de</strong><br />
suivi (2).<br />
22
La démonstration est i<strong>de</strong>ntique pour le cancer <strong>de</strong> <strong>la</strong> prostate. La ma<strong>la</strong>die apparaît 3 à 5 ans<br />
plus tard chez les hommes ayant travaillé <strong>de</strong>hors par rapport à ceux qui ont travaillé à<br />
l’intérieur (2).<br />
Une étu<strong>de</strong> américaine réalisée sur 36 000 patientes avait montré l’absence <strong>de</strong> réduction <strong>de</strong><br />
cancer du côlon chez <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes recevant soit un p<strong>la</strong>cebo soit vitamine D et calcium. Mais<br />
il faut remarquer que cette étu<strong>de</strong> donnait seulement 400 UI <strong>de</strong> vitamine D par jour (17).<br />
Il existe donc un lien entre vitamine D et cancer. Par contre, il est nécessaire d’effectuer<br />
d’ autres étu<strong><strong>de</strong>s</strong> afin d’évaluer l’intérêt d’un traitement par vitamine D pour prévenir le risque<br />
<strong>de</strong> cancer.<br />
3 ) Ma<strong>la</strong>dies Auto-Immunes<br />
Le VDR et <strong>la</strong> 1α-hydroxy<strong>la</strong>se ont également été mis en évi<strong>de</strong>nce sur certaines lignées <strong>de</strong><br />
leucocytes notamment les macrophages, les lymphocytes T et B et les cellules présentatrices<br />
d’antigène. La vitamine D inhibe <strong>la</strong> production <strong>de</strong> certaines cytokines et <strong>la</strong> prolifération<br />
lymphocytaire. Sur <strong><strong>de</strong>s</strong> étu<strong><strong>de</strong>s</strong> animales, il a été possible <strong>de</strong> prouver qu’en association avec un<br />
régime riche en calcium, <strong>la</strong> vitamine D est capable d’inhiber ou <strong>de</strong> diminuer <strong>la</strong> survenue <strong>de</strong><br />
pathologies inf<strong>la</strong>mmatoires (20, 21).<br />
Des étu<strong><strong>de</strong>s</strong> épidémiologiques chez l’humain ont montré que vivre les 10 premières années<br />
sous 35° <strong>de</strong> <strong>la</strong>titu<strong>de</strong> diminue <strong>de</strong> 50 % le risque <strong>de</strong> développer <strong>la</strong> sclérose en p<strong>la</strong>ques (8).<br />
Par rapport à <strong>la</strong> sclérose en p<strong>la</strong>ques, <strong><strong>de</strong>s</strong> femmes ayant pris 400 UI/j <strong>de</strong> vitamine D ont un<br />
risque diminué <strong>de</strong> 42 % (2).<br />
Une étu<strong>de</strong> américaine sur <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion militaire a montré qu’un taux <strong>de</strong> vitamine D supérieur<br />
à 99 nmol/l est associé à une réduction significative du risque <strong>de</strong> sclérose en p<strong>la</strong>ques<br />
(OR 0,38 ; IC 95 % 0,19-0,75, p = 0,006) (22).<br />
Une étu<strong>de</strong> fin<strong>la</strong>ndaise a suivi <strong><strong>de</strong>s</strong> enfants qui absorbaient 2 000 UI/j durant <strong>la</strong> première année<br />
<strong>de</strong> leur vie. Le risque <strong>de</strong> développer un diabète <strong>de</strong> type 1 a diminué <strong>de</strong> 80 % sur un suivi <strong>de</strong> 31<br />
ans (2).<br />
De même, pour d’autres pathologies auto-immunes comme les ma<strong>la</strong>dies inf<strong>la</strong>mmatoires<br />
intestinales ou <strong>la</strong> polyarthrite rhumatoï<strong>de</strong>, <strong>la</strong> carence en vitamine D favorise les poussées (8).<br />
Par contre, il reste à préciser <strong>la</strong> valeur seuil au-<strong>de</strong>là duquel <strong>la</strong> vitamine a un effet protecteur.<br />
23
4 ) Pathologies cardiovascu<strong>la</strong>ires<br />
L’augmentation du risque <strong>de</strong> pathologies cardiovascu<strong>la</strong>ires est liée à un mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> vie à <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
<strong>la</strong>titu<strong><strong>de</strong>s</strong> élevées (2).<br />
Il a été prouvé que <strong><strong>de</strong>s</strong> séances <strong>de</strong> photothérapie avec <strong><strong>de</strong>s</strong> UVB chez <strong><strong>de</strong>s</strong> patients hypertendus<br />
entraînaient un impact significatif sur les chiffres tensionnels avec une baisse <strong>de</strong> 6 mmHg aux<br />
niveaux systolique et diastolique (2).<br />
Zittermann A et al. ont examiné le lien entre le taux <strong>de</strong> vitamine D et l’insuffisance cardiaque<br />
chez <strong><strong>de</strong>s</strong> patients <strong>de</strong> sta<strong>de</strong> NYHA 2 par rapport à un groupe contrôle. Le faible taux <strong>de</strong><br />
vitamine D est alors retrouvé <strong>de</strong> manière significative avec p < 0,001 (23).<br />
Son implication résulterait <strong>de</strong> <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> VDR au niveau <strong><strong>de</strong>s</strong> cellules endothéliales et<br />
myocardiques. La vitamine interviendrait également dans le contrôle du système rénineangiotensine.<br />
De plus l’activité anti-inf<strong>la</strong>mmatoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D permettrait <strong>de</strong> diminuer le<br />
taux <strong>de</strong> protéine C réactive médiateur <strong>de</strong> l’inf<strong>la</strong>mmation et probablement liée à<br />
l’artériosclérose (2).<br />
5 ) Autres<br />
Le déficit en vitamine D, d’après l’étu<strong>de</strong> NHANES, montre un risque accru d’apparition d’un<br />
syndrome métabolique (obésité, hypertension artérielle, hyperglycémie à jeun,<br />
hypertriglydéridémie) lorsque le taux est inférieur à 50 nmol/l (24).<br />
La carence en vitamine D serait aussi liée à une augmentation <strong>de</strong> l’inci<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> pathologies<br />
psychiatriques telles que <strong>la</strong> schizophrénie ou <strong>la</strong> dépression (2).<br />
24
B / L’HYPOVITAMINOSE D<br />
I / Définition<br />
Rappelons qu’il s’agit du dosage <strong>de</strong> <strong>la</strong> 25(OH) vitamine D qui reflète l’état <strong><strong>de</strong>s</strong> réserves en<br />
vitamine D <strong>de</strong> l’organisme.<br />
Le dosage <strong>de</strong> <strong>la</strong> 1,25(OH)²D n’est pas approprié car un taux normal <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière peut<br />
masquer une carence en 25(OH)D. En effet une carence en 25(OH)D entraîne une moindre<br />
absorption <strong>de</strong> calcium au niveau intestinal compensée par une majoration <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécrétion <strong>de</strong><br />
PTH. Cette hyperparathyroïdie secondaire provoque une stimu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong> 1-α hydroxy<strong>la</strong>se ce<br />
qui va augmenter <strong>la</strong> concentration sérique <strong>de</strong> <strong>la</strong> 1,25(OH)²D (2).<br />
Pour définir les valeurs seuils <strong>de</strong> vitamine D, les experts se sont basés sur l’observation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
re<strong>la</strong>tion étroite et inversée entre le taux <strong>de</strong> vitamine D et le taux <strong>de</strong> parathormone. Ainsi une<br />
carence en vitamine D engendre une augmentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> PTH. Cette majoration, même<br />
minime, produit un début <strong>de</strong> conséquence sur <strong>la</strong> santé osseuse. A l’inverse <strong>la</strong> baisse <strong>de</strong> <strong>la</strong> PTH<br />
se stabilise lorsque <strong>la</strong> vitamine D atteint une valeur seuil. Le taux <strong>de</strong> vitamine D est situé alors<br />
entre 75 et 100 nmol/l en fonction <strong><strong>de</strong>s</strong> étu<strong><strong>de</strong>s</strong> (2, 7).<br />
De manière consensuelle, cette étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> courbe inversée a permis <strong>de</strong> définir <strong>la</strong> valeur normale<br />
inférieure <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D. Il est admis que cette limite inférieure est <strong>de</strong> 75 nmol/l<br />
(soit 30 ng/ml) (25).<br />
En <strong><strong>de</strong>s</strong>sous <strong>de</strong> ce seuil, il existe différents sta<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong> carences :<br />
- une insuffisance en vitamine D <strong>de</strong> 52 à 75 nmol/l (soit <strong>de</strong> 20,8 à 30 ng/ml)<br />
- un déficit en vitamine D <strong>de</strong> 30 à 52 nmol/l (soit <strong>de</strong> 12 à 20,8 ng/ml)<br />
- un déficit sévère en vitamine D si < 30 nmol/l (soit < 12 ng/ml)<br />
- une vitamine D indétectable si < 10 nmol/l (soit < 4 ng/ml)<br />
25
II / Prévalence<br />
De par l’implication <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D sur le métabolisme osseux et par ses probables effets<br />
extra-osseux, <strong>de</strong> nombreuses étu<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong> prévalence ont été réalisées. Elles ont montré une forte<br />
prévalence d’hypovitaminose D sur l’ensemble du globe.<br />
Cette forte prévalence est majorée du fait <strong>de</strong> l’augmentation récente <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong> seuil.<br />
Ainsi en France, le travail du Dr Be<strong>la</strong>ïd montre le caractère endémique <strong>de</strong> l’hypovitaminose D<br />
sur une popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> femmes jeunes issues <strong>de</strong> <strong>la</strong> région lyonnaise avec 99 % d’entre elles qui<br />
possè<strong>de</strong>nt un taux inférieur à 53 nmol/l (26).<br />
De même, l’enquête nationale SUVIMAX <strong>de</strong> Chapuy et al., réalisée entre 1994 et 1995, a mis<br />
en évi<strong>de</strong>nce que 14 % <strong><strong>de</strong>s</strong> personnes en bonne santé inclues dans l’étu<strong>de</strong> avaient un taux <strong>de</strong><br />
vitamine D inférieur à 30 nmol /l et 78 % <strong><strong>de</strong>s</strong> 1 579 sujets étudiés avaient un taux inférieur à<br />
75 nmol/l (27).<br />
Des résultats simi<strong>la</strong>ires sont retrouvés en Europe. Ainsi une étu<strong>de</strong> alleman<strong>de</strong> a mis en<br />
évi<strong>de</strong>nce que 75 % <strong><strong>de</strong>s</strong> femmes d’origine turque sont carencées avec un taux moyen <strong>de</strong><br />
vitamine D à 38,1 nmol/l (28).<br />
En Angleterre, Elina Hyppönen and Chris Power ont étudié une cohorte <strong>de</strong> 7 591 personnes<br />
toutes nées en 1958. Ils ont démontré que <strong>la</strong> prévalence d’hypovitaminose D est majorée au<br />
cours <strong>de</strong> l’hiver et du printemps avec 87 % <strong>de</strong> <strong>la</strong> cohorte au cours <strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong> ayant un<br />
taux inférieur à 75 nmol/l (29).<br />
Aux USA, une étu<strong>de</strong> basée sur les données <strong>de</strong> <strong>la</strong> NHANES III avec 15 390 adultes inclus a<br />
montré une prévalence d’hypovitaminose D significativement plus élevée chez les femmes<br />
par rapport aux hommes. Le taux moyen <strong>de</strong> vitamine D chez les hommes d'origine hispanique<br />
est <strong>de</strong> 68,3 nmol/l et <strong>de</strong> 56,7 chez les femmes (p < 0,0001), <strong>de</strong> même chez les hommes et les<br />
femmes noirs avec respectivement 52,2 et 45,3 nmol/l (p
En Iran, sur 1 210 sujets sélectionnés, 9,5 % ont un taux sérique <strong>de</strong> vitamine D inférieur à<br />
12,5 nmol/l, 57,6 % ont un déficit compris entre 12,5 et 25 nmol/l et 14,2 % entre 25 et<br />
35 nmol/l (33).<br />
III / Facteurs <strong>de</strong> risque<br />
Tous les éléments qui interfèrent avec <strong>la</strong> pénétration <strong><strong>de</strong>s</strong> rayons UVB sur <strong>la</strong> terre ou <strong>la</strong><br />
transmission <strong><strong>de</strong>s</strong> UVB sur <strong>la</strong> peau ont un effet négatif sur le taux circu<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> vitamine D.<br />
a ) Causes intrinsèques<br />
Ces causes organiques sont directement liées au métabolisme <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D. Un<br />
dysfonctionnement <strong>de</strong> chacune <strong><strong>de</strong>s</strong> étapes du métabolisme peut donc entraîner une carence.<br />
Avant tout, <strong>de</strong> nombreuses étu<strong><strong>de</strong>s</strong> ont montré une différence significative en fonction du sexe.<br />
Les femmes ont un taux plus bas que les hommes, les causes <strong>de</strong> cette différence seraient<br />
multiples (apport nutritionnel, exposition so<strong>la</strong>ire ou influence hormonale) (27, 30).<br />
1 ) Synthèse cutanée<br />
La mé<strong>la</strong>nine responsable <strong>de</strong> <strong>la</strong> pigmentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau a un rôle protecteur contre les rayons<br />
ultraviolets dont les UVB (34). A quantité égale <strong>de</strong> vitamine D synthétisée, une personne <strong>de</strong><br />
phototype foncé <strong>de</strong>vra rester exposée plus longtemps (35). La prévalence <strong>de</strong> carence en<br />
vitamine D est plus élevée chez les personnes ayant un phototype foncé, <strong>de</strong> même cette<br />
carence est plus importante. Dans une étu<strong>de</strong> américaine, le taux <strong>de</strong> vitamine D chez <strong><strong>de</strong>s</strong> jeunes<br />
filles <strong>de</strong> phototype c<strong>la</strong>ir en été était <strong>de</strong> 102 nmol/l pour 72 nmol/l dans le groupe phototype<br />
foncé (36).<br />
Susan S Harris et Bess Dawson-Hughes ont mesuré le taux <strong>de</strong> vitamine D chez 51 patientes à<br />
phototype foncé et 39 à phototype c<strong>la</strong>ir <strong>de</strong> 20 à 40 ans. Les prélèvements ont été effectués en<br />
février-mars, juin-juillet, octobre-novembre et encore février-mars. Le taux <strong>de</strong> vitamine D est<br />
toujours inférieur chez les personnes à phototype foncé. De plus <strong>la</strong> majoration saisonnière<br />
entre février et juin est moins importante chez les sujets à phototype noir <strong>de</strong> manière<br />
significative (10,8 +/- 14 nmol/l comparé à 25,4 +/- 29,8 nmol/l, p = 0,006) (37).<br />
27
L’âge du patient intervient également dans <strong>la</strong> capacité à synthétiser <strong>la</strong> vitamine D. Une<br />
analyse <strong>de</strong> <strong>la</strong> concentration du précurseur <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D, le 7-<strong>de</strong>hydrocholesterol, a montré<br />
une baisse <strong>de</strong> sa concentration dans les tissus cutanés avec l’âge (34). L’épaisseur <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau<br />
diminue <strong>de</strong> manière linéaire chez l’homme à partir <strong>de</strong> 20 ans. Une étu<strong>de</strong> a comparé, après une<br />
durée d’exposition égale, le taux <strong>de</strong> vitamine D chez <strong><strong>de</strong>s</strong> patients jeunes par rapport à <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
patients âgés <strong>de</strong> 62 à 80 ans. La concentration maximale retrouvée est <strong>de</strong> 78,1 nmol/l chez les<br />
patients jeunes pour 20,8 nmol/l dans l’autre groupe (34).<br />
2 ) Absorption digestive<br />
Toutes les pathologies <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>bsorption peuvent affecter le taux sérique <strong>de</strong> vitamine D. Parmi<br />
celles-ci, les plus souvent citées sont : <strong>la</strong> mucoviscidose, <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Crohn, <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong><br />
Whipple ou <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die coeliaque (2).<br />
Certains traitements provoquent une ma<strong>la</strong>bsorption comme les gastrop<strong>la</strong>sties avec <strong>la</strong><br />
technique par bypass et les médicaments réduisant l’absorption du cholestérol.<br />
3 ) Activation hépatique<br />
Le foie est le lieu indispensable <strong>de</strong> <strong>la</strong> première hydroxy<strong>la</strong>tion. Seules les pathologies<br />
hépatiques diminuant <strong>de</strong> 90 % son activité entraînent une diminution <strong>de</strong> cette étape. En<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong>sous <strong>de</strong> ce seuil, l’activation sera possible mais l’absorption digestive sera perturbée (2).<br />
4 ) Activation rénale<br />
Le rein est l’organe principal <strong>de</strong> <strong>la</strong> formation du métabolite actif. Une insuffisance rénale a<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> conséquences sur l’homéostasie vitamino-calcique. Dès lors que <strong>la</strong> c<strong>la</strong>irance <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
créatinine est inférieure à 89 ml/min, il existe une baisse <strong><strong>de</strong>s</strong> taux <strong>de</strong> 1,25(OH)²D. Puis pour<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> valeurs <strong>de</strong> c<strong>la</strong>irance inférieure à 30 ml/min, il existe une hypocalcémie avec<br />
hyperparathyroïdie secondaire entraînant à terme une ostéodystrophie rénale (2).<br />
Les syndromes néphrotiques abaissent également le taux sérique par leur excrétion<br />
substantielle (2).<br />
28
5 ) Stockage<br />
La vitamine D est séquestrée au niveau du tissu adipeux ce qui provoque une baisse <strong>de</strong> sa<br />
biodisponibilité (2, 38).<br />
Le taux <strong>de</strong> vitamine D chez <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes regroupées en fonction <strong>de</strong> leur IMC montre cette<br />
différence <strong>de</strong> manière significative. Dans le groupe obésité morbi<strong>de</strong> le taux est <strong>de</strong> 37,9 +/- 16<br />
nmol/l versus 40,2 +/- 13 nmol/l dans le groupe obésité non morbi<strong>de</strong> versus 56,7 +/- 21 nmol/l<br />
dans le groupe non obèse (39).<br />
6 ) Catabolisme<br />
Le catabolisme <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D peut être modifié par certains traitements comme les anticonvulsivants,<br />
<strong>la</strong> rifampicine, les corticoï<strong><strong>de</strong>s</strong>, certains traitements anti-rejets <strong>de</strong> greffe et<br />
certains médicaments utilisés dans <strong>la</strong> trithérapie anti-VIH (2).<br />
b ) Causes extrinsèques<br />
1 ) Géographie<br />
La majorité <strong><strong>de</strong>s</strong> apports <strong>de</strong> vitamine D provient <strong>de</strong> <strong>la</strong> voie endogène liée à l’exposition aux<br />
rayonnements UV. De nombreux facteurs influent sur cette quantité d’UVB notamment <strong>la</strong><br />
<strong>la</strong>titu<strong>de</strong>, <strong>la</strong> saison, l’heure d’exposition et <strong>la</strong> durée.<br />
En fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong>titu<strong>de</strong>, plus on se rapproche <strong>de</strong> l’équateur donc avec <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>la</strong>titu<strong><strong>de</strong>s</strong> basses,<br />
plus le taux <strong>de</strong> vitamine D est haut (11).<br />
L’étu<strong>de</strong> SUVIMAX a analysé 1 569 personnes d’âge moyen <strong>de</strong> 50 +/- 6 ans. Ces individus<br />
étaient répartis sur l’ensemble du territoire français <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong>titu<strong>de</strong> 53° N à 43° N. Un gradient<br />
Nord-Sud a été mis en évi<strong>de</strong>nce avec, pour <strong>la</strong> région Nord, une moyenne <strong>de</strong> vitamine D <strong>de</strong><br />
43 +/- 21 nmol/l par rapport à 94 +/- 38 nmol/l pour <strong>la</strong> région Sud Ouest (27).<br />
La saison joue également un rôle sur <strong>la</strong> quantité d’UVB transmis et donc sur <strong>la</strong> vitamine D.<br />
Par exemple en France, <strong>la</strong> synthèse cutanée <strong>de</strong> pré-vitamine D3 est maximale <strong>de</strong> juin à août<br />
alors qu’elle est indétectable <strong>de</strong> novembre à mars (27). Une étu<strong>de</strong> suisse réalisée d’octobre à<br />
juin, sur 3 cantons situés entre le 46° N et le 47° N, a montré cette variation saisonnière.<br />
29
Le point le plus bas se situait en février avec une médiane à 41 nmol/l et le taux le plus haut<br />
était atteint en juin avec une médiane à 55 nmol/l (40).<br />
Cette variation a été démontrée dans le sud <strong>de</strong> <strong>la</strong> Flori<strong>de</strong> <strong>la</strong>titu<strong>de</strong> 25,46° N. Par exemple pour<br />
le sous-groupe <strong><strong>de</strong>s</strong> femmes, <strong>la</strong> moyenne du taux <strong>de</strong> vitamine D en hiver était <strong>de</strong> 22 nmol/l<br />
(55 – 20,8 nmol/l) et augmentait significativement l’été à 25 nmol/l (62,5 – 23,5 nmol/l) ce<br />
qui représente une augmentation saisonnière <strong>de</strong> 13 %. La prévalence entre l’hiver et l’été<br />
diminue <strong>de</strong> 40 % à 22 % pour un taux défini comme inférieur à 50 nmol/l (31).<br />
L’heure d’exposition doit aussi être prise en compte dans <strong>la</strong> production <strong>de</strong> vitamine D. Ainsi<br />
à Boston (42° N), <strong>la</strong> photosynthèse <strong>de</strong> précholécalciférol est efficace <strong>de</strong> 7h00 à 17h00 en<br />
pério<strong>de</strong> d’été, alors qu’au printemps et en automne elle n’est efficace que <strong>de</strong> 10h00 à 15h00<br />
(34).<br />
2 ) Mo<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong> vie<br />
Le type vestimentaire est un facteur influençant le risque <strong>de</strong> carence <strong>de</strong> vitamine D. Le<br />
travail du Dr Be<strong>la</strong>ïd a montré <strong>la</strong> forte prévalence <strong>de</strong> carence chez les patientes portant un<br />
vêtement couvrant. En effet, 99 % <strong><strong>de</strong>s</strong> 96 patientes étudiées avaient un taux <strong>de</strong> vitamine<br />
inférieur à 53 nmol/l (26).<br />
A <strong>la</strong> suite <strong>de</strong> ce travail, le Dr Contardo a montré le lien entre port <strong>de</strong> vêtement couvrant et<br />
carence en vitamine D. Il correspond à un risque re<strong>la</strong>tif significatif <strong>de</strong> 1,32 d’avoir un taux <strong>de</strong><br />
vitamine D inférieur à 52 nmol/l et <strong>de</strong> 2,17 pour un taux inférieur à 30 nmol/l (41).<br />
Ces résultats concor<strong>de</strong>nt avec <strong>la</strong> littérature internationale. De nombreuses étu<strong><strong>de</strong>s</strong> ont été<br />
effectuées dans <strong><strong>de</strong>s</strong> pays ayant une <strong>la</strong>titu<strong>de</strong> plus basse que <strong>la</strong> France et ont confirmé ce<br />
résultat. Ainsi au Liban (33° N), une étu<strong>de</strong> a comparé <strong><strong>de</strong>s</strong> hommes et <strong><strong>de</strong>s</strong> femmes<br />
(respectivement 99 et 217), portant ou non un vêtement couvrant, vivant en milieu rural ou<br />
urbain. La prévalence <strong>de</strong> carence sévère en vitamine D (définie comme inférieure à 12,5<br />
nmol/l) est observée chez 41,5 % <strong><strong>de</strong>s</strong> femmes et 61,8 % parmi les femmes voilées. En analyse<br />
multivariée le vêtement couvrant est considéré comme un facteur <strong>de</strong> risque d’hypovitaminose<br />
(42).<br />
En Turquie (Istanbul 41° N), <strong><strong>de</strong>s</strong> femmes <strong>de</strong> 14 à 44 ans ont été réparties en fonction <strong>de</strong> leur<br />
style vestimentaire : groupe I : les zones habituelles <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau sont exposées au soleil,<br />
groupe II : vêtement traditionnel les mains et <strong>la</strong> face sont découvertes, groupe III : habit<br />
recouvrant totalement le corps (mains et face inclues). La moyenne respective du taux <strong>de</strong><br />
30
vitamine D pour chaque groupe est <strong>de</strong> 56 +/- 41,3 nmol/l, 31,9 +/- 24,4 nmol/l et 9 +/- 5,7<br />
nmol/l. La différence est significative entre les groupes I et III (p
Des étu<strong><strong>de</strong>s</strong> ont montré le lien entre carence et douleurs ostéo-muscu<strong>la</strong>ires (48), notamment<br />
l’une d’elles effectuée en Egypte dans un service <strong>de</strong> rhumatologie. Soixante patientes se<br />
p<strong>la</strong>ignant <strong>de</strong> lombalgies chroniques ont eu un dosage sanguin <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D et <strong>de</strong> <strong>la</strong> PTH.<br />
Les patientes avec <strong><strong>de</strong>s</strong> lombalgies chroniques avaient un taux significativement plus bas<br />
(p < 0,05) <strong>de</strong> vitamine D que le groupe témoin et un taux plus élevé <strong>de</strong> PTH ( p < 0,05) (49).<br />
L’hypovitaminose évolue sans traitement vers une ostéoma<strong>la</strong>cie. Le tableau clinique est<br />
simi<strong>la</strong>ire associant douleurs ostéo-muscu<strong>la</strong>ires et asthénie. La moindre résistance osseuse due<br />
à l’accumu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> tissu ostéoï<strong>de</strong> provoque <strong><strong>de</strong>s</strong> fissures voire <strong><strong>de</strong>s</strong> fractures.<br />
b ) Diagnostic biologique<br />
Une étu<strong>de</strong> ang<strong>la</strong>ise <strong>de</strong> 2 cohortes entre 1998 et 2000 avec 467 patients, puis entre 2001 et<br />
2003 avec 719 patients, a analysé l’intérêt ou non d’un dosage <strong>de</strong> calcium, <strong>de</strong> phosphore ou<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> phosphatases alcalines (PAL) en cas d’hypovitaminose D. Le dosage <strong>de</strong> ces différents<br />
paramètres biologiques n’est pas prédictif d’une carence (50).<br />
Une autre étu<strong>de</strong> portant sur 84 patients ayant une hypovitaminose D et une hyperparathyroïdie<br />
secondaire a montré que dans 20 % <strong><strong>de</strong>s</strong> cas les autres paramètres biologiques sont normaux.<br />
De manière séparée, <strong>la</strong> calcémie est normale dans 66 % <strong><strong>de</strong>s</strong> cas, <strong>la</strong> phosphorémie est normale<br />
dans 81 % <strong><strong>de</strong>s</strong> cas et le dosage <strong><strong>de</strong>s</strong> PAL est normal dans 29 % <strong><strong>de</strong>s</strong> cas (51).<br />
La suspicion clinique et <strong>la</strong> recherche <strong>de</strong> facteurs <strong>de</strong> risque sont suffisants pour effectuer<br />
un dosage <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D.<br />
c ) Retard diagnostic<br />
Le manque <strong>de</strong> connaissance du tableau clinique <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong><strong>de</strong>s</strong> mé<strong>de</strong>cins, le caractère subjectif<br />
<strong>de</strong> l’asthénie et <strong><strong>de</strong>s</strong> douleurs entraînent fréquemment un retard diagnostic.<br />
Une étu<strong>de</strong> a ainsi montré que le temps entre le début <strong><strong>de</strong>s</strong> p<strong>la</strong>intes et le diagnostic varie <strong>de</strong> 7 à<br />
103 mois avec une moyenne à 59 mois. Avant le diagnostic, l’ensemble <strong><strong>de</strong>s</strong> patients a reçu un<br />
traitement par AINS et <strong>la</strong> majorité a bénéficié <strong>de</strong> soins <strong>de</strong> kinésithérapie (52).<br />
Ce temps <strong>de</strong> <strong>la</strong>tence est également constaté dans une autre étu<strong>de</strong>. Le premier diagnostic<br />
évoqué par les mé<strong>de</strong>cins était une pathologie psychosomatique dans 90 % <strong><strong>de</strong>s</strong> cas. Le temps<br />
moyen <strong>de</strong> diagnostic <strong>de</strong> carence en vitamine D est d’environ 30 mois (53).<br />
32
V / Besoin nutritionnel<br />
a ) Définition<br />
Il est nécessaire <strong>de</strong> rappeler quelques définitions <strong>de</strong> certaines valeurs nutritives :<br />
- Apport Nutritionnel Conseillé (ANC) : correspond à l’apport suffisant d’un<br />
nutriment pour couvrir les besoins <strong>de</strong> 97 % d’un groupe homogène d’individus donnés (sexe,<br />
âge). C’est le Besoin Nutritionnel Moyen auquel on ajoute <strong>de</strong>ux écart-types. Aux USA, ce<br />
terme équivaut à Recommen<strong>de</strong>d Dietary Allowance (RDA).<br />
- Besoin Nutritionnel Moyen (BNM) : correspond à l’apport suffisant pour respecter<br />
les besoins <strong>de</strong> 50 % <strong><strong>de</strong>s</strong> individus.<br />
- Limites <strong>de</strong> sécurité : correspond à l’apport maximal sûr qui ne causera aucun danger<br />
pour les individus du groupe.<br />
Les recommandations françaises et internationales pour l’ANC <strong>de</strong> vitamine D sous-enten<strong>de</strong>nt<br />
une sécrétion cutanée <strong>de</strong> vitamine D.<br />
L’ANC pour un adulte <strong>de</strong> 18 à 50 ans est <strong>de</strong> 5 µg/j soit 200 UI/j, pour une femme enceinte ou<br />
al<strong>la</strong>itant cet ANC passe à 10 µg/j (400 UI/j).<br />
b ) Des apports insuffisants<br />
Robert P Heaney et al. ont analysé au cours <strong>de</strong> l’hiver (pour limiter l’effet <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
photosynthèse) l’apport <strong>de</strong> différentes doses <strong>de</strong> vitamine D (0, 25, 125 et 250 µg/j) et les<br />
résultats sur le dosage sérique <strong>de</strong> vitamine D. Ils en ont déduit que pour 1 microgramme pris<br />
équiva<strong>la</strong>it une augmentation <strong>de</strong> 0,7 nmol/l <strong>de</strong> vitamine D sérique, ainsi un apport conseillé <strong>de</strong><br />
400 UI/j n’augmenterait le taux sérique que <strong>de</strong> 7 nmol/l. Cet apport est donc insuffisant pour<br />
les personnes considérées à risque <strong>de</strong> carence (54).<br />
L’étu<strong>de</strong> SUVIMAX révèle que l’apport alimentaire moyen <strong>de</strong> vitamine D en France est <strong>de</strong><br />
3,4 µg/j +/- 7,6 µg/l soit 136 UI/j (27). Les pays nordiques comme <strong>la</strong> Suè<strong>de</strong> ont un apport<br />
quotidien plus important (6µg/j ou 240 UI/j) du fait d’une supplémentation <strong>de</strong> leurs produits<br />
alimentaires comme le <strong>la</strong>it ou <strong>la</strong> margarine ainsi que d’une plus gran<strong>de</strong> consommation <strong>de</strong><br />
poissons gras comme le saumon ou le hareng (55).<br />
33
Malgré cette augmentation d’apport, <strong>la</strong> moyenne du taux sérique <strong>de</strong> vitamine D dans cet<br />
échantillon étudié est inférieure à <strong>la</strong> normale avec 69 nmol/l. Un lien significatif a été mis en<br />
évi<strong>de</strong>nce entre <strong>la</strong> consommation <strong>de</strong> produits riches en vitamine D et un taux plus élevé <strong>de</strong><br />
vitamine D.<br />
Comme nous l’avons vu précé<strong>de</strong>mment, les effets bénéfiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D nécessitent un<br />
taux circu<strong>la</strong>nt entre 75 et 100 nmol/l. Les recommandations nutritionnelles actuelles sont donc<br />
insuffisantes. Afin d’obtenir <strong>de</strong> tels taux sériques, les étu<strong><strong>de</strong>s</strong> récentes privilégient un apport<br />
<strong>de</strong> 20 à 25 µg/j (soit <strong>de</strong> 800 à 1 000 UI/j) (2, 3, 56, 57).<br />
Pour pallier ce manque d’apport par l’alimentation, certaines équipes réfléchissent sur <strong>la</strong><br />
supplémentation systématique en vitamine D d’aliments comme le <strong>la</strong>it et ses produits dérivés<br />
(<strong>la</strong>it en poudre, crème, yaourt, crème g<strong>la</strong>cée..), l’huile, <strong>la</strong> margarine et les jus d’orange. En<br />
Fin<strong>la</strong>n<strong>de</strong>, un modèle <strong>de</strong> supplémentation a été développé afin <strong>de</strong> déterminer à quelle hauteur<br />
doit s’effectuer cette majoration, le problème étant <strong>de</strong> ne pas dépasser les limites <strong>de</strong> sécurité<br />
(58).<br />
En Amérique du Nord, l’apport <strong>de</strong> vitamine D dépend principalement <strong><strong>de</strong>s</strong> aliments<br />
supplémentés en vitamine D. Une étu<strong>de</strong> à partir <strong><strong>de</strong>s</strong> données <strong>de</strong> <strong>la</strong> NHANES III a montré une<br />
différence significative <strong>de</strong> consommation <strong>de</strong> ces produits entre les groupes ethniques et entre<br />
les sexes. Cette différence, ainsi que <strong>la</strong> variabilité <strong>de</strong> l’ANC en fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, est<br />
source <strong>de</strong> difficulté pour définir une supplémentation <strong><strong>de</strong>s</strong> aliments, d’autant plus que cette<br />
stratégie d’enrichissement serait probablement insuffisante pour les personnes à risque au<br />
cours <strong>de</strong> l’hiver (59).<br />
VI / Traitement<br />
a ) Apport <strong>de</strong> <strong>la</strong> synthèse cutanée<br />
Une étu<strong>de</strong> effectuée sur le personnel d’un sous-marin a montré le rôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> photosynthèse.<br />
Les militaires ont été séparés en <strong>de</strong>ux groupes, l’un recevant un p<strong>la</strong>cebo et l’autre un<br />
complément <strong>de</strong> 15 µg/j <strong>de</strong> vitamine D. Privé d’exposition so<strong>la</strong>ire, le premier groupe voit le<br />
taux sérique <strong>de</strong> vitamine D chuter <strong>de</strong> 37 % à 1,5 mois d’étu<strong>de</strong> et <strong>de</strong> 39 % à 3 mois par rapport<br />
à 17 % et 0,3 % dans le second groupe. Un mois après que les groupes aient quitté le<br />
34
sous-marin, le taux sérique était remonté <strong>de</strong> 40 % dans le groupe p<strong>la</strong>cebo et <strong>de</strong> 20,9 % dans le<br />
groupe supplémenté (5).<br />
Déterminer l’apport <strong>de</strong> <strong>la</strong> photosynthèse par rapport à <strong>la</strong> quantité <strong>de</strong> vitamine requise n’est pas<br />
évi<strong>de</strong>nt. Comme nous l’avons vu, <strong>la</strong> synthèse cutanée dépend <strong>de</strong> différents facteurs comme<br />
l’âge, le phototype, <strong>la</strong> <strong>la</strong>titu<strong>de</strong>, l’heure d’exposition. Michael F Holick démontre qu’une<br />
exposition so<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> l’ensemble du corps provoquant un érythème cutané minime (« one<br />
minimal erythemal ») est comparable à <strong>la</strong> prise <strong>de</strong> 10 000 à 25 000 UI <strong>de</strong> vitamine D (soit <strong>de</strong><br />
250 à 650 µg). En effet lors d’expérimentation sur <strong>de</strong> jeunes adultes, l’exposition du corps<br />
entier aux UVB responsables d’un érythème minime induit une augmentation du taux sérique<br />
d’environ 52 nmol/l (34).<br />
Le temps d’exposition nécessaire serait alors <strong>de</strong> 5 à 15 minutes trois à quatre fois par<br />
semaine sur les mois d’été et plus long pendant les mois d’hiver (35, 60).<br />
L’étu<strong>de</strong> faite sur <strong><strong>de</strong>s</strong> hommes vivant à Omaha (USA <strong>la</strong>titu<strong>de</strong> 41° N) a montré l’importance<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> réserves <strong>de</strong> vitamine D constituées par <strong>la</strong> photosynthèse au cours <strong><strong>de</strong>s</strong> mois d’été. Robert P<br />
Heaney et al. ont remarqué que 12,5 µg/j (soit 500 UI/j) d’apports supplémentaires suffisent<br />
pour maintenir un taux sérique <strong>de</strong> vitamine D proche <strong>de</strong> 70 nmol/l. En admettant que les<br />
apports alimentaires soient inférieurs à 5 µg/j et d’après le calcul <strong>de</strong> <strong>la</strong> pente ( 0,7 nmol / L /<br />
µg / j), les 2 sources associées seraient responsables d’un taux sérique <strong>de</strong> 12 nmol/l. La<br />
différence constatée <strong>de</strong> 58 nmol/l proviendrait alors <strong>de</strong> l’utilisation par l’organisme <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
réserves tissu<strong>la</strong>ires en vitamine D. Toujours grâce à leur formule, 58 nmol/l <strong>de</strong> vitamine D<br />
sérique correspondraient à un apport <strong>de</strong> 82 µg/j ou 3 300 UI/j.<br />
Ces calculs montrent l’importance <strong><strong>de</strong>s</strong> réserves <strong>de</strong> vitamine D au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong><br />
hivernale et les conséquences pour les personnes incapables d’effectuer un stockage tissu<strong>la</strong>ire<br />
lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> estivale (54).<br />
b ) Apport pharmacologique <strong>de</strong> vitamine D<br />
1 ) Vitamine D2 versus vitamine D3<br />
Pendant <strong>de</strong> nombreuses années, <strong>la</strong> vitamine D3 semb<strong>la</strong>it être plus efficace que <strong>la</strong> vitamine D2.<br />
Une plus gran<strong>de</strong> affinité <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D3 avec <strong>la</strong> « vitamin D Binding Protein » ou DBP que<br />
<strong>la</strong> vitamine D2 expliquerait cette différence. De ce fait, l’élimination <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D3 serait<br />
35
plus lente que <strong>la</strong> vitamine D2 et l’hydroxy<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D3 serait plus efficace que<br />
celle <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D2 (61, 62).<br />
Mais une étu<strong>de</strong> récente effectuée par MF Holick et al. en double aveugle contre p<strong>la</strong>cebo a<br />
comparé les taux sériques <strong>de</strong> vitamine 25(OH)D, <strong>de</strong> vitamine 25(OH)D2 et <strong>de</strong> vitamine<br />
25(OH)D3 chez <strong><strong>de</strong>s</strong> patients qui recevaient soit un p<strong>la</strong>cebo, soit 1 000 UI <strong>de</strong> vitamine D3, soit<br />
1 000 UI <strong>de</strong> vitamine D2 soit 500 UI <strong>de</strong> vitamine D2 plus 500 UI <strong>de</strong> vitamine D3. La<br />
moyenne du groupe p<strong>la</strong>cebo est restée stable ce qui montre le peu d’influence <strong>de</strong><br />
l’environnement extérieur au cours <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong>. L’augmentation et le p<strong>la</strong>teau atteint à<br />
6 semaines par le groupe vitamine D3 (28,9 +/- 11,0 ng/ml) sont simi<strong>la</strong>ires au groupe<br />
vitamine D2 (26,8 +/- 9,6 ng/ml) sans différence statistique significative. Le groupe recevant<br />
500 UI <strong>de</strong> vitamine D2 associées à 500 UI <strong>de</strong> vitamine D3 montre l’absence d’interférence <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> vitamine D2 sur le métabolisme <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D3 car l’augmentation est i<strong>de</strong>ntique aux<br />
<strong>de</strong>ux autres groupes traités (63).<br />
Des étu<strong><strong>de</strong>s</strong> complémentaires semblent alors nécessaires pour préciser si <strong>la</strong> forme galénique et<br />
les excipients ont une importance dans <strong>la</strong> biodisponibilité (63) ainsi qu’une prise quotidienne<br />
plutôt qu’une prise ponctuelle (17).<br />
2 ) Posologie<br />
L’étu<strong>de</strong> du taux sérique <strong>de</strong> vitamine D après <strong>la</strong> prise unique d’une forte dose <strong>de</strong> vitamine D<br />
permet d’analyser le temps <strong>de</strong> réponse et <strong>la</strong> décroissance du taux sérique. Marium I<strong>la</strong>hi et al.<br />
ont analysé le dosage sanguin <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D chez <strong><strong>de</strong>s</strong> patients après une prise unique <strong>de</strong><br />
100 000 UI <strong>de</strong> cholécalciférol. L’augmentation du taux sérique moyen est rapi<strong>de</strong>, il passe <strong>de</strong><br />
27,7 ng/ml +/- 7,7 ng/ml (64,6 +/- 18 nmol/l) à une Cmax <strong>de</strong> 42 +/- 9,1 ng/ml (98 +/- 21,2<br />
nmol/l. Le pic est atteint en 7 jours. Les valeurs moyennes <strong>de</strong>viennent inférieures à 32,1 ng/ml<br />
(75 nmol/l) en environ 70 jours. Ni surdosage en vitamine D ni hypercalcémie n’ont été<br />
constatés (64).<br />
A partir <strong>de</strong> là, il faut déterminer un protocole thérapeutique <strong>de</strong> supplémentation efficace afin<br />
d’obtenir un taux sérique <strong>de</strong> vitamine D au moins égal à 75 nmol/. De nombreux auteurs ont<br />
étudié différents protocoles (56).<br />
Une difficulté rési<strong>de</strong> dans le fait que l’augmentation <strong><strong>de</strong>s</strong> concentrations après une<br />
supplémentation n’est pas linéaire. Elle dépend notamment du taux initial et l’augmentation<br />
est plus importante pour <strong><strong>de</strong>s</strong> concentrations <strong>de</strong> base plus faibles (8).<br />
36
Holick MF et al. proposent par exemple <strong>de</strong> donner 50 000 UI toutes les semaines pendant<br />
8 semaines puis 50 000 UI toutes les 2 à 4 semaines (65).<br />
JC Souberbielle et al. se sont inspirés <strong>de</strong> différents travaux dont ceux <strong>de</strong> Holick pour mettre<br />
en p<strong>la</strong>ce un protocole <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong> <strong>la</strong> carence et le traitement « d’entretien ». La première<br />
étape dépend du taux sérique initial <strong>de</strong> vitamine D et consiste à atteindre une concentration <strong>de</strong><br />
75 nmol/l.<br />
Si <strong>la</strong> concentration initiale est < 25 nmol/l (10 ng/ml), il faut prescrire une ampoule <strong>de</strong><br />
100 000 UI <strong>de</strong> vitamine D3 toutes les <strong>de</strong>ux semaines pendant <strong>de</strong>ux mois soit quatre ampoules<br />
au total.<br />
Si <strong>la</strong> concentration est comprise entre 25 et 50 nmol/l (10 – 20 ng/ml), il faut prescrire<br />
100 000 UI toutes les <strong>de</strong>ux semaines pendant un mois et <strong>de</strong>mi soit trois ampoules au total.<br />
Si <strong>la</strong> concentration est comprise entre 50 et 75 nmol/l (20 – 30 ng/ml), il faut prescrire<br />
100 000 UI toutes les <strong>de</strong>ux semaines pendant un mois soit <strong>de</strong>ux ampoules au total.<br />
Le maintien d’une concentration sérique à 75 nmol/l est obtenu par <strong>la</strong> prise régulière tous les<br />
<strong>de</strong>ux ou trois mois <strong>de</strong> 100 000 UI <strong>de</strong> vitamine D3 (17).<br />
De même John F Aloia et al. ont étudié un protocole avec réajustement <strong><strong>de</strong>s</strong> posologies au<br />
cours <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> tous les 2 mois pendant 6 mois.<br />
Pour une concentration sérique inférieure à 50 nmol/l, les patients prennent 4 000 UI/j soit<br />
120 000 UI par mois. Pour une concentration comprise entre 50 et 80 nmol/l, ils prennent<br />
2 000 UI/J.<br />
Lors <strong><strong>de</strong>s</strong> dosages intermédiaires si <strong>la</strong> concentration est inférieure à 50 nmol/l ou comprise<br />
entre 50 et 80 nmol/l, <strong>la</strong> prise quotidienne est augmentée <strong>de</strong> 2 000 UI ; si le dosage est<br />
compris entre 80 et 140 nmol/l, aucun changement n’est effectué ; s’il est supérieur à<br />
140 nmol/l alors <strong>la</strong> prise est diminuée <strong>de</strong> 2 000 UI/j.<br />
Le taux sérique <strong>de</strong> 75 nmol/l a été atteint par environ 90 % <strong><strong>de</strong>s</strong> patients à <strong>la</strong> semaine 18. La<br />
dose journalière moyenne pour les patients était <strong>de</strong> 3 440 UI. En conclusion, les auteurs<br />
recomman<strong>de</strong>nt une prise <strong>de</strong> 5 000 UI/j si le taux initial est inférieur à 55 nmol/l et <strong>de</strong><br />
3 800 UI/j s’il est supérieur à 55 nmol/l (66).<br />
3 ) Dose toxique et effets secondaires<br />
L’ensemble <strong>de</strong> ces doses testées est donc supérieur aux ANC et aux limites <strong>de</strong> sécurité chez<br />
l’adulte en France (maximum 1 000 UI/j), en Europe et aux Etats Unis 2 000 UI/j (54).<br />
Pourtant peu d’effets secondaires ont été signalés au cours <strong>de</strong> ces différentes étu<strong><strong>de</strong>s</strong>.<br />
37
Une intoxication avec surdosage en vitamine D provoque une hypercalcémie. Elle se<br />
manifeste par <strong><strong>de</strong>s</strong> troubles digestifs avec nausée, anorexie et perte <strong>de</strong> poids.<br />
Une infiltration <strong><strong>de</strong>s</strong> tissus mous est possible notamment au niveau cardiaque avec une atteinte<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> valves, <strong><strong>de</strong>s</strong> artères et <strong><strong>de</strong>s</strong> fibres myocardiques responsable d’un raccourcissement du QT.<br />
L’hypercalcémie est également responsable d’une hypercalciurie favorisant <strong>la</strong> formation <strong>de</strong><br />
lithiase rénale et <strong>la</strong> néphrocalcinose.<br />
Au cours <strong><strong>de</strong>s</strong> 6 mois <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> menée par John F Aloia et al. aucun effet secondaire n’a été<br />
répertorié.<br />
Une revue bibliographique menée par Reinhold Vieth montre qu’une hypercalcémie est<br />
toujours accompagnée d’un taux sérique <strong>de</strong> vitamine D supérieur à 220 nmol/l (56).<br />
Robert P Heaney et al. ont supplémenté pendant 20 semaines <strong><strong>de</strong>s</strong> patients ayant un taux<br />
sérique proche <strong>de</strong> 70 nmol/l. Les patients ont reçu en moyenne <strong>de</strong> 5 500 à 11 000 UI/j, aucun<br />
n’a présenté une calcémie supérieure à <strong>la</strong> normale y compris pour <strong><strong>de</strong>s</strong> concentrations à<br />
220 nmol/l (54).<br />
John N Hathcock et al. ont, lors d’une revue bibliographique, déterminé <strong>la</strong> limite supérieure<br />
<strong>de</strong> prise tolérable (Tolerable Upper Intake Level ou UL). L’absence <strong>de</strong> toxicité dans les essais<br />
conduits chez <strong><strong>de</strong>s</strong> hommes sains permet <strong>de</strong> retenir comme UL <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong> 250 µg/j soit<br />
10 000 UI/j (67).<br />
4 ) Association avec le calcium<br />
Certaines étu<strong><strong>de</strong>s</strong> mettent en évi<strong>de</strong>nce l’importance d’associer un apport <strong>de</strong> calcium à <strong>la</strong><br />
supplémentation vitaminique.<br />
Une étu<strong>de</strong> is<strong>la</strong>ndaise a démontré que les personnes avec un taux sérique <strong>de</strong> vitamine D<br />
inférieur à 25 nmol/l ont un taux <strong>de</strong> PTH significativement plus haut lorsque l’apport calcique<br />
est inférieur à 800 mg par rapport aux personnes ayant un apport <strong>de</strong> calcium supérieur<br />
à 1 200 mg/j (68).<br />
Une méta-analyse Cochrane incluant 45 étu<strong><strong>de</strong>s</strong> montre que <strong>la</strong> vitamine D seule chez les<br />
personnes âgées ne semble pas efficace pour prévenir les fractures <strong>de</strong> hanche (neufs essais,<br />
24 749 participants, RR = 1,15 ; IC 95 % 0,99 – 1,33), les fractures vertébrales (cinq essais,<br />
9 138 participants, RR = 0,90 ; IC 95 % 0,42 – 1,92) ou d’autres fractures (dix essais, 25 016<br />
participants, RR = 1,01 ; IC 95 % 0,93 – 1,09), alors que <strong>la</strong> vitamine D associée au calcium<br />
réduit les fractures <strong>de</strong> hanche (huit essais, 46 658 participants, RR = 0,84 ; IC 95 % 0,73 –<br />
0,96) (13).<br />
38
Une autre méta-analyse confirme ces résultats. Le risque re<strong>la</strong>tif pour <strong>la</strong> fracture <strong>de</strong> hanche<br />
lorsque <strong>la</strong> vitamine D était prise seule était <strong>de</strong> 1,1 (IC 95 % ; 0,89 – 1,36) alors qu’un apport<br />
<strong>de</strong> vitamine D <strong>de</strong> 700 à 800 UI/j complété par 1 000 à 1 200 mg/j <strong>de</strong> calcium réduit le risque<br />
<strong>de</strong> fracture <strong>de</strong> hanche ( RR = 0,82 ; IC 95 % 0,71 – 0,94) (69).<br />
L’association vitamine D plus calcium aurait également un effet sur <strong>la</strong> réduction du risque <strong>de</strong><br />
cancer. Joan M Lappe et al. ont effectué un essai randomisé en double aveugle <strong>de</strong> 4 ans chez<br />
1 179 femmes ménopausées recevant soit du calcium seul, soit 1 400 à 1 500 mg/j <strong>de</strong> calcium<br />
plus 1 100 UI/j <strong>de</strong> vitamine D, soit un p<strong>la</strong>cebo. Le risque re<strong>la</strong>tif <strong>de</strong> développer un cancer à <strong>la</strong><br />
fin <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> pour le groupe calcium plus vitamine D est <strong>de</strong> 0,4 (IC 0,2 – 0,82 ; p = 0,01)<br />
comparé au risque re<strong>la</strong>tif dans le groupe calcium seul qui est <strong>de</strong> 0,53 (IC 0,27 – 1,03 ;<br />
p = 0,06) (19).<br />
39
MATERIEL ET METHODE<br />
A / JUSTIFICATIF DE L’ETUDE<br />
Nous avons donc vu, lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> première partie, l’importance <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D dans<br />
l’organisme et <strong>la</strong> forte prévalence <strong>de</strong> sa carence. Ce constat a généré <strong>de</strong> nombreux travaux sur<br />
<strong>la</strong> région lyonnaise.<br />
En 2006, le Dr Be<strong>la</strong>ïd a démontré dans son travail <strong>de</strong> thèse que 99 % <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes couvertes<br />
inclues dans son étu<strong>de</strong> présentaient un taux <strong>de</strong> vitamine D inférieur à 53 nmol/l, mais cette<br />
étu<strong>de</strong> pilote manquait d’une popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> contrôle (26).<br />
Lors <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> VESTAL, le Dr Contardo a confirmé cette prévalence et a mis en évi<strong>de</strong>nce<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> facteurs <strong>de</strong> risque en comparant une popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> femmes couvertes par rapport à <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
femmes non couvertes. Ainsi <strong>la</strong> prévalence <strong>de</strong> carence <strong>de</strong> vitamine D dans <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
témoin est <strong>de</strong> 94,8 % et d’environ 98 % dans <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion étudiée avec comme facteur <strong>de</strong><br />
risque le port <strong>de</strong> vêtements couvrants. D’autres facteurs <strong>de</strong> risque ont été trouvés, il s’agit<br />
d’un manque d’exposition so<strong>la</strong>ire et d’un IMC supérieur à 25 (41).<br />
Dans <strong>la</strong> littérature internationale, il a été démontré que <strong>la</strong> carence en vitamine D est<br />
responsable <strong>de</strong> douleurs chroniques.<br />
Une étu<strong>de</strong> égyptienne a regroupé 60 patientes se p<strong>la</strong>ignant <strong>de</strong> douleurs lombaires chroniques<br />
<strong>de</strong>puis plus <strong>de</strong> 3 mois. Chez ces patientes le taux <strong>de</strong> vitamine D était significativement plus<br />
bas avec un taux <strong>de</strong> PTH significativement plus haut que dans une popu<strong>la</strong>tion témoin (49).<br />
De même en Arabie Saoudite, une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> 360 patients (90 % <strong>de</strong> femmes et 10 %<br />
d’hommes) ayant <strong><strong>de</strong>s</strong> lombalgies <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 6 mois sans cause évi<strong>de</strong>nte a montré que 83 %<br />
d’entre eux avaient un taux <strong>de</strong> vitamine D abaissé (70).<br />
Plotnikoff et Quigley constatent que le risque d’hypovitaminose D aux Etats Unis est étendu à<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> popu<strong>la</strong>tions considérées comme non à risque auparavant (c’est à dire <strong><strong>de</strong>s</strong> patients d’âge<br />
inférieur à 65 ans, non isolés socialement et non issus <strong>de</strong> l’immigration). Leur étu<strong>de</strong> a<br />
regroupé 150 patients <strong>de</strong> différentes origines ethniques ayant consulté dans un centre <strong>de</strong> soins<br />
40
pour <strong><strong>de</strong>s</strong> douleurs musculo-squelettiques persistantes et non spécifiques. Ils montrent que<br />
140 <strong>de</strong> ces patients soit 93 % ont une vitamine inférieure à 50 nmol/l, 28 % ont un déficit<br />
sévère dont 55 % d’entre eux ont moins <strong>de</strong> 30 ans (71).<br />
Turner MK et al. ont montré, parmi une popu<strong>la</strong>tion présentant <strong><strong>de</strong>s</strong> douleurs chroniques, une<br />
différence concernant <strong>la</strong> prise <strong>de</strong> médicaments opiacés entre <strong><strong>de</strong>s</strong> patients ayant un taux <strong>de</strong><br />
vitamine D inférieur à 50 nmol/l par rapport à ceux ayant un taux supérieur à 50 nmol/l. Les<br />
patients carencés consomment en moyenne 133,5 mg/j contre 70 mg/j chez les patients non<br />
carencés (p = 0,001). Les patients avec un taux <strong>de</strong> vitamine D inadéquat consomment <strong>de</strong>puis<br />
plus longtemps <strong>de</strong> <strong>la</strong> morphine (71,1 mois contre 43,8 ; p = 0,023). Suite à l’évaluation par le<br />
SF-36, ces patients ont également un plus mauvais score concernant l’activité physique<br />
(p = 0,041) et <strong>la</strong> santé perçue ( p = 0,003) (72).<br />
D’un point <strong>de</strong> vue thérapeutique, l’étu<strong>de</strong> menée en Arabie Saoudite montre qu’une<br />
supplémentation pendant trois mois en fonction du poids <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes a permis une<br />
amélioration clinique avec diminution ou disparition <strong><strong>de</strong>s</strong> douleurs (70).<br />
Une étu<strong>de</strong> réalisée en Suisse chez <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes <strong>de</strong>man<strong>de</strong>uses d’asile avec <strong><strong>de</strong>s</strong> douleurs<br />
musculo-squelettiques a montré l’importance <strong>de</strong> <strong>la</strong> prise en charge thérapeutique adaptée. En<br />
effet après un retard diagnostic important, les patientes ont été traitées par administration <strong>de</strong><br />
cholécalciférol. Environ 66 % <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes ont répondu au traitement. Une amélioration<br />
subjective a été ressentie après une moyenne <strong>de</strong> 1,47 mois et une amélioration définitive après<br />
une moyenne <strong>de</strong> 2,84 mois. L’amélioration <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes a été constatée par une moindre<br />
consultation aux urgences ainsi que par une diminution <strong>de</strong> prescription d’antalgiques (53).<br />
Cet aspect médico-économique a été étudié par le Dr Martinand. Il a prouvé un intérêt dans <strong>la</strong><br />
prise en charge <strong>de</strong> cette carence en comparant les dépenses engendrées par une popu<strong>la</strong>tion<br />
carencée avant et après une prise en charge médicale adaptée. Il démontre ainsi une baisse<br />
significative <strong><strong>de</strong>s</strong> dépenses <strong>de</strong> santé avec notamment une baisse <strong>de</strong> <strong>la</strong> fréquence <strong>de</strong> consultation<br />
(73). La prise en charge adaptée <strong>de</strong> <strong>la</strong> carence chez ces patientes améliorerait alors <strong>la</strong> qualité<br />
<strong>de</strong> vie par une moindre <strong>de</strong>man<strong>de</strong> médicale.<br />
41
B / HYPOTHESE ET OBJECTIFS<br />
I / Hypothèse<br />
Les patientes carencées en vitamine D se p<strong>la</strong>ignent <strong>de</strong> douleurs ostéo-muscu<strong>la</strong>ires et <strong>de</strong><br />
fatigue, et elles ont une qualité <strong>de</strong> vie médiocre (cf. travail du Dr G. CONTARDO (41)).<br />
L’apport <strong>de</strong> vitamine D adapté à leur carence pour retrouver un taux sérique normal apportera<br />
à ces femmes une amélioration tant au niveau <strong><strong>de</strong>s</strong> douleurs que <strong>de</strong> <strong>la</strong> fatigue et <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong><br />
vie.<br />
II / Objectifs<br />
a ) Principal :<br />
Evaluer si un traitement par apport <strong>de</strong> vitamine D à <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes carencées améliorerait leur<br />
qualité <strong>de</strong> vie sociale, leurs douleurs et leur fatigue.<br />
b ) Secondaire :<br />
Déterminer <strong>la</strong> fréquence et <strong>la</strong> posologie nécessaires en vitamine D pour maintenir un niveau<br />
sérique <strong>de</strong> vitamine D suffisant (75 nmol/l).<br />
C / TYPE D’ETUDE<br />
Il s’agit d’une étu<strong>de</strong> prospective sur un an qui consiste à suivre une cohorte <strong>de</strong> patientes<br />
âgées <strong>de</strong> 19 à 49 ans carencées en vitamine D.<br />
L’étu<strong>de</strong> a pu être réalisée grâce à <strong>la</strong> participation <strong>de</strong> 12 mé<strong>de</strong>cins généralistes libéraux<br />
exerçant sur <strong>la</strong> région Rhône-Alpes. La plupart travaillent sur Lyon ou ses alentours<br />
(Villeurbanne, Rillieux-<strong>la</strong>-Pape, Oullins), 3 d’entre eux sont à Villefontaine (Isère), et 2<br />
mé<strong>de</strong>cins pratiquent dans les environs <strong>de</strong> Valence (Drôme).<br />
42
Ils ont participé au préa<strong>la</strong>ble à l’étu<strong>de</strong> VESTAL qui était une étu<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong>criptive <strong>de</strong> prévalence<br />
<strong>de</strong> carence en vitamine D chez les femmes âgées <strong>de</strong> 19 à 49 ans consultant en mé<strong>de</strong>cine<br />
générale. Cette étu<strong>de</strong> a démontré l’existence <strong>de</strong> facteurs <strong>de</strong> risque d’hypovitaminose D.<br />
D / POPULATION ETUDIEE<br />
Cette étu<strong>de</strong> a consisté à effectuer le suivi <strong>de</strong> <strong>la</strong> cohorte <strong>de</strong> femmes carencées issues <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong><br />
VESTAL.<br />
L’inclusion s’est déroulée sur une pério<strong>de</strong> al<strong>la</strong>nt du 1er janvier au 31 mars 2008.<br />
Les femmes incluses dans cette étu<strong>de</strong> sont toutes <strong><strong>de</strong>s</strong> femmes carencées en vitamine D, âgées<br />
<strong>de</strong> 19 à 49 ans, portant ou non <strong><strong>de</strong>s</strong> vêtements couvrants et acceptant le protocole <strong>de</strong> suivi.<br />
Les facteurs d’exclusion sont le refus d’effectuer le suivi, une grossesse, une pathologie<br />
psychiatrique entravant gravement <strong>la</strong> compréhension ou toute pathologie survenant à partir <strong>de</strong><br />
l’inclusion qui pourrait interférer avec le métabolisme phosphocalcique (insuffisance<br />
hépatique, insuffisance rénale, ma<strong>la</strong>bsorption, pathologie cutanée).<br />
Le suivi s’effectue dans le cadre <strong><strong>de</strong>s</strong> soins courants : correction <strong>de</strong> <strong>la</strong> carence, vérification<br />
biologique et clinique tous les 3 mois pendant un an.<br />
E / RECUEIL DES DONNEES<br />
I / Dosage sanguin<br />
Les <strong>la</strong>boratoires BIOMNIS® et DIASORIN® ont accepté <strong>de</strong> poursuivre <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration<br />
engagée lors <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> VESTAL du Dr Contardo.<br />
Le dosage est basé sur <strong>la</strong> technique <strong>de</strong> chimioluminescence.<br />
Un dosage <strong>de</strong> vitamine D est effectué 1 mois après <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière prise orale <strong>de</strong> vitamine D. Il est<br />
répété ainsi tous les 3 mois pendant 1 an. La valeur normale est comprise entre 75 et<br />
200 nmol/l.<br />
43
Un dosage <strong>de</strong> <strong>la</strong> PTH a été effectué lors <strong>de</strong> l’inclusion à l’étu<strong>de</strong> VESTAL. Afin <strong>de</strong> limiter les<br />
coûts, il ne sera vérifié qu’en fin d’étu<strong>de</strong>. La valeur normale est comprise entre 15 et 65 ng/l.<br />
II / Base <strong>de</strong> données<br />
Les informations ont été recueillies sur une grille anonyme remplie par les investigateurs à <strong>la</strong><br />
suite d’un interrogatoire.<br />
III / Fiche <strong>de</strong> recueil<br />
Une fiche <strong>de</strong> recueil a été créée pour le suivi <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong>.<br />
Elle a permis <strong>de</strong> répertorier :<br />
- Les informations administratives : les trois premières lettres du nom, les <strong>de</strong>ux<br />
premières du prénom (garantissant l’anonymat), le numéro d’i<strong>de</strong>ntification du mé<strong>de</strong>cin, <strong>la</strong><br />
date <strong>de</strong> naissance ;<br />
- Le phototype déterminé d’après <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification <strong>de</strong> Fitzpatrick (cf. tableau);<br />
- La date d’inclusion ;<br />
- Le niveau socioprofessionnel : bénéficiaire ou non <strong>de</strong> <strong>la</strong> CMU, <strong>la</strong> profession exercée<br />
ou non ;<br />
- Le port <strong>de</strong> vêtement couvrant ou non ;<br />
- Les éléments médicaux EVA douleur et EVA asthénie ;<br />
- Les éléments biologiques avec le dosage sérique <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D et <strong>de</strong> <strong>la</strong> PTH ;<br />
- Le traitement vitamino-calcique prescrit ;<br />
- Le traitement vitamino-calcique pris ou non par <strong>la</strong> patiente (permettant d’évaluer<br />
l’observance <strong>de</strong> <strong>la</strong> supplémentation).<br />
44
Tableau : C<strong>la</strong>ssification du phototype selon Fitzpatrick<br />
PHOTOTYPE MORPHOTYPE APTITUDE AU BRONZAGE<br />
I roux, blond pâle brûle toujours, ne bronze pas<br />
II<br />
III<br />
blond, yeux c<strong>la</strong>irs, peau c<strong>la</strong>ire<br />
châtain<br />
IIIa : yeux c<strong>la</strong>irs. IIIb : yeux foncés<br />
brûle facilement, bronze peu et avec<br />
difficulté<br />
brûle parfois mais bronze<br />
IV brun, yeux foncés, peau mate bronze facilement, brûle peu<br />
V<br />
peau mate, yeux et cheveux<br />
foncés, asiatique mate, métisse<br />
bronze foncé très facilement, brûle<br />
rarement<br />
VI noir toujours bronzé, ne brûle jamais<br />
F / DEROULEMENT DE L’ETUDE<br />
Avant <strong>la</strong> supplémentation, chaque femme incluse a eu, grâce à l’étu<strong>de</strong> VESTAL, une<br />
évaluation <strong>de</strong> sa qualité <strong>de</strong> vie par le test SF-12, <strong>de</strong> sa consommation <strong>de</strong> vitamine D, <strong>de</strong> son<br />
exposition so<strong>la</strong>ire, du niveau <strong>de</strong> sa douleur et <strong>de</strong> sa fatigue.<br />
Tous les 3 mois à partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> date d’inclusion, le suivi <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes effectué par leur mé<strong>de</strong>cin<br />
traitant consistait à :<br />
- Réaliser un dosage sérique <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D ;<br />
- Surveiller l’évolution <strong><strong>de</strong>s</strong> signes cliniques avec EVA douleur et EVA asthénie ;<br />
- Prescrire ou non en fonction du résultat biologique une supplémentation vitaminique.<br />
45
Le protocole <strong>de</strong> supplémentation a été mis en p<strong>la</strong>ce à partir <strong><strong>de</strong>s</strong> données observées dans <strong>la</strong><br />
littérature :<br />
- Si Vitamine D < 30 nmol/l : prescrire 100 000 UI <strong>de</strong> vitamine D3 tous les 15 jours<br />
pendant 2 mois soit 400 000 UI en 2 mois ;<br />
- Si Vitamine D entre 30 et 53 nmol/l : prescrire 100 000 UI <strong>de</strong> vitamine D3 tous les<br />
mois pendant 2 mois soit 200 000 UI en 2 mois ;<br />
- Si Vitamine D entre 53 et 75 nmol/l : prescrire 100 000 UI <strong>de</strong> vitamine D3 en<br />
1 fois soit 100 000 UI en 2 mois ;<br />
- Si Vitamine D supérieure à 75 nmol/l : pas <strong>de</strong> supplémentation.<br />
Ce schéma <strong>de</strong> suivi a été effectué tous les 3 mois pendant une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> 1 an.<br />
A <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong>, <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> vie est <strong>de</strong> nouveau évaluée à l’ai<strong>de</strong> du questionnaire SF-12.<br />
De même que pour l’exposition so<strong>la</strong>ire ou l’apport alimentaire, nous avons décidé <strong>de</strong><br />
conserver le questionnaire i<strong>de</strong>ntique à l’étu<strong>de</strong> VESTAL afin <strong>de</strong> pouvoir comparer les données<br />
avant et après traitement.<br />
L’évaluation <strong>de</strong> l’exposition so<strong>la</strong>ire tient compte <strong>de</strong> <strong>la</strong> proportion <strong>de</strong> corps exposé, <strong>de</strong><br />
l’horaire, <strong>de</strong> <strong>la</strong> durée, <strong>de</strong> <strong>la</strong> fréquence et du lieu.<br />
Le SF-12 est un questionnaire comprenant 12 questions issues du SF-36. Il permet <strong>de</strong><br />
déterminer <strong>de</strong>ux scores : l’un pour <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> vie physique (score résumé physique ou<br />
Physical Composite Score ou PCS), l’autre pour <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> vie psychique (score résumé<br />
psychique ou Mental Composite Score ou MCS).<br />
L’analyse <strong><strong>de</strong>s</strong> réponses du questionnaire a été effectuée grâce à un site internet (74).Elle a<br />
permis d’évaluer 8 dimensions :<br />
- Activité physique ou physical functioning (symbole PF) :<br />
Mesure les limitations <strong><strong>de</strong>s</strong> activités physiques telles que marcher, monter <strong><strong>de</strong>s</strong> escaliers,<br />
soulever <strong><strong>de</strong>s</strong> objets et les efforts physiques importants et modérés.<br />
- Limitation due à l’état physique ou role physical (symbole RP) :<br />
Mesure <strong>la</strong> gêne due à l’état physique dans les activités quotidiennes : mesure les limitations <strong>de</strong><br />
certaines activités ou <strong>la</strong> difficulté pour les réaliser.<br />
- Douleurs physiques ou bodily pain (symbole BP)<br />
Mesure l’intensité <strong><strong>de</strong>s</strong> douleurs et <strong>la</strong> gêne occasionnée.<br />
46
- Santé perçue ou general health (symbole GH) :<br />
Auto-évaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé en général, résistance à <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die.<br />
- Vitalité ou vitality (symbole VT) :<br />
Auto-évaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitalité, <strong>de</strong> l’énergie, <strong>de</strong> <strong>la</strong> fatigue.<br />
- Vie et re<strong>la</strong>tion avec les autres ou social fuctioning (symbole SF) :<br />
Mesure les limitations <strong><strong>de</strong>s</strong> activités sociales dues aux problèmes <strong>de</strong> santé physique et<br />
psychique.<br />
- Limitation due à l’état psychique ou role emotional (symbole RE) :<br />
Mesure <strong>la</strong> gêne due aux problèmes psychiques dans les activités quotidiennes.<br />
- Santé psychique ou mental health (symbole MH) :<br />
Auto-évaluation <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé psychique : anxiété, dépression, bien-être.<br />
Les dimensions PF, RP, BP et GH sont combinées pour calculer le score résumé physique, les<br />
dimensions VT, SF, RE et MH sont utiles pour le calcul du score résumé psychique.<br />
Enfin les résultats aux différents scores s’analysent en fonction <strong>de</strong> l’âge et <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation<br />
géographique. Un résultat au-<strong><strong>de</strong>s</strong>sus <strong>de</strong> <strong>la</strong> moyenne correspond à un meilleur état <strong>de</strong> santé que<br />
<strong>la</strong> moyenne, alors qu’un résultat en <strong><strong>de</strong>s</strong>sous <strong>de</strong> <strong>la</strong> moyenne correspond à un moins bon état <strong>de</strong><br />
santé.<br />
G / SAISIE ET ANALYSE DES DONNEES<br />
Les données sont analysées à partir du logiciel SAS Institute software (Cary, NC).<br />
Les patientes seront décrites sur leurs principales caractéristiques exprimées en valeurs<br />
moyenne, médiane et écart type pour les variables quantitatives et en fréquence et<br />
pourcentage pour les variables qualitatives.<br />
L'analyse <strong><strong>de</strong>s</strong> facteurs <strong>de</strong> risque est faite au moyen du test non-paramétrique <strong>de</strong> Friedman, <strong>la</strong><br />
comparaison avant-après avec le test du signe <strong>de</strong> Wilcoxon, ainsi qu’avec le test du chi².<br />
47
H / RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE<br />
Nous avons utilisé MEDLINE pour notre recherche bibliographique, avec les mots clés :<br />
vitamin D - young - women - <strong>de</strong>ficiency - veiled - treatment - therapeutic - family practice<br />
48
RESULTATS<br />
A / Echantillon initial<br />
L’échantillon <strong>de</strong> départ est composé <strong>de</strong> 186 patientes.<br />
L’âge moyen est <strong>de</strong> 36 ans.<br />
La répartition <strong><strong>de</strong>s</strong> femmes en fonction <strong>de</strong> l’âge est :<br />
- <strong>de</strong> 19 à 29 ans : 43 femmes soit 22,99 %<br />
- <strong>de</strong> 30 à 39 ans : 76 femmes soit 40,64 %<br />
- <strong>de</strong> 40 à 49 ans : 67 femmes soit 35,83 %<br />
I / Répartition en fonction <strong>de</strong> facteurs socio-économiques :<br />
a ) Vêtement couvrant :<br />
Sur 186 patientes, 53 patientes portent un vêtement couvrant soit 29 %, 130 ne portent pas <strong>de</strong><br />
vêtement couvrant soit 71,03 % et pour 3 patientes l’information est manquante.<br />
Figure 1 : Répartition <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes en fonction du port d’un vêtement couvrant ou non<br />
vêtement couvrant<br />
pas <strong>de</strong> vêtement couvrant<br />
49
En fonction <strong>de</strong> l’âge, les femmes voilées sont réparties ainsi : 41,5 % sont dans <strong>la</strong> tranche <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
30 à 39 ans, 35,8% ont moins <strong>de</strong> 30 ans et 22,6% ont un âge supérieur à 39 ans.<br />
Figure 2 : Répartition <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes portant un vêtement couvrant en fonction <strong>de</strong> l’âge<br />
20 - 29 ans<br />
30 - 39 ans<br />
40 - 49 ans<br />
En fonction <strong>de</strong> l’âge, les femmes non couvertes sont réparties majoritairement dans <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
tranches plus âgées que les femmes couvertes. En effet, 42 % ont plus <strong>de</strong> 39 ans, 40,5 % ont<br />
un âge compris entre 30 et 39 ans et 17,5 % ont moins <strong>de</strong> 29 ans.<br />
Figure 3 : Répartition <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes ne portant pas un vêtement couvrant en fonction <strong>de</strong> l’âge<br />
20 - 29 ans<br />
30 - 39 ans<br />
40 - 49 ans<br />
50
) Phototype :<br />
Le phototype est défini par <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification <strong>de</strong> Fitzpatrick, réparti en 6 groupes.<br />
Les phototypes 3B et 4 sont les plus représentés avec respectivement 33,14 % et 29,65 % <strong>de</strong><br />
prévalence dans <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion étudiée. Le phototype 3A représente 19,77 % alors que les<br />
autres phototypes 2, 5, 6 et 1, par ordre décroissant, sont minoritaires.<br />
Figure 4 : Répartition <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes en fonction du phototype<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1 2 3A 3B 4 5 6<br />
c ) CMU :<br />
Sur l’ensemble <strong>de</strong> l’échantillon initial 136 patientes, soit 77,27 %, ne bénéficient pas <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
CMU et 40 patientes, soit 22,73 %, en bénéficient.<br />
B / Evolution <strong>de</strong> l’échantillon<br />
L’étu<strong>de</strong> étant prospective avec le suivi d’une cohorte, <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes sont sorties <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> au<br />
cours <strong>de</strong> cette année pour diverses raisons.<br />
54 patientes ont été perdues à cause d’une mauvaise observance soit 29 %, 26 patientes ont<br />
présenté un critère d’exclusion soit 14 % et 14 patientes ont été perdues <strong>de</strong> vue soit 7,5 %.<br />
51
I / Liée à différentes situations <strong>de</strong> mauvaise observance<br />
a ) Situation liée à l’investigateur<br />
6 patientes soit 3,2 % participaient à l’étu<strong>de</strong> VESTAL par le biais du mé<strong>de</strong>cin n°5 mais il n’a<br />
pas effectué leur suivi.<br />
b ) Situation liée aux patientes<br />
- 15 patientes soit 8,1 % ne sont pas venues chercher leur traitement malgré <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
mé<strong>de</strong>cins participants.<br />
- 6 patientes soit 3,2 % ont déménagé au cours <strong>de</strong> l’année 2008-2009 ce qui a rendu<br />
impossible le suivi.<br />
- 27 patientes soit 14,5 % n’ont pas observé le schéma <strong>de</strong> suivi (prélèvements sanguins à<br />
intervalle régulier, prise du traitement prescrit). Elles ne peuvent pas être considérées comme<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> vraies perdues <strong>de</strong> vue car elles consultent encore le même mé<strong>de</strong>cin traitant ; ce sont plutôt<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> patientes « mal-observantes ».<br />
II / Liée à un critère d’exclusion<br />
- 2 patientes soit 1 % sont exclues <strong>de</strong> l’analyse pour non respect <strong><strong>de</strong>s</strong> critères d’inclusion du<br />
fait <strong>de</strong> leur âge supérieur à <strong>la</strong> limite fixée <strong>de</strong> 49 ans (n° 13/02 et 13/12 respectivement 54 ans<br />
et 50 ans).<br />
- 15 patientes soit 8,1 % ont déc<strong>la</strong>ré une grossesse au cours <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong>.<br />
- 7 patientes soit 3,8 % ont présenté une pathologie intercurrente pouvant interférer avec les<br />
résultats <strong>de</strong> l’EVA, <strong>de</strong> <strong>la</strong> biologie ou avec le suivi (par exemple pathologie chirurgicale,<br />
néop<strong>la</strong>sique ou psychiatrique).<br />
- 2 patientes soit 1 % ont refusé le suivi nécessaire.<br />
III / Liée aux perdues <strong>de</strong> vue<br />
14 patientes soit 7,5 % sont <strong><strong>de</strong>s</strong> perdues <strong>de</strong> vue sans précision.<br />
52
C / Echantillon final<br />
I / Taux <strong>de</strong> participation aux dosages sanguins<br />
En fonction <strong><strong>de</strong>s</strong> différentes évolutions citées, les patientes n’ont pas fait tous les dosages <strong>de</strong><br />
vitamine D.<br />
113 patientes ont participé à <strong>la</strong> visite 2 ce qui équivaut à un taux <strong>de</strong> participation <strong>de</strong> 60,8 %,<br />
65 patientes ont effectué le troisième dosage soit 34,9% <strong>de</strong> participation et 30 patientes ont<br />
réalisé les quatre dosages préconisés soit 16,1%.<br />
Figure 5 : Taux <strong>de</strong> participation aux dosages sanguins <strong>de</strong> vitamine D<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
100<br />
60,8<br />
34,9<br />
16,1<br />
V1 V2 V3 V4<br />
Nous verrons que ce taux <strong>de</strong> participation <strong>de</strong> plus en plus faible a une conséquence sur<br />
l’analyse statistique <strong><strong>de</strong>s</strong> données.<br />
D’autre part, les dosages sanguins ont été effectués à différentes pério<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong> l’année. Une<br />
visite <strong>de</strong>vait être effectuée chaque trimestre. Ainsi le dosage 1 <strong>de</strong>vait correspondre au premier<br />
trimestre 2008, le dosage 2 au second trimestre 2008, le dosage 3 au troisième trimestre 2008<br />
et le dosage 4 au <strong>de</strong>rnier trimestre 2008. Etant donné le lien entre saison et vitamine D, il est<br />
important <strong>de</strong> connaître <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> à <strong>la</strong>quelle les dosages ont été réalisés.<br />
53
Tableau 6 : Répartition chronologique <strong><strong>de</strong>s</strong> dosages en fonction <strong>de</strong> chaque visite<br />
nombre <strong>de</strong><br />
1° trimestre<br />
2° trimestre<br />
3° trimestre<br />
4° trimestre<br />
1° trimestre<br />
2° trimestre<br />
Dates<br />
dosages<br />
2008<br />
2008<br />
2008<br />
2008<br />
2009<br />
2009<br />
manquantes<br />
dosage 1 47 8 10<br />
dosage 2 1 29 20 5 10<br />
dosage 3 15 25 15 5 5<br />
dosage 4 1 22 5 37<br />
II / Taux <strong>de</strong> participation au questionnaire final<br />
63 patientes ont répondu au questionnaire final ce qui représente un taux <strong>de</strong> réponse <strong>de</strong><br />
33,9 % mais seuls 60 dossiers seront interprétables car il manque le questionnaire initial pour<br />
un dossier et <strong>de</strong>ux autres présentent un critère d’exclusion.<br />
La différence entre le taux <strong>de</strong> participation au questionnaire et le taux <strong>de</strong> participation au<br />
<strong>de</strong>rnier prélèvement sanguin s’explique par le fait que certaines patientes répondaient au<br />
questionnaire au cabinet du mé<strong>de</strong>cin sans effectuer ensuite le prélèvement biologique.<br />
III / Description <strong>de</strong> l’échantillon final<br />
Etant donné le nombre important <strong>de</strong> femmes qui ne sont pas allées au bout <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> pour les<br />
raisons énoncées ci-<strong><strong>de</strong>s</strong>sus, nous analyserons <strong>de</strong> manière plus importante les résultats <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
patientes ayant effectué au moins trois dosages <strong>de</strong> vitamine D soit 65 patientes.<br />
54
Tableau 7 : Comparaison <strong><strong>de</strong>s</strong> valeurs à V1 entre les patientes non revenues à V3 (n=122) par<br />
rapport aux patientes revenues à V3 (n=65)<br />
EVA fatigue EVA douleur Vitamine D PTH âge<br />
bénéficiaire <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> CMU en %<br />
port du<br />
vêtement<br />
couvrant en %<br />
non revenues<br />
à V3<br />
2,3 2,4 29,54 59,19 35,6 23 31<br />
revenues V3 3,1 3 30,4 55,76 36,7 18 23<br />
p-value 0,25 0,24 0,91 0,69 0,53 0,31<br />
Nous n’avons donc pas pu mettre en évi<strong>de</strong>nce une différence entre les divers critères pris en<br />
compte au début <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong>.<br />
L’effectif que nous avons pu suivre jusqu’à V3 est équivalent en ce qui concerne le facteur<br />
<strong>de</strong> risque principal : le port d’un vêtement couvrant, mais également équivalent sur le taux <strong>de</strong><br />
vitamine D et <strong>de</strong> PTH, l’EVA douleur et asthénie et sur l’âge.<br />
D / Evolution <strong><strong>de</strong>s</strong> critères étudiés<br />
Les critères étudiés correspon<strong>de</strong>nt au taux <strong>de</strong> vitamine D, au taux <strong>de</strong> PTH, à l’EVA douleur et<br />
l’EVA fatigue. Leurs valeurs évoluent en fonction du temps (Visite 1, Visite 2, Visite 3 et<br />
Visite 4) et en fonction du nombre d’ampoules <strong>de</strong> vitamine D prises par les patientes.<br />
I / Le taux <strong>de</strong> vitamine D<br />
Lors du premier dosage, le taux moyen <strong>de</strong> vitamine D était <strong>de</strong> 30,4 nmol/l avec un écart type<br />
<strong>de</strong> 17,1. Sur 113 patientes ayant un second dosage, le taux moyen augmente à 82,1 nmo/l. A<br />
<strong>la</strong> troisième visite, 65 patientes effectuent le dosage avec une moyenne <strong>de</strong> 68,3 nmol/l. Lors<br />
du <strong>de</strong>rnier prélèvement sanguin effectué sur 30 patientes, le taux moyen est <strong>de</strong> 73,8 nmo/l.<br />
L’augmentation globale du taux <strong>de</strong> vitamine D entre <strong>la</strong> première visite (V1) et <strong>la</strong><br />
troisième visite (V3) est significative avec p < 0,001.<br />
55
Figure 8 : Représentation <strong><strong>de</strong>s</strong> valeurs <strong>de</strong> vitamine D lors <strong>de</strong> chaque visite (IC 5-95 %)<br />
250<br />
42 173<br />
200<br />
42<br />
150<br />
10<br />
158<br />
100<br />
50<br />
0<br />
VitD1 VitD2 VitD3 VitD4<br />
56
Figure 9 : Evolution globale du taux <strong>de</strong> vitamine D en fonction du temps<br />
taux <strong>de</strong> vitamine D (nmol/l)<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1 2 3 4<br />
visite<br />
vitamine D<br />
Cette évolution en « <strong>de</strong>nts <strong>de</strong> scie » est <strong>la</strong> conséquence du schéma thérapeutique mis en<br />
p<strong>la</strong>ce. En effet, <strong>la</strong> dose <strong>de</strong> vitamine D prescrite aux patientes variait en fonction du taux <strong>de</strong><br />
vitamine. Les patientes ayant un taux <strong>de</strong> vitamine D supérieur ou égal à 75 nmol/l ne<br />
recevaient pas <strong>de</strong> nouvelle prescription <strong>de</strong> vitamine D. Lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> secon<strong>de</strong> visite, 67 patientes<br />
ayant un taux supérieur à 75 nmol/l, représentant 59,29 % <strong>de</strong> l’échantillon, n’ont pas eu <strong>de</strong><br />
vitamine D jusqu’à <strong>la</strong> troisième visite. Le nombre <strong>de</strong> patientes ayant un taux <strong>de</strong> vitamine D<br />
supérieur à 75 nmol/l lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> troisième visite a alors diminué à 30,77 %.<br />
57
Tableau 10 : Répartition <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes en fonction du taux <strong>de</strong> vitamine D lors <strong><strong>de</strong>s</strong> différentes<br />
visites<br />
Visite 1 2 3 4<br />
Vitamine D Nb % Nb % Nb % Nb %<br />
75 0 0 69 61,06 23 35,38 9 30<br />
total 186 113 65 30<br />
DM * 74 122 157<br />
*DM = Données manquantes. Le chiffre est important mais il comprend l’ensemble <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
patientes exclues, <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes mal observantes et <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes perdues <strong>de</strong> vues<br />
(cf. chapitre B)<br />
Par exemple sur l’échantillon <strong>de</strong> 65 patientes ayant effectué 3 dosages <strong>de</strong> vitamine D, 37<br />
d’entre elles ont un second taux sérique supérieur à 75 nmol/l. A <strong>la</strong> troisième visite, 70 % <strong>de</strong><br />
ces patientes (26 sur 37) sont à nouveau en <strong><strong>de</strong>s</strong>sous <strong>de</strong> 75 nmol/l (Fig. 11).<br />
Figure 11 : Evolution du taux <strong>de</strong> vitamine D chez les patientes ayant V2 > 75<br />
et V3 < 75 nmol/l (n=26/37)<br />
250<br />
taux <strong>de</strong> vitamine D (nmol/l)<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
1° 2° 3° 4°<br />
visite<br />
58
D’autre part en terme <strong>de</strong> proportion (cf. tableau 10), les groupes 30-53 nmol/l et<br />
54-75 nmol/l augmentent <strong>de</strong> V2 à V3 car les patientes ayant un taux <strong>de</strong> vitamine D compris<br />
dans ces intervalles continuent à avoir une prescription <strong>de</strong> vitamine D. Leur progression est<br />
linéaire.<br />
Par exemple parmi le groupe <strong><strong>de</strong>s</strong> 65 patientes, toutes les patientes ayant à V2 un taux inférieur<br />
à 75 nmol/l (n=28) ont présenté une majoration <strong>de</strong> leur taux que ce soit entre V2 et V3<br />
(Fig. 12) ou entre V1 et V3 (Fig. 13).<br />
A V3, 61 % (17 sur 28) ont eu une majoration <strong>de</strong> leur taux sérique <strong>de</strong> V2 à V3 (Fig. 12).<br />
Figure 12 : Evolution du taux <strong>de</strong> vitamine D chez les patientes ayant un taux inférieur à<br />
75 nmol/l à V2 avec une majoration entre V2 et V3 (n=17).<br />
120<br />
taux <strong>de</strong> vitamine D (nmol/l)<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
1° 2° 3° 4°<br />
visite<br />
59
Figure 13 : Evolution du taux <strong>de</strong> vitamine D chez les patientes ayant un taux inférieur à<br />
75 nmol/l à V2 avec une majoration entre V1 et V3 (n=11).<br />
taux <strong>de</strong> vitamine D (nmol/l)<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1° 2° 3° 4°<br />
visite<br />
II / Le taux <strong>de</strong> PTH<br />
Comme prévu dans le schéma <strong>de</strong> suivi, le taux <strong>de</strong> PTH <strong>de</strong>vait être effectué lors <strong>de</strong> V1 et <strong>de</strong><br />
V4. Il n’était pas obligatoire à chaque visite pour <strong><strong>de</strong>s</strong> raisons économiques. Le praticien était<br />
libre <strong>de</strong> le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r au cours <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> s’il le jugeait nécessaire.<br />
Lors <strong>de</strong> V1, le taux moyen était <strong>de</strong> 58 ng/l avec un écart-type <strong>de</strong> 26,4 ng/l, un minimum à 16<br />
et un maximum à 147 ng/l. Le taux <strong>de</strong> PTH a été effectué chez 56 patientes à V2. Son taux<br />
moyen était alors <strong>de</strong> 52,6 ng/l. Lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> troisième visite, sur 37 patientes le taux moyen était<br />
à 54, 3 ng/l. Enfin à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière consultation, le dosage a été effectué auprès <strong>de</strong> 20 patientes.<br />
La moyenne était <strong>de</strong> 54,8 ng/l avec un écart-type à 22, 3 pour un minimum à 25 et un<br />
maximum à 125 ng/l.<br />
60
Figure 14 : Représentation du taux <strong>de</strong> PTH en fonction du temps<br />
taux <strong>de</strong> PTH (ng/l)<br />
59<br />
58<br />
57<br />
56<br />
55<br />
54<br />
53<br />
52<br />
51<br />
50<br />
49<br />
1 2 3 4<br />
visite<br />
Figure 15 : Evolution combinée du taux <strong>de</strong> vitamine D et du taux <strong>de</strong> PTH en fonction du<br />
temps<br />
59<br />
90<br />
58<br />
80<br />
taux <strong>de</strong> PTH (ng/l)<br />
57<br />
56<br />
55<br />
54<br />
53<br />
52<br />
51<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
taux <strong>de</strong> vitamine D (nmol/l)<br />
50<br />
10<br />
49<br />
1 2 3 4<br />
0<br />
visite<br />
taux <strong>de</strong> PTH<br />
vitamine D<br />
61
III / L’EVA douleur et l’EVA fatigue<br />
Ces <strong>de</strong>ux paramètres <strong>de</strong>vaient juger <strong>de</strong> l’efficacité clinique <strong>de</strong> <strong>la</strong> supplémentation. Ces<br />
échelles ont été insuffisamment pratiquées pour mettre en évi<strong>de</strong>nce un bénéfice du traitement.<br />
En effet l’EVA douleur a été effectuée chez 163 patientes lors <strong>de</strong> V1 avec un taux moyen à<br />
2,5. Lors <strong>de</strong> V2, l’EVA moyenne était <strong>de</strong> 2,0 chez 88 patientes. A V3, 32 patientes ont eu une<br />
EVA puis à V4 seulement 11 patientes. Le taux moyen était alors respectivement à 2,9 puis<br />
2,5.<br />
La discordance entre nos attentes et les résultats est simi<strong>la</strong>ire pour l’EVA fatigue. Lors <strong>de</strong> V1<br />
sur 114 patientes, l’EVA était à 2,5 puis augmentait à 2,9 <strong>de</strong> moyenne pour 72 patientes à V2.<br />
31 patientes ont eu une EVA fatigue moyenne à 2,7 à V3. Enfin 10 patientes ont une EVA<br />
fatigue moyenne à 2,8 en fin d’étu<strong>de</strong>.<br />
IV / La qualité <strong>de</strong> vie et le SF 12<br />
Nous avons étudié les scores résumé physique (PCS) et mental (MCS) avant et après<br />
traitement <strong>de</strong> <strong>la</strong> carence. La comparaison a été faite sur 60 dossiers. Nous n’avons pas pu<br />
mettre en évi<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> différence à cause <strong>de</strong> ce faible effectif. La p-value du test <strong>de</strong> wilcoxon<br />
est <strong>de</strong> 0,91 pour le PCS et <strong>de</strong> 0,94 pour le MCS.<br />
En début d’étu<strong>de</strong>, <strong>la</strong> moyenne pour le PCS était <strong>de</strong> 47,8 ; elle passait à 48,02 en fin d’étu<strong>de</strong>.<br />
La majoration est également faible pour le MCS qui évolue <strong>de</strong> 41,35 à 41,8.<br />
D’un point <strong>de</strong> vue <strong><strong>de</strong>s</strong>criptif, environ autant <strong>de</strong> femmes ont montré une augmentation du PCS<br />
(n=31) qu’une diminution (n=29). Mais les femmes ayant montré une amélioration <strong>de</strong> leur<br />
score physique sont celles qui ont eu une plus gran<strong>de</strong> hausse <strong>de</strong> leur taux <strong>de</strong> vitamine D entre<br />
le début <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> et <strong>la</strong> fin (taux <strong>de</strong> vitamine D à V3 – taux <strong>de</strong> vitamine D à V1). La médiane<br />
<strong>de</strong> ce différentiel est plus élevée parmi les femmes ayant un PCS augmenté par rapport à<br />
celles ayant un PCS diminué (36 contre 26).<br />
Cette remarque n’est pas va<strong>la</strong>ble pour le score résumé mental.<br />
62
E / Evolution en fonction du facteur <strong>de</strong> risque : port d’un<br />
vêtement couvrant<br />
I / Représentation <strong>de</strong> l’effectif <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes portant un vêtement couvrant<br />
Le nombre <strong>de</strong> patientes portant un vêtement couvrant a diminué régulièrement <strong>de</strong> manière<br />
équivalente aux patientes non voilées.<br />
Tableau 16 : Effectif <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes non voilées comparé aux patientes voilées en fonction <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
visites.<br />
visite patientes non voilées patientes voilées total<br />
1 130 53 183<br />
2 81 32 113<br />
3 50 15 65<br />
4 22 8 30<br />
Le taux <strong>de</strong> représentation <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes voilées par rapport aux patientes non voilées varie peu.<br />
Il est maximum à V1 avec environ 29 %, et minimum avec 23,1 % à V3.<br />
Figure 17 : Représentation du pourcentage <strong>de</strong> femmes portant le vêtement couvrant ou non<br />
lors <strong>de</strong> chaque visite.<br />
100%<br />
pourcentage <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
patientes voilées<br />
patientes non voilées<br />
0%<br />
1 2 3 4<br />
visite<br />
63
II / Evolution du taux <strong>de</strong> vitamine D chez ces patientes à risque<br />
a ) Avec 53 nmol/l comme valeur seuil<br />
Parmi les 92 patientes (cf. tableau 10) ayant un taux <strong>de</strong> vitamine D supérieur à 53 nmol/l lors<br />
<strong>de</strong> V2, on retrouve 22 patientes couvertes, soit 23,9%, par rapport à 70 patientes non<br />
couvertes, soit 76,1 % (Fig. 18).<br />
Figure 18 : Représentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> proportion <strong>de</strong> femmes portant un vêtement couvrant ayant<br />
un taux sérique <strong>de</strong> vitamine D supérieur à 53 nmol/l à V2<br />
avec vêtement couvrant<br />
sans vêtement couvrant<br />
A V3, parmi les 48 femmes ayant un taux <strong>de</strong> vitamine D supérieur à 53 nmol/l, 10 patientes<br />
portent un vêtement couvrant soit 20,8 % contre 79,2 % ne portant pas <strong>de</strong> vêtement couvrant.<br />
A V2, il y a donc 22 patientes couvertes parmi les 32 patientes couvertes qui ont un taux<br />
supérieur à 53 nmol/l soit 68,8 % par rapport aux 70 non couvertes sur l’ensemble <strong><strong>de</strong>s</strong> 81<br />
patientes non couvertes soit 86,4 % (Fig. 19).<br />
64
Figure 19 : Représentation <strong><strong>de</strong>s</strong> proportions <strong>de</strong> patientes atteignant <strong>la</strong> valeur seuil <strong>de</strong> 53 nmol/l<br />
à V2 chez les patientes portant un vêtement couvrant ou non.<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
patientes non voilées<br />
patientes voilées<br />
>53 70 22<br />
< 53 11 10<br />
En terme <strong>de</strong> proportion, les femmes voilées sont donc moins nombreuses à atteindre <strong>la</strong><br />
valeur seuil parmi l’ensemble <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes suivies mais elles sont également moins<br />
nombreuses dans leur catégorie.<br />
65
) Avec 75 nmol/l comme valeur seuil<br />
Parmi les 69 patientes (cf. tableau 10) ayant un taux <strong>de</strong> vitamine D supérieur ou égal à<br />
75 nmol/l lors <strong>de</strong> V2, on retrouve 15 femmes portant un vêtement couvrant, soit 21,7 %, par<br />
rapport à 54 patientes non voilées, soit 78,3 % (Fig. 20).<br />
Figure 20 : Représentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> proportion <strong>de</strong> femmes portant un vêtement couvrant ayant un<br />
taux sérique <strong>de</strong> vitamine D supérieur ou égal à 75 nmol/l à V2<br />
avec vêtement couvrant<br />
sans vêtement couvrant<br />
La proportion est i<strong>de</strong>ntique à V3 avec 5 patientes voilées sur les 23 patientes ayant un taux<br />
sérique supérieur ou égal à 75 nmol/l, soit environ 22 %, contre 18 patientes pour les patientes<br />
non voilées.<br />
66
A V2, il y a 15 patientes couvertes sur 32 qui atteignent <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong> 75 nmol/l soit 46,9 %<br />
contre 54 patientes non couvertes sur 81 soit 66,7 % (Fig. 21).<br />
Figure 21 : Représentation <strong><strong>de</strong>s</strong> proportions <strong>de</strong> patientes atteignant <strong>la</strong> valeur seuil <strong>de</strong> 75 nmol/l<br />
à V2 chez les patientes portant un vêtement couvrant ou non.<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
patientes non voilées<br />
patientes voilées<br />
>75 54 15<br />
< 75 27 17<br />
67
Ce faible taux <strong>de</strong> patientes voilées atteignant une valeur « normale » <strong>de</strong> vitamine D s’observe<br />
également par l’étu<strong>de</strong> du taux moyen <strong>de</strong> vitamine D au cours du temps. En effet, lors <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
première visite, les patientes voilées étaient plus carencées que les autres patientes. Ceci a été<br />
montré dans l’étu<strong>de</strong> initiale VESTAL. Par contre, nous pouvons constater que, malgré <strong>la</strong><br />
supplémentation, le taux moyen <strong>de</strong> vitamine D chez ces patientes à risque est toujours<br />
inférieur à celui <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes non voilées (Fig. 22).<br />
Figure 22 : Représentation du taux moyen <strong>de</strong> vitamine D (nmol/l) en fonction du port ou non<br />
d’un vêtement couvrant au cours <strong><strong>de</strong>s</strong> visites.<br />
taux moyen <strong>de</strong> vitamine D (nmol/l)<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1 2 3 4<br />
Non voilées 33,76 85,58 69,88 76,86<br />
Voilées 20,27 68,07 63,07 68,13<br />
visite<br />
68
III / Nombre moyen d’ampoules consommées<br />
La carence chez les patientes avec un facteur <strong>de</strong> risque est donc plus profon<strong>de</strong> mais également<br />
plus difficile à corriger. L’étu<strong>de</strong> du nombre moyen d’ampoules prises par les patientes montre<br />
que les femmes portant un vêtement couvrant ont consommé plus d’ampoules <strong>de</strong><br />
vitamine D que les femmes sans vêtement couvrant.<br />
Figure 23 : nombre moyen d’ampoules <strong>de</strong> vitamine D prises par les patientes en fonction du<br />
port ou non d’un vêtement couvrant au cours <strong><strong>de</strong>s</strong> visites.<br />
4<br />
3,9<br />
Nombre moyen d'ampoules prises<br />
3<br />
2<br />
1<br />
2,7<br />
0,9<br />
1,4<br />
1,7<br />
1,9<br />
Non voilées<br />
Voilées<br />
0<br />
1 2 3<br />
visite<br />
IV / /Evolution <strong>de</strong> l’EVA chez ces patientes à risque<br />
Chez les patientes portant un vêtement couvrant l’EVA fatigue moyenne à V1 était à 3,8 puis<br />
à V2 à 3,5 et enfin à V3 à 2,5. L’EVA douleur moyenne chez ces mêmes patientes était<br />
respectivement à 4,6 puis 3,3 et 3,7.<br />
69
Ceci est à comparer aux valeurs chez les patientes non couvertes où l’EVA fatigue moyenne<br />
était à 2,9 puis 3,1 et 2,5 alors que l’EVA douleur moyenne était à 2,5 puis 1,9 et au final à<br />
2,7 (Fig. 24 et 25).<br />
Figure 24 : Représentation <strong>de</strong> l’EVA fatigue moyenne chez les patientes voilées et chez les<br />
patientes non voilées.<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Non voilées<br />
Voilées<br />
1<br />
0<br />
1 2 3<br />
Figure 25 : Représentation <strong>de</strong> l’EVA douleur moyenne chez les patientes voilées et chez les<br />
patientes non voilées.<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Non voilées<br />
Voilées<br />
1<br />
0<br />
1 2 3<br />
70
V / Evolution du taux <strong>de</strong> PTH chez ces patientes à risque<br />
Le taux moyen <strong>de</strong> PTH chez les patientes portant un vêtement couvrant au cours <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong><br />
diminue. Au début, il est dosé à 61,23 ng/l puis à V2 il est à 60,78 ng/l et à V3 il est égal à<br />
53,18.<br />
Figure 26 : Représentation du taux <strong>de</strong> PTH chez les patientes voilées et chez les patientes non<br />
voilées.<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
Non voilées<br />
Voilées<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1 2 3<br />
F / Evolution en fonction du facteur <strong>de</strong> risque : phototype<br />
Pour simplifier <strong>la</strong> comparaison et <strong>la</strong> reproductibilité <strong><strong>de</strong>s</strong> travaux, les phototypes proches ont<br />
été appareillés en 4 groupes <strong>de</strong> manière i<strong>de</strong>ntique à l’étu<strong>de</strong> VESTAL. Ainsi le groupe 1<br />
comprend le phototype I et II, le 3 regroupe le III A et III B, le 4 comprend le phototype IV et<br />
V et le 6 reste VI.<br />
71
Tableau 27 : Effectifs <strong><strong>de</strong>s</strong> différents groupes <strong>de</strong> phototype à V3.<br />
groupe <strong>de</strong> phototypes effectif àV3 pourcentage<br />
1 7 10,80%<br />
3 35 53,80%<br />
4 18 27,70%<br />
6 2 3,10%<br />
DM 3 4,60%<br />
total 65 100 %<br />
Les proportions par rapport à l’effectif lors <strong>de</strong> V1 sont simi<strong>la</strong>ires.<br />
I / Evolution du taux moyen <strong>de</strong> vitamine D en fonction du phototype<br />
Figure 28 : Représentation du taux <strong>de</strong> vitamine en fonction du temps et du phototype.<br />
taux moyen <strong>de</strong> vitamine D (nmol/l)<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
visite 1 visite 2 visite 3<br />
phototype 1 29,86 85,86 71,14<br />
phototype 3 35,69 82,71 72,6<br />
phototype 4 23,11 77 64,39<br />
phototype 6 13 113 52,5<br />
La courbe représentant le phototype 6 est peu informative car elle est faite à partir <strong>de</strong><br />
seulement 3 % <strong>de</strong> l’effectif. Les pentes sont plus importantes que les trois autres courbes.<br />
72
Les groupes <strong>de</strong> phototypes 1, 3 et 4 ont une courbe simi<strong>la</strong>ire. Mais le groupe 4 évolue<br />
toujours dans <strong><strong>de</strong>s</strong> valeurs moins importantes que les groupes 1 et 3.<br />
G / Evolution en fonction d’un facteur socio-économique : <strong>la</strong> CMU<br />
Parmi les 65 patientes ayant effectué un dosage <strong>de</strong> vitamine D à V3, 51 patientes ne<br />
bénéficient pas <strong>de</strong> <strong>la</strong> CMU et 12 patientes en bénéficient.<br />
1 femme sur 2 bénéficiant <strong>de</strong> <strong>la</strong> CMU porte un vêtement couvrant et 2 femmes sur 3 ont un<br />
phototype à risque (groupes 4 et 6). Mais environ 83 % <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes bénéficiant <strong>de</strong> <strong>la</strong> CMU<br />
(10/12) ont au moins un facteur <strong>de</strong> risque (soit port d’un vêtement couvrant soit phototype à<br />
risque).<br />
Figure 29 : Représentation du taux moyen <strong>de</strong> vitamine D chez les patientes bénéficiant <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
CMU ou non.<br />
73
90<br />
80<br />
taux moyen <strong>de</strong> vitamine D (nmol/l)<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
visite 1 visite 2 visite 3<br />
pas CMU 33,29 81,56 71,76<br />
CMU 20,75 85,67 58,33<br />
Les patientes bénéficiant <strong>de</strong> <strong>la</strong> CMU sont donc plus carencées en vitamine D à V1 et à V3,<br />
alors que à V2, elles ont un niveau vitaminique proche <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes ne bénéficiant pas <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
CMU ; les pentes <strong>de</strong> <strong>la</strong> courbe sont donc plus importantes.<br />
DISCUSSION<br />
A / LIMITES<br />
I / Evolution <strong>de</strong> l’échantillon<br />
74
La principale limite <strong>de</strong> notre étu<strong>de</strong> est son manque <strong>de</strong> puissance du fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> faible taille <strong>de</strong><br />
l’échantillon final. En effet, si l’échantillon initial était <strong>de</strong> 186 patientes inclues, nous arrivons<br />
au final à 65 patientes ayant réalisé 3 ou 4 dosages <strong>de</strong> vitamine D.<br />
La perte <strong>de</strong> patientes provient probablement du fait que <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> n’a pas été<br />
suffisamment prise en compte lors <strong>de</strong> l’inclusion par les mé<strong>de</strong>cins et par les patientes.<br />
73 patientes (environ 40 %) ont stoppé l’étu<strong>de</strong> après avoir effectué un seul dosage.<br />
La majorité <strong><strong>de</strong>s</strong> personnes sorties en cours d’étu<strong>de</strong> sont <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes qualifiées <strong>de</strong> « mal<br />
observantes ». Il s’agit <strong>de</strong> patientes consultant toujours le même mé<strong>de</strong>cin traitant mais n’ayant<br />
pas effectué le prélèvement sanguin malgré les nombreuses <strong>de</strong>man<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong> leur mé<strong>de</strong>cin et <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
investigateurs. D’autres ne sont jamais venues chercher <strong>la</strong> prescription <strong>de</strong> vitamine D auprès<br />
<strong>de</strong> leur mé<strong>de</strong>cin.<br />
Malgré leur accord au début <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong>, les patientes inclues consultaient pour un problème <strong>de</strong><br />
santé autre. Cette popu<strong>la</strong>tion inclue est donc différente d’une popu<strong>la</strong>tion recrutée à l’ai<strong>de</strong> d’un<br />
questionnaire envoyé par courrier. Par exemple, dans l’étu<strong>de</strong> SUVIMAX sur 15 789<br />
candidats, 10 984 volontaires ont retourné le questionnaire ; du fait du mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> recrutement<br />
<strong>de</strong> cette cohorte, <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion dans l’étu<strong>de</strong> SUVIMAX est plus « <strong>de</strong>man<strong>de</strong>use » que <strong>la</strong> nôtre<br />
pour participer à une étu<strong>de</strong> et <strong>la</strong> suivre (27).<br />
De plus <strong>la</strong> prise en charge <strong>de</strong> l’hypovitaminose D est confrontée, comme dans d’autres<br />
pathologies chroniques type diabète ou hypertension artérielle, à un problème <strong>de</strong> mauvaise<br />
observance. Celle-ci a aussi pu être majorée dans cette étu<strong>de</strong> par le manque <strong>de</strong> connaissance<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong><strong>de</strong>s</strong> mé<strong>de</strong>cins et <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes <strong>de</strong> <strong>la</strong> morbidité liée à l’hypovitaminose D. Le<br />
traitement <strong>de</strong> <strong>la</strong> carence a pu apparaître comme n’étant pas prioritaire par rapport à d’autres<br />
pathologies.<br />
Le manque d’observance <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes a pu être lié également à une perte <strong>de</strong> motivation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
part <strong>de</strong> certains mé<strong>de</strong>cins qui me signa<strong>la</strong>ient <strong>la</strong> difficulté <strong>de</strong> réaliser le suivi. En effet, le suivi<br />
était « chronophage » pour tous les mé<strong>de</strong>cins, il nécessitait <strong>de</strong> contacter régulièrement les<br />
patientes afin qu’elles effectuent leur prise <strong>de</strong> sang puis qu’elles viennent retirer leurs<br />
prescriptions. Ce point met en évi<strong>de</strong>nce <strong>la</strong> difficulté d’effectuer <strong><strong>de</strong>s</strong> étu<strong><strong>de</strong>s</strong> prospectives <strong>de</strong><br />
longue durée en mé<strong>de</strong>cine générale et <strong>de</strong> manière bénévole.<br />
75
Toutefois ce faible effectif final est proche <strong>de</strong> l’effectif <strong>de</strong> nombreuses étu<strong><strong>de</strong>s</strong> publiées en<br />
soins primaires qui sont <strong><strong>de</strong>s</strong> séries <strong>de</strong> cas avec 50 à 80 patientes inclues (49, 53, 75).<br />
Par exemple, Reinhold Vieth et al. ont étudié un schéma <strong>de</strong> supplémentation sur 5 mois avec<br />
61 patients, 30 d’entre eux ont effectué l’étu<strong>de</strong> en totalité (76).<br />
II / Evaluation <strong><strong>de</strong>s</strong> signes cliniques<br />
a ) La douleur et l’asthénie<br />
L’échelle visuelle analogique (EVA) s’est avérée être un mauvais outil pour cette étu<strong>de</strong>. La<br />
qualité <strong>de</strong> l’EVA est reconnue et pratiquée <strong>de</strong> manière courante dans <strong>de</strong> nombreuses situations<br />
cliniques mais <strong>la</strong> douleur doit être localisée et caractérisée, ce qui n’est pas le cas <strong><strong>de</strong>s</strong> douleurs<br />
liées à l’hypovitaminose D qui provoque <strong><strong>de</strong>s</strong> douleurs ostéo-muscu<strong>la</strong>ires diffuses. L’EVA<br />
permet <strong>de</strong> juger l’évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> douleur et le bénéfice d’un traitement antalgique lorsqu’elle<br />
est utilisée <strong>de</strong> manière rapprochée comme pour les titrations morphiniques par exemple. Le<br />
schéma <strong>de</strong> notre étu<strong>de</strong> ne permettait pas une telle utilisation.<br />
Il s’agit également d’un outil qui nécessite une pratique régulière <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong><strong>de</strong>s</strong> mé<strong>de</strong>cins et<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> patientes afin d’assurer une reproductibilité et une fiabilité. Ainsi, certaines patientes ont<br />
présenté <strong><strong>de</strong>s</strong> difficultés à chiffrer leur douleur. Nous obtenons un taux <strong>de</strong> participation très<br />
faible ; pour l’EVA douleur nous passons <strong>de</strong> 163 réponses lors <strong>de</strong> V1 à 32 réponses lors <strong>de</strong><br />
V3, et <strong>de</strong> 114 à 31 pour l’EVA fatigue.<br />
Les limites <strong>de</strong> l’EVA pour cette étu<strong>de</strong> étaient déjà repérées lors <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> VESTAL, mais<br />
afin <strong>de</strong> respecter le schéma mis en p<strong>la</strong>ce et <strong>de</strong> permettre une comparaison <strong><strong>de</strong>s</strong> données, il était<br />
préférable <strong>de</strong> conserver cet outil.<br />
b ) La qualité <strong>de</strong> vie<br />
Ce critère était étudié par le questionnaire SF 12. Le choix a été fait lors <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> VESTAL<br />
pour ses qualités <strong>de</strong> faisabilité, <strong>de</strong> fiabilité et aussi son gain <strong>de</strong> temps par rapport au SF 36.<br />
Mais son analyse nécessite <strong><strong>de</strong>s</strong> effectifs <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> taille avec <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong> sous-effectifs<br />
par tranches d’âge (77).<br />
Etant donné le manque <strong>de</strong> puissance <strong>de</strong> notre étu<strong>de</strong>, le SF 12 n’a pas pu mettre en évi<strong>de</strong>nce <strong>de</strong><br />
différence sur <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> vie physique ou morale.<br />
76
B / BIAIS<br />
I / Biais <strong>de</strong> sélection<br />
On peut se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r qu’elle est <strong>la</strong> représentativité <strong><strong>de</strong>s</strong> 65 patientes par rapport aux 186<br />
initiales C’est pourquoi nous avons comparé les patientes <strong>de</strong> <strong>la</strong> première visite qui sont<br />
revenues à V3 et celles qui ne sont pas revenues à V3 (cf. tableau 7). Entre ces <strong>de</strong>ux groupes,<br />
nous n’avons pas pu mettre en évi<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> différence significative que ce soit sur les signes<br />
cliniques (douleurs, asthénie), sur les facteurs <strong>de</strong> risque (port d’un vêtement couvrant ou<br />
phototype foncé) ou sur un critère socio-économique comme <strong>la</strong> CMU.<br />
II / Biais <strong>de</strong> mémoire<br />
Au cours <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong>, l’EVA était réalisée au minimum à trois mois d’intervalle. Sans<br />
oublier les limites <strong>de</strong> cet outil, il semble évi<strong>de</strong>nt qu’il existe un biais <strong>de</strong> mémoire sur <strong>la</strong> note<br />
attribuée aux douleurs ou à <strong>la</strong> fatigue en l’espace <strong>de</strong> trois mois.<br />
Un autre biais <strong>de</strong> mémoire possible concerne l’observance du traitement prescrit. Les<br />
patientes <strong>de</strong>vaient donner le nombre d’ampoules prises entre chaque visite. Si cette donnée<br />
était manquante, nous interrogions à nouveau les patientes lors du questionnaire final. Le biais<br />
semble donc exister entre les ampoules prises, les ampoules achetées mais non prises et les<br />
ampoules prescrites mais non données par le pharmacien par exemple.<br />
Pour limiter ce biais, nous avons joint régulièrement les mé<strong>de</strong>cins investigateurs ou les<br />
patientes afin <strong>de</strong> connaître le nombre d’ampoules prescrites et le nombre d’ampoules prises.<br />
III / Biais <strong>de</strong> c<strong>la</strong>ssement<br />
Le schéma <strong>de</strong> suivi théorique mis en p<strong>la</strong>ce consistait à effectuer un dosage biologique <strong>de</strong><br />
vitamine D tous les trois mois. Ce schéma n’a pas été respecté par les patientes. Comme nous<br />
77
pouvons le voir sur le tableau 6, le premier dosage <strong>de</strong>vait être effectué au cours du premier<br />
trimestre 2008 ce qui a été fait pour <strong>la</strong> majorité. Mais seulement 29 dosages sur 65 et 15 sur<br />
65 ont été effectués dans l’intervalle <strong>de</strong> temps imparti respectivement pour le second et le<br />
troisième dosage. Le <strong>la</strong>ps <strong>de</strong> temps entre 2 prises <strong>de</strong> sang augmente alors que le taux <strong>de</strong><br />
vitamine D diminue avec le temps. L’efficacité du traitement est donc probablement sousestimée.<br />
Nous étudions plus une cinétique globale du taux <strong>de</strong> vitamine D qu’un intervalle <strong>de</strong><br />
temps précis.<br />
Dans le but <strong>de</strong> limiter cet allongement <strong>de</strong> temps entre 2 biologies, nous avions mis en p<strong>la</strong>ce un<br />
p<strong>la</strong>nning <strong>de</strong> suivi <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes avec <strong><strong>de</strong>s</strong> dates pour les contacter ; certains mé<strong>de</strong>cins<br />
envoyaient les ordonnances pour effectuer le prélèvement mais <strong>la</strong> solution <strong>la</strong> plus efficace<br />
aurait été que les mé<strong>de</strong>cins prélèvent eux-mêmes l’échantillon sanguin. L’évolution <strong>de</strong> notre<br />
profession rend cette solution difficile sauf pour un cabinet médical associé à un cabinet<br />
infirmier.<br />
C / Traitement d’une hypovitaminose D<br />
Les recommandations actuelles <strong>de</strong> supplémentation d’une carence chez l’adulte sont en<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong>sous du schéma thérapeutique mis en p<strong>la</strong>ce au cours <strong>de</strong> notre étu<strong>de</strong>. Par exemple le Vidal<br />
recomman<strong>de</strong> une prise <strong>de</strong> 100 000 UI tous les 3 mois en prophy<strong>la</strong>xie ou 1 à 2 ampoules <strong>de</strong><br />
100 000 UI par mois en curatif selon <strong>la</strong> carence. Cette faible posologie recommandée est<br />
donc un frein pour <strong>la</strong> plupart <strong><strong>de</strong>s</strong> mé<strong>de</strong>cins prescripteurs <strong>de</strong> vitamine D et pour les<br />
pharmaciens qui <strong>la</strong> délivrent. De même, une étu<strong>de</strong> effectuée dans un service <strong>de</strong> rhumatologie<br />
a trouvé une forte prévalence d’hypovitaminose et ce malgré une supplémentation <strong>de</strong> 800 UI/j<br />
pour le groupe <strong>de</strong> patients ostéoporotiques (78).<br />
78
Lors <strong>de</strong> l’é<strong>la</strong>boration du schéma <strong>de</strong> supplémentation, nous nous sommes basés sur l’analyse<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> littérature scientifique. Ainsi l’équipe du Dr Souberbielle et al. conseille l’utilisation<br />
d’une dose <strong>de</strong> charge afin <strong>de</strong> remonter rapi<strong>de</strong>ment le taux <strong>de</strong> vitamine D qui varie en fonction<br />
du taux initial <strong>de</strong> vitamine (17).<br />
Pour les patientes ayant un taux inférieur à 30 nmol/l, notre schéma conseil<strong>la</strong>it <strong>de</strong> prescrire<br />
100 000 UI tous les 15 jours pendant 2 mois soit 400 000 UI ; pour les patientes ayant un taux<br />
<strong>de</strong> vitamine D compris entre 30 et 53 nmol/l 100 000 UI tous les mois pendant 2 mois soit<br />
200 000 UI ; pour les patientes entre 53 et 75 nmol/l une ampoule <strong>de</strong> 100 000 UI en une fois.<br />
Grâce à l’application <strong>de</strong> ce protocole, les patientes inclues ont majoré <strong>de</strong> manière<br />
significative leur taux <strong>de</strong> vitamine D puisque le taux moyen lors du premier dosage était <strong>de</strong><br />
30,4 nmol/l pour augmenter à 82,1 nmol/l <strong>de</strong> moyenne au second dosage (Fig. 8 et 9)<br />
Par contre pour les patientes ayant un taux supérieur à 75 nmol/l, notre schéma conseil<strong>la</strong>it <strong>de</strong><br />
ne pas prescrire <strong>de</strong> dose <strong>de</strong> vitamine D, ce qui a été le cas pour 37 patientes sur 65 patientes<br />
ayant effectué 3 dosages (soit 57 %). Parmi ces 37 patientes, 70 % lors du troisième dosage<br />
ont vu leur taux sérique passer en <strong><strong>de</strong>s</strong>sous <strong>de</strong> 75 nmol/l. (Fig. 9 et 11) Cette variation en<br />
« <strong>de</strong>nts <strong>de</strong> scie » du taux sérique montre l’importance d’une dose initiale adaptée à <strong>la</strong><br />
carence mais aussi l’importance d’une prise régulière <strong>de</strong> vitamine D par <strong>la</strong> suite.<br />
En effet, Souberbielle et al. préconisent <strong>la</strong> prescription d’une dose régulière <strong>de</strong> vitamine D<br />
afin <strong>de</strong> maintenir le taux sérique dans <strong><strong>de</strong>s</strong> valeurs normales. Cette dose serait soit mensuelle<br />
avec 100 000 UI tous les 2 ou 3 mois, soit quotidienne avec 800 à 1 200 UI/j en fonction <strong>de</strong><br />
l’observance (17).<br />
En ce qui les concerne, Ish-Shalom S. et al. ont montré que <strong>la</strong> dose totale administrée est<br />
plus importante que l’intervalle <strong>de</strong> prise. Dans leur étu<strong>de</strong>, ils ont prescrit à 3 groupes<br />
différents pendant 2 mois soit 1 500 UI/j, soit 10 500 UI/semaine, soit 45 000 UI tous les 28<br />
jours. Le taux <strong>de</strong> vitamine D a augmenté <strong>de</strong> manière significative dans l’ensemble <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
groupes, sans différence significative entre chaque groupe (79).<br />
Reinhold Vieth et al. ont étudié un protocole <strong>de</strong> supplémentation sur 61 patients avec biologie<br />
<strong>de</strong> contrôle mensuel à partir du mois <strong>de</strong> janvier, sans étudier <strong>la</strong> présence ou non <strong>de</strong> facteurs <strong>de</strong><br />
risque. Le taux <strong>de</strong> vitamine D moyen initial était plus élevé dans cette étu<strong>de</strong> que dans <strong>la</strong> nôtre<br />
(40,7 vs 30,4 nmol/l ). L’étu<strong>de</strong> a été réalisée en double aveugle avec 2 dosages différents <strong>de</strong><br />
supplémentation soit 25 µg/j (1 000 UI/j) soit 100 µg/j (4 000 UI/j). Le taux sérique du groupe<br />
recevant 4 000 UI/j augmentait plus rapi<strong>de</strong>ment pour atteindre un pic à trois mois avec<br />
96,4 +/- 14,6 nmol/l. Les auteurs ont conclu que <strong>la</strong> prise quotidienne <strong>de</strong> 1 000 UI/j offre<br />
l’assurance d’un taux sérique <strong>de</strong> vitamine D supérieur à 40 nmol/l mais ne garantit pas que <strong>la</strong><br />
79
plupart <strong><strong>de</strong>s</strong> sujets atteindrait une valeur supérieure à 75 nmol/l, à l’inverse d’une prise <strong>de</strong><br />
4 000 UI/j (76).<br />
Robert P Heaney et al. ont également démontré l’intérêt d’une supplémentation à forte dose<br />
sur 67 patients recevant 0, 25, 125 ou 250 µg/j (0, 1 000, 5 000 ou 10 000 UI/j) pendant<br />
20 semaines au cours <strong>de</strong> l’hiver. Cette étu<strong>de</strong> leur a permis <strong>de</strong> conclure que les hommes sains<br />
utilisent <strong>de</strong> 3 000 à 5 000 UI/j. La majorité <strong>de</strong> cette consommation au cours <strong>de</strong> l’hiver<br />
provient <strong><strong>de</strong>s</strong> réserves produites par <strong>la</strong> synthèse cutanée au cours <strong>de</strong> l’été. Ils justifient alors <strong>la</strong><br />
majoration <strong><strong>de</strong>s</strong> apports <strong>de</strong> vitamine D chez les patients ayant une absence <strong>de</strong> synthèse cutanée<br />
(54).<br />
Hussein F Saadi et al. ont montré l’efficacité simi<strong>la</strong>ire d’une prise quotidienne <strong>de</strong> 2 000 UI/j<br />
<strong>de</strong> vitamine D2 ou d’une prise mensuelle <strong>de</strong> 60 000 UI/mois <strong>de</strong> vitamine D2. La prise<br />
mensuelle aurait donc un avantage en cas <strong>de</strong> mauvaise observance. Cette étu<strong>de</strong> a été réalisée<br />
dans les Emirats Arabes Unis et confirme <strong>la</strong> forte prévalence <strong>de</strong> <strong>la</strong> carence en vitamine D dans<br />
ces pays avec un taux moyen <strong>de</strong> vitamine D à l’inclusion proche <strong>de</strong> 19 nmol/l. Mais avec une<br />
telle supplémentation, seulement un tiers <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes atteignent un taux supérieur à<br />
50 nmol/l à 3 mois. La supplémentation en vitamine D chez les patientes peu exposées au<br />
soleil doit donc être faite <strong>de</strong> manière plus importante (80).<br />
Holick MF et al. proposent <strong>de</strong> traiter une hypovitaminose D par 50 000 UI/semaine pendant 8<br />
semaines pour atteindre un taux entre 75 et 125 nmol/l, puis en fonction du second dosage <strong>la</strong><br />
possibilité <strong>de</strong> donner une dose <strong>de</strong> 50 000 UI toutes les 2 semaines (11).<br />
John F Aloia et al. ont étudié <strong>la</strong> dose <strong>de</strong> vitamine D nécessaire pour atteindre un taux sérique<br />
supérieur à 75 nmol/l. Un protocole a été mis en p<strong>la</strong>ce et analysé sur 6 mois auprès <strong>de</strong><br />
138 patients. Pour un taux initial entre 50 et 80 nmol/l les patients recevaient 50 µg/j<br />
(2 000 UI/j), pour un taux inférieur à 50 nmol/l ils recevaient 100 µg/j (4 000 UI/j). Toutes les<br />
8 semaines, <strong>la</strong> posologie était adaptée en fonction du taux. Si le taux était inférieur à<br />
50 nmol/l, ils augmentaient <strong>la</strong> posologie <strong>de</strong> 50 µg/j ; si le taux était compris entre 80 et<br />
140 nmol/l, <strong>la</strong> posologie restait i<strong>de</strong>ntique ; si le taux était supérieur à 140 nmol/l, <strong>la</strong> dose était<br />
diminuée <strong>de</strong> 50 µg/j. En conséquence, ils recomman<strong>de</strong>nt pour les patients ayant un taux<br />
supérieur à 55 nmol/l une prise <strong>de</strong> 95 µg/j (3 800 UI/j) et une prise <strong>de</strong> 125 µg/j (5 000 UI/j)<br />
pour ceux ayant un taux inférieur à 55 nmol/l (66).<br />
80
D / Traitement d’une hypovitaminose dans une popu<strong>la</strong>tion à<br />
risque<br />
Nous avons montré au cours <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> que les patientes à risque ont une carence en<br />
vitamine D plus profon<strong>de</strong> et nécessitent donc <strong><strong>de</strong>s</strong> doses <strong>de</strong> vitamine D plus importantes.<br />
Pour <strong>la</strong> valeur seuil <strong>de</strong> 53 nmol/l lors du second dosage, environ 69 % <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes voilées<br />
ont un taux supérieur à 53 nmol/l contre 86 % <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes non voilées (Fig. 19). Cet écart <strong>de</strong><br />
proportion est majoré si <strong>la</strong> valeur seuil est à 75 nmol/l avec 47 % contre 67 % (Fig. 21).<br />
De même, les courbes du taux <strong>de</strong> vitamine D chez les patientes voilées et les patientes non<br />
voilées nous montrent que les patientes à risque ont toujours un taux moyen inférieur à celui<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> autres patientes (Fig. 22). L’écart le plus important se situe lors <strong>de</strong> V2 avec environ<br />
86 nmol/l chez les patientes non voilées contre 68 nmol/l chez les patientes voilées, et bien<br />
que les patientes voilées aient eu en moyenne une dose <strong>de</strong> vitamine D plus forte que les autres<br />
patientes lors <strong>de</strong> V1 avec 3,9 ampoules par femme voilée contre 2,7 ampoules par femme non<br />
voilée (Fig. 23).<br />
Cette différence entre femmes à risque et femmes non à risque est également observable pour<br />
les femmes ayant un phototype à risque. Dans notre étu<strong>de</strong>, les phototypes à risque ont été<br />
définis lors <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> VESTAL, il s’agit <strong><strong>de</strong>s</strong> groupes 4 et 6 (mais l’analyse <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier est<br />
impossible car basée sur 2 patientes) (41). Sur <strong>la</strong> figure 28, nous constatons donc que les<br />
patientes avec un phototype 4 se situent toujours dans <strong><strong>de</strong>s</strong> valeurs inférieures à celles <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
phototypes non à risque.<br />
Ces données sont également retrouvées par Bess Dawson-Hughes lors d’une analyse <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
littérature. En comparant une popu<strong>la</strong>tion à phototype noir avec une popu<strong>la</strong>tion à phototype<br />
c<strong>la</strong>ir, il a été démontré que les patients à phototype foncé ont un taux <strong>de</strong> vitamine D plus<br />
bas que les autres avec environ 30 nmol/l contre 58 nmol/l en hiver. La différence se<br />
retrouve également sur les mois d’été d’autant plus que <strong>la</strong> variation saisonnière est moins<br />
marquée chez les patients à phototype foncé (81). L’auteur suggère alors <strong>de</strong> prendre en<br />
compte cette différence lors <strong><strong>de</strong>s</strong> recommandations.<br />
81
E / Surdosage et toxicité<br />
Au cours <strong>de</strong> notre étu<strong>de</strong>, seulement 2 patientes parmi les 187 inclues ont atteint un taux <strong>de</strong><br />
vitamine D supérieur à 200 nmol/l. La première patiente a dépassé ce seuil lors <strong>de</strong> V3 avec un<br />
dosage à 234 nmol/l, <strong>la</strong> secon<strong>de</strong> lors <strong>de</strong> V4 avec 233 nmol/l. On note également 2 patientes<br />
proches <strong>de</strong> 200 nmol/l lors <strong>de</strong> V2 avec un dosage à 188 nmol/l pour l’une et à 191 nmol/l pour<br />
l’autre. Malgré ces valeurs limites, aucun effet secondaire n’a été signalé par les<br />
investigateurs.<br />
La patiente ayant atteint 234 nmol/l est une patiente non voilée avec un phototype 3A. Elle a<br />
reçu uniquement 2 ampoules <strong>de</strong> 100 000 UI suite à son premier dosage pathologique avec<br />
32 nmol/l en mars 2008. Le second dosage, s’élevant avec 188 nmol/l en juin 2008, n’a pas<br />
engendré <strong>de</strong> prescription. Mais en septembre 2008 le troisième dosage était <strong>de</strong> 234 nmol/l.<br />
Etant donné les dates <strong>de</strong> prélèvements, nous pouvons nous interroger sur le lien entre<br />
exposition so<strong>la</strong>ire et synthèse cutanée. En effet, l’exposition so<strong>la</strong>ire peut produire <strong><strong>de</strong>s</strong> taux <strong>de</strong><br />
vitamine D élevés supérieurs à 200 nmol/l sans provoquer d’hypercalcémie comme l’indique<br />
Reinhold Vieth (76).<br />
MF Holick a montré qu’une fois le taux <strong>de</strong> précurseur <strong>de</strong> vitamine D atteint, ce <strong>de</strong>rnier est<br />
dégradé en métabolites inactifs. De ce fait, un surdosage en vitamine D ne peut pas être lié à<br />
une surexposition so<strong>la</strong>ire (34).<br />
Pour le second cas supérieur à 200 nmol/l, il s’agit d’une patiente ayant les trois premiers<br />
dosages dans <strong><strong>de</strong>s</strong> valeurs correctes avec respectivement 38 nmol/l en mars 2008, 86 nmol/l en<br />
juillet 2008 et 53 nmol/l en décembre 2008. Le quatrième dosage est fortement élevé en mars<br />
2009 avec 233 nmol/l. Cette forte augmentation survient à <strong>la</strong> suite d’une prise trop importante<br />
<strong>de</strong> vitamine D prescrite par l’investigateur au cours <strong>de</strong> l’hiver.<br />
Ces valeurs sont élevées, mais elles restent en <strong><strong>de</strong>s</strong>sous <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur considérée comme limite<br />
supérieure soit 250 nmol/l, d’autant plus que cette valeur limite est remise en cause<br />
notamment par Glenville Jones. En effet, <strong><strong>de</strong>s</strong> étu<strong><strong>de</strong>s</strong> effectuées chez l’animal ou chez<br />
l’homme ont montré que le seuil pour <strong><strong>de</strong>s</strong> symptômes <strong>de</strong> toxicité se situerait à environ<br />
750 nmol/l. L’hypercalcémie n’apparaîtrait que pour <strong><strong>de</strong>s</strong> concentrations régulières <strong>de</strong><br />
vitamine D entre 375 et 500 nmol/l (82).<br />
82
Une étu<strong>de</strong> menée par Kara J Pepper et al. a examiné les protocoles <strong>de</strong> supplémentation les<br />
plus fréquemment prescrits dans les différents services <strong>de</strong> leur hôpital. 48 patients ont reçu<br />
450 000 UI sur 5 mois, 80 patients ont eu 300 000 UI sur 6 mois et 27 ont eu 900 000 UI sur<br />
6 semaines. Aucun dosage sérique n’a été signalé lors <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> (83).<br />
Selon MF Holick, les rares cas d’hypervitaminose D sont dûs à <strong><strong>de</strong>s</strong> ingestions acci<strong>de</strong>ntelles et<br />
nécessitent <strong><strong>de</strong>s</strong> doses importantes comme 50 000 UI/j pour augmenter le taux à plus <strong>de</strong><br />
374 nmol/l, alors que <strong><strong>de</strong>s</strong> doses <strong>de</strong> 10 000 UI/j ne seraient pas toxiques (2).<br />
Les articles relevant <strong><strong>de</strong>s</strong> cas d’hypervitaminose D sont étudiés par John N Hathcock et al. Ils<br />
confirment qu’il s’agit <strong>de</strong> séries <strong>de</strong> cas soit liés à une ingestion acci<strong>de</strong>ntelle soit liés à une<br />
interaction médicamenteuse (un thiazidique par exemple) soit liés à un terrain défavorable<br />
(une insuffisance rénale par exemple).<br />
Dans cette récente revue d’articles, les auteurs insistent également sur <strong>la</strong> différence entre<br />
hypervitaminose D, hypercalcémie et hypercalciurie. Le lien entre ces trois notions et <strong>la</strong><br />
formation <strong>de</strong> lithiase rénale est moins évi<strong>de</strong>nt qu’auparavant, l’hypercalciurie contribuerait<br />
davantage à <strong>la</strong> formation <strong>de</strong> lithiase que les <strong>de</strong>ux autres paramètres. Ils critiquent notamment<br />
une étu<strong>de</strong> récente ayant montré un lien entre supplémentation vitamino-calcique et calculs<br />
rénaux, mais le protocole <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière supplémentait les patientes avec seulement<br />
400 UI/j <strong>de</strong> vitamine D. A comparer aux nombreuses étu<strong><strong>de</strong>s</strong> expérimentales ayant administré<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> milliers d’unités par jour sans provoquer d’hypercalcémie ni <strong>de</strong> lithiase, il semble peu<br />
probable que le protocole <strong>de</strong> supplémentation <strong>de</strong> 400 UI/j soit responsable <strong>de</strong> l’augmentation<br />
du risque <strong>de</strong> lithiase. L’équipe <strong>de</strong> recherche suggère alors d’effectuer une étu<strong>de</strong> comparative<br />
d’un protocole <strong>de</strong> supplémentation entre <strong><strong>de</strong>s</strong> patients sujets à <strong>la</strong> formation <strong>de</strong> lithiase et <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
patients non sujets à <strong>la</strong> lithiase.<br />
Selon les auteurs, cette revue d’articles montre qu’une prise au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> 1 250 µg/j soit<br />
50 000 UI/j correspond à une dose toxique (NOAEL = No Observed Adverse Effect Level) ce<br />
qui permet <strong>de</strong> calculer <strong>la</strong> limite supérieure <strong>de</strong> dose tolérable (Tolerable Upper Intake Level ou<br />
UL) à 250 µg/j soit 10 000 UI/j (67).<br />
83
F / Traitement <strong>de</strong> l’hypovitaminose D et amélioration <strong><strong>de</strong>s</strong> signes<br />
cliniques<br />
Notre étu<strong>de</strong> n’a pas pu mettre en évi<strong>de</strong>nce une amélioration significative <strong><strong>de</strong>s</strong> signes cliniques<br />
(asthénie et douleurs) pour plusieurs raisons évoquées dans les chapitres Limites et Biais.<br />
Nous pouvons tout <strong>de</strong> même décrire une tendance. En effet, par l’étu<strong>de</strong> du SF-12,<br />
les patientes ayant eu une plus forte majoration <strong>de</strong> leur taux <strong>de</strong> vitamine D entre V1 et<br />
V3 sont celles qui ont présenté une amélioration <strong>de</strong> leur score résumé physique (PCS).<br />
Cette remarque ne se retrouve pas pour le score résumé mental (MCS) et montre que<br />
l’amélioration physique n’est pas en lien avec l’amélioration d’une pathologie psychique<br />
sous-jacente. Par contre, nous n’avons pas pu établir <strong>de</strong> différence pour le critère concernant<br />
les activités physiques (PF) comme ce<strong>la</strong> était le cas lors <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> VESTAL.<br />
L’EVA fatigue chez les patientes voilées a évolué <strong>de</strong> manière attendue puisqu’elle a baissé<br />
régulièrement au cours <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> ce qui n’a pas été le cas pour les patientes non voilées et<br />
pour l’EVA douleur chez les <strong>de</strong>ux groupes <strong>de</strong> patientes. Ceci peut peut-être s’expliquer par<br />
les doses trop faibles <strong>de</strong> vitamine D qui n’ont pas maintenu un taux suffisant <strong>de</strong> façon<br />
linaire au long <strong>de</strong> l’année, nous avons vu que les femmes à haut risque non supplémentées<br />
régulièrement voyaient leur taux sérique diminuer.<br />
Malgré ce manque d’évi<strong>de</strong>nce dans notre étu<strong>de</strong>, l’examen <strong>de</strong> <strong>la</strong> littérature internationale a<br />
démontré l’intérêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> supplémentation dans <strong>la</strong> prise en charge <strong><strong>de</strong>s</strong> douleurs chez les<br />
patientes carencées mais avec <strong>de</strong> fortes doses et un taux sérique maintenu élevé.<br />
De Torrenté <strong>de</strong> <strong>la</strong> Jara G et al. ont repéré 11 cas <strong>de</strong> patientes <strong>de</strong>man<strong>de</strong>uses d’asile dans un<br />
centre <strong>de</strong> premiers soins présentant <strong><strong>de</strong>s</strong> symptômes douloureux d’hypovitaminose D. Ils<br />
confirment le retard diagnostic <strong>de</strong> cette pathologie avec un temps moyen <strong>de</strong> diagnostic <strong>de</strong><br />
38 mois et 3 jours. Le premier diagnostic évoqué chez ces patientes était d’origine<br />
psychosomatique alors que le tableau d’hypovitaminose était bien défini (douleurs<br />
symétriques, débutant au bas du dos puis vers le bassin, les cuisses et les côtes, surtout au<br />
niveau <strong><strong>de</strong>s</strong> os et pas <strong><strong>de</strong>s</strong> articu<strong>la</strong>tions). Le taux moyen <strong>de</strong> vitamine D chez ces patientes étaient<br />
<strong>de</strong> 10,9 nmol/l. Un traitement par injection intra-muscu<strong>la</strong>ire mensuelle <strong>de</strong> 300 000 UI a été<br />
mis en p<strong>la</strong>ce ce qui a permis <strong>la</strong> disparition <strong><strong>de</strong>s</strong> symptômes chez <strong>la</strong> plupart <strong><strong>de</strong>s</strong> patientes en un<br />
à trois mois sauf pour une patiente qui a nécessité sept mois <strong>de</strong> traitement (84).<br />
84
R Vieth et al. ont montré à l’ai<strong>de</strong> d’une étu<strong>de</strong> randomisée l’effet d’une prise <strong>de</strong> vitamine D3<br />
sur le bien-être <strong><strong>de</strong>s</strong> patients. Deux effectifs <strong>de</strong> patients carencés ont été constitués, l’un<br />
prenant 15 µg/j soit 600 UI/j et l’autre prenant 100 µg/j soit 4 000 UI/j. Le bien-être a été<br />
évalué à l’ai<strong>de</strong> d’un questionnaire validé pour ce genre d’étu<strong>de</strong>. Sur <strong>la</strong> première pério<strong>de</strong><br />
d’étu<strong>de</strong>, <strong>la</strong> dose <strong>de</strong> 4 000 UI/j était plus efficace pour améliorer le bien-être <strong><strong>de</strong>s</strong> patients que <strong>la</strong><br />
dose <strong>de</strong> 600 UI/j. Sur <strong>la</strong> secon<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong>, les <strong>de</strong>ux doses ont été efficaces (p < 0,001)<br />
(85).<br />
Glerup H et al. ont étudié l’efficacité d’un traitement par supplémentation sur <strong>la</strong> myopathie lié<br />
à l’hypovitaminose D. Ils ont constitué <strong>de</strong>ux groupes <strong>de</strong> popu<strong>la</strong>tions : l’un <strong>de</strong> 55 femmes<br />
carencées et voilées vivant au Danemark et l’autre <strong>de</strong> 22 femmes danoises témoins. Ils ont<br />
mesuré les contractions volontaires muscu<strong>la</strong>ires et les stimuli électriques au niveau du<br />
quadriceps au début <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> puis 3 mois et 6 mois après avoir traité <strong>la</strong> carence. L’ensemble<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> paramètres muscu<strong>la</strong>ires testés était abaissé <strong>de</strong> manière significative chez les femmes<br />
voilées. Après 3 mois <strong>de</strong> traitement, les paramètres se sont améliorés <strong>de</strong> manière<br />
significative ; après 6 mois, tous les paramètres ont retrouvé <strong><strong>de</strong>s</strong> valeurs normales sauf <strong>la</strong><br />
contraction volontaire maximale qui persiste à <strong><strong>de</strong>s</strong> valeurs inférieures ( p < 0,02) (75).<br />
G / Traitement <strong>de</strong> l’hypovitaminose D et amélioration du taux<br />
sérique <strong>de</strong> PTH<br />
Notre étu<strong>de</strong> a confirmé que le taux sérique <strong>de</strong> vitamine D est inversement lié au taux<br />
sérique <strong>de</strong> PTH, comme le montre <strong>la</strong> figure 15. Le taux moyen <strong>de</strong> PTH était maximum lors<br />
<strong>de</strong> V1 avec 58 ng/l lorsque le taux moyen <strong>de</strong> vitamine D était au plus bas avec 30,4 nmol/l. La<br />
PTH moyenne était au minimum atteint dans cette étu<strong>de</strong> lors <strong>de</strong> V2 avec 52,6 ng/l quand le<br />
taux <strong>de</strong> vitamine D moyen était à son maximum avec 82,1 nmol/l. Malgré ces résultats, nous<br />
notons <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> quelques résultats paradoxaux pour lesquels nous ne trouvons pas<br />
d’explications, c’est à dire que <strong>la</strong> PTH augmente ou se stabilise à <strong><strong>de</strong>s</strong> valeurs hautes alors que<br />
le taux <strong>de</strong> vitamine D augmente.<br />
Cette re<strong>la</strong>tion inverse est <strong>la</strong>rgement admise dans <strong>la</strong> littérature internationale (86).<br />
Robert P Heaney et al. lors d’une étu<strong>de</strong> testant différents schémas <strong>de</strong> supplémentations ont<br />
montré l’importance <strong>de</strong> traiter une hypovitaminose D pour intervenir sur une<br />
hyperparathyroïdie secondaire. Les effectifs recevaient <strong><strong>de</strong>s</strong> doses <strong>de</strong> vitamine D différentes<br />
85
0, 25, 125 ou 250 µg/j (0, 1 000, 5 000 ou 10 000 UI/j) pendant 20 semaines au cours <strong>de</strong><br />
l’hiver.<br />
Ils ont constaté que le taux <strong>de</strong> PTH a augmenté <strong>de</strong> 6 % dans le groupe recevant 0 UI/j<br />
(p = 0,05), qu’il était inchangé dans les groupes intermédiaires et qu’il a chuté <strong>de</strong> 24 % dans<br />
le groupe 10 000 UI/j (p < 0,001). Mais dans tous les groupes, <strong>la</strong> variation <strong>de</strong> PTH était<br />
inversement corrélée aux taux <strong>de</strong> vitamine D (p < 0,01) (54).<br />
Lips P et al. ont fait <strong>la</strong> même constatation au cours d’une étu<strong>de</strong> comportant 7 564 patientes <strong>de</strong><br />
25 pays différents (p< 0,001). Après 6 mois <strong>de</strong> traitement par 400 à 600 UI/j, le taux <strong>de</strong> PTH a<br />
significativement diminué en fonction du taux <strong>de</strong> vitamine D au début <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong>. Lorsque le<br />
taux <strong>de</strong> vitamine D est inférieur à 25, compris entre 25 et 50 ou supérieur à 50 nmol/l, le taux<br />
<strong>de</strong> PTH diminue respectivement à 0,8-0,5-0,2 pmol/l (p < 0,001). La baisse du taux <strong>de</strong> PTH<br />
est d’autant plus importante que le taux <strong>de</strong> vitamine D initial est bas (87).<br />
En conclusion, <strong>la</strong> PTH évolue <strong>de</strong> manière inverse jusqu’à atteindre un p<strong>la</strong>teau au-<strong>de</strong>là<br />
duquel elle se stabilise malgré <strong>la</strong> hausse du taux <strong>de</strong> vitamine D.<br />
H / Valeur normale du taux sérique <strong>de</strong> vitamine D : 50 nmol/l ou<br />
75 nmol/l <br />
Pour définir le seuil inférieur <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D, les experts se sont basés sur <strong>de</strong>ux types<br />
d’arguments afin d’augmenter récemment les normes <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D sérique.<br />
D’un point <strong>de</strong> vue biologique, l’existence d’un p<strong>la</strong>teau pour <strong>la</strong> variation <strong>de</strong> <strong>la</strong> PTH en fonction<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D sérique est un argument pour déterminer <strong>la</strong> valeur seuil. D’après MF Holick<br />
et selon différentes étu<strong><strong>de</strong>s</strong>, cette valeur se situe aux alentours <strong>de</strong> 75 nmol/l (11).<br />
Une ancienne étu<strong>de</strong> publiée dans Lancet a pourtant retenu 50 nmol/l comme limite. En effet,<br />
Ma<strong>la</strong>banan et al. ont étudié <strong>la</strong> variation du taux <strong>de</strong> PTH en fonction du taux <strong>de</strong> départ <strong>de</strong><br />
vitamine D chez <strong><strong>de</strong>s</strong> patients recevant 50 000 UI/semaine <strong>de</strong> vitamine D pendant 8 semaines.<br />
Après supplémentation, le taux <strong>de</strong> PTH a diminué <strong>de</strong> 35 % pour un taux initial <strong>de</strong> vitamine D<br />
compris entre 27,5 et 40 nmol/l et <strong>de</strong> 26 % pour <strong><strong>de</strong>s</strong> valeurs comprises entre 40 et 50 nmol/l.<br />
Par contre, pour <strong><strong>de</strong>s</strong> valeurs supérieures à 50 nmol/l, le taux <strong>de</strong> PTH n’était pas<br />
significativement différent alors que le taux <strong>de</strong> vitamine D augmentait <strong>de</strong> 66 % (88).<br />
86
Un second argument biologique en faveur d’un taux sérique <strong>de</strong> vitamine D proche <strong>de</strong><br />
75 nmol/l concerne l’absorption optimale <strong>de</strong> calcium. En effet Heaney et al. ont démontré<br />
qu’une popu<strong>la</strong>tion ayant un taux <strong>de</strong> vitamine D moyen proche <strong>de</strong> 86 nmol/l avait une<br />
absorption intestinale <strong>de</strong> calcium meilleure qu’une popu<strong>la</strong>tion ayant un taux moyen <strong>de</strong><br />
50 nmol/l (p < 0,001) (89).<br />
Enfin, d’un point <strong>de</strong> vue clinique, <strong><strong>de</strong>s</strong> étu<strong><strong>de</strong>s</strong> ont montré l’intérêt d’un seuil à 75 nmol/. Ce<br />
seuil serait plus efficace afin <strong>de</strong> prévenir les chutes et le risque <strong>de</strong> fracture chez <strong>la</strong> personne<br />
âgée (14, 90). De nombreuses étu<strong><strong>de</strong>s</strong> d’observation ont également constaté le lien entre<br />
vitamine D et pathologies variées (cf. chapitre Données Générales)<br />
C’est ainsi qu’en 2005, un consensus d’experts a admis que 75 nmol/l <strong>de</strong>vaient être <strong>la</strong><br />
limite inférieure pour <strong>la</strong> vitamine D (25).<br />
87
CONCLUSIONS<br />
La vitamine D appelée également « vitamine du soleil » a une double origine soit<br />
exogène soit endogène. L’apport alimentaire ou exogène est faible dans nos pays car les<br />
aliments naturellement riches en vitamine D sont peu consommés et <strong>la</strong> supplémentation <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
aliments pauvres en vitamine D est faible. L’apport cutané ou endogène est majoritaire. Les<br />
rayons UVB permettent une transformation <strong><strong>de</strong>s</strong> précurseurs en pré-vitamine D3. Ensuite,<br />
l’ergocalciférol et le cholécalciférol vont subir une hydroxy<strong>la</strong>tion hépatique puis rénale pour<br />
<strong>de</strong>venir <strong><strong>de</strong>s</strong> composés actifs.<br />
L’activité principale <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D est son implication dans le métabolisme<br />
phosphocalcique. Elle stimule l’absorption calcique intestinale et inhibe <strong>la</strong> sécrétion <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
hormones para-thyroïdiennes. Un déficit en vitamine D favorise une ostéoma<strong>la</strong>cie liée à un<br />
défaut <strong>de</strong> minéralisation et une ostéoporose liée à l’hyperparathyroïdie secondaire. De par <strong>la</strong><br />
distribution ubiquitaire <strong><strong>de</strong>s</strong> récepteurs à vitamine D, l’hypovitaminose D serait impliquée dans<br />
d’autres pathologies notamment <strong><strong>de</strong>s</strong> cancers, <strong><strong>de</strong>s</strong> pathologies auto-immunes ou <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
pathologies cardio-vascu<strong>la</strong>ires.<br />
Des étu<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong> prévalence ont montré le caractère endémique <strong>de</strong> l’hypovitaminose D<br />
aussi bien au niveau régional avec les travaux <strong><strong>de</strong>s</strong> Docteurs BELAID et CONTARDO (étu<strong>de</strong><br />
VESTAL) qui trouvent respectivement 99 % et 98 % <strong>de</strong> femmes carencées, qu’au niveau<br />
national avec le Professeur CHAPUY (étu<strong>de</strong> SUVIMAX) pour qui 54,8 % <strong><strong>de</strong>s</strong> moins <strong>de</strong> 60<br />
ans ont un taux inférieur à 60 nmol/l. De même au niveau international, l’étu<strong>de</strong> NHANES III<br />
fait apparaître que 46,7 % <strong><strong>de</strong>s</strong> moins <strong>de</strong> 40 ans présentent une carence.<br />
Les facteurs <strong>de</strong> risque <strong>de</strong> carence sont connus. Il s’agit <strong>de</strong> facteurs réduisant <strong>la</strong> synthèse<br />
cutanée (port d’un vêtement couvrant, phototype foncé, vieillissement cutané, lieu <strong>de</strong> vie à<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>la</strong>titu<strong><strong>de</strong>s</strong> hautes), diminuant soit l’absorption digestive soit <strong>la</strong> double activation, ou<br />
favorisant le stockage <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D dans le tissu adipeux.<br />
L’hypovitaminose est responsable d’un tableau clinique associant :<br />
- <strong><strong>de</strong>s</strong> douleurs osseuses, d’allure mécanique, généralement symétriques, localisées aux<br />
ceintures pelvienne et scapu<strong>la</strong>ire, puis qui s’éten<strong>de</strong>nt aux membres, au grill costal et au rachis.<br />
C<strong>la</strong>ssiquement, les douleurs ne sont pas articu<strong>la</strong>ires et ne vont pas au-<strong>de</strong>là <strong><strong>de</strong>s</strong> cou<strong><strong>de</strong>s</strong> et <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
genoux.<br />
88
- <strong><strong>de</strong>s</strong> douleurs muscu<strong>la</strong>ires proximales avec faiblesse muscu<strong>la</strong>ire sans signe <strong>de</strong> déficit<br />
neurologique.<br />
- une asthénie.<br />
Des étu<strong><strong>de</strong>s</strong> ont prouvé une amélioration clinique <strong><strong>de</strong>s</strong> signes en cas <strong>de</strong> supplémentation adaptée<br />
c’est-à-dire à forte dose et maintenant un taux sérique élevé. Le Docteur MARTINAND a<br />
alors montré que ce bénéfice est également socio-économique.<br />
Nous avons réalisé une étu<strong>de</strong> prospective sur un an qui a consisté à suivre une cohorte<br />
<strong>de</strong> patientes âgées <strong>de</strong> 19 à 49 ans carencées en vitamine D.<br />
Notre objectif principal était d’évaluer si un traitement par apport <strong>de</strong> vitamine D à <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
patientes carencées améliorerait leur qualité <strong>de</strong> vie sociale, leurs douleurs et leur fatigue.<br />
Nos objectifs secondaires étaient <strong>de</strong> déterminer <strong>la</strong> fréquence et <strong>la</strong> posologie nécessaires en<br />
vitamine D pour maintenir un niveau sérique <strong>de</strong> vitamine D suffisant (75nmol/l).<br />
Le schéma <strong>de</strong> supplémentation théorique mis en p<strong>la</strong>ce à partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> littérature internationale<br />
consistait à prendre <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D sur 2 mois puis à faire un dosage sérique le troisième<br />
mois. Notre schéma conseil<strong>la</strong>it <strong>de</strong> prescrire :<br />
- 100 000 UI tous les 15 jours pendant 2 mois, soit 400 000 UI, pour les patientes ayant<br />
un taux inférieur à 30 nmol/l,<br />
- 100 000 UI tous les mois pendant 2 mois, soit 200 000 UI, pour les patientes ayant un<br />
taux <strong>de</strong> vitamine D compris entre 30 et 53 nmol/l<br />
- une ampoule <strong>de</strong> 100 000 UI en une fois pour les patientes entre 53 et 75 nmol/l.<br />
Le taux moyen <strong>de</strong> vitamine D a significativement augmenté en passant <strong>de</strong> 30,4 nmol/l<br />
initialement à 82,1 nmol/l au second dosage. Par contre, le taux sérique moyen a évolué « en<br />
<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> scie » puisque, lors du troisième dosage, il est retombé à 68,3 nmol/l.<br />
Cette évolution montre l’intérêt d’une dose <strong>de</strong> charge adaptée à <strong>la</strong> carence et le maintien<br />
d’une prise régulière <strong>de</strong> vitamine D par <strong>la</strong> suite.<br />
Notre étu<strong>de</strong> a montré que <strong>la</strong> carence est d’autant plus profon<strong>de</strong> et difficile à traiter chez les<br />
patientes à risque (port d’un vêtement couvrant ou phototype foncé) qui ont toujours présenté<br />
un taux moyen en vitamine D inférieur aux autres patientes et ceci malgré un nombre plus<br />
important d’ampoules prises.<br />
L’évolution <strong><strong>de</strong>s</strong> signes cliniques était mesuré tous les trois mois par l’EVA pour les douleurs<br />
et l’asthénie et par le SF-12 pour <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> vie en fin d’étu<strong>de</strong>. Une amélioration a été<br />
repérée concernant l’EVA fatigue ainsi que sur le score résumé physique du SF-12.<br />
89
Le manque d’évi<strong>de</strong>nce sur les paramètres cliniques peut s’expliquer en partie par le fait que le<br />
taux sérique n’a pas été maintenu <strong>de</strong> façon linéaire à <strong><strong>de</strong>s</strong> valeurs adéquates.<br />
D’un point <strong>de</strong> vue biologique, le taux moyen <strong>de</strong> PTH a évolué inversement au taux moyen <strong>de</strong><br />
vitamine D. Il était donc au plus bas avec 52,6 ng/l quand le taux <strong>de</strong> vitamine D moyen était à<br />
son maximum avec 82,1 nmol lors du second dosage.<br />
A noter que <strong><strong>de</strong>s</strong> valeurs très élevées ont été atteintes par 2 patientes au cours <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> sans<br />
pour autant dépasser <strong>la</strong> limite <strong>de</strong> 250 nmol/l. Aucun effet indésirable n’a été déc<strong>la</strong>ré par les<br />
investigateurs. Notre supplémentation proposée était pourtant supérieure aux<br />
recommandations actuelles.<br />
Bien que nos résultats ne soient pas significatifs, notre étu<strong>de</strong> montre <strong><strong>de</strong>s</strong> résultats simi<strong>la</strong>ires à<br />
d’autres étu<strong><strong>de</strong>s</strong> faites en soins primaires.<br />
Les conséquences <strong>de</strong> l’hypovitaminose D sur <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> vie et les douleurs <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
patientes doit inciter les mé<strong>de</strong>cins à prendre en charge cette pathologie notamment lors <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
présence <strong>de</strong> facteurs <strong>de</strong> risque. Malheureusement, <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion médicale est confrontée à un<br />
manque <strong>de</strong> recommandations appropriées aux patientes d’âges compris entre 18 et 49 ans ou à<br />
risque. Notre travail peut contribuer à <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce d’un protocole <strong>de</strong> supplémentation. Ce<br />
<strong>de</strong>rnier <strong>de</strong>vra être évalué lors <strong>de</strong> prochains travaux sur une popu<strong>la</strong>tion plus importante. Par<br />
ailleurs, l’utilisation d’un outil <strong>de</strong> cotation plus adapté que l’EVA permettrait <strong>de</strong> prouver <strong>de</strong><br />
manière plus spécifique l’amélioration <strong><strong>de</strong>s</strong> signes cliniques typiques d’hypovitaminose D.<br />
Le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> thèse,<br />
Vu et permis d’imprimer<br />
Lyon, le …………………..<br />
Vu : Le doyen <strong>de</strong> <strong>la</strong> Faculté <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine<br />
Vu : Pour Le Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Université<br />
Lyon-Est C<strong>la</strong>u<strong>de</strong> Bernard Le Prési<strong>de</strong>nt du Comité <strong>de</strong><br />
Coordination <strong><strong>de</strong>s</strong> Etu<strong><strong>de</strong>s</strong> Médicales<br />
Professeur Jérôme ETIENNE<br />
Professeur François-Noël GILLY<br />
90
BIBLIOGRAPHIE<br />
1. Norman AW. Sunlight, season, skin pigmentation, vitamin D, and 25-hydroxyvitamin<br />
D: integral components of the vitamin D endocrine system. Am J Clin Nutr. 1998<br />
Jun;67(6):1108-10.<br />
2. Holick MF. Vitamin D <strong>de</strong>ficiency. N Engl J Med. 2007 Jul 19;357(3):266-81.<br />
3. Vieth R, Bischoff-Ferrari H, Boucher BJ, Dawson-Hughes B, Gar<strong>la</strong>nd CF, Heaney<br />
RP, et al. The urgent need to recommend an intake of vitamin D that is effective. Am J Clin<br />
Nutr. 2007 Mar;85(3):649-50.<br />
4. Tangpricha V, Turner A, Spina C, Decastro S, Chen TC, Holick MF. Tanning is<br />
associated with optimal vitamin D status (serum 25-hydroxyvitamin D concentration) and<br />
higher bone mineral <strong>de</strong>nsity. Am J Clin Nutr. 2004 Dec;80(6):1645-9.<br />
5. Holick MF. McCollum Award Lecture, 1994: vitamin D--new horizons for the 21st<br />
century. Am J Clin Nutr. 1994 Oct;60(4):619-30.<br />
6. Zerwekh JE. Blood biomarkers of vitamin D status. Am J Clin Nutr. 2008<br />
Apr;87(4):1087S-91S.<br />
7. Lips P. Vitamin D physiology. Prog Biophys Mol Biol. 2006 Sep;92(1):4-8.<br />
8. Briot K, Audran M, Cortet B, Far<strong>de</strong>llone P, Marcelli C, Orcel P, et al. [Vitamin D:<br />
skeletal and extra skeletal effects; recommendations for good practice]. Presse Med. 2009<br />
Jan;38(1):43-54.<br />
9. Mortensen L, Charles P. Bioavai<strong>la</strong>bility of calcium supplements and the effect of<br />
Vitamin D: comparisons between milk, calcium carbonate, and calcium carbonate plus<br />
vitamin D. Am J Clin Nutr. 1996 Mar;63(3):354-7.<br />
10. DeLuca HF. Overview of general physiologic features and functions of vitamin D. Am<br />
J Clin Nutr. 2004 Dec;80(6 Suppl):1689S-96S.<br />
11. Holick MF. High prevalence of vitamin D ina<strong>de</strong>quacy and implications for health.<br />
Mayo Clin Proc. 2006 Mar;81(3):353-73.<br />
12. Cranney A, Weiler HA, O'Donnell S, Puil L. Summary of evi<strong>de</strong>nce-based review on<br />
vitamin D efficacy and safety in re<strong>la</strong>tion to bone health. Am J Clin Nutr. 2008<br />
Aug;88(2):513S-9S.<br />
13. Avenell A, Gillespie WJ, Gillespie LD, O'Connell D. Vitamin D and vitamin D<br />
analogues for preventing fractures associated with involutional and post-menopausal<br />
osteoporosis. Cochrane Database Syst Rev. 2009(2):CD000227.<br />
14. Bischoff-Ferrari HA, Willett WC, Wong JB, Giovannucci E, Dietrich T, Dawson-<br />
Hughes B. Fracture prevention with vitamin D supplementation: a meta-analysis of<br />
randomized controlled trials. JAMA. 2005 May 11;293(18):2257-64.<br />
15. Broe KE, Chen TC, Weinberg J, Bischoff-Ferrari HA, Holick MF, Kiel DP. A higher<br />
dose of vitamin d reduces the risk of falls in nursing home resi<strong>de</strong>nts: a randomized, multipledose<br />
study. J Am Geriatr Soc. 2007 Feb;55(2):234-9.<br />
16. Dhesi JK, Jackson SH, Bearne LM, Moniz C, Hurley MV, Swift CG, et al. Vitamin D<br />
supplementation improves neuromuscu<strong>la</strong>r function in ol<strong>de</strong>r people who fall. Age Ageing.<br />
2004 Nov;33(6):589-95.<br />
17. Souberbielle JC, Prie D, Courbebaisse M, Fried<strong>la</strong>n<strong>de</strong>r G, Houillier P, Maruani G, et al.<br />
[Update on vitamin D and evaluation of vitamin D status]. Ann Endocrinol (Paris). 2008<br />
Dec;69(6):501-10.<br />
91
18. Holick MF. Vitamin D: importance in the prevention of cancers, type 1 diabetes, heart<br />
disease, and osteoporosis. Am J Clin Nutr. 2004 Mar;79(3):362-71.<br />
19. Lappe JM, Travers-Gustafson D, Davies KM, Recker RR, Heaney RP. Vitamin D and<br />
calcium supplementation reduces cancer risk: results of a randomized trial. Am J Clin Nutr.<br />
2007 Jun;85(6):1586-91.<br />
20. Cantorna MT, Zhu Y, Froicu M, Wittke A. Vitamin D status, 1,25-dihydroxyvitamin<br />
D3, and the immune system. Am J Clin Nutr. 2004 Dec;80(6 Suppl):1717S-20S.<br />
21. Deluca HF, Cantorna MT. Vitamin D: its role and uses in immunology. FASEB J.<br />
2001 Dec;15(14):2579-85.<br />
22. Munger KL, Levin LI, Hollis BW, Howard NS, Ascherio A. Serum 25-<br />
hydroxyvitamin D levels and risk of multiple sclerosis. JAMA. 2006 Dec 20;296(23):2832-8.<br />
23. Zittermann A, Schleithoff SS, Ten<strong>de</strong>rich G, Berthold HK, Korfer R, Stehle P. Low<br />
vitamin D status: a contributing factor in the pathogenesis of congestive heart failure J Am<br />
Coll Cardiol. 2003 Jan 1;41(1):105-12.<br />
24. Bouillon R. [Vitamin D and human health]. Presse Med. 2009 Jan;38(1):3-6.<br />
25. Dawson-Hughes B, Heaney RP, Holick MF, Lips P, Meunier PJ, Vieth R. Estimates of<br />
optimal vitamin D status. Osteoporos Int. 2005 Jul;16(7):713-6.<br />
26. Be<strong>la</strong>id S, Martin A, Schott AM, Laville M, Le Goaziou MF. [Hypovitaminosis D<br />
among 18-to-49-years-old women wearing concealing clothes, an ignored reality in general<br />
practice]. Presse Med. 2008 Feb;37(2 Pt 1):201-6.<br />
27. Chapuy MC, Preziosi P, Maamer M, Arnaud S, Ga<strong>la</strong>n P, Hercberg S, et al. Prevalence<br />
of vitamin D insufficiency in an adult normal popu<strong>la</strong>tion. Osteoporos Int. 1997;7(5):439-43.<br />
28. Erkal MZ, Wil<strong>de</strong> J, Bilgin Y, Akinci A, Demir E, Bo<strong>de</strong>ker RH, et al. High prevalence<br />
of vitamin D <strong>de</strong>ficiency, secondary hyperparathyroidism and generalized bone pain in Turkish<br />
immigrants in Germany: i<strong>de</strong>ntification of risk factors. Osteoporos Int. 2006;17(8):1133-40.<br />
29. Hypponen E, Power C. Hypovitaminosis D in British adults at age 45 y: nationwi<strong>de</strong><br />
cohort study of dietary and lifestyle predictors. Am J Clin Nutr. 2007 Mar;85(3):860-8.<br />
30. Zadshir A, Tareen N, Pan D, Norris K, Martins D. The prevalence of hypovitaminosis<br />
D among US adults: data from the NHANES III. Ethn Dis. 2005 Autumn;15(4 Suppl 5):S5-<br />
97-101.<br />
31. Levis S, Gomez A, Jimenez C, Veras L, Ma F, Lai S, et al. Vitamin d <strong>de</strong>ficiency and<br />
seasonal variation in an adult South Florida popu<strong>la</strong>tion. J Clin Endocrinol Metab. 2005<br />
Mar;90(3):1557-62.<br />
32. Med<strong>de</strong>b N, Sahli H, Chahed M, Ab<strong>de</strong>lmou<strong>la</strong> J, Feki M, Sa<strong>la</strong>h H, et al. Vitamin D<br />
<strong>de</strong>ficiency in Tunisia. Osteoporos Int. 2005 Feb;16(2):180-3.<br />
33. Hashemipour S, Larijani B, Adibi H, Javadi E, Sedaghat M, Pajouhi M, et al. Vitamin<br />
D <strong>de</strong>ficiency and causative factors in the popu<strong>la</strong>tion of Tehran. BMC Public Health. 2004<br />
Aug 25;4:38.<br />
34. Holick MF. Environmental factors that influence the cutaneous production of vitamin<br />
D. Am J Clin Nutr. 1995 Mar;61(3 Suppl):638S-45S.<br />
35. Holick MF. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune<br />
diseases, cancers, and cardiovascu<strong>la</strong>r disease. Am J Clin Nutr. 2004 Dec;80(6 Suppl):1678S-<br />
88S.<br />
36. Willis CM, Laing EM, Hall DB, Hausman DB, Lewis RD. A prospective analysis of<br />
p<strong>la</strong>sma 25-hydroxyvitamin D concentrations in white and b<strong>la</strong>ck prepubertal females in the<br />
southeastern United States. Am J Clin Nutr. 2007 Jan;85(1):124-30.<br />
37. Harris SS, Dawson-Hughes B. Seasonal changes in p<strong>la</strong>sma 25-hydroxyvitamin D<br />
concentrations of young American b<strong>la</strong>ck and white women. Am J Clin Nutr. 1998<br />
Jun;67(6):1232-6.<br />
92
38. Wortsman J, Matsuoka LY, Chen TC, Lu Z, Holick MF. Decreased bioavai<strong>la</strong>bility of<br />
vitamin D in obesity. Am J Clin Nutr. 2000 Sep;72(3):690-3.<br />
39. Vi<strong>la</strong>rrasa N, Maravall J, Estepa A, Sanchez R, Mas<strong>de</strong>vall C, Navarro MA, et al. Low<br />
25-hydroxyvitamin D concentrations in obese women: their clinical significance and<br />
re<strong>la</strong>tionship with anthropometric and body composition variables. J Endocrinol Invest. 2007<br />
Sep;30(8):653-8.<br />
40. Burnand B, Sloutskis D, Gianoli F, Cornuz J, Rickenbach M, Paccaud F, et al. Serum<br />
25-hydroxyvitamin D: distribution and <strong>de</strong>terminants in the Swiss popu<strong>la</strong>tion. Am J Clin Nutr.<br />
1992 Sep;56(3):537-42.<br />
41. Contardo-Bouvard G. Etu<strong>de</strong> VESTAL. L'hypovitaminose D chez les femmes <strong>de</strong> 19 à<br />
49 ans durant l'hiver : prévalence et facteurs <strong>de</strong> risque [Thèse <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine]. Lyon: Lyon :<br />
UFR Lyon Grange-B<strong>la</strong>nche<br />
2008.<br />
42. Gannage-Yared MH, Chemali R, Yaacoub N, Ha<strong>la</strong>by G. Hypovitaminosis D in a<br />
sunny country: re<strong>la</strong>tion to lifestyle and bone markers. J Bone Miner Res. 2000<br />
Sep;15(9):1856-62.<br />
43. A<strong>la</strong>gol F, Shiha<strong>de</strong>h Y, Boztepe H, Tanakol R, Yarman S, Azizlerli H, et al. Sunlight<br />
exposure and vitamin D <strong>de</strong>ficiency in Turkish women. J Endocrinol Invest. 2000<br />
Mar;23(3):173-7.<br />
44. Scarlett WL. Ultraviolet radiation: sun exposure, tanning beds, and vitamin D levels.<br />
What you need to know and how to <strong>de</strong>crease the risk of skin cancer. J Am Osteopath Assoc.<br />
2003 Aug;103(8):371-5.<br />
45. Marks R, Foley PA, Jolley D, Knight KR, Harrison J, Thompson SC. The effect of<br />
regu<strong>la</strong>r sunscreen use on vitamin D levels in an Australian popu<strong>la</strong>tion. Results of a<br />
randomized controlled trial. Arch Dermatol. 1995 Apr;131(4):415-21.<br />
46. Farrerons J, Barnadas M, Rodriguez J, Renau A, Yoldi B, Lopez-Navidad A, et al.<br />
Clinically prescribed sunscreen (sun protection factor 15) does not <strong>de</strong>crease serum vitamin D<br />
concentration sufficiently either to induce changes in parathyroid function or in metabolic<br />
markers. Br J Dermatol. 1998 Sep;139(3):422-7.<br />
47. Reichrath J. The challenge resulting from positive and negative effects of sunlight:<br />
how much so<strong>la</strong>r UV exposure is appropriate to ba<strong>la</strong>nce between risks of vitamin D <strong>de</strong>ficiency<br />
and skin cancer Prog Biophys Mol Biol. 2006 Sep;92(1):9-16.<br />
48. Mytton J, Frater AP, Oakley G, Murphy E, Barber MJ, Jahfar S. Vitamin D <strong>de</strong>ficiency<br />
in multicultural primary care: a case series of 299 patients. Br J Gen Pract. 2007<br />
Jul;57(540):577-9.<br />
49. Lotfi A, Ab<strong>de</strong>l-Nasser AM, Hamdy A, Omran AA, El-Rehany MA. Hypovitaminosis<br />
D in female patients with chronic low back pain. Clin Rheumatol. 2007 Nov;26(11):1895-<br />
901.<br />
50. Smith GR, Collinson PO, Kiely PD. Diagnosing hypovitaminosis D: serum<br />
measurements of calcium, phosphate, and alkaline phosphatase are unreliable, even in the<br />
presence of secondary hyperparathyroidism. J Rheumatol. 2005 Apr;32(4):684-9.<br />
51. Peacey SR. Routine biochemistry in suspected vitamin D <strong>de</strong>ficiency. J R Soc Med.<br />
2004 Jul;97(7):322-5.<br />
52. Nellen JF, Smul<strong>de</strong>rs YM, Jos Frissen PH, S<strong>la</strong>ats EH, Silberbusch J. Hypovitaminosis<br />
D in immigrant women: slow to be diagnosed. BMJ. 1996 Mar 2;312(7030):570-2.<br />
53. <strong>de</strong> Torrente <strong>de</strong> <strong>la</strong> Jara G, Pecoud A, Favrat B. Female asylum seekers with<br />
musculoskeletal pain: the importance of diagnosis and treatment of hypovitaminosis D. BMC<br />
Fam Pract. 2006;7:4.<br />
93
54. Heaney RP, Davies KM, Chen TC, Holick MF, Barger-Lux MJ. Human serum 25-<br />
hydroxycholecalciferol response to exten<strong>de</strong>d oral dosing with cholecalciferol. Am J Clin Nutr.<br />
2003 Jan;77(1):204-10.<br />
55. Burgaz A, Akesson A, Oster A, Michaelsson K, Wolk A. Associations of diet,<br />
supplement use, and ultraviolet B radiation exposure with vitamin D status in Swedish women<br />
during winter. Am J Clin Nutr. 2007 Nov;86(5):1399-404.<br />
56. Vieth R. Vitamin D supplementation, 25-hydroxyvitamin D concentrations, and<br />
safety. Am J Clin Nutr. 1999 May;69(5):842-56.<br />
57. Zittermann A. Vitamin D in preventive medicine: are we ignoring the evi<strong>de</strong>nce Br J<br />
Nutr. 2003 May;89(5):552-72.<br />
58. Hirvonen T, Sinkko H, Valsta L, Hanni<strong>la</strong> ML, Pietinen P. Development of a mo<strong>de</strong>l for<br />
optimal food fortification: vitamin D among adults in Fin<strong>la</strong>nd. Eur J Nutr. 2007<br />
Aug;46(5):264-70.<br />
59. Calvo MS, Whiting SJ, Barton CN. Vitamin D fortification in the United States and<br />
Canada: current status and data needs. Am J Clin Nutr. 2004 Dec;80(6 Suppl):1710S-6S.<br />
60. Samanek AJ, Croager EJ, Giesfor Skin Cancer Prevention P, Milne E, Prince R,<br />
McMichael AJ, et al. Estimates of beneficial and harmful sun exposure times during the year<br />
for major Australian popu<strong>la</strong>tion centres. Med J Aust. 2006 Apr 3;184(7):338-41.<br />
61. Trang HM, Cole DE, Rubin LA, Pierratos A, Siu S, Vieth R. Evi<strong>de</strong>nce that vitamin D3<br />
increases serum 25-hydroxyvitamin D more efficiently than does vitamin D2. Am J Clin Nutr.<br />
1998 Oct;68(4):854-8.<br />
62. Houghton LA, Vieth R. The case against ergocalciferol (vitamin D2) as a vitamin<br />
supplement. Am J Clin Nutr. 2006 Oct;84(4):694-7.<br />
63. Holick MF, Biancuzzo RM, Chen TC, Klein EK, Young A, Bibuld D, et al. Vitamin<br />
D2 is as effective as vitamin D3 in maintaining circu<strong>la</strong>ting concentrations of 25-<br />
hydroxyvitamin D. J Clin Endocrinol Metab. 2008 Mar;93(3):677-81.<br />
64. I<strong>la</strong>hi M, Armas LA, Heaney RP. Pharmacokinetics of a single, <strong>la</strong>rge dose of<br />
cholecalciferol. Am J Clin Nutr. 2008 Mar;87(3):688-91.<br />
65. Holick MF, Chen TC. Vitamin D <strong>de</strong>ficiency: a worldwi<strong>de</strong> problem with health<br />
consequences. Am J Clin Nutr. 2008 Apr;87(4):1080S-6S.<br />
66. Aloia JF, Patel M, Dimaano R, Li-Ng M, Talwar SA, Mikhail M, et al. Vitamin D<br />
intake to attain a <strong><strong>de</strong>s</strong>ired serum 25-hydroxyvitamin D concentration. Am J Clin Nutr. 2008<br />
Jun;87(6):1952-8.<br />
67. Hathcock JN, Shao A, Vieth R, Heaney R. Risk assessment for vitamin D. Am J Clin<br />
Nutr. 2007 Jan;85(1):6-18.<br />
68. Steingrimsdottir L, Gunnarsson O, Indridason OS, Franzson L, Sigurdsson G.<br />
Re<strong>la</strong>tionship between serum parathyroid hormone levels, vitamin D sufficiency, and calcium<br />
intake. JAMA. 2005 Nov 9;294(18):2336-41.<br />
69. Boonen S, Lips P, Bouillon R, Bischoff-Ferrari HA, Van<strong>de</strong>rschueren D, Haentjens P.<br />
Need for additional calcium to reduce the risk of hip fracture with vitamin d supplementation:<br />
evi<strong>de</strong>nce from a comparative metaanalysis of randomized controlled trials. J Clin Endocrinol<br />
Metab. 2007 Apr;92(4):1415-23.<br />
70. Al Faraj S, Al Mutairi K. Vitamin D <strong>de</strong>ficiency and chronic low back pain in Saudi<br />
Arabia. Spine (Phi<strong>la</strong> Pa 1976). 2003 Jan 15;28(2):177-9.<br />
71. Plotnikoff GA, Quigley JM. Prevalence of severe hypovitaminosis D in patients with<br />
persistent, nonspecific musculoskeletal pain. Mayo Clin Proc. 2003 Dec;78(12):1463-70.<br />
72. Turner MK, Hooten WM, Schmidt JE, Kerkvliet JL, Townsend CO, Bruce BK.<br />
Prevalence and clinical corre<strong>la</strong>tes of vitamin D ina<strong>de</strong>quacy among patients with chronic pain.<br />
Pain Med. 2008 Nov;9(8):979-84.<br />
94
73. Martinand N. Supplémentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> carence en vitamine D chez <strong>la</strong> femme jeune : une<br />
étu<strong>de</strong> médico-économique en région lyonnaise [Thèse <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine]. Lyon: UFR Lyon<br />
Grnage-B<strong>la</strong>nche; 2008.<br />
74. http://www.qualitymetric.com/<strong>de</strong>mos/sf-12v2.aspx. [cited]; Avai<strong>la</strong>ble from.<br />
75. Glerup H, Mikkelsen K, Poulsen L, Hass E, Overbeck S, An<strong>de</strong>rsen H, et al.<br />
Hypovitaminosis D myopathy without biochemical signs of osteoma<strong>la</strong>cic bone involvement.<br />
Calcif Tissue Int. 2000 Jun;66(6):419-24.<br />
76. Vieth R, Chan PC, MacFar<strong>la</strong>ne GD. Efficacy and safety of vitamin D3 intake<br />
exceeding the lowest observed adverse effect level. Am J Clin Nutr. 2001 Feb;73(2):288-94.<br />
77. Gan<strong>de</strong>k B, Ware JE, Aaronson NK, Apolone G, Bjorner JB, Brazier JE, et al. Crossvalidation<br />
of item selection and scoring for the SF-12 Health Survey in nine countries: results<br />
from the IQOLA Project. International Quality of Life Assessment. J Clin Epi<strong>de</strong>miol. 1998<br />
Nov;51(11):1171-8.<br />
78. Mouyis M, Ostor AJ, Crisp AJ, Ginawi A, Halsall DJ, Shenker N, et al.<br />
Hypovitaminosis D among rheumatology outpatients in clinical practice. Rheumatology<br />
(Oxford). 2008 Sep;47(9):1348-51.<br />
79. Ish-Shalom S, Segal E, Salganik T, Raz B, Bromberg IL, Vieth R. Comparison of<br />
daily, weekly, and monthly vitamin D3 in ethanol dosing protocols for two months in el<strong>de</strong>rly<br />
hip fracture patients. J Clin Endocrinol Metab. 2008 Sep;93(9):3430-5.<br />
80. Saadi HF, Dawodu A, Afandi BO, Zayed R, Benedict S, Nagelkerke N. Efficacy of<br />
daily and monthly high-dose calciferol in vitamin D-<strong>de</strong>ficient nulliparous and <strong>la</strong>ctating<br />
women. Am J Clin Nutr. 2007 Jun;85(6):1565-71.<br />
81. Dawson-Hughes B. Racial/ethnic consi<strong>de</strong>rations in making recommendations for<br />
vitamin D for adult and el<strong>de</strong>rly men and women. Am J Clin Nutr. 2004 Dec;80(6<br />
Suppl):1763S-6S.<br />
82. Jones G. Pharmacokinetics of vitamin D toxicity. Am J Clin Nutr. 2008<br />
Aug;88(2):582S-6S.<br />
83. Pepper KJ, Judd SE, Nanes MS, Tangpricha V. Evaluation of vitamin D repletion<br />
regimens to correct vitamin D status in adults. Endocr Pract. 2009 Mar;15(2):95-103.<br />
84. <strong>de</strong> Torrente <strong>de</strong> <strong>la</strong> Jara G, Pecoud A, Favrat B. Musculoskeletal pain in female asylum<br />
seekers and hypovitaminosis D3. BMJ. 2004 Jul 17;329(7458):156-7.<br />
85. Vieth R, Kimball S, Hu A, Walfish PG. Randomized comparison of the effects of the<br />
vitamin D3 a<strong>de</strong>quate intake versus 100 mcg (4000 IU) per day on biochemical responses and<br />
the wellbeing of patients. Nutr J. 2004 Jul 19;3:8.<br />
86. Aloia JF, Talwar SA, Pol<strong>la</strong>ck S, Feuerman M, Yeh JK. Optimal vitamin D status and<br />
serum parathyroid hormone concentrations in African American women. Am J Clin Nutr.<br />
2006 Sep;84(3):602-9.<br />
87. Lips P, Duong T, Oleksik A, B<strong>la</strong>ck D, Cummings S, Cox D, et al. A global study of<br />
vitamin D status and parathyroid function in postmenopausal women with osteoporosis:<br />
baseline data from the multiple outcomes of raloxifene evaluation clinical trial. J Clin<br />
Endocrinol Metab. 2001 Mar;86(3):1212-21.<br />
88. Ma<strong>la</strong>banan A, Veronikis IE, Holick MF. Re<strong>de</strong>fining vitamin D insufficiency. Lancet.<br />
1998 Mar 14;351(9105):805-6.<br />
89. Heaney RP, Dowell MS, Hale CA, Bendich A. Calcium absorption varies within the<br />
reference range for serum 25-hydroxyvitamin D. J Am Coll Nutr. 2003 Apr;22(2):142-6.<br />
90. Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Willett WC, Staehelin HB, Bazemore MG,<br />
Zee RY, et al. Effect of Vitamin D on falls: a meta-analysis. JAMA. 2004 Apr<br />
28;291(16):1999-2006.<br />
95
ANNEXES<br />
Questionnaire <strong>de</strong> fin d’étu<strong>de</strong> :<br />
N° dossier :<br />
Etu<strong>de</strong> VESTAL - PECCARVIT D<br />
Ce questionnaire est i<strong>de</strong>ntique à celui rempli en début d’étu<strong>de</strong> entre janvier et mars 2008.<br />
Merci <strong>de</strong> prendre quelques minutes pour le remplir.<br />
Une analyse et une comparaison par rapport à vos précé<strong>de</strong>ntes réponses nous permettront<br />
d’observer ou non une modification <strong>de</strong> votre qualité <strong>de</strong> vie, <strong>de</strong> votre exposition au soleil et <strong>de</strong><br />
votre alimentation.<br />
1/ De manière générale <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> prise en charge <strong>de</strong> votre carence en vitamine D, avezvous<br />
ressenti une amélioration <strong>de</strong> votre état <strong>de</strong> santé physique <br />
amélioration importante amélioration moyenne amélioration faible<br />
aucune amélioration<br />
2/ De manière générale <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> prise en charge <strong>de</strong> votre carence en vitamine D, avezvous<br />
ressenti une amélioration <strong>de</strong> votre état <strong>de</strong> santé morale <br />
amélioration importante amélioration moyenne amélioration faible<br />
aucune amélioration<br />
3/ Si oui, pouvez essayer <strong>de</strong> décrire cette amélioration en quelques mots.<br />
Par exemple, si cette amélioration se situe au niveau <strong><strong>de</strong>s</strong> douleurs, <strong>de</strong> <strong>la</strong> fatigue, <strong>de</strong> l’envie <strong>de</strong><br />
faire <strong><strong>de</strong>s</strong> activités, <strong>de</strong> <strong>la</strong> capacité à réaliser certaines activités …<br />
96
4/ Depuis le début <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong>, combien avez vous pris d’ampoule <strong>de</strong> vitamine :<br />
son nom :<br />
Questionnaire <strong>de</strong> QUALITE DE VIE SF12<br />
Q.1 Dans l’ensemble, pensez-vous que votre santé est :<br />
Excellente Très bonne Bonne Médiocre Mauvaise<br />
Q.2 En raison <strong>de</strong> votre état <strong>de</strong> santé actuel, êtes-vous limité pour :<br />
- <strong><strong>de</strong>s</strong> efforts physiques modérés tels que dép<strong>la</strong>cer une table, passer l’aspirateur, jouer<br />
aux boules <br />
Oui, beaucoup limité Oui, un peu limité Non, pas du tout limité<br />
- monter plusieurs étages par l’escalier <br />
Oui, beaucoup limité Oui, un peu limité Non, pas du tout limité<br />
Q.3 Au cours <strong>de</strong> ces 4 <strong>de</strong>rnières semaines, et en raison <strong>de</strong> votre état physique :<br />
- avez-vous accompli moins <strong>de</strong> choses que vous auriez souhaité <br />
Toujours La plupart du temps Souvent Parfois Jamais<br />
- avez-vous été limité pour faire certaines choses <br />
Toujours La plupart du temps Souvent Parfois Jamais<br />
Q.4 Au cours <strong>de</strong> ces 4 <strong>de</strong>rnières semaines, et en raison <strong>de</strong> votre état émotionnel (comme<br />
vous sentir triste, nerveux ou déprimé) :<br />
- avez-vous accompli moins <strong>de</strong> choses que vous auriez souhaité <br />
Toujours La plupart du temps Souvent Parfois Jamais<br />
- avez-vous eu <strong><strong>de</strong>s</strong> difficultés à faire ce que vous aviez à faire avec autant <strong>de</strong> soin et<br />
d’attention que d’habitu<strong>de</strong><br />
Toujours La plupart du temps Souvent Parfois Jamais<br />
Q.5 Au cours <strong>de</strong> ces 4 <strong>de</strong>rnières semaines, dans quelle mesure vos douleurs physiques vous<br />
ont-elles limité dans votre travail ou vos activités domestiques <br />
Pas du tout Un petit peu Moyennement Beaucoup <br />
Enormément<br />
Q.6 Les questions qui suivent portent sur comment vous vous êtes senti au cours <strong>de</strong> ces 4<br />
<strong>de</strong>rnières semaines. Pour chaque question, indiquez <strong>la</strong> réponse qui vous semble <strong>la</strong> plus<br />
appropriée.<br />
- y a t-il eu <strong><strong>de</strong>s</strong> moments où vous vous êtes senti calme et détendu <br />
Toujours La plupart du temps Souvent Parfois Jamais<br />
- y a t-il eu <strong><strong>de</strong>s</strong> moments où vous vous êtes senti débordant d’énergie <br />
Toujours La plupart du temps Souvent Parfois Jamais<br />
- y a t-il eu <strong><strong>de</strong>s</strong> moments où vous vous êtes senti triste et abattu <br />
Toujours La plupart du temps Souvent Parfois Jamais<br />
Q.7 Au cours <strong>de</strong> ces 4 <strong>de</strong>rnières semaines, y a t-il eu <strong><strong>de</strong>s</strong> moments où votre état <strong>de</strong> santé<br />
physique ou émotionnel vous a gêné dans votre vie sociale et vos re<strong>la</strong>tions avec les autres,<br />
votre famille, vos amis, vos connaissances <br />
Toujours La plupart du temps Souvent Parfois Jamais<br />
97
ENSOLEILLEMENT<br />
Merci <strong>de</strong> répondre à ce questionnaire en ne cochant qu’une seule case par question.<br />
Si plusieurs réponses sont possibles, tenir compte uniquement <strong>de</strong> <strong>la</strong> réponse <strong>la</strong> plus côtée.<br />
Exposition dans l’année précédant l’interrogatoire, quelle que soit l’activité (jardinage,<br />
match <strong>de</strong> football, terrasse <strong>de</strong> café, etc… en plein air, en vacances ou au travail), entre le 1 er<br />
juin et 30 septembre <strong>de</strong>rnier en France métropolitaine (ou pays <strong>de</strong> même <strong>la</strong>titu<strong>de</strong>), ou quelle<br />
que soit <strong>la</strong> pério<strong>de</strong>, si pays chauds :<br />
1- Avez-vous exposé <br />
Tête Tête, bras, jambes Corps entier <br />
2- Pendant <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ge horaire 12 à 16 heures :<br />
Non Parfois Oui <br />
3- Pendant une durée totale sur toute <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> du 1 er juin au 30 septembre <strong>de</strong> :<br />
Une semaine ou moins <br />
Plus d’une semaine <br />
4- Lieu d’exposition :<br />
Agglomération Campagne Montagne - Mer - P<strong>la</strong>ge <br />
5- Avez-vous utilisé une crème so<strong>la</strong>ire (Indice <strong>de</strong> protection IP > 15) <br />
Non <br />
Oui <br />
6- Facteur ancienneté : Cette exposition so<strong>la</strong>ire remonte à combien <strong>de</strong> temps :<br />
_______________<br />
(noter le mois)<br />
7- Fréquence <strong>de</strong> vos sorties en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> votre domicile :<br />
Moins ou1 fois/semaine 1 à 3 fois/semaine 1 fois/jour ou plus<br />
<br />
8 - Avez-vous <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> vous exposer au soleil dans un jardin ou sur un balcon, bras et<br />
jambes découvertes au moins Non Oui <br />
9 - Pratiquez-vous un sport :<br />
Non Oui si oui - <strong>de</strong>hors <br />
- dans une salle <br />
98
ALIMENTATION – Apports en vitamine D<br />
Merci <strong>de</strong> répondre en cochant une seule case par question<br />
Evaluez votre consommation <strong><strong>de</strong>s</strong> aliments suivants (portion moyenne considérée)<br />
(exemple dans <strong>la</strong> semaine 1 fois par semaine du saumon, 1 fois du hareng et 1 fois <strong><strong>de</strong>s</strong> sardines,<br />
cocher 2 ou plus/ semaine)<br />
POISSONS FRAIS OU CONGELES :<br />
Saumon, sardine, hareng, truite arc-en ciel, maquereau, thon, anguille, flétan<br />
Moins d’1 fois / mois 1 à 2/mois 1/semaine 2 ou<br />
plus/semaine<br />
POISSONS FUMES ou MARINES :<br />
Saumon, hareng, maquereau<br />
Moins d’1 fois / mois 1 à 2/mois 1/semaine 2 ou<br />
plus/semaine<br />
POISSONS EN CONSERVE :<br />
sardine, hareng, thon, maquereau, anchois<br />
Moins d’1 fois/ semaine 1/semaine 2/semaine 3 ou<br />
plus/semaine<br />
ŒUFS (nombre œufs consommés)<br />
Moins <strong>de</strong> 2/semaine 2à5/semaine 6à10/semaine plus <strong>de</strong><br />
10/semaine<br />
ALIMENTS AVEC ŒUFS (sandwichs, gâteaux : quatre quarts, brioche, quiches….)<br />
Moins <strong>de</strong> 2/semaine 2 à 5/semaine 6 à 10/semaine plus <strong>de</strong><br />
10/semaine<br />
<br />
PRODUITS LAITIERS (une ration = 1/4l <strong>la</strong>it ou 1 yaourt)<br />
- Non enrichis en vit D : <br />
- Enrichi en Vit D moins <strong>de</strong> 1/j 1 à 2/j 2 à 3/j <br />
<br />
HUILE (une ration = 1 cuillère à soupe)<br />
- Non enrichie en vit D : Noter le nom <strong>de</strong> l’huile : ____________________<br />
- Enrichie en vit D : moins <strong>de</strong> 1/semaine 1 à 3 /semaine 3 à 5/semaine <br />
99
Document distribué lors <strong>de</strong> l’inclusion à l’étu<strong>de</strong> VESTAL avec<br />
Schéma <strong>de</strong> supplémentation :<br />
ETUDE VESTAL<br />
Critères d’inclusion :<br />
- pério<strong>de</strong> du 01/12/07 au 31/03/08,<br />
- Femmes âgées <strong>de</strong> 19 à 49 ans acceptant <strong>de</strong> participer à l’étu<strong>de</strong>,<br />
- Pour les 20 femmes non couvertes, 1 ère consultante du matin et 1 ère consultante <strong>de</strong><br />
l’après midi, soit 2 femmes par jour pendant les 10ers jours d’ouverture du cabinet,<br />
- Pour les 10 femmes couvertes, toutes les femmes qui acceptent <strong>de</strong> participer à l’étu<strong>de</strong><br />
et qui consultent consécutivement au cabinet,<br />
- Vêtement couvrant = couvre <strong>de</strong> manière systématique <strong>la</strong> tête et tout le corps ou plus,<br />
non retiré spontanément lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> consultation et porté <strong>de</strong> manière permanente tout au<br />
long <strong>de</strong> l’année à l’intérieur comme à l’extérieur, contrairement aux vestes, manteaux.<br />
Critères d’exclusion :<br />
- refus <strong>de</strong> participer à l’étu<strong>de</strong> (liste <strong>de</strong> refus),<br />
- pathologies responsables d’hypovitaminose D :<br />
insuffisance hépatique,<br />
insuffisance rénale,<br />
ma<strong>la</strong>bsorption,<br />
pathologie psychiatrique entravant gravement <strong>la</strong> compréhension,<br />
pathologie cutanée importante,<br />
- Grossesse et al<strong>la</strong>itement,<br />
- Traitement au long cours, <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 6 mois par: rifampicine,<br />
glucocorticoï<strong><strong>de</strong>s</strong>,<br />
anticonvulsivants,<br />
diurétiques thiazidiques<br />
DEROULEMENT GENERAL :<br />
Inclusion du 01/12/07 au 31/03/08 :<br />
Consultation<br />
Explication <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> à <strong>la</strong> patiente<br />
(remise <strong>de</strong> l’information écrite)<br />
Questionnaire<br />
Dosage vitamine D2 et D3<br />
(remise du bon <strong>de</strong> prise en charge par MERIEUX)<br />
Supérieur à 75 nmol/l<br />
Inférieur à 75 nmol/l<br />
Fin <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong><br />
100
Protocole <strong>de</strong> traitement + Suivi pendant 18 mois<br />
Vitamine D +/- Calcium<br />
I / PROTOCOLE DE SUIVI sur 18 mois :<br />
consultation et dosage / 3 mois<br />
après informations <strong>de</strong> <strong>la</strong> patiente + infos écrites<br />
fiche conseils hygiène <strong>de</strong> vie<br />
Temps<br />
Mois 0 Inclusion = consult n°1 =<br />
Questionnaire n°1<br />
+ Dosage n°1<br />
Vit D < 75nmol/l<br />
Vit D > 75nmol/l<br />
Protocole Traitement<br />
Supplémentation Vitamine D<br />
Supplémentation Calcium obligatoire<br />
Pendant 3 mois<br />
Fin <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong><br />
M+3 Consult + Dosage n°2<br />
+ Noter EVA /10<br />
Dans tableau récapitu<strong>la</strong>tif Fatigue /10<br />
Nombre d’ampoules prescrites<br />
Nombre d’ampoules prises<br />
Vit D < 75nmol/l<br />
Vit D > 75 nmol/l<br />
Protocole Traitement Vitamine D i<strong>de</strong>m<br />
M+6 Consult + Dosage n°3<br />
I<strong>de</strong>m<br />
M+9 Consult + Dosage n°4<br />
M+12 Consult + Dosage n°5<br />
101
M+15 Consult + Dosage n°6<br />
M+18 Consult + Dosage n°7<br />
Noter EVA et Fatigue<br />
Noter nombre d’ampoules prescrites et prises<br />
Questionnaire n°2<br />
II / Protocole <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong> <strong>la</strong> carence en vitamine D :<br />
1/ DOSES :<br />
Si Vitamine D < 30 nmol/l :<br />
- Donner 100 000 UI <strong>de</strong> vitamine D3 tous les 15 jours pendant 2 mois<br />
soit 400 000 UI en 2 mois<br />
- Contrôle du dosage sanguin à <strong>la</strong> fin du 3 ème mois (entre 6 et 8 semaines après <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>rnière dose)<br />
-------- J0 -----J15----J30 ----J45 -----J90 à J105 D = Dosage n°1 ou 2<br />
D1 V1 V2 V3 V4 D2 V = Vitamine à prendre<br />
Si Vitamine D est entre 30 et 53 nmol/l :<br />
- Donner 100 000 UI <strong>de</strong> vitamine D3 tous les mois pendant 2 mois<br />
soit 200 000 UI en 2 mois<br />
- Contrôle du dosage sanguin à <strong>la</strong> fin du 3 ème mois<br />
-----J0 -----J15 ----J30 ----J60 ----J90 à J105<br />
D1 V1 V2 D2<br />
Si Vitamine D est entre 53 et 75 nmol/l :<br />
- Donner 100 000 UI <strong>de</strong> vitamine D3 en 1 fois<br />
soit 100 000 UI en 2 mois<br />
- Contrôle du dosage sanguin à <strong>la</strong> fin du 3 ème mois<br />
Si Vitamine D supérieur à 75 nmol/l :<br />
- pas <strong>de</strong> supplémentation<br />
- Contrôle du dosage sanguin à <strong>la</strong> fin du 3 ème mois (quand <strong>la</strong> patiente a été incluse précé<strong>de</strong>mment)<br />
2/ PRODUITS :<br />
Utilisation conseillée :<br />
- UVEDOSE : ampoule à 100 000IU <strong>de</strong> vitamine D3<br />
- ZYMA D : ampoule <strong>de</strong> 80 000 et 200 000 IU <strong>de</strong> vitamine D3<br />
- Vitamine D3 BON : 200 000 IU <strong>de</strong> D3<br />
Utilisation déconseillée :<br />
- UVESTEROL D : gouttes <strong>de</strong> vitamine D2 (ergocalciferol)<br />
- STEROGYL : gouttes <strong>de</strong> vitamine D2 (ergocalciferol)<br />
- toutes les formes combinées Vitamine D + calcium à cause <strong>de</strong> leurs contraintes<br />
(prises journalières) entrainant une très faible compliance<br />
102
La préférence pour <strong>la</strong> vitamine D3 s’explique par <strong><strong>de</strong>s</strong> étu<strong><strong>de</strong>s</strong> sur le traitement en prévention<br />
secondaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> carence en vitamine D ayant montré <strong>la</strong> supériorité <strong>de</strong> <strong>la</strong> forme D3.<br />
III / Protocole <strong>de</strong> supplémentation en Calcium :<br />
Elle est obligatoire les 3 premiers mois, si les apports sont insuffisants.<br />
Lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> réception d’un dosage inférieur à 75nmol/l, il faut reconvoquer <strong>la</strong> patiente en<br />
consultation pour :<br />
- faire <strong>la</strong> prescription <strong>de</strong> supplémentation en vitamine D,<br />
- lui expliquer le protocole <strong>de</strong> suivi et lui donner <strong>la</strong> feuille d’information,<br />
- évaluer sa consommation <strong>de</strong> calcium, en utilisant le questionnaire simplifié présent dans<br />
votre dossier mais modifié en y ajoutant <strong>la</strong> consommation d’eau minérale,<br />
- prescrire une supplémentation selon les résultats <strong>de</strong> l’enquête alimentaire :<br />
- si 5 et 10, ne pas supplémenter en calcium.<br />
Pour une meilleure observance et compliance pour le traitement <strong>de</strong> <strong>la</strong> carence en vitamine D,<br />
on n’utilisera pas <strong>de</strong> préparation associant Calcium et Vitamine D.<br />
Utilisation conseillée : toutes les formes <strong>de</strong> calcium seul sont équivalente<br />
CALCIDOSE 500mg sachet<br />
CACIT 500mg cp effervescent<br />
CALPEROS 500mg cp à sucer<br />
CALCIFORT 500mg sachet<br />
CALPRIMUM 500mg cp à croquer<br />
CALTRATE 500mg cp<br />
FIXICAL 500mg cp à sucer ou croquer<br />
OROCAL 500mg cp à sucer<br />
OSTEOCAL 500mg cp à sucer<br />
103
IV / DOSAGE <strong>de</strong> <strong>la</strong> PTH :<br />
Il sera fait gratuitement par le <strong>la</strong>boratoire Mérieux lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> première prise <strong>de</strong> sang.<br />
Il faudra recontrôler <strong>la</strong> PTH lors <strong>de</strong> chaque consultation tous les 3 mois, en même temps<br />
que <strong>la</strong> vitamine D, tant que <strong>la</strong> PTH n’est pas normalisée.<br />
Son résultat sera consigné dans le tableau récapitu<strong>la</strong>tif à chaque consultation.<br />
Son résultat ne doit pas gui<strong>de</strong>r <strong>la</strong> supplémentation en vitamine D, ainsi une vitamine D<br />
normalisée et un PTH encore élevée ne doit pas conduire à une poursuite <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
supplémentation en vitamine D.<br />
En effet, sa normalisation sera plus tardive que celle <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D.<br />
L’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> ses variations sera un argument supplémentaire pour prouver l’effet bénéfique sur<br />
l’os <strong>de</strong> <strong>la</strong> prise ne charge <strong>de</strong> cette carence en vitamine D.<br />
104
Fiche <strong>de</strong> recueil <strong><strong>de</strong>s</strong> résultats<br />
I<strong>de</strong>ntification mé<strong>de</strong>cin : _______<br />
Nom : __________________<br />
(3 premières lettres du Nom et 2 premières du Prénom)<br />
Téléphone : ____________________<br />
Numéro patiente :_____<br />
Année <strong>de</strong> naissance : ____________<br />
Date d’inclusion : _______________<br />
Phototype : _______________<br />
Profession : _______________<br />
CMU : _________<br />
Dates précises<br />
Inclusion +3mois +6mois +9mois +12mois +15mois +18mois<br />
FATIGUE (1)<br />
EVA (1)<br />
Dosage<br />
Vitamine D (1)<br />
Dosage PTH<br />
Traitement (2)<br />
Vit D donné<br />
Traitement (2)<br />
Vit D pris<br />
Calcium (2)<br />
Exposition<br />
So<strong>la</strong>ire<br />
Consommation<br />
Vitamine D<br />
Qualité <strong>de</strong> vie<br />
SF 12<br />
A faire ////////////<br />
///////////<br />
A faire ///////////<br />
///////////<br />
A faire ////////////<br />
////////////<br />
(1) mettre les valeurs numériques /10<br />
(2) préciser nom et doses exactes au dos<br />
//////////////<br />
//////////////<br />
/////////////<br />
/////////////<br />
//////////////<br />
//////////////<br />
/////////////<br />
////////////<br />
////////////<br />
////////////<br />
////////////<br />
///////////<br />
/////////////<br />
////////////<br />
////////////<br />
////////////<br />
/////////////<br />
/////////////<br />
////////////<br />
////////////<br />
////////////<br />
////////////<br />
////////////<br />
////////////<br />
A faire<br />
A faire<br />
A faire<br />
105
Fiche <strong>de</strong> conseil distribué aux patientes par les mé<strong>de</strong>cins<br />
Vous avez une carence en vitamine D<br />
A quoi sert <strong>la</strong> vitamine D <br />
La vitamine D est très importante : elle permet d’assimiler et <strong>de</strong> fixer le calcium<br />
sur l’os pour empêcher <strong>la</strong> déminéralisation osseuse et les douleurs.<br />
Il est particulièrement important <strong>de</strong> veiller à vos apports en vitamine D et en<br />
calcium, et éventuellement <strong>de</strong> suivre un traitement médicamenteux.<br />
Où trouver <strong>la</strong> vitamine D <br />
S’exposer au soleil équivaut à 50 à 70% <strong>de</strong> vos besoins<br />
Etre <strong>de</strong>hors, au grand air, permet <strong>la</strong> synthèse <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D par <strong>la</strong> peau, grâce<br />
aux rayons du soleil, même par temps gris. C’est l’exposition directe au soleil qui<br />
permet le plus facilement d’avoir un taux <strong>de</strong> vitamine D normal. Il suffit<br />
d'exposer au soleil tous les jours pendant une <strong>de</strong>mi-heure le visage et les bras<br />
pour couvrir <strong>la</strong> moitié <strong>de</strong> nos besoins en cette vitamine !<br />
Le reste <strong>de</strong> vos besoins se trouve dans l’alimentation<br />
On <strong>la</strong> trouve surtout dans les poissons comme le maquereau, le hareng, <strong>la</strong><br />
sardine, le saumon, l’anchois, le flétan, le thon frais, en conserve ou surgelés.<br />
Vous pouvez préparer ou cuire ces poissons comme vous vous le voulez car <strong>la</strong><br />
quantité <strong>de</strong> vitamine D ne varie pas.<br />
Manger 2 fois par semaine différentes sortes <strong>de</strong> ces poissons<br />
apporter <strong>la</strong> quantité nécessaire en vitamine D.<br />
suffit à vous<br />
On peut trouver aussi <strong>de</strong> <strong>la</strong> vitamine D dans le jaune d’œuf, les margarines et le<br />
beurre et dans les produits <strong>la</strong>itiers et les huiles enrichis en vitamine D.<br />
Tableau : Teneur en vitamine D <strong><strong>de</strong>s</strong> principaux aliments en contenant (en µg/portion)<br />
Aliments Portions Teneur en µg/portion<br />
Saumon frais ou fumé 125 g 25<br />
Sardine à <strong>la</strong> sauce tomate 90 g 10,8<br />
Thon au naturel ou à l'huile 185 g 7,4<br />
Maquereau au vin b<strong>la</strong>nc 100 g 6<br />
Oeuf un œuf 2<br />
Beurre 25 g 0,25<br />
Jambon 1 tranche ou 45 g 0,36<br />
Besoin quotidien 10 µg minimum soit 70 µg par semaine <strong>de</strong> vitamine D<br />
106
LARGE Olivier :<br />
Prise en charge <strong>de</strong> <strong>la</strong> carence en vitamine D chez les femmes <strong>de</strong> 19 à 49 ans : étu<strong>de</strong> prospective<br />
d’un schéma <strong>de</strong> supplémentation titre <strong>de</strong> votre thèse<br />
Th. Méd : Lyon 2009 n°<br />
____________________________________________________________________________<br />
Résumé :<br />
L’hypovitaminose D est responsable d’un tableau clinique associant <strong><strong>de</strong>s</strong> douleurs ostéomuscu<strong>la</strong>ires<br />
et une asthénie.<br />
Nos objectifs étaient <strong>de</strong> déterminer les doses nécessaires à <strong>la</strong> correction <strong>de</strong> <strong>la</strong> carence, <strong>la</strong><br />
fréquence et <strong>la</strong> posologie nécessaires pour maintenir un niveau sérique <strong>de</strong> vitamine D suffisant<br />
(75nmol/l) et d’évaluer l’amélioration <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> vie, <strong><strong>de</strong>s</strong> douleurs et <strong>de</strong> <strong>la</strong> fatigue <strong>de</strong> ces<br />
femmes. Nous avons réalisé une étu<strong>de</strong> prospective sur un an qui a consisté à suivre une cohorte<br />
<strong>de</strong> patientes carencées âgées <strong>de</strong> 19 à 49 ans. Le schéma <strong>de</strong> supplémentation consistait à prendre<br />
entre 100 000 et 400 000 UI <strong>de</strong> vitamine D sur 2 mois en fonction du taux sérique puis à faire un<br />
contrôle sérique le troisième mois.<br />
Le taux moyen <strong>de</strong> vitamine D a significativement augmenté en passant <strong>de</strong> 30,4 nmol/l<br />
initialement à 82,1 nmol/l au second dosage et enfin à 68,3 nmol/l. Cette évolution en « <strong>de</strong>nts <strong>de</strong><br />
scie » montre l’intérêt d’une dose <strong>de</strong> charge puis <strong>la</strong> prise régulière <strong>de</strong> vitamine D. La carence est<br />
d’autant plus profon<strong>de</strong> et difficile à traiter chez les patientes à risque.<br />
L’évolution <strong><strong>de</strong>s</strong> signes cliniques était mesurée tous les trois mois par l’EVA pour les douleurs et<br />
l’asthénie et par le SF-12 pour <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> vie en fin d’étu<strong>de</strong>. Le manque d’évi<strong>de</strong>nce sur les<br />
paramètres cliniques peut s’expliquer par le fait que le taux sérique n’a pas été maintenu <strong>de</strong><br />
façon linéaire à <strong><strong>de</strong>s</strong> valeurs adéquates.<br />
Aucun effet indésirable n’a été déc<strong>la</strong>ré malgré une supplémentation supérieure aux<br />
recommandations actuelles.<br />
Notre étu<strong>de</strong> montre <strong><strong>de</strong>s</strong> résultats simi<strong>la</strong>ires à d’autres étu<strong><strong>de</strong>s</strong> faites en soins primaires. La<br />
popu<strong>la</strong>tion médicale est confrontée à un manque <strong>de</strong> recommandations appropriées aux patientes<br />
d’âges compris entre 19 et 49 ans. D’autres étu<strong><strong>de</strong>s</strong> avec une supplémentation plus régulière <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
femmes à risque ainsi qu’un suivi sur l’état <strong>de</strong> santé global <strong>de</strong> ces femmes sont nécessaires pour<br />
établir <strong><strong>de</strong>s</strong> recommandations précises pour les mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> premier recours.<br />
MOTS CLES<br />
Carence en vitamine D – femme adulte jeune – traitement – supplémentation – mé<strong>de</strong>cine<br />
générale<br />
JURY :<br />
Prési<strong>de</strong>nt : Monsieur le Professeur Ambroise MARTIN<br />
Membres : Madame le Professeur Marie-France LE GOAZIOU<br />
Madame le Professeur Anne-Marie SCHOTT<br />
Monsieur le Docteur Christian DUPRAZ<br />
DATE DE SOUTENANCE : 6 novembre 2009<br />
Adresse <strong>de</strong> l’auteur : 37 rue Joseph Ricard 69110 Sainte Foy lès Lyon<br />
o.<strong>la</strong>rge@<strong>la</strong>poste.net