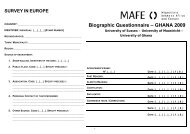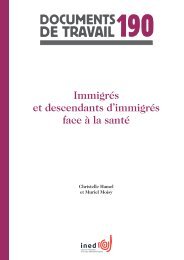La fréquence des accouchements gémellaires en France - Ined
La fréquence des accouchements gémellaires en France - Ined
La fréquence des accouchements gémellaires en France - Ined
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
890 G. PISON, N. COUVERTPour vérifier cette hypothèse et étudier de façon plus générale l’effetde la surv<strong>en</strong>ue d’une grossesse gémellaire sur la constitution <strong>des</strong> familles,nous avons analysé les données <strong>des</strong> quatre dernières <strong>en</strong>quêtes Famillem<strong>en</strong>ées <strong>en</strong> <strong>France</strong> (<strong>en</strong> 1975, 1982, 1990 et 1999). Chacune de ces <strong>en</strong>quêtesportait sur un échantillon de plusieurs c<strong>en</strong>taines de milliers defemmes (1/50 de la population féminine adulte), l’échantillon totalcompr<strong>en</strong>ant plus d’un million de femmes (8) . On a notamm<strong>en</strong>t recueillipour chacune d’elles un historique <strong>des</strong> naissances. On dispose, <strong>en</strong> particulier,de r<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts sur le sexe, la date de naissance et le rang de naissancede chacun de leurs <strong>en</strong>fants (ainsi que de la date de décès pour les<strong>en</strong>fants morts par la suite). Notre analyse s’est limitée aux seules femmesnées après 1920, pour <strong>des</strong> raisons d’effectif et afin de réduire le risqued’erreur de mémoire. Elle porte donc sur un total de 850 987 femmes et2088796 <strong>accouchem<strong>en</strong>ts</strong>, dont 19959 <strong>accouchem<strong>en</strong>ts</strong> doubles.1. Probabilité d’une grossesseultérieure après une grossesse gémellaireNous avons calculé la probabilité pour qu’une femme v<strong>en</strong>ant d’accoucherde jumeaux accouche à nouveau ultérieurem<strong>en</strong>t, <strong>en</strong> la comparant àcelle d’une femme dont la situation familiale est similaire (même nombrede grossesses ou même nombre d’<strong>en</strong>fants), mais qui n’a pas eu d’accouchem<strong>en</strong>tdouble. <strong>La</strong> probabilité d’un nouvel accouchem<strong>en</strong>t est estimée <strong>en</strong>fonction de la durée écoulée depuis le dernier. Les résultats se prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>tsous la forme d’une courbe de « survie » dans l’état « n’a pas accouché ànouveau », qui indique selon la durée écoulée depuis le dernier accouchem<strong>en</strong>tla probabilité de ne pas <strong>en</strong>core avoir eu d’autres <strong>en</strong>fants. Les données<strong>des</strong> <strong>en</strong>quêtes Famille relatives à l’espacem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tre deux<strong>accouchem<strong>en</strong>ts</strong> sont affectées par <strong>des</strong> phénomènes de c<strong>en</strong>sure. Pour <strong>en</strong>t<strong>en</strong>ir compte, les fonctions de survie ont été estimées <strong>en</strong> utilisant laméthode de Kaplan et Meier. <strong>La</strong> figure 9 montre la courbe correspondantepour les femmes interrogées à l’<strong>en</strong>quête Famille de 1999 et ayant déjàaccouché une première fois à un âge compris <strong>en</strong>tre 25 et 30 ans. Trois ansaprès l’accouchem<strong>en</strong>t, 32 % d’<strong>en</strong>tre elles n’ont toujours pas accouché ànouveau. Au bout de 20 ans, la proportion est de 22 %. Lorsque, après unlong délai, la femme n’a toujours pas accouché, le risque qu’elle le fasseest très faible et la courbe de survie est pratiquem<strong>en</strong>t horizontale. L<strong>en</strong>iveau atteint reflète la probabilité de n’avoir à terme aucun autre <strong>en</strong>fant,et le complém<strong>en</strong>t à un (78 %), la probabilité d’agrandissem<strong>en</strong>t. Dans lasuite de l’article, pour les comparaisons, nous utiliserons la probabilité d<strong>en</strong>e pas avoir eu de nouvel <strong>en</strong>fant au bout d’une durée suffisamm<strong>en</strong>t longue,jusqu’à 10 ans après la ménopause, soit 60 ans, la limite choisie étant(8) <strong>La</strong> dernière de ces <strong>en</strong>quêtes, intitulée Enquête sur l’histoire familiale (EHF) 1999 a interrogéun échantillon de 380000 personnes (hommes et femmes) représ<strong>en</strong>tatif de la populationfrançaise âgée de 18 ans ou plus (Cassan et al., 2000).