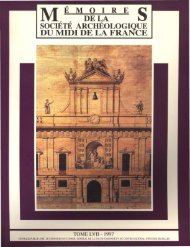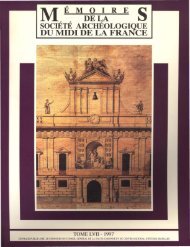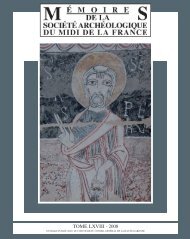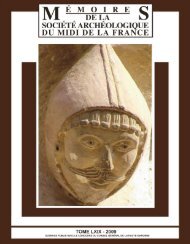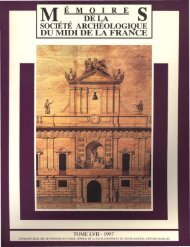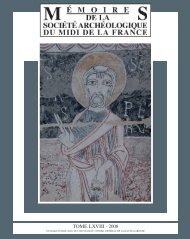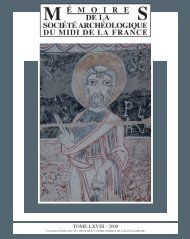Couverture 2005 - Académies et Sociétés savantes de Toulouse
Couverture 2005 - Académies et Sociétés savantes de Toulouse
Couverture 2005 - Académies et Sociétés savantes de Toulouse
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
DÉCOR DES MANUSCRITS DE BERNARD DE CASTANET ET ENLUMINURE TOULOUSAINE 237l’épaisseur du volume actuel peut témoigner <strong>de</strong>s vicissitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> leur histoire. Le nombre <strong>de</strong> folios dans chaquemanuscrit dépend <strong>de</strong> l’ampleur du contenu, mais <strong>de</strong>s acci<strong>de</strong>nts survenus pendant le parcours du manuscritpeuvent l’altérer. Certains auraient été soumis à une perte <strong>de</strong> pages plus ou moins importante, comme c’est lecas du Lat. 5767, composé <strong>de</strong> 25 feuill<strong>et</strong>s <strong>et</strong> contenant seulement, sur sa <strong>de</strong>rnière page actuelle, la table <strong>de</strong>smatières <strong>de</strong> l’Épitomé <strong>de</strong> Florus, précédée <strong>de</strong>s Commentaires <strong>de</strong> César. En ce qui concerne le ms 29 <strong>de</strong>Chambéry, il manque une cinquantaine <strong>de</strong> feuill<strong>et</strong>s au début du manuscrit, car une pagination, effectuée parune main du XVII e siècle, commence à « 101 » <strong>et</strong> correspond au f° 1r° actuel (46). Par contraste, le manuscrit leplus volumineux se compose <strong>de</strong> 368 feuill<strong>et</strong>s (Lat. 6428 B).Le co<strong>de</strong>x est formé par la réunion <strong>de</strong> cahiers <strong>de</strong> parchemin. Dans les dix-sept manuscrits <strong>de</strong> Bernard <strong>de</strong>Castan<strong>et</strong>, le type <strong>de</strong> cahier utilisé est le quinion (ou quinternus). Le quinion est formé <strong>de</strong> 5 bifeuill<strong>et</strong>s, soit 10feuill<strong>et</strong>s ou 20 pages. Comme Marie-Thérèse d’Alverny l’a rapporté, le quinion est le type <strong>de</strong> cahier le plusrépandu dans les manuscrits italiens. Selon les spécialistes <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong>s manuscrits juridiques, les manuscritsbolonais qui datent <strong>de</strong> la secon<strong>de</strong> moitié du XIII e <strong>et</strong> du XIV e siècle sont ordinairement composés <strong>de</strong> cahiers duquinion (47). Pour former le cahier, la règle <strong>de</strong> Grégory est systématiquement respectée: le côté poil duparchemin fait face au côté poil <strong>et</strong> le côté chair du parchemin fait face au côté chair, afin que le livre ouvertprésente la surface d’une même couleur <strong>et</strong> d’une même texture. Il est à noter que dans ces dix-sept manuscritsles cahiers commencent toujours côté chair, peut-être une autre caractéristique partagée avec la productionitalienne (48). L’aspect <strong>de</strong>s parchemins utilisés est également homogène dans tous ces manuscrits. Ils paraissentsouvent jaunâtres, présentant quelques imperfections, comme <strong>de</strong> p<strong>et</strong>its trous <strong>et</strong> déchirures colmatés; engénéral, ils sont plus soli<strong>de</strong>s que le type <strong>de</strong> parchemin appelé vélin.Dans les dix-sept manuscrits, la foliotation en chiffres arabes, portée dans l’angle supérieur droit <strong>de</strong> la pagerecto, est d’époque mo<strong>de</strong>rne (49). Dans l’état primitif <strong>de</strong>s manuscrits, le titre courant, inscrit en margesupérieure <strong>de</strong> chacune <strong>de</strong>s pages, indique l’intitulé <strong>de</strong> l’ouvrage ou le numéro du livre <strong>et</strong> sert <strong>de</strong> repérage àl’intérieur <strong>de</strong> chaque volume. Au moment <strong>de</strong> la confection, n’ayant pas la possibilité <strong>de</strong> renvois aux folios, latable du contenu placée à la tête du manuscrit renseigne toujours sur les titres <strong>de</strong>s ouvrages (fig. 3).L’aspect <strong>de</strong>s écrituresLe type d’écriture <strong>de</strong>s livres d’étu<strong>de</strong> est caractérisé par <strong>de</strong>s l<strong>et</strong>tres <strong>de</strong> forme moins soutenues: une textualissimplifiée. Leurs textes sont souvent <strong>de</strong>nses, l’espace d’entreligne est plus serré <strong>et</strong> le nombre <strong>de</strong> lignes plusgrand que dans la mise en page <strong>de</strong>s livres <strong>de</strong>stinés à un usage plus solennel comme les livres liturgiques. Lemodule <strong>de</strong>s l<strong>et</strong>tres est réduit <strong>et</strong> la forme est simplifiée. Aucun traitement en losange du quadratus, ni d’aspectcarré <strong>de</strong> la tête <strong>et</strong> <strong>de</strong> la base du jambage du prescissus, l’exigence formelle <strong>de</strong> la textualis formata est atténuéedans les écritures employées pour la copie <strong>de</strong>s ouvrages d’étu<strong>de</strong> (50). Cependant, malgré la p<strong>et</strong>itesse <strong>de</strong>l’écriture, le moule <strong>de</strong>s l<strong>et</strong>tres conserve une relative largeur, pouvant s’inscrire dans un carré, <strong>et</strong> elles ten<strong>de</strong>nt às’arrondir, particulièrement dans les manuscrits méridionaux. La clarté formelle <strong>de</strong> la minuscule caroline, très46. Cf. Cat. mss. datés, t. VI, p. 157; Caroline HEID-GUILLAUME <strong>et</strong> Anne RITZ, Manuscrits médiévaux <strong>de</strong> Chambéry…, p. 111.47. Marie-Thérèse D’ALVERNY, « Alain <strong>de</strong> Lille… », p. 326; Frank Pi<strong>et</strong>er Willem SOETERMEER, « À propos d’une famille <strong>de</strong> copistes. Quelquesremarques sur la librairie à Bologne aux XIII e <strong>et</strong> XIV e siècles », dans Studi medievali, ser. III, t. XXX (1989), p. 425-478, en particulier p. 448, n. 109.Nous tenons à remercier vivement M. Frank So<strong>et</strong>ermeer d’avoir bien voulu nous donner d’utiles conseils sur <strong>de</strong>s questions codicologiques <strong>de</strong>manuscrits juridiques.48. Dans les manuscrits <strong>de</strong> Moissac, <strong>de</strong>s XI e <strong>et</strong> XII e siècles, le premier recto du cahier est sur le côté poil du parchemin: Jean DUFOUR, Labibliothèque <strong>et</strong> le scriptorium…, p. 40. Le côté poil à l’extérieur du cahier est la disposition habituelle <strong>de</strong>s manuscrits latins dans les scriptoriamonastiques.49. Par c<strong>et</strong>te numérotation mo<strong>de</strong>rne, le feuill<strong>et</strong> qui porte sur son verso la table du contenu <strong>et</strong> l’ex-dono, placé en tête <strong>de</strong> huit manuscrits <strong>de</strong><strong>Toulouse</strong>, est tantôt folioté, tantôt sans foliotation. Les feuill<strong>et</strong>s <strong>de</strong> gar<strong>de</strong> <strong>de</strong> certains manuscrits sont également foliotés, ce qui fait que le premierfeuill<strong>et</strong> du texte ne porte pas nécessairement la numérotation « 1 ».50. L’intention <strong>de</strong> ce paragraphe relève <strong>de</strong> la codicologie plutôt que <strong>de</strong> la paléographie: il s’agit d’essayer d’analyser le processus <strong>de</strong> fabricationdu livre. L’approche est empruntée à celle enseignée par Denis MUZERELLE dans Paul GÉHIN (dir.), Lire le manuscrit médiéval. Observer <strong>et</strong> décrire,Paris, <strong>2005</strong>, chapitre 4 « L’écriture » aux p. 85-121. Sur l’introduction générale à la paléographie latine, nous avons consulté: Gerard Isaac LIEFTINCK,« Pour une nomenclature <strong>de</strong> l’écriture livresque <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> dite gothique. Essai s’appliquant spécialement aux manuscrits originaires <strong>de</strong>s Pays-Bas médiévaux », dans Bernhard BISCHOFF, Gerard Isaac LIEFTINCK <strong>et</strong> Giulio BATTELLI, Nomenclature <strong>de</strong>s écritures livresques du IX e au XVI e siècle.Actes du premier colloque international <strong>de</strong> paléographie latine, Paris, 28-30 avril 1953, Paris, 1954, p. 15-34; Bernhard BISCHOFF, Paléographie <strong>de</strong>l’Antiquité romaine <strong>et</strong> du Moyen Âge occi<strong>de</strong>ntal, trad. Hartmut ATSMA <strong>et</strong> Jean VEZIN, Paris, 1985; Albert DEROLEZ, The Palaeography of GothicManuscript Books from the Twelfth to the Early Sixteenth Century, Cambridge, 2003.