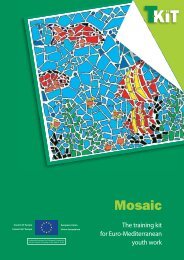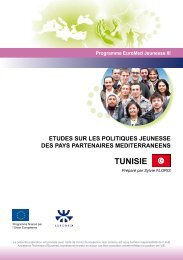T-Kit sur l'apprentissage interculturel - EU-CoE youth partnership
T-Kit sur l'apprentissage interculturel - EU-CoE youth partnership
T-Kit sur l'apprentissage interculturel - EU-CoE youth partnership
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
T-<strong>Kit</strong>L’apprentissage<strong>interculturel</strong>2Les phases ethnocentriquesBennett conçoit l’ethnocentrisme comme unephase dans laquelle l’individu suppose que savision du monde est le centre même de la réalité.La dénégation est le fondement d’une visiondu monde ethnocentrique: l’individu refuse l’existencede différences et d’autres visions du monde.Cette dénégation peut être due à l’isolement: dansce cas, il est peu probable voire même tout à faitimprobable d’être confronté à la différence et d’enfaire l’expérience. Elle peut aussi être due à laséparation, situation dans laquelle la différenceest volontairement mise à l’écart et où un individu,ou un groupe, construit intentionnellementdes barrières entre lui et les personnes «différentes»,afin de ne pas être confronté à la différence.En conséquence, la séparation, parce qu’elleexige au moins un temps la reconnaissance dela différence, est en cela une sorte de développementpar rapport à l’isolement. La ségrégationraciale, encore pratiquée dans le monde, est unexemple de cette phase de séparation.Les membres de groupes opprimés n’expérimententgénéralement pas cette phase de dénégation.Il est en effet difficile de dénier la différence,lorsque c’est votre différence ou votre vision dumonde différente qui sont déniées.En deuxième phase, Bennett décrit la défense. Ladifférence culturelle peut être ressentie commeune menace, parce qu’elle offre une alternative ànotre vision de la réalité et ce faisant, à notre identité.Dans la phase de défense, par conséquent, ladifférence est perçue, mais combattue.La stratégie la plus courante pour lutter contrela différence est le dénigrement, qui consiste àporter un jugement négatif <strong>sur</strong> toute vision dumonde dissemblable. Les stéréotypes et dans leurforme extrême, le racisme, sont des exemples destratégies de dénigrement. L’autre facette du dénigrementest la supériorité, qui consiste à mettrel’accent <strong>sur</strong> les aspects positifs de sa propre cultureet à accorder peu ou pas d’intérêt à la culturede l’autre, de cette façon implicitement dépréciée.On observe parfois une troisième stratégie pourse protéger de la menace que représente la différence,que Bennett appelle le «revirement».L’individu va alors valoriser la culture de l’autreet dénigrer ses propres antécédents culturels.Cette stratégie, qui à première vue peut apparaîtrecomme une preuve de «sensibilité <strong>interculturel</strong>le»,n’est en fait que le remplacement ducentre de son ethnocentrisme (nos propres antécédentsculturels) par un autre.La dernière phase de l’ethnocentrisme est celleque Bennett appelle la minimisation. La différenceest reconnue et n’est plus combattue au moyende stratégies de dénigrement ou de supériorité,mais on en minimise la signification. Les similitudesculturelles sont mises en avant commel’emportant de loin <strong>sur</strong> les différences, ce quirevient à banaliser la différence. Bennett souligneque beaucoup d’organisations voient dansce qu’il appelle la minimisation le stade ultimedu développement <strong>interculturel</strong>, et s’attachent àdévelopper un monde de valeurs partagées etde points communs. Ces points communs sontconstruits <strong>sur</strong> la base de l’universalisme physique,c’est-à-dire <strong>sur</strong> les similitudes biologiquesentre les humains. Nous devons tous manger,digérer et mourir. Considérer que la culture n’estqu’une sorte de prolongement de la biologierevient à en minimiser la signification.Les phases ethnorelatives«Un des fondements de l’ethnorelativisme résidedans l’hypothèse selon laquelle les cultures nepeuvent être comprises que comparativement lesunes aux autres, et qu’un comportement particulierne peut être compris que dans son contexteculturel.» Dans les phases ethnorelatives, la différencen’est plus perçue comme une menace maiscomme un défi. L’individu tente alors de développerde nouvelles catégories pour comprendre,au lieu de préserver les catégories existantes.L’ethnorelativisme commence avec l’acceptationde la différence culturelle. Premièrement, il s’agitd’accepter que les comportements verbaux etnon-verbaux varient d’une culture à l’autre etque toutes ces variantes méritent le respect.Deuxièmement, cette acceptation va s’élargir pourenglober les visions du monde et les valeurssous-jacentes de l’autre culture. Cette deuxièmephase implique la connaissance de ses propresvaleurs et la perception de celles-ci comme étantdéterminée par la culture. Les valeurs sont comprisesen tant que processus, en tant qu’outilspour organiser le monde, plutôt que commequelque chose que l’on «possède». Même lesvaleurs qui motivent le dénigrement d’un groupeparticulier peuvent être considérées comme ayantune fonction dans l’organisation du monde cequi n’exclut pas que l’on puisse avoir une opinionau sujet de cette valeur.La phase suivante, l’adaptation, se développe àpartir de l’acceptation des différences. L’adaptationcontraste avec l’assimilation, cette dernièreconsistant à adopter d’autres valeurs, visions dumonde et comportements en renonçant à sapropre identité. L’adaptation, elle, est un processusd’addition. L’individu apprend un nouveaucomportement convenant à une autre vision dumonde et l’ajoute à son répertoire comportementalpersonnel, de nouveaux styles de communicationprenant alors le dessus. Ici, la culture doit êtreperçue en tant que processus qui se développe etfluctue et non pas en tant que donnée statique.30