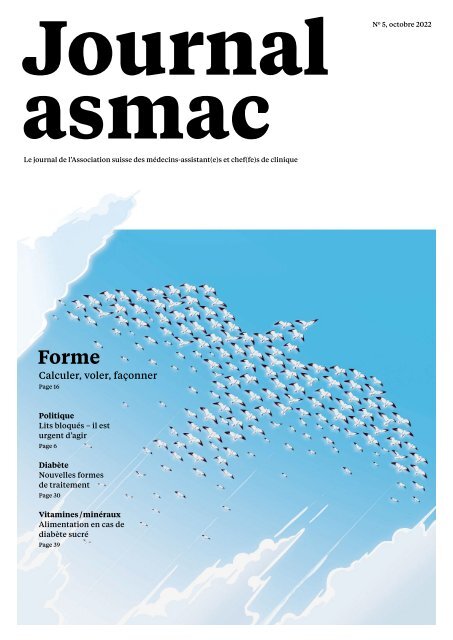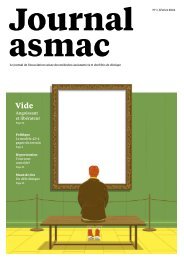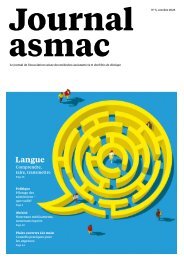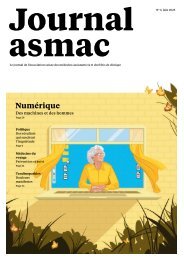Journal asmac No 5 - octobre 2022
Forme - Calculer, voler, façonner Politique - Lits bloqués – il est urgent d’agir Diabète - Nouvelles formes de traitement Vitamines/minéraux - Alimentation en cas de diabète sucré
Forme - Calculer, voler, façonner
Politique - Lits bloqués – il est urgent d’agir
Diabète - Nouvelles formes de traitement
Vitamines/minéraux - Alimentation en cas de diabète sucré
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Journal</strong><br />
N o 5, <strong>octobre</strong> <strong>2022</strong><br />
<strong>asmac</strong><br />
Le journal de l’Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique<br />
Forme<br />
Calculer, voler, façonner<br />
Page 16<br />
Politique<br />
Lits bloqués – il est<br />
urgent d’agir<br />
Page 6<br />
Diabète<br />
<strong>No</strong>uvelles formes<br />
de traitement<br />
Page 30<br />
Vitamines / minéraux<br />
Alimentation en cas de<br />
diabète sucré<br />
Page 39
Sommaire<br />
Forme<br />
Calculer, voler, façonner<br />
Illustration de la page<br />
de couverture: Stephan Schmitz<br />
Editorial<br />
5 Formules et formations<br />
Politique<br />
6 La pénurie de personnel s’aggrave<br />
9 L’essentiel en bref<br />
<strong>asmac</strong><br />
10 <strong>No</strong>uvelles des sections<br />
12 <strong>asmac</strong>-Inside<br />
13 Conseil juridique de l’<strong>asmac</strong><br />
Point de mire: Forme<br />
16 Ballets aériens<br />
18 Dernier adieu dans les formes<br />
20 Dessins célestes<br />
23 Dessine-moi une fractale<br />
26 Cat Circles<br />
28 Le logo, l’image qui fait la différence<br />
Perspectives<br />
30 Aus der «Therapeutischen<br />
Umschau» – Übersichtsarbeit:<br />
Update: Neue Therapieformen<br />
des Diabetes mellitus Typ 2<br />
39 Aus der «Therapeutischen<br />
Umschau» – Übersichtsarbeit:<br />
Ernährung bei Diabetes mellitus<br />
51 Mission pour la Croix-Rouge<br />
mediservice<br />
52 Boîtes aux lettres<br />
54 Financement automobile:<br />
leasing ou crédit?<br />
56 La cuisine saine et savoureuse<br />
Poisson et son accompagnement<br />
automnal<br />
58 Impressum<br />
Annonce<br />
Vertrauen<br />
CH-3860 Meiringen<br />
Telefon +41 33 972 81 11<br />
www.privatklinik-meiringen.ch<br />
Ein Unternehmen der Michel Gruppe<br />
Ärztliche Leitung:<br />
Prof. Dr. med. Thomas J. Müller<br />
Wo Patienten auch Gäste sind.<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 5/22 3
Médecine<br />
Interne Générale<br />
Update Refresher<br />
09. – 12.11.<strong>2022</strong> Lausanne<br />
32 h<br />
Médecine Interne<br />
Update Refresher<br />
06. – 10.12.<strong>2022</strong> Lausanne<br />
39 h<br />
Gynécologie<br />
Update Refresher<br />
09. – 10.11.<strong>2022</strong> Lausanne<br />
16 crédits SSGO<br />
Pédiatrie<br />
Update Refresher<br />
16. – 18.11.<strong>2022</strong> Lausanne<br />
21 h<br />
Psychiatrie et<br />
Psychothérapie<br />
Update Refresher<br />
16. – 18.11.<strong>2022</strong> Lausanne<br />
23 h<br />
Information / Inscription<br />
tél. 041 567 29 80 | info@fomf.ch<br />
www.fomf.ch<br />
Présence sur place ou participation via Livestream<br />
Assurance de protection<br />
juridique pour les médecins<br />
et le personnel médical<br />
Dans votre métier de<br />
professionnel de la santé, tout<br />
tourne autour de l’humain. Pour<br />
vous permettre de vous<br />
concentrer sur vos patients, nous<br />
nous occupons des aspects<br />
juridiques. <strong>No</strong>us sommes à vos<br />
côtés en cas de litige et, si la<br />
situation s’envenime, nous vous<br />
défendons.<br />
Avantages de la protection<br />
juridique pour les médecins et<br />
le personnel médical<br />
• Consultation juridique<br />
individuelle et représentation<br />
légale<br />
• Soutien financier et prise en<br />
charge de tous les frais<br />
• Couverture étendue au<br />
domaine privé<br />
Soigner<br />
sereinement<br />
N’attendez pas pour vous<br />
renseigner, vous pouvez conclure<br />
votre assurance très facilement en<br />
bénéficiant d’un tarif préférentiel:<br />
mediservice-<strong>asmac</strong>.ch/axa
Editorial<br />
Formules et<br />
formations<br />
Catherine Aeschbacher<br />
Rédactrice en chef<br />
du <strong>Journal</strong> <strong>asmac</strong><br />
Le cercle ou la sphère représente la forme parfaite. Les penseurs<br />
antiques en étaient déjà convaincus. Cela n’a pas<br />
changé. En effet, comme la sphère possède la plus petite<br />
superficie par rapport à un volume donné, elle est la plus<br />
stable de tous les corps. Si les corps pouvaient choisir leur forme,<br />
ils deviendraient tous des sphères, étant donné qu’ils aspirent à la<br />
stabilité. C’est ce que la physique nous apprend.<br />
Dans notre Point de mire consacré à la «forme», nous n’aspirons ni<br />
à la stabilité ni à l’idéal. <strong>No</strong>us laisserons donc de côté les sphères pour<br />
nous intéresser aux formes éphémères, aux formes naturelles comme<br />
les nuées d’oiseaux ou celles façonnées par les humains comme les<br />
urnes d’eau. Ensuite, nous plongeons dans les profondeurs des mathématiques<br />
pour aborder les fractales. Il s’agit d’objets autosimilaires<br />
qui possèdent des caractéristiques surprenantes du point de vue<br />
mathématique et que nous rencontrons quotidiennement dans chaque<br />
étalage de légumes sous forme de brocoli ou de romanesco. Quant<br />
aux logos, ils ne doivent pas obligatoirement être stables, mais si<br />
possible inimitables. Vous lirez donc aussi dans notre Point de mire<br />
comment mettre en valeur les produits ou institutions. Pour finir,<br />
nous analysons les raisons qui poussent les chats à s’intéresser aux<br />
formes géométriques.<br />
Services des urgences débordés et lits fermés: cette situation se<br />
présente dans de nombreux établissements, de l’hôpital universitaire<br />
jusqu’à l’hôpital régional. Les deux dernières années ont aggravé<br />
une situation à laquelle on pouvait déjà s’attendre avant: une sérieuse<br />
pénurie de personnel, en particulier dans le domaine des soins.<br />
La pandémie a eu un effet amplificateur en poussant à bout les soignantes<br />
et soignants qui ont abandonné leur profession. Un sondage<br />
que l’<strong>asmac</strong> a réalisé auprès des sections montre à quel point la<br />
situation est précaire. Si l’on devait assister à une nouvelle vague de<br />
coronavirus cet hiver, l’évolution négative se poursuivra. Comme<br />
l’initiative sur les soins infirmiers ne portera des fruits que dans<br />
plusieurs années, l’<strong>asmac</strong> exige des mesures immédiates. Vous découvrirez<br />
les détails à ce propos à la rubrique Politique. Cet article marque<br />
l’arrivée de Philipp Thüler, nouveau responsable politique et communication,<br />
au <strong>Journal</strong> <strong>asmac</strong>. Vous trouverez plus d’informations à<br />
son sujet dans la même rubrique.<br />
Pour finir, un message de la rédaction: le sondage relatif au <strong>Journal</strong><br />
<strong>asmac</strong> est en cours. <strong>No</strong>us vous invitons à consacrer cinq minutes de<br />
votre précieux temps pour nous évaluer. Votre avis nous intéresse:<br />
https://findmind.ch/c/GRnp-Vu77<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 5/22 5
Politique<br />
La pénurie de<br />
personnel s’aggrave<br />
Dans les hôpitaux suisses, les lits bloqués font partie du quotidien.<br />
La pénurie de personnel, en particulier de personnel soignant, en est presque<br />
toujours la raison. L’<strong>asmac</strong> a réalisé un sondage pour en savoir plus sur<br />
la situation dans les cantons. Des mesures susceptibles d’être rapidement mises<br />
en œuvre sont nécessaires pour améliorer la situation.<br />
Philipp Thüler, responsable politique et communication / directeur adjoint de l’<strong>asmac</strong><br />
Dans de nombreux hôpitaux, 5 à 10 % des lits sont bloqués en raison du manque de personnel soignant.<br />
Des mesures sont nécessaires pour améliorer rapidement les conditions de travail.<br />
Pendant la pandémie de coronavirus,<br />
les services d’urgence et<br />
de soins intensifs surchargés<br />
étaient un sujet récurrent dans<br />
les médias suisses. Au printemps, après la<br />
levée des mesures anti-COVID au niveau<br />
fédéral, la situation s’est temporairement<br />
détendue. En été, on pouvait à nouveau<br />
lire dans différents journaux que les urgences<br />
étaient pleines, les opérations devaient<br />
être reportées, les hôpitaux étaient<br />
à la limite de leurs capacités.<br />
Cette situation n’était pas imputable<br />
à la vague estivale de coronavirus, mais<br />
en premier lieu à la pénurie de personnel,<br />
en particulier dans le domaine des soins.<br />
«<strong>No</strong>us avons moins de personnel soignant<br />
à disposition», déclarait Hans-Christoph<br />
Mewes en juillet dans le quotidien «Der<br />
Bund». Il est responsable des soins à la<br />
clinique de médecine interne, aux soins<br />
intensifs, en anesthésiologie et aux services<br />
d’urgence des hôpitaux de Berthoud<br />
et Langnau. Ces établissements ont été<br />
contraints de fermer 14 lits pour soins<br />
stationnaires durant le premier semestre.<br />
«Le problème est aggravé par le fait que<br />
ces personnes ne vont pas travailler dans<br />
d’autres hôpitaux, mais qu’elles quittent la<br />
profession», a-t-il ajouté.<br />
La problématique et le fait que le<br />
COVID n’est pas directement responsable<br />
de cette situation ont été confirmés lors de<br />
la séance d’août du Comité directeur (CD)<br />
où le sujet était inscrit à l’ordre du jour.<br />
L’<strong>asmac</strong> voulait en avoir le cœur net et a<br />
lancé un sondage parmi les sections pour<br />
obtenir une vue d’ensemble de la situation<br />
en Suisse.<br />
Une seule section lève l’alerte<br />
Les résultats confirment les craintes et<br />
l’impression générale. 9 sections sur 16<br />
ont répondu. Une seule a répondu qu’il n’y<br />
avait actuellement pas de lits bloqués dans<br />
sa région. Les autres évoquent 5 à 10 % de<br />
lits bloqués. Dans le canton de St-Gall, il y<br />
a même une réponse officielle du gouvernement<br />
à une interpellation du groupe socialiste.<br />
«De nombreux hôpitaux suisses<br />
ne disposent actuellement pas de suffisamment<br />
de spécialistes pour exploiter<br />
tous les lits. Les hôpitaux dans le canton<br />
de St-Gall sont aussi concernés», lit-on<br />
Photo: Adobe Stock<br />
6<br />
5/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
Politique<br />
dans la réponse. S’ensuivent des chiffres<br />
concrets qui permettent de dresser un tableau<br />
de la situation. En mai <strong>2022</strong>, 66 lits<br />
étaient indisponibles à l’Hôpital cantonal<br />
de St-Gall, ce qui correspond à environ<br />
10% des capacités. A Grabs, une extension<br />
prévue de 20 lits n’a pas pu être réalisée. A<br />
Altstätten, l’extension de cinq lits n’a pas<br />
eu lieu. Dans les deux cas, la raison était la<br />
même: la pénurie de personnel. Dans<br />
d’autres cantons, la situation est identique<br />
et toujours due à la pénurie de personnel.<br />
Il y a ceux qui ne citent que le manque de<br />
personnel, alors que d’autres déplorent<br />
aussi la pénurie de médecins. Concernant<br />
la suite de l’évolution, la plupart ne sont<br />
pas très optimistes. Selon plusieurs cantons,<br />
rien n’indique que la pénurie de personnel<br />
spécialisé dans le secteur de la santé<br />
va se détendre.<br />
personnes un désengagement intérieur<br />
qui se concrétise maintenant.<br />
Globalement, la situation est inquiétante.<br />
Les chiffres publiés par l’Obsan<br />
montrent que 36% du personnel infirmier<br />
quitte la profession pendant les cinq premières<br />
années après l’entrée dans la profession.<br />
Par ailleurs, le nombre de postes<br />
vacants a presque doublé comparativement<br />
à 2019 (selon Jobradar).<br />
Il faut donc agir maintenant, car la situation<br />
ne va pas se régler d’elle-même. Au<br />
contraire, un cercle vicieux nous menace,<br />
vu que la pénurie de personnel accroît la<br />
pression sur le personnel restant. De plus,<br />
la pression sur les coûts continue d’augmenter<br />
et le nombre de patients augmentera<br />
probablement en automne et en hiver,<br />
par exemple à cause d’une nouvelle vague<br />
de coronavirus.<br />
<strong>No</strong>uveau responsable<br />
politique et communication<br />
Philipp Thüler<br />
Seit Depuis début août,<br />
Philipp Thüler travaille<br />
au secrétariat central<br />
de l’<strong>asmac</strong> en tant que<br />
responsable du département<br />
politique et<br />
communication. Après<br />
des études en histoire, sciences politiques<br />
et des médias, il a œuvré comme<br />
spécialiste et responsable de la communication<br />
pour différentes organisations.<br />
Ses activités antérieures lui ont permis<br />
de se familiariser avec le travail associatif<br />
ainsi qu’avec le secteur de la santé.<br />
Il remplace Marcel Marti, qui a travaillé<br />
pour l’<strong>asmac</strong> jusqu’à fin juillet.<br />
Photo: màd<br />
Problèmes divers<br />
Il ne s’agit pas seulement de postes vacants,<br />
mais aussi de cas complexes dont la<br />
prise en charge est plus fastidieuse en raison<br />
du progrès médical et qui requièrent<br />
donc davantage de personnel. A cela<br />
s’ajoute un afflux de patients en augmentation<br />
à cause de la croissance constante<br />
de la population. Plusieurs voix évoquent<br />
aussi les tarifs qui ne couvrent pas les<br />
coûts, en particulier pour les patients<br />
complexes, ce qui empêche d’engager plus<br />
de personnel.<br />
Les postes qui ne peuvent pas être<br />
pourvus et l’exode du personnel soignant<br />
vers d’autres professions constituent le<br />
principal problème. Cela se répercute<br />
aussi sur les médecins-assistant(e)s qui<br />
doivent, en particulier dans les services<br />
d’urgence, assumer des tâches qui incombent<br />
normalement au personnel soignant.<br />
Les raisons qui sont citées pour<br />
expliquer la pénurie de personnel sont<br />
les salaires qui n’augmentent pas, la<br />
surcharge de travail, le manque de considération,<br />
les conditions de travail peu<br />
attractives qui se répercutent aussi négativement<br />
sur l’équilibre entre vie professionnelle<br />
et vie privée. A cela s’ajoute aussi<br />
un écart croissant entre le travail quotidien<br />
et la manière dont on envisageait<br />
initialement la profession: le travail se<br />
dépersonnalise, les différentes tâches<br />
sont réparties sur plusieurs spécialistes.<br />
Parfois, on aborde aussi des thèmes<br />
que l’on pourrait qualifier d’effets de rattrapage<br />
de la pandémie: la surcharge<br />
constante pendant la pandémie liée à la<br />
peur de s’infecter et/ou la pression de se<br />
vacciner a provoqué chez de nombreuses<br />
Agir rapidement<br />
La voie à emprunter semble assez claire: en<br />
adoptant l’initiative sur les soins infirmiers<br />
l’automne dernier, le peuple suisse s’est<br />
clairement exprimé en faveur d’un système<br />
de santé de qualité. La mise en œuvre demande<br />
toutefois du temps. Les lois correspondantes<br />
sont actuellement discutées au<br />
Parlement, mais il faudra plusieurs années<br />
jusqu’à ce qu’elles déploient leurs effets.<br />
Les cantons ou même les hôpitaux doivent<br />
donc prendre des mesures immédiates. Il y<br />
a de bons exemples qui montrent la voie à<br />
suivre, comme le groupe Siloah qui a réduit<br />
la durée hebdomadaire de travail pour le<br />
personnel infirmier de 42 à 40 heures. Le<br />
GZO Wetzikon va encore plus loin: depuis<br />
juin dernier, le personnel infirmier travaille<br />
37,8 heures par semaine au lieu de 42 heures<br />
auparavant, à salaire égal. Dans ce contexte,<br />
le fait de ne pas savoir si la mesure permettra<br />
de pourvoir les postes nécessaires<br />
constitue la principale inconnue. C’est<br />
pourquoi d’autres hôpitaux comme le<br />
Centre hospitalier Bienne misent sur des<br />
salaires plus élevés et des suppléments<br />
pour le travail du week-end et de nuit.<br />
Le plus important est d’agir, indépendamment<br />
de l’approche choisie. L’<strong>asmac</strong><br />
reste mobilisée sur le sujet qui est d’ailleurs<br />
étroitement lié à notre revendication<br />
de la semaine de 42-heures-PLUS.<br />
Pour en savoir plus sur le sujet:<br />
<strong>asmac</strong>.ch/conditions-de-travail/<br />
droit-du-travail/#durée-de-travail<br />
@vsao<strong>asmac</strong><br />
medifuture:<br />
inscrivez-vous!<br />
La prochaine édition de medifuture,<br />
notre congrès de carrière annuel avec<br />
mediservice vsao-<strong>asmac</strong>, aura lieu<br />
le 5 novembre. Le stade du Wankdorf<br />
à Berne servira à nouveau d’écrin<br />
à la manifestation. Il est possible de<br />
s’inscrire dès maintenant sur le site<br />
web remanié: www.medifuture.ch.<br />
Changements de<br />
section et demandes de<br />
réduction: communiquez-les<br />
à temps<br />
En février, le secrétariat central de<br />
l’<strong>asmac</strong> envoie les factures annuelles<br />
pour les cotisations. L’appartenance<br />
à la section et les éventuelles réductions<br />
de la cotisation se répercutent sur le<br />
montant de la facture. Vous devez donc<br />
annoncer vos changements de section<br />
et déposer vos demandes de réduction<br />
pour l’année 2023 au plus tard jusqu’au<br />
31 janvier 2023 auprès du secrétariat<br />
central de l’<strong>asmac</strong>. Les annonces de<br />
changement de section et les demandes<br />
de réduction qui nous parviennent<br />
après cette date ne pourront être prises<br />
en compte pour l’année 2023 qu’en cas<br />
de force majeure. <strong>No</strong>us vous remercions<br />
de votre collaboration!<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 5/22 7
Publireportage<br />
Les nouveaux antibiotiques dans le traitement des<br />
infections bactériennes aiguës de la peau et des<br />
tissus mous : l’opportunité de décharger les hôpitaux<br />
Les infections bactériennes aiguës de la peau<br />
et des tissus mous (IBAPTM) ont un risque élevé<br />
d’évolution clinique sévère. Afin d’éviter les<br />
infections nosocomiales associées et de ménager<br />
les capacités hospitalières, l’attention se<br />
porte sur des options de prise en charge des<br />
patients présentant une IBAPTM permettant de<br />
réduire le nombre et la durée d’hospitalisations<br />
en poursuivant le traitement en ambulatoire.<br />
À l’occasion du Congrès européen de microbiologie<br />
clinique et des maladies infectieuses<br />
(ECCMID) <strong>2022</strong> à Lisbonne, un symposium organisé<br />
par A. Menarini a traité des nouveaux<br />
antibiotiques : des nouvelles fluoroquinolones,<br />
d’une part, et des glycopeptides à longue durée<br />
d’effet, d’autre part. Ces derniers sont mieux<br />
tolérés que les traitements précédents tout en<br />
améliorant l’observance.<br />
Les infections bactériennes aiguës de la<br />
peau et des tissus mous (IBAPTM) sont<br />
un sous-groupe important des infections<br />
compliquées de la peau et des tissus<br />
mous (cSSTI). Ainsi que l’expliqua le Prof.<br />
Alex Soriano, Hôpital universitaire de Barcelone,<br />
la fréquence des IBAPTM – principalement<br />
des formes dues aux souches de<br />
S. aureus – a fortement augmenté ces 15<br />
dernières années 1 . En outre, les IBAPTM<br />
sont responsables d’une augmentation<br />
marquée à la fois du nombre et de la durée<br />
des hospitalisationfis 2 .<br />
« Un grand nombre des patients traités<br />
pour IBAPTM dans les services d’urgence<br />
ne nécessite pas d’hospitalisation en fait.<br />
Mais les options thérapeutiques orales utilisées<br />
actuellement, p. ex. les sulfamides, les<br />
céphalosporines de la première génération<br />
ou les tétracyclines, ont leurs limitations<br />
et compliquent la poursuite du traitement<br />
à domicile, notamment chez les patients<br />
moins observants. La probabilité d’un<br />
échec du traitement est particulièrement<br />
élevée chez les patients présentant des<br />
facteurs de risque comme un âge avancé,<br />
des œdèmes, un diabète, une obésité ou<br />
une maladie vasculaire périphérique 3 . »<br />
« <strong>No</strong>us avons un besoin urgent de nouvelles<br />
options thérapeutiques plus efficaces et<br />
mieux tolérables pour le traitement des<br />
IBAPTM », souligne le Prof. Soriano. Selon<br />
l’expert, les nouveaux lipoglycopeptides et<br />
les nouvelles fluoroquinolones ont le potentiel<br />
non seulement d’améliorer les résultats<br />
du traitement par antibiotiques en cas<br />
d’IBAPTM, mais aussi de contourner ou de<br />
réduire le problème d’observance chez les<br />
patients.<br />
Place de l’oritavancine et de la delafloxacine<br />
dans le traitement des IBAPTM<br />
Ainsi qu’expliqué par la Prof. Maddalena<br />
Gianella, infectiologue auprès de l’Université<br />
de Bologne, de nouveaux antibiotiques<br />
à longue durée d’effet ont été développés<br />
ces dernières années, en tenant<br />
particulièrement compte de la prévalence<br />
élevée des souches multirésistantes de<br />
S. aureus résistant à la méticilline (SARM).<br />
Ils peuvent être administrés une fois par<br />
semaine ou, comme dans le cas de l’oritavancine,<br />
en prise unique.<br />
L’orivantacine est un nouveau lipoglycopeptide<br />
à longue durée d’effet avec<br />
trois mécanismes d’action et un effet<br />
bactéricide puissant contre les bactéries<br />
Gram positives, y compris les entérocoques<br />
résistants à la vancomycine. Le<br />
lipoglycopeptide à longue durée d’effet a<br />
été autorisé aux USA et dans l’UE pour le<br />
traitement des IBAPTM chez l’adulte sur<br />
la base des études de phase 3 SOLO I et<br />
SOLO II qui ont démontré la non-infériorité<br />
d’une administration unique d’oritavancine<br />
de 1200 mg par rapport à la vancomycine<br />
2 fois par jour pendant 7 – 10 jours<br />
chez les patients atteints d’infections de<br />
la peau et des tissus mous 4,5,8,9 . Les données<br />
de sécurité poolées des deux études<br />
ont montré que l’efficacité à long terme de<br />
l’oritavancine n’a pas d’effet négatif sur<br />
son innocuité 6 .<br />
« En ce qui concerne les infections polymicrobiennes<br />
ou ‹mixtes› de la peau et des<br />
tissus mous, les germes Gram positifs ne<br />
sont toutefois pas les seuls germes impliqués<br />
en cas d’IBAPTM », fait remarquer le<br />
Prof. Thomas Lodise de l’Albany College of<br />
Pharmacy and Health Sciences à Albany/<br />
New York. Contrairement à l’oritavancine,<br />
la delafloxacine, une fluoroquinolone anionique<br />
disponible sous forme orale et intraveineuse,<br />
couvre un large spectre de bactéries<br />
Gram positives et Gram négatives, y<br />
compris P. aeruginosa et les anaérobies 7,8 .<br />
Message à retenir<br />
Avec l’oritavancine et sa longue demi-vie<br />
terminale de 245 heures et la delafloxacine<br />
sous forme orale et intraveineuse, nous<br />
disposons maintenant de deux nouveaux<br />
antibiotiques avec une efficacité prouvée et<br />
un bon profil de sécurité pour le traitement<br />
des patients atteints d’IBAPTM 4-9 . Selon<br />
les intervenants du symposium ECCMID,<br />
ces deux principes actifs ont le potentiel de<br />
transférer la prise en charge des patients<br />
avec IBAPTM du domaine stationnaire au<br />
domaine ambulatoire et de minimiser les<br />
dépenses totales de santé publique.<br />
Références<br />
1. Sader HS et al. Frequency and antimicrobial susceptibility of bacterial<br />
isolates from patients hospitalised with community-acquired skin and<br />
skin-structure infection in Europe, Asia and Latin America. J Glob Antimicrob<br />
Resist. 2019 Jun;17:103-108.<br />
2. Berger A et al. Initial treatment failure in patients with complicated<br />
skin and skin structure infections. Surg Infect (Larchmt). 2013<br />
Jun;14(3):304-12<br />
3. Eron LJ et al. Managing skin and soft tissue infections: expert panel<br />
recommendations on key decision points. J Antimicrob Chemother.<br />
2003 <strong>No</strong>v;52 Suppl 1:i3-17.<br />
4. Corey GR et al. Single-dose oritavancin in the treatment of acute<br />
bacterial skin infections. N Engl J Med. 2014 Jun 5;370(23):2180-90.<br />
5. Corey GR et al. Single-dose oritavancin versus 7-10 days of vancomycin<br />
in the treatment of gram-positive acute bacterial skin and skin structure<br />
infections: the SOLO II noninferiority study. Clin Infect Dis. 2015<br />
Jan 15;60(2):254-62.<br />
6. Corey GR et al. Single Intravenous Dose of Oritavancin for Treatment<br />
of Acute Skin and Skin Structure Infections Caused by Gram-Positive<br />
Bacteria: Summary of Safety Analysis from the Phase 3 SOLO Studies.<br />
Antimicrob Agents Chemother. 2018 Mar 27;62(4):e01919-17.<br />
7. Hoover R et al. Safety, Tolerability, and Pharmacokinetic Properties<br />
of Intravenous Delafloxacin After Single and Multiple Doses in Healthy<br />
Volunteers. Clin Ther. 2016 Jan 1;38(1):53-65.<br />
8. Information professionnelle Quofenix, www.swissmedicinfo.ch, 12/2021<br />
9. Information professionnelle Tenkasi, www.swissmedicinfo.ch, 08/2021<br />
L’information professionnelle abrégée de Tenkasi ® se trouve<br />
dans ce magazine sur la page 2.<br />
Les documents et références peuvent être démandés en conctactant<br />
A. Menarini GmbH, Thurgauerstrasse 36/38, 8050 Zürich.<br />
METEN5045_22.08<br />
Quofenix ® . C: Délafloxacine en poudre pour solution à diluer pour perfusion. Chaque flacon à usage unique contient 300 mg de délafloxacine. Chaque comprimé contient 450mg de délafloxacine. I: Traitement des infections<br />
bactériennes aiguës de la peau et des tissus mous chez l’adulte D: schéma posologique recommandé pour Quofenix est de 300 mg administrés toutes les 12 heures en perfusion IV de 60 minutes, sur une durée de 5 à 14<br />
jours. Après 6 doses IV, le médecin peut décider de poursuivre le traitement par voie orale. Insuffisance rénale : en cas d’administration IV, pas d’ajustement posologique en cas d’IR légère à modérée (ClCr ≥30 ml/min). En cas<br />
d’IR sévère (ClCr
Politique<br />
Chercher ce qui nous<br />
unit plutôt que ce qui<br />
nous sépare<br />
Ces dernières années, en particulier depuis la pandémie<br />
de coronavirus, j’ai l’impression que les rapports<br />
humains n’ont pas évolué dans le bon sens. Les gens<br />
sont devenus plus impatients, exigeants et insultants.<br />
Evidemment, ma vision subjective ne correspond pas forcément<br />
à la réalité, mais l’ambiance à la caisse de la Coop est souvent<br />
tendue. Il en va de même sur les routes. Mais au cabinet aussi,<br />
les patients semblent plus impatients, exigeants,<br />
voire même insultants. Dans l’environnement<br />
politique, on peut même l’objectiver: sur les<br />
réseaux sociaux, dans les commentaires,<br />
mais aussi dans des courriers personnels<br />
ou lors de discussions, les insultes,<br />
les discours haineux, les menaces,<br />
voire les attaques physiques<br />
contre les personnes qui pensent<br />
autrement sont en augmentation.<br />
Cela ne se produit pas seulement<br />
lors de grands débats fondamentaux.<br />
L’ambiance agressive et la disposition<br />
à la violence semblent aussi<br />
s’être accentuées lorsqu’il s’agit de<br />
banalités.<br />
C’est alarmant et triste. Que se passe-t-il<br />
dans notre société? Même si une certaine tendance<br />
pouvait déjà être ressentie auparavant, la<br />
pandémie, la guerre en Ukraine, les catastrophes climatiques,<br />
l’augmentation des prix de l’énergie et les éventuelles<br />
crises énergétiques à avenir semblent déclencher une réaction<br />
de peur chez bon nombre d’entre nous. Dans ce contexte marqué<br />
par un sentiment de renoncement, nous semblons considérer<br />
nos semblables comme des ennemis qui menacent de nous<br />
prendre une chose ou de nous en refuser une autre. Certains<br />
pensent donc légitimement pouvoir s’attaquer à leurs<br />
semblables, par n’importe quel moyen.<br />
L’essentiel<br />
en bref<br />
diversité comme une menace et en mettant l’accent sur ce<br />
qui nous sépare que nous avancerons, mais en acceptant en toute<br />
humilité que l’individu ne peut pas avancer sans les autres. Pour<br />
moi, cela s’applique à la politique, à la médecine, à la politique<br />
professionnelle, à la vie privée et aux loisirs. Et très franchement,<br />
en tant que «teamplayer», je n’éprouverais aucun plaisir à<br />
m’engager sans l’aide de mes semblables.<br />
Oui, d’accord, je l’admets, ce n’est pas toujours<br />
facile! Il y a des situations dans lesquelles<br />
j’attaque les autres, je réagis trop violemment<br />
ou de manière injuste. Parfois<br />
en raison d’une menace réelle, parfois<br />
par peur de perdre la face ou sous<br />
le coup d’une impulsion. Si dans<br />
mon action, je me concentre sur<br />
les points communs, je peux<br />
découvrir de nouvelles perspectives<br />
et donc relativiser mes<br />
problèmes personnels.<br />
Je reste convaincu que nous devons<br />
réapprendre, en tant qu’individus et<br />
en tant que société, à mettre davantage<br />
l’accent sur ce qui nous rassemble et à<br />
considérer nos différences comme une<br />
opportunité et non pas comme une menace.<br />
Au lieu d’insulter les autres, de les harceler ou<br />
de les rendre responsables de nos ennuis, nous devons<br />
comprendre que nous avons tous nos problèmes et difficultés,<br />
et que nous pourrons les surmonter que dans un commun effort.<br />
Dans la médecine, dans la politique et dans la vie privée.<br />
Photo: màd<br />
J’ai une autre vision des choses. Les grands problèmes et<br />
défis ne peuvent être surmontés que dans un commun effort.<br />
Chaque individu peut y contribuer avec sa personnalité, ses<br />
idées, ses expériences et son savoir. Il faut écouter les autres,<br />
viser un échange d’égal à égal pour élargir ses connaissances et<br />
découvrir de nouvelles perspectives. Ensuite, nous pouvons<br />
avancer ensemble. Les personnes d’origines très diverses doivent<br />
chercher ensemble des solutions. Ce n’est pas en considérant la<br />
Angelo Barrile,<br />
président de l’<strong>asmac</strong><br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 5/22 9
<strong>asmac</strong><br />
<strong>No</strong>uvelles<br />
des sections<br />
Berne<br />
Save the Date!<br />
Cet automne, nous organiserons deux manifestations<br />
intéressantes et serions heureux<br />
de vous y accueillir!<br />
Atelier sur la planification des<br />
services<br />
Vous passez souvent de longues soirées à<br />
plancher sur les horaires de service de<br />
votre département et ne voyez finalement<br />
plus que des symboles PEP danser devant<br />
vos yeux? Vous aimeriez savoir comment<br />
judicieusement intégrer le travail à temps<br />
partiel dans l’horaire de service? Vous<br />
hésitez parfois quant à la manière d’aborder<br />
les obstacles de la planification et d’appliquer<br />
correctement la loi sur le travail?<br />
Vous voulez savoir comment établir un<br />
horaire de service correct?<br />
Dans ce cas, vous devez absolument<br />
participer à l’atelier gratuit sur la planification<br />
des services organisé par l’ASMAC<br />
Berne.<br />
Simon Schneider (avocat et directeur<br />
suppléant de l’ASMAC Berne), le Dr méd.<br />
Philipp Rahm (conseiller en matière de planification<br />
des services de l’<strong>asmac</strong>) et Susanne<br />
Nüesch (médecin hospitalier spécialiste<br />
au centre universitaire des urgences,<br />
Hôpital de l’Ile, responsable de la planification<br />
des services pour les médecins-assistant[e]s)<br />
assureront un programme passionnant<br />
et répondront volontiers à toutes<br />
vos questions.<br />
Date:<br />
mercredi 26 <strong>octobre</strong>, 14h à 16h30,<br />
avec en-cas<br />
Lieu:<br />
salle de conférence de l’<strong>asmac</strong>, Bollwerk 10,<br />
3011 Berne (à côté de la gare de Berne)<br />
Inscription jusqu’au 19 <strong>octobre</strong> <strong>2022</strong> à<br />
l’adresse info@vsao-bern.ch. <strong>No</strong>us avons<br />
besoin de votre prénom, nom et lieu de travail.<br />
Si vous avez des questions spécifiques,<br />
nous vous invitons à nous les communiquer<br />
à l’avance.<br />
Le défi de la génération Z<br />
Pour la première fois, quatre générations<br />
travaillent en même temps dans les hôpitaux.<br />
La plus jeune est la génération Z<br />
(personnes nées depuis 1995), c’est-à-dire<br />
celle qui entre maintenant dans le monde<br />
hospitalier. On a le sentiment que cette génération<br />
a des besoins et attentes différents<br />
vis-à-vis de la profession.<br />
Qu’est-ce qui caractérise une génération<br />
et pourquoi les différentes générations<br />
vivent-elles dans des mondes parfois<br />
très différents? Les idées, souhaits et objectifs<br />
de chaque génération sont marqués<br />
par les évènements politiques et économiques<br />
ainsi que par des facteurs sociaux<br />
qui ont un impact particulièrement important<br />
dans la jeunesse. La génération Z<br />
est la première génération qui a grandi à<br />
l’ère numérique et dont l’environnement<br />
social est marqué par une interaction et un<br />
feed-back constants.<br />
<strong>No</strong>us organiserons le jeudi 10 novembre<br />
à Berne, dès 19h, une manifestation gratuite<br />
sur ce thème. Il s’agira d’une part de<br />
présenter le contexte et d’autre part de discuter<br />
des défis que cela implique dans le<br />
travail quotidien. Un apéro et un échange<br />
sont ensuite prévus.<br />
Vous trouverez les détails à ce propos<br />
sur notre site web et dans les médias sociaux.<br />
Janine Junker, directrice de l’ASMAC Berne<br />
Photo: màd<br />
10<br />
5/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
<strong>asmac</strong><br />
Zurich /<br />
Schaffhouse<br />
L’ASMAC Zurich exige<br />
de meilleures conditions<br />
de travail<br />
Ce n’est pas seulement depuis que le cas de<br />
l’hôpital d’Einsiedeln a été rendu public<br />
que nous savons à quel point les conditions<br />
de travail des médecins sont exigeantes.<br />
Au cours des dernières semaines,<br />
notre section s’est engagée à plusieurs reprises<br />
au niveau politique pour que les<br />
choses changent enfin. Et cela pas seulement<br />
dans le cadre de notre audition auprès<br />
de la commission de la sécurité sociale<br />
et de la santé du Parlement cantonal<br />
zurichois relative à la loi sur l’Hôpital universitaire<br />
de Zurich (USZG) en août, mais<br />
aussi dans le cadre d’un échange entre les<br />
associations du personnel et le Conseil<br />
d’Etat in corpore à la mi-septembre.<br />
Il faut agir maintenant!<br />
L’attractivité de la profession de médecin<br />
a fortement baissé et ce, déjà bien avant<br />
la crise du coronavirus et l’ère du télétravail.<br />
Une grande partie des médecins<br />
travaillent au-delà de la durée hebdomadaire<br />
maximale de travail de 50 heures,<br />
d’après notre sondage souvent entre 50 et<br />
70 heures par semaine. Il s’agit de travail<br />
supplémentaire non rémunéré, d’incompatibilité<br />
entre profession et vie privée<br />
et – en lien avec le travail en équipe nuisible<br />
à la santé – aussi d’un risque accru<br />
de développer des maladies physiques et<br />
psychiques.<br />
L’économisation croissante et la pression<br />
constante sur les coûts ont aussi pour<br />
conséquence que la formation postgraduée<br />
et continue est de plus en plus souvent négligée<br />
en faveur de la prestation aux patients,<br />
ce qui met en péril à long terme la<br />
prise en charge des patients. La surcharge<br />
administrative fait que la définition originelle<br />
de l’activité du médecin, c’est-à-dire<br />
le contact avec les patients et leur prise en<br />
charge, est redéfinie en travail de bureau. A<br />
cela s’ajoute le manque d’estime, y compris<br />
la critique du public et de la politique, ainsi<br />
que les restrictions du libre exercice de la<br />
profession de médecin imposées par le pilotage<br />
des admissions.<br />
Ces thèmes concernent chacun d’entre<br />
nous, aussi en tant que patients. Que ce soit<br />
aujourd’hui ou dans quelques années, chacun<br />
consultera un médecin à un moment<br />
donné.<br />
Une CCT cantonale<br />
Les conditions de travail doivent donc rapidement<br />
s’améliorer. <strong>No</strong>us demandons<br />
concrètement que dans le cadre du mandat<br />
de prestations, les cliniques soient tenues<br />
de saisir le temps de formation<br />
postgraduée structurée séparément du<br />
temps de travail (temps pour la prestation<br />
au patient). C’est la seule façon de contrôler<br />
le respect de l’obligation légale de formation<br />
postgraduée. En effet, nous disposons<br />
de nombreux indices selon lesquels<br />
les médecins-assistant(e)s ne bénéficient<br />
que d’une formation postgraduée insuffisante<br />
malgré la contribution financière du<br />
canton. Une formation postgraduée de<br />
haut niveau constitue pourtant un critère<br />
de qualité pour assurer la prise en charge<br />
médicale à l’avenir. Il est donc dans l’intérêt<br />
de tous que le financement cantonal<br />
soit effectivement utilisé à cet effet.<br />
Etablir des conditions de travail plus<br />
attractives permettrait de créer des conditions<br />
équitables pour tous et de calmer la<br />
situation pour enfin freiner la spirale négative<br />
de la pénurie de personnel. <strong>No</strong>us restons<br />
à l’affût et nous engageons aussi sur le<br />
plan politique pour que les choses bougent<br />
enfin!<br />
Dominique Iseppi, assistante de communication,<br />
ASMAC Zurich<br />
Annonce<br />
Agence matrimoniale<br />
Service Personalisé · Compétent · Sérieux<br />
Löwenstrasse 25, 8001 Zürich<br />
044 534 19 50<br />
<strong>No</strong>us serions ravis de vous rencontrer.<br />
Kathrin Grüneis<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 5/22 11
<strong>asmac</strong><br />
<strong>asmac</strong>-Inside<br />
Yvonne Stadler<br />
Lieu de résidence: Muri bei Bern<br />
A l’<strong>asmac</strong> depuis: mai <strong>2022</strong><br />
L’<strong>asmac</strong> pour toi en bref:<br />
dynamique, orientée vers les solutions,<br />
constructive<br />
Yvonne Stadler occupe depuis<br />
le 1 er mai <strong>2022</strong> le poste de<br />
responsable du département<br />
droit et celui de directrice<br />
adjointe au secrétariat central de l’<strong>asmac</strong>.<br />
Elle a cependant déjà commencé le travail<br />
le 30 avril à l’occasion de la séance du<br />
Comité central. Une entrée en matière<br />
intensive pour la juriste de 41 ans: «Le soir,<br />
je suis rentrée chez moi avec la tête pleine<br />
de nouvelles impressions, de souvenirs<br />
positifs et – le plus important – impatiente<br />
d’entamer ma nouvelle activité à l’<strong>asmac</strong>»,<br />
dit-elle rétrospec tivement.<br />
Son domaine d’activité à l’<strong>asmac</strong> est<br />
vaste. «Je m’occupe principalement des<br />
questions concernant le droit du travail et<br />
de la santé. De plus, j’accompagne des<br />
projets relatifs à des thèmes juridiques et<br />
je suis responsable du bureau de notification<br />
auprès duquel les jeunes médecins<br />
peuvent annoncer leurs problèmes.»<br />
Enfin, elle occupe la fonction de secrétaire<br />
juridique de la Commission de<br />
déontologie et de l’Instance de conciliation<br />
pour les procédures de déontologie<br />
à l’<strong>asmac</strong>.<br />
Mais pour Yvonne Stadler, ce n’est<br />
pas assez. A côté de son activité pour<br />
l’<strong>asmac</strong>, elle est avocate indépendante<br />
dans une étude d’avocat bernoise. Là<br />
aussi, elle traite avant tout des questions<br />
touchant au droit du travail et de la santé.<br />
Cela fait d’ailleurs bien des années qu’elle<br />
s’intéresse au domaine de la santé. Après<br />
ses études de droit à Fribourg et l’obtention<br />
du brevet d’avocat à St-Gall, elle a<br />
d’abord travaillé pour une assurance de<br />
protection juridique et ensuite plusieurs<br />
années dans le service juridique d’un<br />
hôpital universitaire. En outre, elle a<br />
enseigné le droit au personnel infirmier<br />
dans différentes écoles supérieures.<br />
A l’<strong>asmac</strong>, Yvonne Stadler veut<br />
s’engager pour une amélioration des<br />
conditions-cadres pour les collaboratrices<br />
et collaborateurs dans les hôpitaux et<br />
cabinets médicaux. «Ces personnes accomplissent<br />
quotidiennement un énorme<br />
travail. Pour que cela reste ainsi, il est<br />
indispensable de créer les conditionscadres<br />
nécessaires», dit-elle. Et que fait<br />
Yvonne Stadler quand elle ne travaille<br />
pas? «La famille, c’est le plus important<br />
pour moi. Avec deux enfants en âge<br />
de scolarité, je ne chôme pas. Si j’ai du<br />
temps à me consacrer, j’y vais tranquillement<br />
– que ce soit en faisant du footing<br />
le long de l’Aar, lors d’un bon repas<br />
avec des amis ou en randonnée dans<br />
les montagnes grisonnes.»<br />
Photo: màd<br />
12<br />
5/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
<strong>asmac</strong><br />
Conseil juridique de l’<strong>asmac</strong><br />
Incapacité de travail<br />
au moment de l’entrée<br />
en fonction<br />
Un médecin-assistant a un<br />
accident quelques jours<br />
avant le terme de son<br />
contrat de travail à durée<br />
déterminée dans l’hôpital X et ne peut<br />
entrer en fonction chez son nouvel<br />
employeur, l’hôpital Y, que 20 jours<br />
plus tard que prévu. Quelles conséquences<br />
cela engendre-t-il? Quel<br />
employeur doit verser le salaire? Cela<br />
se répercute-t-il sur le contrat de<br />
travail à l’hôpital Y?<br />
Photos: Adobe Stock; màd<br />
L’accident s’est produit pendant<br />
les rapports de travail à l’hôpital X.<br />
L’assurance-accidents de l’employeur X<br />
doit donc reconnaître le cas et verser<br />
les indemnités journalières. Les indemnités<br />
journalières sont dues au-delà de la<br />
fin des rapports de travail. L’incapacité<br />
de travail et ses conséquences ne sont<br />
pas assurées auprès du nouvel employeur,<br />
étant donné que l’évènement<br />
s’est produit avant l’entrée en fonction.<br />
Suite à la communication de l’incapacité<br />
de travail par le médecin-assistant,<br />
l’employeur Y a prié ce dernier de signer<br />
un nouveau contrat de travail débutant<br />
à une date ultérieure, ce qui n’est pourtant<br />
pas nécessaire. L’employeur Y n’est<br />
pas tenu de verser le salaire pendant<br />
la durée de l’incapacité de travail. De<br />
plus, une éventuelle période d’essai<br />
est prolongée de la durée de la réduction<br />
effective, sinon le but de la période<br />
d’essai ne peut pas être atteint. En cas<br />
d’absences prolongées, il se peut que<br />
les rapports de travail soient résiliés<br />
pendant la période d’essai vu que l’on<br />
ne tombe pas sous le coup des dispositions<br />
de protection applicables<br />
en cas de maladie, d’accident ou de<br />
maternité.<br />
Un autre point à ne pas négliger en<br />
cas d’adaptation du contrat et d’absences<br />
concerne les règles de prise en compte<br />
de la période de formation postgraduée<br />
en vertu de l’art. 31 de la Réglementation<br />
pour la formation postgraduée. La notice<br />
correspondante de l’ISFM fournit des<br />
informations à ce sujet. En règle générale,<br />
les absences sans faute de la personne<br />
d’une durée maximale de huit semaines<br />
par année ne doivent pas être rattrapées<br />
et la période de formation postgraduée<br />
est entièrement prise en compte.<br />
Cette situation montre les risques<br />
auxquels on s’expose avec un contrat de<br />
travail à durée déterminée en cas d’incapacité<br />
de travail. Par ailleurs, il vaut la<br />
peine d’analyser la situation en matière<br />
d’assurance lorsque l’on change d’emploi.<br />
L’assurance-accidents accorde une<br />
couverture complémentaire de 30 jours.<br />
Ensuite, on peut conclure une assurance<br />
par convention pour une durée d’au<br />
maximum 180 jours avant de devoir<br />
inclure le risque-accidents auprès de<br />
l’assurance-maladie. L’assurance-maladie<br />
d’indemnités journalières n’accorde par<br />
contre aucune couverture complémentaire.<br />
Elle n’offre que la possibilité d’un<br />
passage dans l’assurance individuelle.<br />
Janine Junker,<br />
directrice et juriste de<br />
l’ASMAC Berne<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 5/22 13
La sécurité de l’approvisionnement<br />
est prioritaire<br />
Aucune entreprise pharmaceutique ne vend autant de boîtes de médicaments<br />
en Suisse que Mepha Suisse. L’an dernier, ce nombre s’est monté à 18.4 millions<br />
de boîtes. 1<br />
Depuis quelques années déjà, il ne va plus<br />
de soi, même en Suisse, que chaque médicament<br />
soit disponible à tout moment.<br />
D’une manière générale, la pandémie et<br />
la guerre en Ukraine ont aggravé les problèmes<br />
de livraison. L’entreprise Mepha<br />
Suisse qui est implantée à Bâle et vend le<br />
volume le plus important de boîtes de médicaments<br />
de tous les fournisseurs suisses<br />
n’est pas non plus à l’abri de ces difficultés.<br />
Andrej Salát qui a repris la direction de<br />
Mepha Suisse le 1 er juin est conscient de la<br />
grande responsabilité qu’implique le succès<br />
de l’entreprise. Il déclare: «<strong>No</strong>tre objectif<br />
principal consiste à approvisionner la population<br />
suisse en médicaments de bonne<br />
qualité à des prix équitables, même en ces<br />
temps difficiles». Depuis 2011, Mepha Suisse<br />
à laquelle sont rattachées les sociétés de<br />
distribution Mepha Pharma et Teva Pharma<br />
fait partie de la société Teva Pharmaceuticals<br />
active au niveau mondial. Ce rattachement<br />
à une entreprise active dans le monde<br />
entier disposant d’un réseau sophistiqué<br />
de chaînes d’approvisionnement et le fait<br />
qu’environ 80 pour cent des produits vendus<br />
en Suisse sont issus de la production<br />
européenne contribuent à augmenter la<br />
disponibilité de livraison. 2<br />
Andrej Salát<br />
est titulaire d’un master en<br />
gestion. Originaire de<br />
Slovaquie, il est père de deux<br />
adolescents et passionné<br />
de ski.<br />
Ce qu’il faut savoir sur les génériques<br />
Un environnement plein de défis<br />
La complexité du développement, de la<br />
fabrication et de la commercialisation des<br />
médicaments a empiré. En même temps,<br />
la pression sur les prix des génériques a<br />
continué d’augmenter en Suisse. Mepha<br />
Suisse bénéficie sous plusieurs aspects du<br />
rattachement à Teva Pharmaceuticals. C’est<br />
ainsi que l’entreprise fondée il y a 121 ans<br />
et qui opère au niveau mondial fabrique<br />
par exemple plus de 300 substances actives<br />
sur ses propres sites de production.<br />
Les génériques contiennent les mêmes substances actives que les produits<br />
originaux. Leur qualité et leur sécurité sont équivalentes à celles des préparations<br />
originales. Seuls les excipients peuvent différer.<br />
Les génériques sont entre 20 et 70 pour cent moins chers que les médicaments<br />
originaux.<br />
Les génériques allègent les coûts de santé de 450 millions de francs par an.<br />
Une utilisation systématique permettrait de réaliser des économies supplémentaires<br />
de 220 millions de francs 3 par an. Afin de profiter au maximum du<br />
potentiel d’économie, il vaut la peine d’orienter les patientes et patients,<br />
particulièrement s’ils souffrent de maladies chroniques, dès le début vers<br />
des génériques.<br />
Les génériques peuvent avoir des avantages supplémentaires pour les<br />
patientes et les patients par comparaison à l’original, par exemple, ils peuvent<br />
être plus faciles à diviser ou être exempts de lactose et/ou de gluten.<br />
Andrej Salát explique: «Grâce à leur appartenance<br />
à une plus grande entreprise,<br />
Mepha et Teva ont accès à un pipeline attractif.<br />
Pour une entreprise sans attaches<br />
internationales, il ne serait guère possible<br />
de développer, de fabriquer et de commercialiser<br />
autant de produits uniquement<br />
pour le marché suisse».<br />
Le point fort de Teva Pharmaceuticals réside<br />
dans le développement et la fabrication<br />
de nouveaux médicaments et de<br />
propres substances actives. L’entreprise investit<br />
également dans de propres préparations<br />
originales ainsi que dans le domaine<br />
des produits biologiques. À Ulm (RFA), Teva<br />
Pharmaceuticals construit actuellement un<br />
centre de production à la pointe de la modernité<br />
dédié aux anticorps monoclonaux.<br />
En tout, Teva dispose au niveau mondial<br />
de 60 centres de recherche et de développement,<br />
dont 31 sont basés en Europe. 4<br />
Andrej Salát nous confie: «Seuls de grands<br />
groupes ont ces possibilités. En fin de<br />
compte, ce sont de nombreux marchés plus<br />
petits tels que la Suisse, entre autres, qui en<br />
profitent».<br />
Une large gamme de produits génériques<br />
Teva Pharmaceuticals offre dans le monde<br />
entier une très large gamme comportant<br />
environ 3 500 produits. Chaque jour, 200<br />
millions de personnes sont traitées dans le<br />
monde avec des médicaments du groupe<br />
Teva. Outre les génériques, Teva fabrique
PUBLIREPORTAGE<br />
Faits concernant Mepha Suisse SA<br />
La société Mepha Suisse SA dont le siège se trouve à Bâle, est l’une des principales entreprises pharmaceutiques de Suisse<br />
et, depuis 2011, elle fait partie du groupe international Teva, l’une des premières entreprises sur le marché mondial des<br />
génériques. Les entreprises de distribution Teva Pharma SA et Mepha Pharma SA, leader sur le marché suisse des génériques,<br />
font partie de Mepha Suisse SA. L’entreprise emploie actuellement environ 160 collaborateurs. Mepha Pharma SA et<br />
Teva Pharma SA commercialisent ensemble plus de 300 produits, parmi ceuxci environ 250 génériques ainsi que des<br />
médicaments sans ordonnance, des compléments alimentaires, des produits médicaux et des médicaments originaux,<br />
ces derniers dans les domaines du système nerveux central, des maladies respiratoires et de l’oncologie. Le large portefeuille<br />
de produits couvre en tout 18 domaines d’indications médicales et est commercialisé par l’intermédiaire des pharmacies,<br />
des médecins autodispensateurs, des parapharmacies et des hôpitaux.<br />
www.mepha.ch<br />
www.tevapharma.ch<br />
différents produits, par exemple pour les<br />
indications des domaines de l’oncologie,<br />
de la neurologie et de la pneumologie.<br />
En Suisse également, la gamme de produits<br />
est très large et très variée. En tout, l’entreprise<br />
propose sous la marque Mepha plus<br />
de 250 produits génériques, dont beaucoup<br />
présentent des avantages qui facilitent<br />
la thérapie par comparaison au médicament<br />
d’origine. 1 En plus des génériques,<br />
Mepha Pharma et Teva Pharma offrent des<br />
produits biologiques, des spécialités, des<br />
OTC et des produits médicaux. Dans ces<br />
domaines également, l’entreprise prévoit<br />
de poursuivre encore l’élargissement de sa<br />
gamme de produits.<br />
La marque à l’arcenciel jouit d’une grande<br />
notoriété et de la confiance des professionnels<br />
de la santé ainsi que des patientes et<br />
patients. Andrej Salát est convaincu que<br />
cette confiance n’a toutefois pas été offerte<br />
à Mepha: «<strong>No</strong>us avons dû la mériter:<br />
elle est fondée sur une longue expérience,<br />
un haut niveau de qualité et un service de<br />
qualité». Néanmoins, il ajoute qu’en tant<br />
que directeur général du premier fournisseur<br />
de médicaments génériques en Suisse,<br />
il ne veut pas se reposer sur ses lauriers,<br />
mais faire ses preuves chaque jour afin de<br />
répondre aux hautes attentes envers la<br />
marque. C’est ainsi que Mepha Suisse s’engagera<br />
également sous sa direction, par<br />
exemple, pour la formation postgrade des<br />
médecins – en organisant des symposiums<br />
et par des parrainages comme le soutien<br />
du congrès JHAS.<br />
Des économies dans le domaine des coûts<br />
de la santé<br />
En plus de 70 ans d’existence, Mepha Suisse<br />
s’est fait un nom. L’an dernier, l’entreprise<br />
est parvenue à étendre sa part du marché<br />
des génériques de 43 pour cent. 1 Ainsi, la<br />
marque à l’arcenciel contribue considérablement<br />
aux économies du secteur de la<br />
santé suisse. L’an dernier, les économies se<br />
sont montées en tout environ à 450 millions<br />
de francs grâce aux médicaments génériques.<br />
Leur utilisation systématique permettrait<br />
de réaliser des économies supplémentaires<br />
de 220 millions de francs. 3<br />
Une équipe sur le chemin du succès<br />
En tant que directeur général de Mepha<br />
Suisse SA, Andrej Salát mise sur la continuité<br />
et un bon travail d’équipe. Outre la<br />
sécurité de l’approvisionnement qui est sa<br />
priorité absolue, il va s’engager en plus<br />
pour la numérisation dans le secteur de la<br />
santé. Ce qu’il trouve particulièrement gratifiant<br />
dans son travail, c’est la mission que<br />
Mepha et Teva poursuivent en Suisse. Il déclare:<br />
«Chaque jour, nous nous engageons<br />
pour la santé des Hommes et permettons<br />
l’accès à des soins médicaux de qualité.<br />
Certes, nos médicaments ne sont pas en<br />
mesure de guérir toutes les maladies, mais<br />
ils peuvent contribuer à ce que les patientes<br />
et les patients se sentent mieux et<br />
que leur qualité de vie s’améliore grâce au<br />
traitement. C’est ce qui rend mon travail si<br />
particulier».<br />
80 pour cent des produits<br />
vendus en Suisse sont<br />
issus de la production<br />
européenne. 2<br />
Références<br />
1 IQVIA Pharma Panel /31.12.2021 MAT<br />
2 Mepha Suisse SA. Provenance des producteurs de produits<br />
en vrac avec des produits actifs de 2014 à <strong>2022</strong>. Bâle:<br />
Mepha Suisse SA, <strong>2022</strong>.<br />
3 Intergenerika. Contribution d’efficacité des génériques,<br />
Rapport de l’année 2021, Édition <strong>2022</strong>.<br />
https://www.intergenerika.ch/wpcontent/uploads/<strong>2022</strong>/02/<br />
EffizienzbeitragderGenerika2021_Stand_<strong>2022</strong>.02.15.pdf,<br />
dernière consultation le 05.09.<strong>2022</strong><br />
4 Teva Manufacturing Resilience Report 2020<br />
Références disponibles sur demande.
Point de mire<br />
Les «murmurations» des étourneaux sont non seulement un spectacle époustouflant,<br />
elles constituent aussi un défi pour les chercheurs, toutes branches confondues.<br />
Ballets aériens<br />
Les oiseaux volent en nuées pour se protéger des prédateurs,<br />
traverser les continents sans encombre et économiser de l’énergie.<br />
Mais comment parviennent-ils à changer brusquement<br />
de direction et à synchroniser leur vol? Les chercheurs tentent toujours<br />
de comprendre ce phénomène.<br />
Prof. Barbara Helm, responsable Migrations, Station ornithologique suisse de Sempach<br />
Photo: Adobe Stock<br />
16<br />
5/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
Point de mire<br />
La migration des oiseaux et les<br />
autres chorégraphies de ces<br />
acrobates aériens fascinent les<br />
humains depuis des siècles. Les<br />
oiseaux qui se déplacent en formation<br />
sont particulièrement remarquables. Certains<br />
auteurs romains les qualifiaient de<br />
«vaisseaux de chasse» aériens. Ils ne représentent<br />
néanmoins qu’une petite partie<br />
des migrateurs: la plupart des oiseaux<br />
migrent la nuit et souvent seuls ou en<br />
groupes informels.<br />
Ce sont surtout les espèces hautement<br />
sociales qui se déplacent collectivement.<br />
En nuée ou en formation, ils migrent entre<br />
leur site de reproduction et leur quartier<br />
d’hiver, et souvent aussi entre des lieux<br />
de repos et des points d’alimentation communs.<br />
Mais on observe également des<br />
mouvements de vol synchronisés remarquables<br />
dans d’autres contextes sociaux.<br />
Les rapaces, par exemple, se livrent à des<br />
jeux aériens communs époustouflants lors<br />
de l’accouplement, que l’on retrouve également<br />
dans le comportement de jeu des<br />
grands corbeaux. Certaines figures peuvent<br />
s’effectuer dans des arrangements spécifiques,<br />
peut-être comparables à une danse<br />
dans un espace tridimensionnel. D’autres<br />
espèces sociales, comme les martinets,<br />
chassent ensemble à grande vitesse dans<br />
les agglomérations, un comportement qui<br />
peut servir à la formation en groupe.<br />
Les formations peuvent couvrir un<br />
large spectre. Cela commence par un regroupement<br />
apparemment désuni, mais<br />
dans lequel les oiseaux changent brusquement<br />
de direction ensemble (exemple du<br />
bécasseau variable). De telles nuées<br />
peuvent se contracter ou s’étendre tout<br />
aussi rapidement, surtout si un prédateur<br />
se trouve à proximité, l’exemple le plus<br />
frappant étant celui des étourneaux, dont<br />
les «murmurations» ressemblent à de véritables<br />
ballets aériens. Ornithologues, modeleurs<br />
et économistes se préoccupent de<br />
savoir comment les oiseaux parviennent à<br />
synchroniser leur vol aussi rapidement.<br />
Ensemble, ils tentent de décoder les mouvements<br />
de groupe à l’aide des techniques<br />
les plus modernes.<br />
La précision avant tout<br />
Le vol en groupe présente assurément de<br />
grands avantages, d’une part pour se protéger<br />
des prédateurs, et d’autre part pour<br />
échanger des informations et trouver son<br />
chemin («intelligence collective»). Outre<br />
les avantages cités, le vol en groupe désuni<br />
comporte aussi des inconvénients, car les<br />
oiseaux doivent effectuer des manœuvres<br />
de vol très précises et énergivores. Les collisions<br />
sont cependant extrêmement<br />
rares, elles se produisent principalement<br />
lorsqu’une nuée est déstabilisée par un rapace<br />
qui l’attaque ou par la pollution lumineuse<br />
nocturne.<br />
On observe des formes plus ordonnées<br />
dans de nombreuses variations. Les<br />
mouettes, par exemple, volent souvent en<br />
file côte à côte, et on peut également observer<br />
des vols en chaîne en ligne droite chez<br />
certaines espèces. Toutefois, la formation<br />
la plus classique est probablement le vol en<br />
chevron clairement structuré (également<br />
appelé formation en V): le leader du groupe<br />
est positionné en tête, suivi à gauche et à<br />
droite par d’autres oiseaux en ligne décalée<br />
en V. Les oiseaux peuvent voler en chevron<br />
parfait ou asymétrique, et parfois aussi en<br />
une seule ligne décalée.<br />
Cette forme de vol se retrouve chez de<br />
nombreux grands oiseaux. C’est le cas notamment<br />
des oies de différentes espèces<br />
qui volent en groupes familiaux et coordonnent<br />
leurs mouvements de vol collectifs<br />
par des vocalisations permanentes.<br />
Les ibis, les cormorans, les cigognes, les<br />
grues, les grands limicoles et les oiseaux<br />
de mer comptent parmi les autres espèces<br />
qui volent en formation.<br />
Outre les avantages du vol en groupe<br />
mentionnés ci-dessus, la formation de vol<br />
en chevron présente des atouts indéniables<br />
sur le plan aérodynamique. Si les<br />
oiseaux se positionnent précisément les<br />
uns par rapport aux autres, seul le leader<br />
doit supporter toute la charge énergétique<br />
du vol. Tous les autres oiseaux bénéficient<br />
de son sillage pour économiser de l’énergie.<br />
Le leader est donc non seulement expérimenté<br />
dans la recherche d’une destination,<br />
mais aussi en bonne condition<br />
physique. Au bout d’un certain temps, il se<br />
met en retrait et un autre oiseau prend le<br />
relais. Chez les oies, ce changement est<br />
parfois annoncé par des vocalisations.<br />
Les avantages aérodynamiques de la<br />
formation en V étaient présumés depuis<br />
longtemps. Des calculs ont révélé des économies<br />
supposées d’environ 10 à 20 % de<br />
l’énergie nécessaire au vol. De telles économies<br />
ont d’abord été démontrées expérimentalement<br />
dans des souffleries, puis<br />
sur des oiseaux en vol libre grâce à de nouvelles<br />
technologies. Des enregistrements<br />
physiologiques sur des pélicans roses<br />
(Pelecanus onocrotalus) en vol libre ont<br />
montré que les oiseaux suiveurs avaient<br />
une fréquence cardiaque nettement plus<br />
basse que celle du leader, économisant<br />
ainsi beaucoup d’énergie.<br />
Manœuvrer dans l’espace<br />
Pour réaliser une telle économie, les mouvements<br />
des oiseaux doivent toutefois être<br />
coordonnés avec précision. Récemment,<br />
une étude très remarquée a examiné une<br />
espèce locale d’ibis, l’ibis chauve (Geronticus<br />
eremita), en vol libre en groupe. Les<br />
ibis chauves portaient des mini-ordinateurs<br />
dotés d’une localisation GPS et de<br />
capteurs inertiels. De plus, les animaux,<br />
qui faisaient partie d’un programme de<br />
réintroduction, ont été filmés depuis<br />
des avions légers par des chercheurs «navigants»,<br />
permettant ainsi d’enregistrer<br />
simultanément le trajet migratoire et le<br />
comportement de chaque animal.<br />
Les chercheurs ont observé que les<br />
oiseaux qui se suivent en formation en V<br />
se positionnent précisément par rapport<br />
à celui qui les précède. Ils respectent exactement<br />
la phase de leur prédécesseur avec<br />
l’extrémité de leurs ailes et volent avec<br />
des battements d’ailes synchronisés. Ils<br />
peuvent ainsi utiliser de manière optimale<br />
les courants ascendants générés par leur<br />
prédécesseur et éviter les vents descendants.<br />
Lorsque les ibis chauves volent en<br />
ligne directe les uns derrière les autres,<br />
cette synchronisation de phase n’existe<br />
pas. Les oiseaux effectuent donc des<br />
manœuvres spatiales très complexes et<br />
ciblées pour profiter de la formation. Il est<br />
toujours impressionnant de constater à<br />
quel point les oiseaux migrateurs font<br />
preuve d’inventivité lors de leurs grands<br />
voyages.<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 5/22 17
Point de mire<br />
Dernier adieu<br />
dans les formes<br />
Les objets que Nathalie Heid fabrique dans son atelier sont<br />
à l’image de la vie: éphémères. Grâce à ses urnes, le dernier adieu<br />
prend une forme particulière.<br />
Bianca Molnar, rédactrice du <strong>Journal</strong> <strong>asmac</strong>. Photos: Christine Strub / Trinipix.<br />
Lorsque nous nous rencontrons<br />
pour la première fois, Nathalie<br />
Heid attend dans la pièce au<br />
fond de son atelier. Elle me propose<br />
un café. En guise de tablier, elle<br />
porte un pantalon léger en tissu brun,<br />
dans lequel elle s’essuie allègrement les<br />
mains. Avec ses cheveux relevés à la hâte,<br />
elle se tient dans son atelier comme au<br />
milieu d’un tableau qui, sans un mot, en<br />
dit long sur elle: Nathalie Heid est céramiste<br />
et crée des urnes qui proposent un<br />
rituel d’adieu différent. Ou comme elle le<br />
dit elle-même:<br />
C’est la dernière enveloppe, le berceau<br />
des cendres. La particularité de l’urne<br />
d’eau est qu’elle se dissout pendant la cérémonie,<br />
en l’espace de trente à soixante ou<br />
quatre-vingt-dix minutes. On la regarde<br />
disparaître puis s’écouler dans le lit de la<br />
rivière.<br />
Dans la vitrine de son atelier situé à la<br />
Länggasse à Berne, on aperçoit ces récipients,<br />
de différentes formes blanches et<br />
mates, coiffés de couvercles qui se fondent<br />
presque dans les contours des urnes. Nathalie<br />
Heid saisit l’urne au fond arrondi,<br />
18<br />
5/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
Point de mire<br />
la tapote et la fait légèrement vaciller:<br />
«Elle me plaît car elle finit toujours par se<br />
rééquilibrer.» Je m’empresse de l’imiter.<br />
Tous les récipients allient robustesse<br />
et légèreté, tous sont dénués du poids qui<br />
leur est habituellement associé. Outre les<br />
urnes blanches, il en existe qui imitent<br />
l’apparence de certaines pierres. Pour obtenir<br />
ce rendu, Nathalie Heid mélange différentes<br />
couleurs d’argile afin de reproduire<br />
le plus fidèlement possible la structure<br />
de la surface.<br />
La conception et la fabrication des<br />
urnes d’eau sont le fruit d’un long développement<br />
professionnel et personnel. Après<br />
un cours préparatoire de création à Olten,<br />
elle a suivi un apprentissage de peintre sur<br />
céramique au sein d’une entreprise industrielle,<br />
«où elle ne créait pas ses propres<br />
céramiques, mais devait peindre selon un<br />
modèle et travaillait à la chaîne (en pointant<br />
ses heures)», comme elle l’explique,<br />
puis une formation de designer en céramique<br />
à l’Ecole d’Arts Visuels Berne.<br />
Pour son travail de diplôme, elle a réalisé<br />
une sculpture de douche en forme de<br />
squelette de baleine. Il lui tenait à cœur<br />
de créer quelque chose qui puisse aussi<br />
être utile.<br />
J’ai intitulé ce travail «Embrasser»,<br />
l’étreinte, mais qui ne serre pas. On est dehors,<br />
on entrevoit la verdure entre les côtes,<br />
mais on est protégé. A posteriori, je trouve<br />
cela captivant, car la mort est en quelque<br />
sorte également présente dans cette forme,<br />
dans le squelette. Mais la sculpture n’a rien<br />
de macabre, elle est magnifique.<br />
On sent que Nathalie Heid est une<br />
chercheuse qui élargit la portée des questions<br />
qui lui sont posées et les prend<br />
comme point de départ pour explorer les<br />
grandes dimensions de la condition humaine.<br />
Elle pense à voix haute, sonde les<br />
réponses qu’elle présente ensuite comme<br />
des possibilités, souvent introduites par<br />
un «peut-être».<br />
La thématique de la finitude et les questions<br />
sur le sens de la vie et la mort m’ont toujours<br />
accompagnée dans mon travail. Les<br />
crises que j’ai traversées ont peut-être aussi<br />
contribué à ce que je m’y intéresse.<br />
Lorsque je l’interroge sur la genèse de<br />
l’idée de l’urne soluble, elle raconte très<br />
ouvertement la perte d’un ami proche qui<br />
s’est suicidé il y a plusieurs années:<br />
Lors de la cérémonie d’adieu qui précédait<br />
l’incinération, nous avons abordé la<br />
question de l’urne avec des amis. Les urnes<br />
classiques ne lui correspondaient pas du<br />
tout. On m’a alors interpellée: «Toi qui es<br />
céramiste, pourquoi ne créerais-tu pas une<br />
Des récipients créés pour disparaître lentement: les urnes d’eau sont des symboles de l’évanescence.<br />
urne à son image? C’était un vendredi, et la<br />
cérémonie avait lieu la semaine suivante.<br />
Les étapes de fabrication, à savoir le modelage,<br />
le séchage et la cuisson, nécessitent<br />
deux semaines. Je ne les avais pas. J’ai donc<br />
eu l’idée de supprimer l’étape de la cuisson.<br />
L’urne a juste besoin d’eau pour se dissoudre,<br />
nous avions décidé de la poser dans<br />
l’Aar. Cela réglait aussi la question de la répartition<br />
des cendres. <strong>No</strong>us avons donc mis<br />
le récipient dans l’eau et l’avons regardé se<br />
désintégrer peu à peu, tout en buvant du<br />
vin et en écoutant de la musique, toutes ces<br />
belles choses que nous avions l’habitude de<br />
partager avec lui. Et quand nous sommes<br />
partis, l’urne n’était plus là. Tout était parfaitement<br />
cohérent ...<br />
En l’écoutant, on a l’impression que<br />
cet événement douloureux a permis de<br />
rassembler plusieurs fils épars, thèmes et<br />
questions qui ont toujours accompagné<br />
Nathalie Heid, et de leur donner une direction<br />
fructueuse.<br />
Sa mort a fait émerger cette idée qui ne<br />
m’avait jamais vraiment traversé l’esprit,<br />
avec des questions comme: «Avec quoi pourrais-je<br />
gagner de l’argent, qu’est-ce qui<br />
n’existe pas encore sur le marché?» J’ai eu<br />
l’impression de recevoir un cadeau de sa<br />
part, même si j’étais rongée par la tristesse.<br />
J’ai ensuite reçu des demandes de personnes<br />
qui étaient présentes à la cérémonie<br />
et qui avaient perdu un proche un an plus<br />
tard. J’ai pris mon courage à deux mains et<br />
j’ai soumis mon projet à la Fondation bernoise<br />
de design afin d’obtenir une bourse.<br />
Nathalie Heid nous confie qu’elle est<br />
beaucoup plus sereine aujourd’hui, parce<br />
qu’elle a davantage conscience de la valeur<br />
du moment présent grâce à son travail,<br />
et aussi grâce au contact avec ses clients.<br />
Elle en accompagne certains dans son atelier,<br />
qui souhaitent façonner eux-mêmes<br />
leur urne.<br />
Ce qui me touche, c’est d’être face à une<br />
personne condamnée, qui accepte son sort,<br />
qui sait que le temps est compté et qui tient<br />
encore à faire cette urne de ses propres<br />
mains.<br />
Ainsi, une femme atteinte d’un cancer<br />
a souhaité modeler son urne en forme de<br />
soupière, comme symbole des précieux<br />
moments passés avec sa famille et ses<br />
amis. Il arrive aussi que des demandes<br />
spéciales soient formulées, comme cette<br />
urne en forme d’igloo pour un pêcheur inhumé<br />
dans le lac de Neuchâtel.<br />
Il est très important pour moi que cela<br />
représente la personne et les événements<br />
qui ont jalonné son existence, et que cela<br />
soit visible tant que l’urne se trouve dans<br />
l’église pendant la cérémonie funéraire.<br />
Elle estime également qu’il est important<br />
d’inciter les personnes qui ne sont pas<br />
directement concernées à parler des questions<br />
liées à la mort.<br />
Lorsque notre conversation prend fin,<br />
la nuit est déjà tombée. Nathalie Heid emballe<br />
quelques urnes non achevées dans<br />
du papier journal et éteint la lumière de la<br />
vitrine. Sur son grand plan de travail, dépassant<br />
d’un simple sac, une plaque d’argile<br />
claire, parsemée de particules couleur<br />
goudron. Qui sait ce qu’il en adviendra?<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 5/22 19
Point de mire<br />
Les avions du PC-7 TEAM ne sont<br />
qu’à 3 mètres environ de distance les<br />
uns des autres. Pour réussir de telles<br />
prouesses, la confiance et les compétences<br />
aéronautiques sont tout aussi importantes<br />
que l’esprit critique et le sang-froid.<br />
Dessins célestes<br />
Lors de démonstrations aériennes, les compétences<br />
aéronautiques sont au premier plan. Les pilotes doivent, en outre,<br />
pouvoir se faire une confiance aveugle et pratiquer une culture<br />
de l’erreur ouverte, afin que les idées et les doutes de chacun soient<br />
écoutés sans distinction.<br />
Capitaine Andreas Menk, pilote de chasse, leader du PC-7 TEAM<br />
Au début, il faut s’habituer à<br />
faire des loopings et autres<br />
manœuvres aériennes entouré<br />
de huit autres avions à environ<br />
3 mètres de distance. Un pilote<br />
d’avion de combat devient membre du<br />
PC-7 TEAM après seulement trois semaines<br />
de formation. En tant qu’élément<br />
de démonstration officiel des Forces aériennes<br />
suisses, nous effectuons un show<br />
aérien de 25 minutes avec neuf avions à<br />
hélices de type PC-7. <strong>No</strong>tre chorégraphie<br />
commence par des changements de formation<br />
rapides de toute la patrouille.<br />
<strong>No</strong>us dessinons différentes formes géométriques<br />
dans le ciel à une vitesse d’environ<br />
500 km/h. Un losange se transforme<br />
rapidement en triangle, puis en étoile, et<br />
nous présentons ces formes au public tantôt<br />
en ligne droite, tantôt en virage ou en<br />
looping. La trajectoire de vol est mise en<br />
valeur par la fumée blanche de nos avions,<br />
le tout accompagné du ronronnement de<br />
nos turbines à hélices. Au cours du programme<br />
de vol, la formation se divise en<br />
sous-formations plus petites et en solistes.<br />
Les manœuvres de vol deviennent<br />
plus dynamiques. Dans le dernier tiers du<br />
spectacle, sept avions se réunissent pour<br />
constituer à nouveau une grande et élégante<br />
formation: le tunnel, traversé par<br />
deux autres avions. <strong>No</strong>us dessinons aussi<br />
parfois pour nos spectateurs un cœur, une<br />
cascade ou une croix dans le ciel.<br />
Photos: màd<br />
20<br />
5/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
Point de mire<br />
La confiance est capitale<br />
Mais comment une formation de neuf pilotes<br />
peut-elle donner l’impression aux<br />
spectateurs au sol que les avions sont reliés<br />
en une seule forme? Qui orchestre le<br />
programme de vol et comment chaque pilote<br />
s’oriente-t-il pour que les figures paraissent<br />
symétriques?<br />
La confiance mutuelle est la base de<br />
notre travail au sein du PC-7 TEAM.<br />
Chaque pilote doit pouvoir compter sur la<br />
concentration à toute épreuve de son ailier,<br />
et s’assurer qu’il suit minutieusement<br />
le déroulement du programme de vol. Une<br />
inattention dans la conduite des commandes<br />
ou un changement de formation<br />
mal exécuté peut aussitôt conduire à une<br />
collision entre deux avions. Et comme nos<br />
avions ne sont pas équipés de sièges éjectables,<br />
une assistance médicale serait<br />
sans doute superflue dans un tel scénario<br />
catastrophe.<br />
Afin de garantir cette confiance au<br />
sein de l’équipe, nous, les pilotes, sélectionnons<br />
nous-mêmes les nouveaux<br />
membres du PC-7 TEAM. <strong>No</strong>s supérieurs<br />
ne sont pas impliqués dans le processus<br />
de sélection et chaque membre de l’équipe<br />
peut mettre son veto sans devoir se justifier.<br />
Les pilotes de F/A-18 des Forces<br />
aériennes suisses font partie de notre vivier<br />
de candidats. Tous nos pilotes volent<br />
en effet à plein temps sur des avions de<br />
combat – les démonstrations de vol sont<br />
une tâche supplémentaire.<br />
Gestion des erreurs et des doutes<br />
Je considère notre culture de gestion des<br />
risques et des erreurs comme un autre facteur<br />
de réussite. Cela commence dès le<br />
briefing qui précède la mission. Outre les<br />
faits concrets comme le programme de vol<br />
prévu, nous nous concentrons surtout sur<br />
les risques potentiels. <strong>No</strong>us nous accordons<br />
sur les mesures à prendre pour minimiser<br />
ces derniers et définissons les procédures<br />
à appliquer lorsqu’un risque se<br />
réalise. L’objectif du briefing est d’éviter<br />
toute mauvaise surprise en vol et de préparer<br />
mentalement tous les pilotes au vol.<br />
En tant que leader, j’utilise une check-list<br />
pour diriger le briefing. Disposons-nous<br />
des toutes dernières données météo? Y<br />
a-t-il des obstacles dans la zone de démonstration?<br />
Et surtout: comment les pilotes<br />
se sentent-ils? Qu’ont-ils retenu du<br />
briefing? Car pour pouvoir se concentrer à<br />
100% sur sa tâche, aucun doute ne doit<br />
subsister dans l’esprit du pilote lorsqu’il<br />
s’installe dans le cockpit. Et en tant que<br />
leader, cela me rassure de savoir, une fois<br />
le briefing terminé, que nous sommes<br />
neuf à avoir visualisé mentalement la<br />
tâche à accomplir. Que l’on soit tout jeune<br />
pilote, mécanicien aéronautique ou responsable<br />
de la maintenance de l’équipement<br />
de vol, il ne faut surtout pas hésiter<br />
à soulever toutes les questions et les<br />
doutes qu’on peut se poser.<br />
Chaque vol est filmé depuis le sol.<br />
Pendant le débriefing, nous étudions minutieusement<br />
les vidéos et évaluons les<br />
différentes figures aériennes. Les débriefings<br />
se terminent par l’aspect le plus important:<br />
les enseignements tirés. Chaque<br />
pilote résume sa propre performance et<br />
Annonce<br />
« Le magnifique parc est<br />
idéal pour des consultations<br />
en plein air. »<br />
Elena Frei, médecin assistante<br />
Le centre psychiatrique Münsingen fait partie des<br />
plus grandes cliniques psychiatriques de Suisse.<br />
Plus de 3100 adultes souffrant de troubles psychiques<br />
y sont traités chaque année. Les thérapies<br />
s’articulent autour des domaines suivants :<br />
dépression et anxiété, psychose et addictions ainsi<br />
que psychiatrie gériatrique et neuropsychiatrie.<br />
Au sein du Centre hospitalier Bienne, le CPM gère<br />
le service Psychiatrie Biel/Bienne qui assure<br />
une offre de soins psychiatriques auprès de la<br />
population de la région de Bienne-Seeland-Jura<br />
bernois.<br />
<strong>No</strong>us recherchons des<br />
médecins qui partagent<br />
activement leurs idées<br />
et valorisent la collaboration<br />
multidisciplinaire.<br />
Renseignements :<br />
CPM Centre psychiatrique Münsingen SA<br />
Beat Ryter • Directeur adjointe des RH<br />
Hunzigenallee 1 • 3110 Münsingen<br />
031 720 86 20 • beat.ryter@pzmag.ch<br />
<strong>No</strong>us nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir<br />
votre candidature : Vous pouvez consulter nos<br />
offres d’emploi sur :<br />
www.pzmag.ch/jobs<br />
*Des connaissances de l’allemand et/ou du français sont requises.<br />
<strong>No</strong>tre offre<br />
• Soutien dans la formation<br />
menant au titre de<br />
spécialiste en psychiatre<br />
et psychothérapie<br />
• Formation complémentaire<br />
et continue,<br />
avec soutien financier<br />
• Échanges professionnels<br />
intensifs<br />
• Possibilité de travailler<br />
à temps plein ou à temps<br />
partiel<br />
• Places en crèche et<br />
logement de fonction<br />
trouver ensemble des solutions.<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 5/22 21
Point de mire<br />
explique les adaptations qu’il souhaite apporter<br />
lors du prochain vol afin que la performance<br />
du PC-7 TEAM soit encore plus<br />
spectaculaire.<br />
Un travail manuel solide<br />
Bien sûr, il va de soi que pour réussir cette<br />
performance, chaque pilote doit posséder<br />
les connaissances nécessaires et certaines<br />
compétences aéronautiques. Il convient<br />
de préciser que le vol en formation est un<br />
travail manuel. Le pilote n’utilise aucun<br />
système ni instrument. Il effectue l’ensemble<br />
du programme à vue et corrige rapidement<br />
et avec précision les écarts par<br />
rapport à la position «théorique» ciblée<br />
dans la formation. Cela nécessite une<br />
bonne coordination œil–main–pied, une<br />
bonne représentation spatiale et bien sûr<br />
beaucoup d’entraînement. Un futur<br />
membre de l’équipe commence par des<br />
vols d’entraînement en formation à deux,<br />
avant de voler en formation complète avec<br />
les neuf avions.<br />
En tant que leader, je suis responsable<br />
du choix des trajectoires de l’ensemble du<br />
groupe. Je répartis les virages, loopings,<br />
etc. de manière à ce qu’ils soient idéalement<br />
placés devant le public, tout en respectant<br />
des distances ou des hauteurs minimales.<br />
Car la sécurité passe toujours<br />
avant tout. Mes huit copilotes me suivent<br />
presque aveuglément. Seul le leader se<br />
concentre sur la topographie et a la capacité<br />
d’éviter les collisions avec le terrain.<br />
Les ailiers sont chargés d’éviter les rapprochements<br />
intempestifs entre les différents<br />
avions.<br />
Les pilotes des avions situés juste à côté<br />
ou derrière moi contrôlent en permanence<br />
deux points fixes visuels sur mon<br />
avion. L’un définit l’angle correct, l’autre la<br />
distance visée. Ces points fixes peuvent<br />
varier en fonction de la formation de vol.<br />
Si un pilote constate des écarts par rapport<br />
à un point fixe, il les corrige en actionnant<br />
subtilement le manche, le palonnier ou la<br />
manette des gaz. Les corrections de position<br />
doivent être aussi délicates que possible,<br />
notamment parce que plusieurs<br />
avions dessinent une forme dans le ciel,<br />
l’un derrière ou à côté de l’autre. Le pilote<br />
de queue a donc la tâche la plus difficile. Il<br />
doit non seulement corriger en permanence<br />
ses propres écarts, mais aussi ceux<br />
des pilotes qui le précèdent.<br />
Trouver le bon angle<br />
L’effet d’optique désigné par le terme «parallaxe»<br />
constitue une autre difficulté lors<br />
du vol en formation devant des spectateurs<br />
au sol. En raison de l’évolution<br />
constante de la position des avions dans<br />
l’espace devant le public, l’angle de vue du<br />
spectateur sur nos avions change également.<br />
De ce fait, la forme de la formation<br />
vue du sol peut sembler asymétrique,<br />
même si tout semble correct du point de<br />
vue du pilote. Pour corriger l’effet de parallaxe,<br />
nous devons donc aussi constamment<br />
adapter nos points fixes. Ce qui peut<br />
alors paraître faux depuis le cockpit<br />
semble cohérent pour le public ou sur la<br />
vidéo lors du débriefing. La parallaxe joue<br />
d’ailleurs aussi un rôle dans la lecture des<br />
instruments à aiguille (p. ex. un tensiomètre<br />
de conception ancienne). En fonction<br />
de l’angle de lecture sur l’instrument,<br />
une autre valeur de mesure est lue.<br />
En résumé, je dirais que les facteurs<br />
de réussite d’une démonstration aérienne<br />
sont de trois types: il faut un savoir-faire<br />
aéronautique («Skill»), des connaissances<br />
et de l’expérience («Knowledge») et surtout<br />
une culture et une approche appropriée<br />
de la part de tous les acteurs («Attitude»).<br />
Je serais ravi que les médecins-assistant(e)s<br />
et les chef(fe)s de clinique assistent<br />
eux aussi aux démonstrations du<br />
PC-7 TEAM. L’agenda des événements se<br />
trouve sur notre site Internet: www.pc7-<br />
team.ch.<br />
Photo: màd<br />
22<br />
5/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
Point de mire<br />
Dessine-moi<br />
une fractale<br />
En 1982, Benoît Mandelbrot publie son ouvrage<br />
«The Fractal Geometry of Nature», attirant ainsi l’attention des<br />
non-mathématiciens sur les fractales, connues depuis bien<br />
plus longtemps déjà. Des images et animations d’une beauté fascinante<br />
les ont ensuite rendues célèbres auprès d’un large public.<br />
D r Joël Adler, professeur de mathématiques, Haute école pédagogique de Berne<br />
Photo: Adobe Stock<br />
Figure 1: Le bonhomme pomme.<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 5/22 23
Point de mire<br />
Le mathématicien franco-polonais<br />
Benoît Mandelbrot (1924–<br />
2015) introduit le terme «fractale»<br />
en 1975. Ce terme n’a pas<br />
de définition mathématique formelle,<br />
mais décrit un phénomène. Il désigne,<br />
très schématiquement, des objets géométriques<br />
autosimilaires. Mandelbrot<br />
commence par découvrir les structures<br />
autosimilaires dans ses travaux sur la<br />
mécanique des fluides et la théorie de<br />
l’information, ainsi que dans ses études<br />
sur les fluctuations de prix des marchés<br />
financiers dans les années 1950 et 1960.<br />
Dans les années 1970, il se consacre à<br />
l’étude d’objets mathématiques fractals.<br />
Ni ligne ni surface<br />
Le mathématicien suédois Helge von Koch<br />
(1870–1924) est le premier à décrire formellement<br />
en 1904 un objet fractal, la<br />
fameuse courbe de von Koch, qu’il avait<br />
introduite comme exemple de courbe<br />
continue dérivable en aucun point. A savoir<br />
une courbe que l’on peut tracer sans<br />
lever le crayon, mais qui n’a aucun point<br />
de tangente. Il s’agit de la courbe limite<br />
que l’on obtient en remplaçant le tiers médian<br />
d’un segment initial par les deux côtés<br />
du triangle équilatéral dont la base est<br />
le tiers remplacé, et en répétant cette procédure<br />
avec chaque segment du tracé obtenu.<br />
La figure 2 illustre les quatre premières<br />
étapes de sa construction itérative.<br />
La longueur de la courbe limite est infinie,<br />
car chaque reproduction multiplie la longueur<br />
par le facteur .<br />
La dimension de Hausdorff est introduite<br />
en 1918 par le mathématicien allemand<br />
Felix Hausdorff (1868–1942). Celleci<br />
attribue aux courbes un nombre qui<br />
Figure 2: La courbe de von Koch<br />
(image: Heiner Rohner)<br />
24<br />
E 0<br />
E 1<br />
E 2<br />
E 3<br />
.<br />
K<br />
indique dans quelle mesure une courbe<br />
remplit les voisinages des points de<br />
courbe. La dimension de Hausdorff de la<br />
courbe de von Koch est de ≈1,261, ce<br />
qui signifie que la courbe de von Koch<br />
n’est ni une ligne ni une surface. La notion<br />
habituelle de dimension, selon laquelle<br />
les segments et les lignes droites ont une<br />
dimension 1, les carrés et les plans une dimension<br />
2, les cubes et l’espace une dimension<br />
3, n’est donc pas assez précise<br />
pour caractériser les objets fractals.<br />
La dimension de Hausdorff est également<br />
définie pour des sous-ensembles de<br />
l’espace, ce qui est important pour les applications<br />
des fractales en médecine et en<br />
ingénierie.<br />
Surfaces limitées à bord infini<br />
La courbe limite de la répétition de la figure<br />
3 se définit de la même manière que la<br />
courbe de von Koch. Dans la courbe de<br />
Minkowski, les deux quarts centraux d’un<br />
segment sont remplacés par les trois côtés<br />
du carré de même dimension. Sa dimen-<br />
Figure 3: La courbe de Minkowski<br />
(image: Heiner Rohner)<br />
2<br />
E 0<br />
E 1<br />
E 2<br />
E 3<br />
.<br />
M<br />
sion de Hausdorff est de 1,5, ce qui signifie<br />
qu’elle remplit davantage les voisinages de<br />
ses points que la courbe de von Koch.<br />
Figure 4: Le flocon de Koch<br />
(image: Heiner Rohner)<br />
Si l’on remplace chaque côté d’un<br />
triangle équilatéral par la courbe de von<br />
Koch correspondante, on obtient ce que<br />
l’on appelle un «flocon de neige». Son aire<br />
est finie – 1,6 fois l’aire du triangle de départ<br />
– mais la longueur de son bord est infinie!<br />
3<br />
La courbe devient surface<br />
Mandelbrot est devenu célèbre grâce au<br />
«bonhomme pomme» représenté dans la<br />
figure 1, qui contient une infinité de réductions<br />
de lui-même, que l’on désigne<br />
par le terme «autosimilarité». Pour chaque<br />
point C du système de coordonnées, une<br />
règle simple – une fonction quadratique<br />
dépendant de C – calcule une suite de<br />
points C 0<br />
,C 1<br />
,C 2<br />
,… avec une valeur de départ<br />
C 0<br />
=(0,0). Si cette séquence reste à l’intérieur<br />
du cercle avec le centre (0, 0) et le<br />
rayon 2, le cercle est colorié en noir. Les<br />
autres valeurs de C donneront des points<br />
coloriés d’une certaine façon selon le<br />
temps d’échappement.<br />
Comme le flocon de neige, le bonhomme<br />
pomme possède une courbe limite<br />
de longueur infinie. La courbe limite est si<br />
sinueuse que sa dimension de Hausdorff<br />
est de 2, soit la dimension d’une surface!<br />
Les fractales dans la nature et la<br />
technique<br />
Les structures fractales sont très répandues<br />
dans la nature. Les fougères, les cours<br />
d’eau et les arbres en sont des exemples<br />
(figure 5). Comme il s’agit d’objets finis, ils<br />
ne sont en réalité que des approximations<br />
de véritables fractales. C’est ce que montre<br />
la courbe de von Koch. Sa dimension de<br />
Hausdorff est de 1 pour chaque courbe obtenue<br />
après un nombre fini de répétitions,<br />
c’est-à-dire égale au segment de départ.<br />
Seule la courbe limite a une dimension supérieure<br />
à 1.<br />
5/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
Point de mire<br />
Figure 5: Les arbres présentent une structure fractale.<br />
Photo: Adobe Stock<br />
Le feuillage d’un arbre et les poumons<br />
ont en commun un échange gazeux efficace,<br />
obtenu par une disposition fractale<br />
des cellules responsables de l’échange de<br />
gaz. Le poumon ressemble à un arbre tourné<br />
à 180°. La surface des poumons est de<br />
50 à 100 m 2 pour un volume de 4 à 6 litres!<br />
La profondeur de ramification de la trachée<br />
jusqu’aux alvéoles est de 11.<br />
Grâce à la géométrie fractale, le poumon<br />
atteint une grande surface pour un<br />
volume modeste. Le même principe est appliqué<br />
dans la technique. Les ordinateurs<br />
sont de plus en plus puissants et petits.<br />
L’un des problèmes liés à leur fonctionnement<br />
est la chaleur qu’ils produisent. Pour<br />
une répartition efficace du liquide de refroidissement,<br />
des ingénieurs de l’Université<br />
de l’Oregon ont gravé une structure<br />
fractale dans des puces. Les antennes pour<br />
la communication mobile présentent également<br />
une structure fractale, ce qui permet<br />
d’utiliser de nombreuses fréquences<br />
en économisant de la place.<br />
Applications des fractales en<br />
médecine<br />
Certaines approches prometteuses permettent<br />
de détecter précocement les<br />
changements liés à la maladie en déterminant<br />
la dimension fractale des organes,<br />
des tissus et des vaisseaux. La croissance<br />
cellulaire incontrôlée des tumeurs s’accompagne<br />
souvent de la formation de<br />
nouveaux vaisseaux sanguins, ce qui se<br />
traduit par une augmentation de la dimension<br />
fractale de la tumeur. La dimension<br />
fractale de la tumeur peut même évoluer<br />
sans croissance visible et ne peut<br />
donc être détectée qu’en la déterminant au<br />
préalable.<br />
On a ainsi comparé la dimension fractale<br />
des vaisseaux sanguins de la rétine de<br />
dix patients souffrant de rétinopathie diabétique<br />
et de dix personnes d’un groupe de<br />
contrôle. Une augmentation significative a<br />
été constatée par rapport au groupe de<br />
contrôle [1].<br />
La possibilité de diagnostiquer un emphysème<br />
pulmonaire sur la base de la dimension<br />
fractale des poumons semble<br />
également intéressante. Les poumons<br />
sains présentent une dimension fractale<br />
plus basse.<br />
Bibliographie<br />
spécialisée et exemples<br />
[1] Applications of Fractals in<br />
Medicine, K. L. Uahabi, M. Atounti. Annals<br />
of the University of Craiova, Mathematics<br />
and Computer Science Series Volume 42(1),<br />
2015, Pages 167–174.<br />
Magnifique vidéo sur<br />
le bonhomme pomme de Mandelbrot:<br />
https://www.youtube.com/watch?v=b005i-<br />
Hf8Z3g<br />
(ajoutée le 27.7.<strong>2022</strong>)<br />
Fractals in physiology and medicine,<br />
A. L. Goldberger, B. J. West. Yale J Biol Med,<br />
1987 Sep–Oct; 60(5): 421–35.<br />
The Fractal Geometry of Nature, Benoît<br />
Mandelbrot, UK, 1982<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 5/22 25
Point de mire<br />
Curiosité, comportement territorial,<br />
sécurité – différentes raisons expliquent la<br />
fascination des chats pour les formes géométriques.<br />
Cat Circles<br />
Les photos ou vidéos d’internautes montrant leur chat assis<br />
immobile au milieu d’un cercle envahissent régulièrement la Toile.<br />
Les propriétaires de chats savent que leurs compagnons<br />
à quatre pattes aiment s’installer sur un simple journal posé au sol.<br />
<strong>No</strong>s colocataires poilus ont-ils vraiment un rapport particulier<br />
avec les formes géométriques?<br />
Regina Röttgen, journaliste indépendante spécialisée dans les animaux et la nature<br />
Les vidéos de chats sont populaires.<br />
En ce moment, de nombreux<br />
propriétaires de chats se<br />
passionnent pour des photos et<br />
des vidéos de chats semblant irrésistiblement<br />
attirés par les formes géométriques.<br />
Si l’on trace par exemple un carré ou un<br />
cercle sur le sol à l’aide de craie, de corde,<br />
de ruban adhésif ou d’une serviette, ils ne<br />
tardent pas à s’y installer. C’est du moins<br />
le récit le plus courant.<br />
Katrin Held, comportementaliste et<br />
conseillère en nutrition pour chats, relève<br />
plusieurs raisons possibles à ce comportement.<br />
«Le comportement territorial souvent<br />
invoqué sur les réseaux sociaux n’en<br />
fait toutefois pas partie, car les formes au<br />
sol se trouvent déjà sur le territoire du<br />
chat.» Lorsque le chat est déjà assis dans<br />
le carré ou le cercle, c’est la distanciation<br />
sociale qui entrerait alors en jeu. «Si le<br />
chat semble défendre son territoire géométrique,<br />
il souhaite en fait que l’on respecte<br />
sa distanciation sociale. Car les<br />
formes sont en principe un peu plus<br />
petites que l’espace personnel du chat qui<br />
s’y est installé.»<br />
L’experte voit une autre explication<br />
possible à la curiosité de ces félins. «Un<br />
chat aime observer son maître. Peu importe<br />
qu’il soit en train de lire le journal, de<br />
monter un meuble ou de coller du ruban<br />
adhésif sur le sol.» Il voit juste qu’il accorde<br />
Photos: Adobe Stock<br />
26<br />
5/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
Point de mire<br />
beaucoup d’attention au cercle ou au carré<br />
posé sur le sol. Ce qui éveille sa curiosité.<br />
«Les chats sont naturellement des créatures<br />
inquisitrices, ils veulent aller explorer<br />
ce que leur maître vient de poser.»<br />
Les formes confèrent un sentiment<br />
de sécurité<br />
Pour Katrin Held, le plus probable est que<br />
les chats s’assoient dans des formes géométriques<br />
dessinées en raison de leur besoin<br />
de sécurité. «Les formes encadrent les<br />
chats, leur offrent une possibilité de retrait.<br />
Cela leur donne un sentiment de sécurité.»<br />
Certains spécialistes avancent l’hypothèse<br />
que ce phénomène renverrait au procédé<br />
de nidification. Se blottir tout contre sa maman,<br />
avec ses frères et sœurs, apporte au<br />
jeune chaton chaleur et sécurité. Des espaces<br />
bidimensionnels, à peine plus grands<br />
que lui, donneront au chat adulte un sentiment<br />
de sécurité.<br />
Un groupe de chercheurs, dirigé par<br />
la biologiste comportementale Gabriella<br />
Smith du Hunter College de New York, a<br />
récemment découvert que les chats étaient<br />
tout aussi sensibles aux formes illusoires.<br />
Pour le déroulement de l’expérience,<br />
30 pro priétaires de chats ont placé un<br />
carré de Kanizsa sur le sol. Le motif de<br />
Kanizsa était délimité par quatre formes<br />
style «Pacman» formant les coins d’un<br />
carré invisible. Le motif de Kanizsa est une<br />
illusion d’optique basée sur la perception<br />
de contours subjectifs, car seuls les coins<br />
d’une forme sont visibles. Les propriétaires<br />
portaient des lunettes de soleil pour éviter<br />
que le contact visuel n’influence le comportement<br />
du chat. Environ un tiers des sujets<br />
se sont assis dans la forme Kanizsa au cours<br />
des cinq premières minutes.<br />
L’experte suppose donc qu’en plus de la<br />
préférence individuelle, le mode d’élevage<br />
du chat pourrait être déterminant.<br />
«Comme nos essais sur le terrain portaient<br />
exclusivement sur des chats d’extérieur, il<br />
est possible qu’ils trouvent suffisamment<br />
d’occupation à l’extérieur et n’aient donc<br />
pas montré d’intérêt pour les formes.» En<br />
revanche, les chats vivant uniquement en<br />
appartement pourraient très bien être captivés<br />
par les carrés et les cercles sur le sol,<br />
car ils aiment généralement découvrir de<br />
nouveaux stimuli. «La plupart des chats<br />
d’intérieur connaissent chaque centimètre<br />
carré de leur maison.»<br />
L’enthousiasme de nos compagnons à<br />
quatre pattes pour les formes pleines est<br />
beaucoup plus universel. Un livre sur la<br />
table, une serviette pliée sur le lit ou une<br />
feuille de papier posée sur le sol – à peine<br />
le chat l’aperçoit-il qu’il s’assoit dessus.<br />
Les spécialistes des chats sont catégoriques:<br />
il s’agit là d’un comportement territorial.<br />
Selon Katharina Aeschimann,<br />
tout ce qui se trouve sur le sol est intéressant.<br />
«Un nouvel élément a été introduit<br />
sur son territoire et doit être contrôlé. Il<br />
marque ainsi son territoire.» Les propriétaires<br />
de chats, quant à eux, restent<br />
convaincus que les félins choisissent toujours<br />
une forme géométrique pour s’asseoir<br />
ou se coucher.<br />
Les chats créent des<br />
formes géométriques<br />
Lorsqu’ils sont plusieurs, les chats<br />
aiment s’asseoir en demi-cercle ou en<br />
cercle. L’experte en félins Katrin Held<br />
sait pourquoi: «Pour les chats, il est<br />
préférable de s’asseoir dans une forme<br />
plutôt qu’en ligne. Ainsi, ils n’ont pas<br />
d’ennemi potentiel dans le dos.» Il est<br />
primordial pour un chat d’avoir un<br />
contact visuel avec ses congénères. «Si<br />
aucun des chats ne veut tourner le dos<br />
à un autre, la manière dont ils se<br />
positionneront ressemblera inévitablement<br />
à une forme géométrique.»<br />
Ainsi, trois chats se positionneront<br />
naturellement en triangle, et quatre<br />
chats, en carré.<br />
Les chats d’extérieur moins<br />
intéressés<br />
Cependant, tous les chats ne sont pas attirés<br />
par les formes placées au sol. C’est précisément<br />
pour cette raison que de telles<br />
vidéos et photos sur Internet doivent être<br />
interprétées avec prudence, indique l’experte<br />
en félins Katharina Aeschimann.<br />
«Dans les vidéos, on ne montre que les<br />
chats qui s’assoient dans les formes, rarement<br />
ceux qui n’y prêtent aucun intérêt.»<br />
Selon la conseillère diplômée en psychologie<br />
animale, n’importe quelle autre vidéo<br />
ne générerait pas non plus de clics. Ces<br />
images ne reflètent donc pas le comportement<br />
général des chats. Dans ses propres<br />
essais sur le terrain, la majorité des chats<br />
de trois foyers avec jardin ne s’intéressaient<br />
pas aux formes posées ou collées.<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 5/22 27
Point de mire<br />
Le logo,<br />
l’image qui fait<br />
la différence<br />
Lorsque l’on évoque la création de logos, on pense à des<br />
designers qui passent des nuits penchés sur leur pupitre à peaufiner<br />
la forme parfaite. C’est faux. Ils sont avant tout à l’écoute.<br />
Denise Delémont, spécialiste des marques à l’agence de branding et de design Scholtysik<br />
Reconnaissable au premier coup d’œil dans le monde entier, même si le lettrage est dans une autre langue:<br />
Coca-Cola a une image de marque qui répond à toutes les exigences.<br />
Photo: Adobe Stock<br />
28<br />
5/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
Point de mire<br />
Autrefois, il fallait se faire un<br />
nom – aujourd’hui, il faut un<br />
logo. Rares sont les entreprises<br />
qui peuvent s’en passer.<br />
Un nouveau projet? Il faut un logo. Qu’il<br />
s’agisse d’une société, d’un produit ou<br />
d’une initiative – le logo s’impose. Il est<br />
aujourd’hui possible d’obtenir un logo à<br />
moindres frais sur des plates-formes en<br />
ligne. Accessibles à tous et parfois réalisés<br />
avec un savoir-faire artisanal, les logos<br />
sont proposés dans toutes les formes et<br />
couleurs. Une évolution logique si l’on<br />
considère les atouts d’un logo: il permet<br />
de s’orienter et, avec le temps, de gagner<br />
la confiance ainsi que, dans le meilleur<br />
des cas, la fidélité. Certains parlent même<br />
de «love brands» (marques aimées).<br />
La fonction définit la forme<br />
Dans un monde où les stimuli ne manquent<br />
pas et avec une offre de produits et de<br />
services qui se nivelle de plus en plus, le<br />
logo fournit un repère. On le reconnaît, il<br />
marque notre esprit et nous réconforte.<br />
Le simple fait d’exister contribue donc<br />
déjà à l’efficacité du logo. Et ce, sur une<br />
longue période. Pour cela, nul besoin de<br />
designers – c’est dans la nature des choses.<br />
Pour être efficace cependant, un logo doit<br />
avant tout être bon. Mais qu’est-ce qui est<br />
«bon»? Et quel rapport avec le design? Une<br />
petite clarification s’impose. Le célèbre<br />
designer Dieter Rams a formulé dans les<br />
années 1970 ses thèses novatrices sur la<br />
définition du bon design, toujours valables<br />
aujourd’hui. En résumé: un bon design<br />
n’est pas le fruit du hasard ou de l’arbitraire.<br />
La forme est définie par la fonction.<br />
En conséquence, le design d’un logo ne se<br />
mesure pas à la manière dont il plaît, mais<br />
à son adéquation avec la marque et à l’effet<br />
qu’il produit sur les personnes qui le regardent.<br />
Avant de s’attaquer à la forme, les<br />
designers doivent donc d’abord déterminer<br />
à quel contenu ils ont affaire.<br />
C’est là qu’intervient notre travail de<br />
concepteur de logos. <strong>No</strong>us écoutons et posons<br />
beaucoup de questions, même celles<br />
qui fâchent. Parallèlement, nous analysons<br />
les choses sans préjugés, dans la perspective<br />
neutre d’une personne extérieure.<br />
A partir de là, nous développons avec nos<br />
clients une stratégie pour leur marque: le<br />
positionnement souhaité sur le marché et<br />
un concept de base gagnant qui distingue<br />
la marque des autres et lui confère de la<br />
pertinence. <strong>No</strong>us formulons cette idée<br />
sous la forme de promesses de marque et<br />
d’une personnalité de marque. Dans le jargon<br />
marketing, on parle aussi d’«ADN de<br />
la marque». Une fois que cette description<br />
du contenu est établie, que nous avons<br />
soulevé tous les points et que nous sommes<br />
certains d’avoir bien compris notre interlocuteur,<br />
son offre, son marché et son public,<br />
nous nous attelons à la conception de<br />
la forme.<br />
Inimitable, accrocheur et adaptable<br />
S’ensuit la création d’un logo en cohérence<br />
avec la stratégie de la marque. Evoque-t-il<br />
des associations qui sont en accord avec<br />
l’ADN de la marque? Parvient-on à le situer<br />
dans la bonne branche? Est-il suffisamment<br />
original ou pourrais-je le confondre<br />
avec d’autres? Pour cela, il faut bien sûr<br />
aussi regarder les logos des concurrents.<br />
De plus, il est parfois nécessaire d’effectuer<br />
des recherches juridiques approfondies.<br />
En effet, non seulement le risque de<br />
confusion avec d’autres marques protégées<br />
complique la protection de sa propre<br />
marque, mais il présente aussi un potentiel<br />
de conflit élevé, ce qui peut être très<br />
fâcheux.<br />
<strong>No</strong>us devons donc oublier la vision romantique<br />
selon laquelle la conception<br />
d’un logo est un art pur de considérations<br />
profanes. Il faut tout de même tenir<br />
compte d’un grand nombre de critères artisanaux:<br />
puis-je saisir rapidement la<br />
forme et bien lire le nom? Même de très<br />
loin ou en tout petit sur un crayon? Peut-il<br />
être affiché comme photo de profil sur les<br />
réseaux sociaux? Les couleurs choisies<br />
sont-elles accessibles sur le web? Puis-je<br />
également le reproduire en noir et blanc?<br />
Et surtout: la forme est-elle suffisamment<br />
simple? Pour le savoir, une simple expérience<br />
mentale suffit: pourrait-on dessiner<br />
le logo dans le sable avec son doigt? C’est<br />
effectivement possible pour de nombreuses<br />
marques populaires. Il suffit de<br />
penser aux anneaux olympiques, au M incurvé<br />
de McDonald’s, à l’étoile de Mercedes,<br />
à l’hexagone de Roche, au swoosh de<br />
Nike ou aux C croisés de Chanel.<br />
Le processus créatif dans la conception<br />
de logos suit les mêmes étapes que<br />
dans l’architecture, le design de meubles<br />
ou la mode: concevoir, rejeter, affiner. A la<br />
main ou sur ordinateur. Naturellement<br />
animé dans une réalité qui devient toujours<br />
plus virtuelle, et de plus en plus souvent<br />
accompagné d’une identité sonore<br />
caractéristique de la marque.<br />
Pour les clients, ce processus de rapprochement<br />
progressif est généralement<br />
intense et parfois empreint d’une lourde<br />
charge émotionnelle, car nous collons au<br />
plus près de l’ADN de la marque. Il est par<br />
conséquent important que les personnes<br />
concernées soient impliquées dans le processus<br />
créatif et qu’elles aient la possibilité<br />
de juger non seulement sur la base de leurs<br />
goûts personnels, mais aussi sur des critères<br />
rationnels et objectifs. Dans l’idéal,<br />
les projets de logos sont examinés en environnement<br />
réel: sur un site web. Comme<br />
photo de profil sur Twitter. Comme photomontage<br />
sur un emballage ou sur la façade<br />
d’un bâtiment. Tel que l’exige la tâche en<br />
question.<br />
Enfin la forme parfaite?<br />
Une fois que le logo a trouvé sa forme définitive,<br />
son introduction demande à nouveau<br />
du doigté. Les collaborateurs, qui<br />
sont fiers de porter le logo et de représenter<br />
la marque, veulent connaître l’idée qui<br />
en est à l’origine. Les clients, les partenaires<br />
commerciaux et le public veulent se<br />
familiariser avec la marque et savoir ce<br />
qu’elle représente. Cela nécessite non seulement<br />
de bonnes prestations, mais aussi<br />
une communication habile et de la persévérance.<br />
Une étude de marché permet d’évaluer<br />
la popularité du nouveau logo. Des<br />
mesures régulières tous les un ou deux ans<br />
montrent comment la notoriété, la familiarité<br />
et l’attribution des qualités souhaitées<br />
évoluent au fil du temps. La valeur financière<br />
d’une marque peut également<br />
être mesurée. Dernièrement, Coca-Cola a<br />
été évaluée à plus de 50 milliards de dollars,<br />
Apple même à plus de 400 milliards.<br />
Ces sommes astronomiques ne se réfèrent<br />
évidemment pas uniquement au logo,<br />
mais que serait Apple sans son logo en<br />
forme de pomme? Investir dans une forme<br />
parfaite aura, dans tous les cas, été bénéfique.<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 5/22 29
Perspectives<br />
Aus der «Therapeutischen Umschau»* – Übersichtsarbeit<br />
Update:<br />
Neue Therapieformen des<br />
Diabetes mellitus Typ 2<br />
Stefan Fischli, Abteilung für Endokrinologie, Diabetologie und klinische Ernährung, Kantonsspital Luzern<br />
Die Behandlung des Diabetes<br />
mellitus Typ 2 hat in den<br />
letzten Jahren fundamentale<br />
Neuerungen erfahren: Schritt <br />
weise haben sich antidiabetische Medikamente<br />
mit neuen Wirkprinzipien etabliert.<br />
Diese Stoffklassen haben den Vorteil,<br />
dass sie frei von den «üblichen»<br />
Nebenwirkungen antidiabetischer Medikamente<br />
wie Hypoglykämie oder Gewichtszunahme<br />
sind. Eines der wichtigsten<br />
Charakteristika der neuen Antidiabetika<br />
wie GLP-1-Rezeptoragonisten oder<br />
SGLT-2-Hemmer ist ihr positiver Einfluss<br />
auf die kardiovaskuläre Morbidität und<br />
Mortalität sowie auf assoziierte diabetische<br />
Komorbiditäten (z. B. Nephropathie).<br />
Diese Erkenntnisse stützen sich auf inzwischen<br />
zahlreich vorhandene Daten<br />
aus kardiovaskulären bzw. renalen Endpunkt-Studien.<br />
Einer der Paradigmenwechsel<br />
in der modernen Diabetesbehandlung<br />
stellt die Tatsache dar, dass bei<br />
kardiovaskulären Vorerkrankungen (koronare<br />
Herzkrankheit, Herzinsuffizienz)<br />
bzw. entsprechender Hochrisikosituation<br />
primär Präparate eingesetzt werden sollen,<br />
die in den Studien eine Risikoreduktion<br />
gezeigt haben.<br />
Für den Praktiker ist die Anzahl verfügbarer<br />
Medikamente und möglicher<br />
Kombinationen bisweilen schwer überschaubar,<br />
zumal gewisse Therapieregimes<br />
noch nicht kassenzulässig sind. Der<br />
vorliegende Artikel orientiert sich an den<br />
neuen nationalen und internationalen<br />
* Der Artikel erschien ursprünglich in der<br />
«Therapeutischen Umschau» (2020), 77(7),<br />
319–327. mediservice vsao-Mitglieder können<br />
die «Therapeutische Umschau» zu äusserst<br />
günstigen Konditionen abonnieren. Details<br />
s. unter www.hogrefe.ch/downloads/vsao.<br />
Guide lines [1, 2], gibt zuerst einen aktuellen<br />
Überblick über die «neuesten» Antidiabetika<br />
(DPP-IV-Hemmer, GLP-1-Rezeptoragonisten<br />
und SGLT-2-Hemmer) und<br />
leitet dann zu praktischen Aspekten der<br />
Diabetesbehandlung über.<br />
Übersicht über neuere Antidiabetika<br />
Inkretinbasierte Therapien (vgl. Abb. 1)<br />
Unter diesem Begriff werden Behandlungen<br />
zusammengefasst, die am Inkretinsystem<br />
des Körpers angreifen. Inkretine<br />
(z. B. glucagon-like peptide 1, GLP-1 oder<br />
glucose-dependent insulinotropic peptide,<br />
GIP) sind Darm Hormone, die als Reaktion<br />
auf eine perorale Kohlenhydratbzw.<br />
Glukose-Zufuhr ausgeschüttet werden<br />
und die prandiale Insulinsekretion<br />
stimulieren. Dieser als sog. «Inkretineffekt»<br />
bezeichnete Mechanismus ist bei<br />
Typ-2-Diabetikern gestört bzw. reduziert<br />
[3], die pathophysiologischen Grundlagen<br />
dafür sind nicht restlos geklärt [4, 5].<br />
Therapeutisch kann der Inkretineffekt<br />
zweifach beeinflusst werden: Einerseits<br />
kann der Abbau der zirkulierenden,<br />
endogenen Inkretine durch Hemmung<br />
des metabolisierenden Enzyms – der Dipeptidyl-Peptidase-IV<br />
– gehemmt und<br />
damit die Inkretinspiegel erhöht werden<br />
(DPP-IV-Hemmer). Andererseits können<br />
dem körpereigenen GLP-1-ähnliche<br />
Substanzen, sog. GLP-1-Analoga oder<br />
GLP-1-Rezeptoragonisten (GLP-1-RA) eingesetzt<br />
werden, um die Inkretinwirkung<br />
zu potenzieren. Neben Differenzen in<br />
Bezug auf Wirkstärke (HbA1c-Reduktion)<br />
und Gewichtsverlauf unterscheiden sich<br />
DPP-IV-Hemmer und GLP-1-RA substanziell<br />
in ihren Effekten auf die kardiovaskuläre<br />
Morbidität und Mortalität.<br />
DPP-IV-Hemmer (Gliptine)<br />
DPP-IV-Hemmer wirken mässig blutzuckersenkend<br />
(HbA1c-Reduktion um 1 %)<br />
und sind gewichtsneutral. Das Nebenwirkungsprofil<br />
ist günstig: Im Gegensatz zu<br />
den GLP-1-Agonisten fehlen gastrointestinale<br />
Nebenwirkungen. DPP-IV-Hemmer<br />
weisen, wie GLP-1-RA, kein intrinsisches<br />
Hypoglykämierisiko auf. Eine klare Assoziation<br />
mit dem Auftreten von Pankreatitiden<br />
konnte sowohl für GLP-1-RA als auch<br />
für DPP-IV-Hemmer bisher nicht belegt<br />
werden [6, 7]. Jedoch sollten beide Stoffklassen<br />
bei Patienten mit stattgehabter<br />
oder Risikofaktoren für eine Pankreatitis<br />
gestoppt bzw. der Einsatz kritisch hinterfragt<br />
werden.<br />
DPP-IV-Hemmer werden nach wie<br />
vor sehr häufig und meist in Kombination<br />
mit Metformin eingesetzt. Zu betonen ist<br />
jedoch, dass keines der Präparate einen<br />
protektiven kardiovaskulären Effekt zeigen<br />
konnte (vgl. Tab. 1). Zusätzlich besteht<br />
möglicherweise ein erhöhtes Risiko für eine<br />
Herzinsuffizienz unter gewissen DPP-<br />
IV-Hemmern [8]. DPP-IV-Hemmer können<br />
prinzipiell mit allen oralen Antidiabetika<br />
oder mit Basalinsulin kombiniert<br />
werden. Eine Kombination von DPP-IV-<br />
Hemmern mit GLP-1-RA ist jedoch nicht<br />
zugelassen, und es kann damit keine additive<br />
HbA1c-Senkung erreicht werden [9].<br />
GLP-1-Rezeptoragonisten (GLP-1-RA)<br />
Im Gegensatz zur Behandlung mit DPP-<br />
IV-Hemmern kommt es beim Einsatz von<br />
GLP-1-RA zu einer deutlicheren Verstärkung<br />
des Inkretineffektes. Klinisch schlägt<br />
sich dies in einer grösseren HbA1c-Senkung<br />
und einem gewichtsreduzierenden<br />
Effekt nieder. Jedoch gehen die Wirkungen<br />
auch mit einer erhöhten gastrointesti<br />
30<br />
5/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
Perspectives<br />
nalen Nebenwirkungsrate (Übelkeit, Inappetenz)<br />
einher. Die Nebenwirkungen sind<br />
jedoch meist nur passager am Anfang der<br />
Behandlung vorhanden und können<br />
durch schrittweise Dosistitration abgeschwächt<br />
bzw. verhindert werden.<br />
Neben den Wirkungen auf die endokrine<br />
Pankreasfunktion hemmen die GLP-<br />
1-RA die Magenentleerung und wirken<br />
im Gehirn direkt auf Appetit- und Sättigungszentren<br />
[10]. Die GLP-1-RA sind momentan<br />
die Antidiabetika mit dem stärksten<br />
Effekt auf die Gewichtsreduktion. Im<br />
Zellmodell und im Tierversuch hat GLP-1<br />
einen trophischen Effekt auf die Betazelle<br />
und verhindert die Apoptose bzw. stimuliert<br />
deren Proliferation.<br />
In der Schweiz sind verschiedene<br />
GLP-1-RA zugelassen, entweder als Monosubstanz<br />
oder als Kombinationspräparat<br />
zusammen mit Insulin (vgl. Abb. 2).<br />
Die Substanzen unterscheiden sich primär<br />
durch die Halbwertszeit bzw. die<br />
damit verbundene Applikationsfrequenz<br />
(täglich vs. 1× / Woche). Die Halbwertszeit<br />
des Agonisten bzw. die Dauer der<br />
GLP-1-Rezeptoraktivierung spielt dabei<br />
eine Rolle, ob eher postprandiale (durch<br />
Hemmung der Magenentleerung) oder<br />
Nüchtern-Blutzuckerwerte beeinflusst<br />
werden [11]. Als erste orale GLP-1-RA-Formulierung<br />
ist Semaglutid (Rybelsus®) seit<br />
Kurzem in der Schweiz zugelassen.<br />
Verschiedene GLP-1-RA haben eine<br />
Reduktion kardiovaskulärer Endpunkte<br />
bzw. eine Mortalitätsreduktion gezeigt<br />
(vgl. Tab. 1). GLP-1-RA wirken sich ebenfalls<br />
positiv auf den Verlauf einer diabetischen<br />
Nephropathie aus. Sie verhindern<br />
primär die Progression der Albuminurie<br />
und die Entwicklung bzw. das Neu-Auftreten<br />
einer Makroalbuminurie. Anzumerken<br />
ist jedoch, dass es sich bei der<br />
überwiegenden Mehrheit der Daten um<br />
sekundäre Endpunkte aus den kardiovaskulären<br />
Endpunktstudien handelt.<br />
GLP-1-RA können mit allen oralen Antidiabetika<br />
(ausser DPP-IV-Hemmern, siehe<br />
oben) und Insulin kombiniert werden.<br />
SGLT-2-Hemmer können ebenfalls zusammen<br />
mit GLP-1-RA gegeben werden.<br />
Die Kombination ist zum jetzigen Zeitpunkt<br />
jedoch nicht kassenzulässig, d. h.<br />
eine vorgängige Kostengutsprache beim<br />
Versicherer ist notwendig.<br />
SGLT-2-Hemmer (Gliflozine) (vgl. Abb. 3)<br />
Die neueste antidiabetische Stoffklasse,<br />
die SGLT-2-Hemmer, vermindern im proximalen<br />
Tubulus die Rückresorption von<br />
Glukose durch Hemmung des Natrium-Glukose-Symporters<br />
(sodium dependent<br />
glucose transporter, SGLT). Die daraus<br />
resultierende Glukosurie schlägt sich<br />
in einer HbA1c-Senkung mit Gewichtsreduktion<br />
nieder. Neben ihrer blutzucker-senkenden<br />
Wirkungen weisen die<br />
SGLT-2-Hemmer aber auch kardio- und<br />
nephroprotektive Effekte auf. Die genauen,<br />
dafür verantwortlichen Mechanismen<br />
sind noch nicht allesamt geklärt. Auf kardialer<br />
Seite führen verschiedene Faktoren<br />
Abbildung 1. Inkretinbasierte Therapie: Übersicht über Ansatzpunkte und Wirkungen.<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 5/22 31
Perspectives<br />
Tabelle 1. Kohlenhydrate für Diabetes-Patienten: Alternativen zu ungünstigen Quellen.<br />
Substanz<br />
(Markenname)<br />
3-P-MACE 1<br />
Kardiovaskuläre<br />
Mortalität<br />
Gesamt-<br />
Mortalität<br />
Nicht-fataler<br />
CVI<br />
Nicht- fataler<br />
Myokardinfarkt<br />
Herz -<br />
insuffizienz<br />
Nephropathie<br />
DPP-IV-Hemmer<br />
Saxaglipitin<br />
(Onglyza®)<br />
Aloglipitin<br />
(Vipida®)<br />
Sitagliptin<br />
(Januvia®)<br />
Linaglipitin<br />
(Trajenta®)<br />
Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Erhöht Reduziert 2<br />
Neutral Neutral Neutral N. E. Neutral Erhöht N. E.<br />
Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral<br />
Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Reduziert 2<br />
GLP-1-Rezeptoragonisten<br />
Lixisenatid<br />
(Lyxumia®)<br />
Liraglutid<br />
(Victoza®)<br />
Semaglutid s.c.<br />
(Ozempic®)<br />
Semaglutid p.o.<br />
(Rybelsus®)<br />
Dulaglutid<br />
(Trulicity ®)<br />
Exenatid ER<br />
(Bydureon®)<br />
Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Reduziert 3<br />
Reduziert Reduziert Reduziert Neutral Neutral Neutral Reduziert 3<br />
Reduziert Neutral Neutral Reduziert Neutral Neutral Reduziert 3<br />
Neutral Reduziert Neutral Neutral Neutral Neutral N. E.<br />
Reduziert Neutral Neutral Reduziert Neutral Neutral Reduziert 3<br />
Neutral Neutral Reduziert 4 Neutral Neutral Neutral Reduziert<br />
SGLT-2-Inhibitoren<br />
Empagliflozin<br />
(Jardiance®)<br />
Canagliflozin<br />
(Invokana®<br />
Dapagliflozin<br />
(Forxiga®)<br />
Reduziert Reduziert Reduziert Neutral Neutral Reduziert Reduziert<br />
Reduziert Neutral Neutral Neutral Neutral Reduziert 4 Reduziert<br />
Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Reduziert Reduziert<br />
Anmerkungen: N. E.: nicht evaluiert; 1 3-P-MACE: 3-Point Major Adverse Cardiovascular Event: kombinierter Endpunkt in kardiovaskulären Endpunktstudien<br />
beinhaltet kardiovaskulärer Tod, nicht-fataler Myokardinfarkt, nicht-fataler stroke; 2 v. a. Progression der Albuminurie; 3 v. a. Entwicklung einer<br />
Makroalbuminurie; 4 explorativer Endpunkt.<br />
wie Vor- und Nachlastsenkung, zunehmende<br />
Hämokonzentrierung, der durch<br />
osmotische Phänomene vermittelte diuretische<br />
Effekt, ein möglicherweise verändertes<br />
Nährstoffangebot (z. B. Ketonkörper)<br />
an das Myokard und die Hemmung<br />
des Natrium-Hydrogen-Exchangers zu<br />
den dokumentierten protektiven Effekten<br />
bei Pat. mit KHK und einer Herzinsuffizienz<br />
[12]. In Bezug auf die Nephroprotektion<br />
ist einer der zentralen Mechanismen<br />
die Abnahme des glomerulären Filtrationsdruckes<br />
und der Hyperfiltration durch<br />
Beeinflussung des tubulo-glomerulären<br />
Feedbacks [13]. Dadurch kommt es zu einer<br />
verzögerten Progression der diabetischen<br />
Nephropathie. In Studien konnte<br />
gezeigt werden, dass unter Behandlung<br />
mit SGLT-2-Hemmern die Nieren-spezifischen<br />
Endpunkte wie Einleiten eines Nierenersatzverfahrens<br />
oder renaler Tod seltener<br />
auftreten [14, 15]. Die bisher einzige<br />
Studie, die den Einfluss eines SGLT-2-<br />
Hemmers (Canagliflozin) auf die diabetische<br />
Nephropathie als primären Endpunkt<br />
untersucht hat, war das CREDEN<br />
CE-trial [15]. Die positive Beeinflussung<br />
dieses sog. «kardio-renalen Systems»<br />
scheint denn auch ein zentraler Aspekt<br />
der Morbiditäts- und Mortalitätsreduktion<br />
unter SGLT-2-Hemmerbehandlung zu<br />
sein [16 – 18] (vgl. Tab. 1).<br />
Obwohl die SGLT-2-Hemmer, neben<br />
den GLP-1-RA, einen Meilenstein der modernen<br />
Diabetestherapie darstellen, ist<br />
das pleiotrope Wirkspektrum auch mit<br />
Nebenwirkungen assoziiert. Die seltene<br />
euglykäme diabetische Ketoazidose (eD<br />
KA) ist als metabolische Azidose mit meist<br />
nur gering erhöhten Plasmaglukosewerten<br />
charakterisiert. Die Bestätigung der<br />
Verdachtsdiagnose erfordert immer eine<br />
32<br />
5/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
Perspectives<br />
Täglich applizierbare Präparate<br />
Generischer Name Exenatid Liraglutid Lixisenatid<br />
Markennanme Byetta® Victoza® Lyxumia®<br />
Zulassung (CH) 2006 2009 2017<br />
Grundstruktur Exendin-4 GLP-1 Exendin-4<br />
Molekulargewicht (Da) 4186.6 3751.2 4909.5<br />
Halbwertszeit + ++ +<br />
Senkung Nüchtern-BZ + ++ +<br />
Senkung pp-BZ ++ + ++<br />
Applikation 2x tgl. 1x tgl. 1x tgl. zur Hauptmahlzeit<br />
Kombination mit Basalinsulin (gem. SL) Ja Ja 1 Ja 2<br />
Wöchentlich applizierbare Präparate<br />
Generischer Name Exenatid LAR 3 Dulaglutid Semaglutid<br />
Markennanme Bydureon® Trulicity® Ozempic®<br />
Zulassung (CH) 2012 2015 2019<br />
Grundstruktur Exendin-4 GLP-1 GLP-1<br />
Molekulargewicht (Da) 4186.6 59669.81 4113.64<br />
Halbwertszeit +++ +++ +++<br />
Senkung Nüchtern-BZ ++ ++ ++<br />
Senkung pp-BZ + + +<br />
Applikation 1x wöchentlich 1x wöchentlich 1x wöchentlich<br />
Kombination mit Basalinsulin (gem. SL) Nein Nein Ja<br />
Abbildung 2. GLP-1-Rezeptoragonisten: Übersicht über s.c.-applizierbare Präparate. 1 Fixkombination Liraglutid / Insulin degludec (Xultophy®) erhältlich;<br />
2 Fixkombination Lixisenatid / Insulin glargin (Suliqua®) erhältlich; 3 Exenatid in Mikrosphären vorliegend (führt zur verzögerten Freisetzung).<br />
BZ: Blutzucker; gem. SL: Indikation zugelassen gem. Spezialitätenliste; Da: Dalton.<br />
Blutgasanalyse, ansonsten wird die Übersäuerung<br />
verpasst und der Verlauf kann<br />
fatal enden. Analog zur Metformin-assoziierten<br />
Laktatazidose ist die eDKA eine<br />
meist vorhersehbare und abwendbare<br />
Komplikation, wenn grundlegende Vorsichtsmassnahmen<br />
(vgl. Kasten 1) strikte<br />
befolgt werden. Das Risiko für urogenitale<br />
Infekte (meist Mykosen) ist unter<br />
SGLT-2-Hemmer-Behandlung erhöht. Unklar<br />
ist zum jetzigen Zeitpunkt die Frage,<br />
ob auch komplizierte Harnwegsinfekte<br />
bzw. Pyelonephri tiden oder Formen der<br />
urogenitalen, nekrotisierenden Fasziitis<br />
(Fournier-Gangrän) einen Zusammenhang<br />
mit der SGLT-2-Hemmerbehandlung<br />
haben. Auch ist bis jetzt noch nicht<br />
klar, ob das Amputationsrisiko (v. a. an der<br />
unteren Extremität) unter den Gliflozinen<br />
erhöht ist. Vorsicht ist geboten bei Patienten<br />
mit diabetischem Fuss syndrom, fortgeschrittener<br />
Neuropathie und kritischer<br />
Blutversorg ung bzw. Kompromittierung<br />
derselben durch eine zusätzliche Volu<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 5/22 33
Perspectives<br />
Kasten 1. Vorsichtsmassnahmen unter Behandlung mit SGLT-2-Hemmern.<br />
Risikopersonen / Risikosituationen für Komplikationen<br />
(Infekte / Ketoazidose) identifizieren<br />
• Gehäufte urogenitale Infekte, Prädisposition<br />
für Infekte z. B. schwere obstruktive Uropathie<br />
• Nicht-erkannter Typ-1-Diabetes<br />
• Akute Erkrankungen, z. B. mit Dehydratation<br />
(Gastroenteritis)<br />
• Chirurgische Eingriffe<br />
• Stoppen / ausgeprägte Dosisreduktion von Insulin<br />
• Fortgeschrittene Niereninsuffizienz bzw. rasche<br />
Verschlechterung der Nierenfunktion<br />
• Patienten mit «kritischer» PAVK, St. n. Amputation,<br />
Polyneuropathie, diabetisches Fusssyndrom<br />
• Patienten mit grossem Sturzrisiko<br />
• Therapien mit Risiko für Volumendepletion<br />
(Schleifendiuretika)<br />
Massnahmen<br />
• Auf Ausführliche Information des Patienten über Nebenwirkungen,<br />
Symptome des Infektes bzw. der Ketoazidose,<br />
unbedingte <strong>No</strong>twendigkeit des Stoppens bei akuter<br />
Erkrankung / Operation<br />
• Stoppen von SGLT-2-Hemmern bei Patienten mit akuter<br />
Erkrankung / hospitalisierten Patienten<br />
• Regelmässige Fusskontrollen bei Patienten mit diabetischem<br />
Fusssyndrom bzw. bekannter PAVK, Behandlung<br />
einer klinisch relevanten PAVK<br />
• Keine Verordnung von SGLT-2-Hemmern bei Patienten<br />
mit Typ-1-Diabetes (keine zugelassene Indikation)<br />
• Kennen der Symptome einer Ketoazidose und im Zweifelsfall<br />
immer Ausschluss einer Azidose mittels Blutgasanalyse<br />
dem entsprechenden Medikament gesenkt<br />
werden kann. Dabei ist zu beachten,<br />
dass bei hohen HbA1c-Ausgangswerten<br />
die Senkung des glykierten Hämoglobins<br />
immer deutlicher ausfallen wird. Bei anfänglichen<br />
HbA1c-Werten über 9 % kann<br />
der Beginn einer dualen Therapie (z. B.<br />
Metformin in Kombination mit einem<br />
zweiten Antidiabetikum) von Anfang<br />
an evaluiert werden, um eine raschere<br />
HbA1c-Senkung zu erreichen [19]. Das<br />
Therapieansprechen sollte mit regelmässigen<br />
HbA1c-Messungen (alle 3 – 6 Monate)<br />
kontrolliert werden und bei Nichterreichen<br />
der HbA1c-Ziele eine kontinuierliche<br />
Anpassung der Behandlung erfolgen.<br />
Abbildung 3. SGLT-2-Inhibitoren: Wirkungen auf Blutzuckerstoffwechsel und auf kardiale / renale<br />
Physiologie (NHE: sodium-hydrogen exchanger).<br />
mendepletion (z. B. durch additive Gabe<br />
von Schleifendiuretika).<br />
Praktisches Vorgehen<br />
Das primäre Ziel einer effektiven und<br />
nachhaltigen Diabetesbehandlung ist die<br />
Reduktion der kardiovaskulären Morbidität<br />
und Mortalität, die Verhinderung bzw.<br />
die Verlangsamung der mikrovaskulären<br />
Diabeteskomplika tionen (z. B. diabetische<br />
Nephropathie oder Retinopathie) unter<br />
Vermeidung therapiespezifischer Nebenwirkungen<br />
wie Hypoglykämie oder Gewichtszunahme.<br />
Für jeden Patienten soll<br />
individuell ein HbA1c-Zielbereich festgelegt<br />
werden. Dieser fällt bei jüngeren<br />
Diabetikern ohne fortgeschrittene Sekundärerkrankungen<br />
tiefer aus (unter 7 %,<br />
bzw. unter 6.5 % wenn dieses Ziel ohne<br />
Hypoglykämie-verursachende Therapie<br />
erreicht werden kann) als bei Älteren mit<br />
Vorerkrankungen bzw. Personen mit hohem<br />
Hypoglykämierisiko (um 8 %).<br />
Bei der Wahl der Substanzen muss auf<br />
die antidiabe tische Potenz geachtet werden<br />
(vgl. Tab. 2, Spalte HBA1c-Senkung),<br />
d. h. es sollte in etwa abgeschätzt werden,<br />
um wieviel Prozentpunkte das HbA1c mit<br />
Wahl des Antidiabetikums<br />
(vgl. Abb. 4)<br />
Grundlage jeder Behandlung bei Typ-2-Diabetes<br />
stellt das Umsetzen der lebensstiländernden<br />
Massnahmen (Gewichtsreduktion,<br />
Ernährungsumstellung, regelmässige<br />
Bewegung) und die multifaktorielle<br />
Behandlung der kardiovaskulären Risikofaktoren<br />
(Statingabe, Blutdruckkontrolle,<br />
Rauchstopp) dar.<br />
Bei der medikamentösen Behandlung<br />
(Erstbehandlung bzw. Ausbau der Therapie)<br />
müssen folgende Fragen gestellt werden:<br />
1. Braucht der Patient Insulin?<br />
2. Liegt eine Nierenfunktionseinschränkung<br />
vor?<br />
3. Hat der Patient ein hohes kardiovaskuläres<br />
Risiko, bestehen kardiovasku läre<br />
Erkrankungen (etablierte KHK oder<br />
Herzinsuffizienz) oder eine fortgeschrittene<br />
diabetische Nephropathie?<br />
34<br />
5/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
Perspectives<br />
Tabelle 2. Übersicht über verschiedene Antidiabetika (Adaptiert nach [23 – 29]).<br />
Stoffklasse HbA1c-Reduktion (%) Gewichtsverlauf (kg) Dosierung bei Niereninsuffizienz<br />
Metformin –2 –1.5 GFR 59 – 45 ml / min.: max. 1500 mg / d<br />
GFR 44 – 30 ml / min.: max. 500 – 1000 mg 1<br />
GFR < 30 ml / min.: Stopp<br />
Sulfonylharnstoff<br />
(Gliclazid)<br />
–2 +1 bis 2 In der Regel Stopp bei GFR 30 – 45 ml / min. oder tiefer<br />
DPP-IV-Hemmer –1 0 Gabe bis GFR < 30 ml / min. möglich 2<br />
GLP-1-Rez.-Agonist –1.6 –3 Gabe bis GFR < 30 ml / min. möglich<br />
SGLT-2-Hemmer –1 –2 Bei GFR < 45ml / min.: Stopp 3<br />
Insulin –3.5 +3 Keine Einschränkung 4<br />
Anmerkungen: 1 Kein Neubeginn mit Metformin, regelmässige Kontrollen der Nierenfunktion, sick day rules befolgen; 2 Bei gewissen Substanzen muss<br />
eine Dosisadaptation erfolgen (ausser Linagliptin); 3 Gem. Kompendium (in Studien: sicherer Einsatz bis GFR 30 ml / min. gezeigt), Ausnahme Ertugliflozin<br />
(Stopp bei GFR < 60 ml / min.); 4 Bei schwerer Einschränkung der Nierenfunktion (GFR < 15 – 30 ml / min.) bzw. Dialysepflichtigkeit muss ggf. die Insulindosis<br />
reduziert werden (ggf. erhöhtes Hypoglykämierisiko).<br />
Braucht der Patient Insulin?<br />
Das älteste und potenteste Antidiabetikum,<br />
das Insulin, kommt immer dann<br />
zum Einsatz, wenn die Stoffwechsellage<br />
stark entgleist ist und / oder Hinweise auf<br />
einen Insulinmangel (z. B. bei einem<br />
Typ-1-Diabetes) bzw. auf eine katabole Situation<br />
bestehen (vgl. Kasten 2). In den<br />
meisten Fällen kann mit dem Einsatz eines<br />
Basisinsulins (meist in Kombination<br />
mit anderen Antidiabetika, ausser zusammen<br />
mit Sulfonylharnstoffen) eine rasche<br />
und ausreichende Stoffwechselkontrolle<br />
erreicht werden. Die Basalinsulinbehandlung<br />
stellt – verglichen mit anderen Insulinregimes<br />
(Mischinsuline bzw. Basis-Bolusbehandlung)<br />
die Therapieform mit<br />
dem geringsten Potenzial für Unterzuckerungen<br />
und Gewichtszunahme dar [20].<br />
Liegt eine Nierenfunktionseinschränkung<br />
vor?<br />
Die Prävalenz einer chronischen Nierenerkankung,<br />
definiert durch eine eingeschränkte<br />
glomeruläre Filtrationsrate oder<br />
das Vorliegen einer Albuminurie, beträgt in<br />
grossen Typ-2-Diabetes-Kollektiven über<br />
40 % [21] und ist damit eine sehr häufige<br />
Komorbidität. Eine fortgeschrittene Niereninsuffizienz<br />
(GFR < 45 ml / min / 1.73 m 2 )<br />
schliesst die Verordnung von einigen Antidiabetika<br />
aus (vgl. Tab. 2). Bei einer GFR<br />
unter 30 ml / min / 1.73 m 2 können weiterhin<br />
GLP-1-Agonisten, Insulin und DPP-IV-<br />
Hemmer eingesetzt werden. Bei letzterer<br />
Substanzklasse ist jedoch bei gewissen Präparaten<br />
eine Anpassung der Dosis erforderlich.<br />
Zusammenfassung<br />
Die Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 hat in den letzten Jahren grundlegende<br />
Änderungen erfahren. Neue Präparate mit fehlendem Hypoglykämiepotenzial und<br />
gewichtsreduzierendem Effekt wurden zugelassen. In grossen Studien konnten die<br />
protektiven Eigenschaften von GLP-1-Rezeptoragonisten und SGLT-2-Hemmer auf die<br />
kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität gezeigt werden. Die neuen Erkenntnisse<br />
schlagen sich in Änderungen in der Behandlungsstrategie nieder: Typ-2-Diabetiker mit<br />
Herz- / Kreislauf-Erkrankungen oder einem hohen kardiovaskulären Risiko werden<br />
primär mit Substanzen behandelt, die einen Benefit in Bezug auf die Risikoreduktion<br />
gezeigt haben. SGLT-2-Inhibitoren wirken durch direkten Angriff auf die Nierenphysiologie<br />
nephroprotektiv und können den Verlauf einer diabetischen Nephropathie günstig<br />
beeinflussen. Der vorliegende Artikel stellt in einem Überblick Wirkmechanismen und<br />
Charakteristika der neueren Antidiabetika (DPPIV-Hemmer, GLP-1-Rezeptoragonisten,<br />
SGLT-2-Hemmer) vor und leitet dann über zu den praktischen Aspekten bei der Behandlung<br />
von Personen mit Typ-2-Diabetes.<br />
Abstract:<br />
Update: new forms of therapy for type-2-diabetes<br />
In the past few years medical treatment of type-2-diabetes experienced fundamental<br />
changes. New medications were approved which have no intrinsic risk of hypoglycemia<br />
and exert weight loss. Cardiovascular outcome trials demonstrated positive effects on<br />
cardiovascular morbidity and mortality for GLP-1-receptor agonists and SGLT-2-inhibitors,<br />
the latter showing also specific nephroprotective effects. The growing bulk of data<br />
leads to modified therapy strategies: Persons with established cardiovascular disease or<br />
high cardiovascular risk should be treated primary with these medications. This review<br />
starts with an overview on newer antidiabetic substances (DPPIV-inhibitors, GLP-1-receptor<br />
agonists, SGLT-2-inhibitors). Then practical aspects of treatment regimens according<br />
to actual national and international guidelines are discussed.<br />
Hat der Patient ein hohes<br />
kardiovaskuläres Risiko, bestehen<br />
kardiovaskuläre Erkrankungen<br />
(etablierte KHK oder Herzinsuffizienz)<br />
oder eine fortgeschrittene diabetische<br />
Nephropathie?<br />
Bestehen bereits kardiovaskuläre Vorerkrankungen<br />
(z. B. St. n. Myokardinfarkt<br />
bzw. Herzinsuffizienz) oder liegt ein hohes<br />
kardiovaskuläres Risiko (z. B. lange Diabetesdauer,<br />
Endorganschäden in Kombination<br />
mit Vorliegen mehrerer kardiovaskulärer<br />
Risikofaktoren) vor, sollen primär Antidiabetika<br />
gewählt werden, die einen protektiven<br />
Effekt auf diese Erkrankungen<br />
aufweisen (vgl. Tab. 1). D.h. man sollte eine<br />
Metformintherapie primär mit einem<br />
GLP-1-Agonisten oder einem SGLT-2-Hem<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 5/22 35
Perspectives<br />
Abbildung 4. Auswahl des Antidiabetikums (CV: kardiovaskulär; MI: Myokardinfarkt).<br />
mer kombinieren. Bei Vorliegen einer fortgeschrittenen<br />
diabetischen Nephro pathie<br />
(Makroalbuminurie / nephrotisches Syndrom)<br />
und bereits bestehender Behandlung<br />
mit einem ACE-Hemmer oder einem<br />
Sartan kann eine SGLT-2-Inhibitor-Therapie<br />
mit Canagliflozin evaluiert werden, das<br />
für diese Indika tion neu zugelassen ist. In<br />
allen anderen Fällen ist man in der Wahl<br />
des zweiten bzw. dritten Antidiabetikums<br />
frei (z. B. DPP-IV-Hemmer) oder richtet<br />
sich nach zusätz lichem Therapienutzen<br />
(z. B. GLP-1-Agonist bei Wunsch nach effektiver<br />
Gewichtsreduk tion).<br />
Beginn einer Injektionstherapie<br />
(vgl. Abb. 5)<br />
Ist die Stoffwechselkontrolle unter 2 – 3<br />
oralen Antidiabe tika ungenügend und das<br />
definierte HbA1c-Ziel nicht erreicht, stellt<br />
der nächste Schritt der Beginn einer Injektionstherapie<br />
dar. In der Vergangenheit<br />
war dieser gleichbedeutend mit dem Einleiten<br />
einer Insulintherapie. Heute wird<br />
jedoch in den meisten Fällen – und bei<br />
fehlenden Indikationen für eine Insulintherapie<br />
(vgl. Kasten 2) – der Beginn einer<br />
Behandlung mit einem GLP-1-Agonisten<br />
empfohlen [21]. Die Vorteile gegenüber<br />
der Insulintherapie sind das fehlende<br />
Hypoglykämierisiko und der positive Effekt<br />
auf den Gewichtsverlauf. Die GLP-1-<br />
Agonisten therapie kann im Verlauf problemlos<br />
mit einem Basisinsulin ergänzt<br />
werden. Der Nutzen der Kombinationstherapie<br />
ist inzwischen gut belegt. Pharmakologisch<br />
wirken beide Substanzen<br />
über verschiedene Mechanismen blutzuckersenkend<br />
und synergistisch. Die Beeinflussung<br />
der zentralen Appetit- und<br />
Sättigungsregulation durch den GLP-1-Rezeptoragonist<br />
hilft jedoch, eine Gewichtszunahme<br />
unter Insulintherapie zu verhindern.<br />
Immer mehr Daten belegen nun<br />
auch den Nutzen einer solchen Kombinationstherapie<br />
hinsichtlich Gewichtsverlauf,<br />
Insulindosis, Stoffwechselkontrolle<br />
und Hypoglykämierisiko [20 – 22].<br />
Dr. med. Stefan Fischli<br />
Abteilung für Endokrinologie, Diabetologie<br />
und klinische Ernährung<br />
Departement Medizin<br />
Luzerner Kantonsspital<br />
6000 Luzern 16<br />
stefan.fischli@luks.ch<br />
Kasten 2. Indikationen für eine Insulintherapie.<br />
• Akutsituationen (z. B. Herzinfarkt,<br />
Hirnschlag, Operation)<br />
• Schwere Entgleisungen<br />
(Blutzucker > 20 – 25 mmol / l,<br />
HbA1c > 12 %)<br />
• Anabolismus gewünscht<br />
(Ältere, Tumorpatienten)<br />
• Kontraindikationen für orale<br />
Antidiabetika<br />
• Schmerzhafte Polyneuropathie<br />
• Schwere Entgleisung unter<br />
Glukokortikoidtherapie<br />
• Pankreatopriver Diabetes<br />
• Schwangerschaft<br />
• Hinweise auf absoluten Insulinmangel<br />
(Verdacht auf D. mellitus<br />
Typ 1)<br />
– Akuter Beginn<br />
– Gewichtsverlust unabhängig<br />
von Ausgangsgewicht<br />
– Ketonkörper nachweisbar<br />
36<br />
5/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
Perspectives<br />
Abbildung 5. Beginn einer Injektionstherapie.<br />
Literatur<br />
[1] Schweizerische Gesellschaft<br />
für Endokrinologie und Diabetologie,<br />
Hrsg. Empfehlungen der<br />
Schweizerischen Gesellschaft für<br />
Endokrinologie und Diabetologie<br />
(SGED / SSED) für die Behandlung<br />
von Diabetes mellitus Typ 2 (2020)<br />
[Internet]. Baden: SGED SSED; 28.<br />
Februar 2020 [abgerufen am 17.<br />
März 2020]. Verfügbar unter: https://<br />
www.sgedssed.ch/diabetologie/<br />
sged-empfehlungen-diabetologie<br />
[2] Davies MJ, D'Alessio<br />
DA, Fradkin J, Kernan WN,<br />
Mathieu C, Mingrone G, et al.<br />
Management of Hyperglycemia in<br />
Type 2 Diabetes, 2018. A Consensus<br />
Report by the American<br />
Diabetes Association (ADA) and<br />
the European Association for the<br />
Study of Diabetes (EASD). Diabetes<br />
Care. 2018; 41: 2669 – 701.<br />
[3] Nauck MA, Homberger<br />
E, Siegel EG, Allen RC, Eaton RP,<br />
Ebert R, et al. Incretin effects of<br />
increasing glucose loads in man<br />
calculated from venous insulin<br />
and C-peptide responses. J Clin<br />
Endocrinol Metab. 1986; 63 (2):<br />
492 – 8.<br />
[4] Meier JJ, Nauck MA. Is<br />
the diminished incretin effect in<br />
type 2 diabetes just an epi-phenomenon<br />
of impaired beta-cell function?<br />
Diabetes. 2010; 59: 1117 – 25.<br />
[5] Nauck MA, Vardarli<br />
I, Deacon CF, Holst JJ, Meier JJ.<br />
Secretion of glucagon-like peptide-1<br />
(GLP-1) in type 2 diabetes:<br />
what is up, what is down? Diabetologia.<br />
2011; 54: 10 – 8.<br />
[6] Montvida O, Green JB,<br />
Atherton J, Paul SK. Treatment<br />
with incretins does not increase<br />
the risk of pancreatic diseases<br />
compared to older anti-hyperglycaemic<br />
drugs, when added to<br />
metformin: real world evidence<br />
in people with Type 2 diabetes.<br />
Diabet Med. 2019; 36: 491 – 8.<br />
[7] Kim Y-G, Kim S, Han SJ,<br />
Kim DJ, Lee K-W, Kim HJ. Dipeptidyl<br />
Peptidase-4 Inhibitors and<br />
the Risk of Pancreatitis in Patients<br />
with Type 2 Diabetes Mellitus: A<br />
Population-Based Cohort Study. J<br />
Diabetes Res. 2018; 2018: 5246976.<br />
[8] Packer M. Do DPP-4<br />
Inhibitors Cause Heart Failure<br />
Events by Promoting Adrenergically<br />
Mediated Cardiotoxicity?<br />
Clues From Laboratory Models and<br />
Clinical Trials. Circ Res. 2018; 122:<br />
928 – 32.<br />
[9] Nauck MA, Kahle M, Baranov<br />
O, Deacon CF, Holst JJ. Addition<br />
of a dipeptidyl peptidase-4<br />
inhibitor, sitagliptin, to ongoing<br />
therapy with the glucagon-like<br />
peptide-1 receptor agonist liraglutide:<br />
A randomized controlled trial<br />
in patients with type 2 diabetes.<br />
Diabetes Obes Metab. 2017; 19:<br />
200 – 7.<br />
[10] Baggio LL, Drucker DJ.<br />
Glucagon-like peptide-1 receptors<br />
in the brain: controlling food<br />
intake and body weight. J Clin<br />
Invest. 2014; 124: 4223 – 6.<br />
[11] Lund A, Knop FK,<br />
Vilsbøll T. Glucagon-like peptide-1<br />
receptor agonists for the treatment<br />
of type 2 diabetes: differences and<br />
similarities. Eur J Intern Med.<br />
2014; 25: 407 – 14.<br />
[12] Zelniker TA, Braunwald<br />
E. Cardiac and Renal Effects of<br />
Sodium-Glucose Co-Transporter<br />
2 Inhibitors in Diabetes: JACC<br />
State-of-the-Art Review. J Am Coll<br />
Cardiol. 2018; 72: 1845 – 55.<br />
[13] Fioretto P, Zambon A,<br />
Rossato M, Busetto L, Vettor R.<br />
SGLT2 Inhibitors and the Diabetic<br />
Kidney. Diabetes Care. 2016; 39<br />
Suppl 2: S165 – 71.<br />
[14] Wanner C, Inzucchi<br />
SE, Lachin JM, Fitchett D, von<br />
Eynatten M, Mattheus M, et al.<br />
Empagliflozin and Progression of<br />
Kidney Disease in Type 2 Diabetes.<br />
N Engl J Med. 2016; 375: 323 – 34.<br />
[15] Perkovic V, Jardine MJ,<br />
Neal B, Bompoint S, Heerspink<br />
HJL, Charytan DM, et al. Canagliflozin<br />
and Renal Outcomes in Type<br />
2 Diabetes and Nephropathy. N<br />
Engl J Med. 2019; 380: 2295 – 306.<br />
[16] Zinman B, Wanner C,<br />
Lachin JM, Fitchett D, Bluhmki<br />
E, Hantel S, et al. Empagliflozin,<br />
Cardiovascular Outcomes, and<br />
Mortality in Type 2 Diabetes. N<br />
Engl J Med. 2015; 373: 2117 – 28.<br />
[17] Neal B, Perkovic V,<br />
Mahaffey KW, de Zeeuw D, Fulcher<br />
G, Erondu N, et al. Canagliflozin<br />
and Cardiovascular and Renal<br />
Events in Type 2 Diabetes. N Engl J<br />
Med. 2017; 377: 644 – 57.<br />
[18] Wiviott SD, Raz I,<br />
Bonaca MP, Mosenzon O, Kato ET,<br />
Cahn A, et al. Dapagliflozin and<br />
Cardiovascular Outcomes in Type<br />
2 Diabetes. N Engl J Med. 2019;<br />
380: 347 – 57.<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 5/22 37
Perspectives<br />
Literatur (Fortsetzung)<br />
[19] Association AD. 9. Pharmacologic<br />
Approaches to Glycemic<br />
Treatment: Standards of Medical<br />
Care in Diabetes – 2020. Diabetes<br />
Care. 2020; 43(Suppl 1): S98 – 110.<br />
[20] Holman RR, Farmer AJ,<br />
Davies MJ, Levy JC, Darbyshire JL,<br />
Keenan JF, et al. Three-year efficacy<br />
of complex insulin regimens<br />
in type 2 diabetes. N Engl J Med.<br />
2009; 361: 1736 – 47.<br />
[21] Bailey RA, Wang Y, Zhu<br />
V, Rupnow MFT. Chronic kidney<br />
disease in US adults with type<br />
2 diabetes: an updated national<br />
estimate of prevalence based on<br />
Kidney Disease: Improving Global<br />
Outcomes (KDIGO) staging. BMC<br />
Res <strong>No</strong>tes. 2014; 7: 415.<br />
[22] Eng C, Kramer CK,<br />
Zinman B, Retnakaran R. Glucagon-like<br />
peptide-1 receptor agonist<br />
and basal insulin combination<br />
treatment for the management<br />
of type 2 diabetes: a systematic<br />
review and meta-analysis. Lancet.<br />
2014; 384: 2228 – 34.<br />
[23] Maiorino MI, Chiodini<br />
P, Bellastella G, Capuano A, Esposito<br />
K, Giugliano D. Insulin and<br />
Glucagon-Like Peptide 1 Receptor<br />
Agonist Combination Therapy<br />
in Type 2 Diabetes: A Systematic<br />
Review and Meta-analysis of<br />
Randomized Controlled Trials.<br />
Diabetes Care. 2017; 40: 614 – 24.<br />
[24] Castellana M, Cignarelli<br />
A, Brescia F, Laviola L, Giorgino<br />
F. GLP-1 receptor agonist added<br />
to insulin versus basal-plus or<br />
basal-bolus insulin therapy in type<br />
2 diabetes: A systematic review and<br />
meta-analysis. Diabetes Metab Res<br />
Rev. 2019; 35 (1): e3082.<br />
[25] Nathan DM, Buse JB,<br />
Davidson MB, Ferrannini E, Holman<br />
RR, Sherwin R, et al. Medical<br />
management of hyperglycemia<br />
in type 2 diabetes: a consensus<br />
algorithm for the initiation and<br />
adjustment of therapy: a consensus<br />
statement of the American Diabetes<br />
Association and the European<br />
Association for the Study of<br />
Diabetes. Diabetes Care. 2009; 32:<br />
193 – 203.<br />
[26] Kendall DM, Cuddihy<br />
RM, Bergenstal RM. Clinical application<br />
of incretin-based therapy:<br />
therapeutic potential, patient<br />
selection and clinical use. Am J<br />
Med. 2009; 122 (6 Suppl): S37 – 50.<br />
[27] Madsbad S. Liraglutide<br />
Effect and Action in Diabetes<br />
(LEAD TM ) trial. Expert Rev Endocrinol<br />
Metab. 2009; 4: 119 – 29.<br />
[28] Meneghini LF, Orozco-Beltran<br />
D, Khunti K, Caputo<br />
S, Damçi T, Liebl A, et al. Weight<br />
beneficial treatments for type 2<br />
diabetes. J Clin Endocrinol Metab.<br />
2011; 96: 3337 – 53. Verweis in<br />
Legende zu Tabelle 2<br />
[29] Vasilakou D, Karagiannis<br />
T, Athanasiadou E, Mainou<br />
M, Liakos A, Bekiari E, et al.<br />
Sodium-glucose cotransporter 2<br />
inhibitors for type 2 diabetes: a systematic<br />
review and meta-analysis.<br />
Ann Intern Med. 2013; 159: 262 – 74.<br />
Verweis in Legende zu Tabelle 2<br />
Annonce<br />
Quand Marc va bien,<br />
tout le monde va bien.<br />
Pour que cela perdure, nous accompagnons<br />
Marc, sa famille et chaque personne assurée<br />
tout au long de leur vie.
Perspectives<br />
Aus der «Therapeutischen Umschau»* – Übersichtsarbeit<br />
Ernährung bei<br />
Diabetes mellitus<br />
David Fäh, Departement Gesundheit, Ernährung und Diätetik, Berner Fachhochschule,<br />
Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention, Universität Zürich<br />
1<br />
Im gesamten Beitrag ist mit «Diabetes» Typ 2<br />
Diabetes mellitus gemeint, falls nicht näher<br />
beschrieben.<br />
* Der Artikel erschien ursprünglich in der<br />
«Therapeutischen Umschau» (2020), 77(7),<br />
302–311. mediservice vsao-Mitglieder können<br />
die «Therapeutische Umschau» zu äusserst<br />
günstigen Konditionen abonnieren. Details<br />
s. unter www.hogrefe.ch/downloads/vsao.<br />
Diabetes 1 nimmt weltweit zu.<br />
Alterung der Bevölkerung<br />
aber auch steigende Adipositas-Raten<br />
sind die Haupttreiber.<br />
Neben der körperlichen Aktivität<br />
ist die Er nährung der bedeutendste beeinflussbare<br />
Faktor. Entsprechend wichtig<br />
wären stringente Ernährungsempfehlungen,<br />
um den Krankheitsverlauf bei Diabetespatienten<br />
möglichst positiv beeinflussen<br />
zu können. Diese sind leider nur<br />
bedingt möglich, da ungenügende wissenschaftliche<br />
Evidenz dafür vorliegt: Die<br />
jeweiligen Effekte sind klein, die Signifikanzniveaus<br />
gering, die Resultate heterogen.<br />
Kommt hinzu, dass im Ernährungsbereich<br />
selbst randomisierte kontrollierte<br />
Versuche nur bedingt geeignet sind um<br />
verlässlichere Resultate mit Kausalitätsnachweis<br />
zu generieren [1, 2]. Deshalb<br />
und weil jeder Mensch unterschiedlich<br />
auf eine Ernährungsumstellung reagiert,<br />
sollten unter Berücksichtigung ernährungsphysiologischer<br />
Grundsätze individuelle<br />
Herangehensweisen verfolgt werden.<br />
Folgender Beitrag soll als Grundlage<br />
dazu dienen, indem er Vor- und Nachteile<br />
der wichtigsten Makronährstoffe Kohlenhydrate,<br />
Fette, Eiweisse und Alkohol<br />
zusammenträgt. Obwohl es auch Evidenz<br />
gibt, die für oder gegen einzelne Lebensmittel<br />
spricht, sollte die Ernährung stets<br />
als Ganzes betrachtet werden. Entsprechend<br />
wichtig sind Untersuchungen zu<br />
den Effekten von Ernährungsmustern auf<br />
das Körpergewicht und Diabetesmanagement.<br />
Dabei scheinen Qualität und Verarbeitung<br />
von Produkten mindestens so<br />
wichtig zu sein wie die absoluten Mengen<br />
oder die Verhältnisse der Makronährstoffe.<br />
Für Personen mit Diabetes gelten zudem<br />
die gleichen Kriterien für eine ausgewogene<br />
Ernährung wie für die Allgemeinbevölkerung,<br />
wobei das Vermeiden einer<br />
positiven Energiebilanz noch stärker im<br />
Vordergrund steht.<br />
Kohlenhydrate und<br />
zugesetzte Süssungsmittel<br />
Auch wenn die Evidenz für eine konkrete<br />
Kohlenhydrat-Empfehlung fehlt, spricht<br />
vieles dafür die Zufuhr im Fenster zwischen<br />
45 und 60 Energieprozent vorzusehen<br />
[3]. Bei einem Tagesbedarf von 2000<br />
kcal bedeutet dies ca. 200 bis 300 g / Tag.<br />
Eine kohlenhydratarme Ernährung führt<br />
zwar meist zu einer Verbesserung der<br />
HbA1c-Werte [4, 5]. Bei der Gewichtsreduktion<br />
hat sie aber keine Vorteile gegenüber<br />
anderen Diäten und ist bei der Nachhaltigkeit<br />
einer mediterranen Ernährungsweise<br />
unterlegen [4 – 9]. Eine zu starke<br />
Einschränkung resultiert in einer<br />
übermässigen Zufuhr an Eiweissen oder<br />
Fett. Beides kann je nach Quelle mit einem<br />
erhöhten Sterberisiko assoziiert sein [10].<br />
Zudem fördert eine Low-Carb-Ernährung<br />
eine ketogene Stoffwechsellage, was für<br />
manche Patienten problematisch sein<br />
kann [11]. Low-Carb-Diäten sollten also<br />
Patienten mit Diabetes nicht routinemässig<br />
empfohlen werden [5, 7]. Neben der<br />
Menge entscheidet auch die Art der Kohlenhydrate<br />
über den Krankheitsverlauf.<br />
Bis anhin wurden der Glykämische Index<br />
(GI: «Geschwindigkeit»)) und die Glykämische<br />
Last (GL: «Masse») als Massstäbe<br />
dafür verwendet wie schnell, in welcher<br />
Menge und über welche Dauer Glukose im<br />
Blut erscheint. Einigermassen robuste<br />
Evidenz zeigt, dass ein Ersatz von<br />
hoch-GI-Lebensmitteln durch solche mit<br />
niedrigerem GI Vorteile bringt bei Glukoseparametern,<br />
Diabetesmanagement und<br />
auch das Herz-Kreislauf(HKL)-Risiko<br />
senkt [12 – 15]. Diese generelle Ansicht<br />
muss jedoch insofern revidiert werden, als<br />
der GI eines Lebensmittels sich von<br />
Mensch zu Mensch erheblich unterscheiden<br />
kann. Der in Tabellen angegebene<br />
Wert mag für die Mehrheit stimmen und<br />
in der <strong>No</strong>rmalverteilung den Medianwert<br />
darstellen. Bei manchen Lebensmitteln ist<br />
diese Verteilung der individuellen Blutzuckerantwort<br />
aber breit, was bedeutet, dass<br />
viele Individuen anders als die «<strong>No</strong>rm» reagieren.<br />
So gibt es Menschen, die auf Vollkornbrot<br />
mit einem stärkeren Blutzuckeranstieg<br />
reagieren als auf den Verzehr<br />
von Weissbrot [16, 17].<br />
Da Kohlenhydrate selten isoliert konsumiert<br />
werden, muss deren Konsum immer<br />
auch im Kontext betrachtet werden.<br />
Wenn es eine generelle Empfehlung gibt,<br />
dann die, dass die meisten Kohlenhydratquellen<br />
im Sinne der Diabetesprävention<br />
und der Gewichtskontrolle bessere Eigenschaften<br />
haben, wenn sie nur wenig verarbeitet<br />
sind [18, 19]. Alternativen mit weniger<br />
oder weniger schnell verfügbaren Kohlenhydraten<br />
sind in Tabelle 1 ersichtlich.<br />
Auch wenn Unterschiede im Blutzucker-Verlauf<br />
bescheiden anmuten kön-<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 5/22 39
Perspectives<br />
nen, so haben die faserreichen Alternativen<br />
zusätzliche Vorteile wie bessere Sättigung,<br />
nachhaltigere Gewichtsreduktion<br />
und verringerte Mortalität bei Diabetes-Patienten<br />
[20 – 23]. Hingegen ist unklar,<br />
inwiefern die Bildung von resistenter<br />
Stärke beim Abkühlen von stärkehaltigen<br />
Lebensmitteln zur besseren Blutzuckerkontrolle<br />
bei Diabetespatienten beitragen<br />
kann [24 – 26].<br />
Weltweit sind Getränke eine wichtige<br />
Quelle von zugesetztem Zucker [27]. Regelmässiger<br />
Konsum von zuckergesüssten<br />
Getränken, aber auch von Fruchtsaft ist<br />
mit einem erhöhten Diabetesrisiko verbunden<br />
– teilweise unabhängig vom BMI<br />
[28, 29]. Es ist unwahrscheinlich, dass<br />
Fruchtsäfte und künstlich gesüsste Getränke<br />
gesündere Alternativen zu zuckergesüssten<br />
Varianten sind [28], zumal auch<br />
künstlich gesüsste Getränke mit einem<br />
erhöhten Sterberisiko assoziiert sind [30].<br />
Vor- und Nachteile von Kohlenhydraten in<br />
der Diabetesprävention und -therapie sind<br />
in Tabelle 2 zusammengefasst.<br />
Fette<br />
Aufgrund der fehlenden wissenschaftlichen<br />
Evidenz kann keine Empfehlung für<br />
die Gesamtfettzufuhr gemacht werden.<br />
Tabelle 1. Kohlenhydrate für Diabetes-Patienten: Alternativen zu ungünstigen Quellen.<br />
Für die meisten Diabetes-Patienten ungünstig<br />
Reis<br />
Kartoffeln<br />
Teigwaren<br />
Flakes (Cornflakes, Flakes auf Reisbasis).<br />
Viele «Weizenflakes» bestehen überwiegend aus Reis<br />
Kekse aus Weissmehl<br />
Weissbrot (oder anderes Brot mit Mehl mit<br />
hohem Ausmahlungsgrad)<br />
Fruchtsaft / Gemüsesaft (hat meist Zuckerzusatz)<br />
Entsprechende Alternativen<br />
Reis mit hohem Amylose- und niedrigem Amylopektin-Gehalt;<br />
Vollreis; Reis mit darin verarbeitetem Gemüse oder Nüssen;<br />
Linsen, Kichererbsen, Bohnen, Buchweizen<br />
Süsskartoffeln, Topinambur, Yam, Knollensellerie, Pastinaken,<br />
Petersilienwurzel, Rote Bete (Randen)<br />
«Al dente» kochen, Vollkornvarianten, Teigwaren mit einem Anteil<br />
an Dinkel, Hülsenfrüchten oder Buchweizen<br />
Minimal verarbeitete Getreideflocken, v. a. Haferflocken<br />
Alternativen mit höherem Faser- und einem niedrigeren Zuckeranteil,<br />
aus Hafer oder Dinkel, mit Rosinen oder anderen Trockenfrüchten<br />
zum Süssen<br />
Brot aus Mehl mit niedrigem Ausmahlungsgrad (am hohen Faseranteil<br />
erkennbar) und darin verarbeiteten Nüssen, Kernen und Samen;<br />
Roggenbrot<br />
Unverarbeitete Früchte<br />
Tabelle 2. Vor- und Nachteile von Kohlenhydraten in der Ernährung bei Diabetes mellitus.<br />
Vorteile<br />
+ Der Konsum von komplexen Kohlenhydraten ist mit einem<br />
nied rigeren Krankheitsrisiko assoziiert als der weitgehende<br />
Verzicht darauf.<br />
+ Natürliche Kohlenhydratquellen enthalten Vitamine,<br />
Mineral stoffe, Nahrungsfasern und andere wertvolle Stoffe.<br />
+ Manche Quellen wie Hafer oder Hülsenfrüchte enthalten<br />
Stoffe, die die Zuckeraufnahme und damit die Insulinantwort<br />
verzögern.<br />
+ Insbesondere Glukose und Stärke können von allen Organen<br />
verwertet werden. Sie liefern unter allen Bedingungen optimal<br />
Energie, vor allem beim Sport.<br />
+ In Kombination mit geeigneten Fett- und Eiweissquellen<br />
sorgen Kohlenhydrate für eine gute Sättigung.<br />
Nachteile<br />
– Eine zu hohe Zufuhr an Kohlenhydraten (v. a. raffinierte) ist<br />
mit einem erhöhten Sterberisiko verbunden.<br />
– Kohlenhydrate kommen oft in flüssiger Form vor, etwa in<br />
Süss getränken oder Fruchtsäften, was eine rasche Kalorieneinnahme<br />
begünstigt. Vor allem in Süssgetränken kommen<br />
Zucker zudem als «leere» Kalorien vor, also ohne Mikronährstoffe.<br />
– Flüssige Kohlenhydrate sättigen schlecht und fördern so<br />
Übergewicht.<br />
– Viele Kohlenhydrate sind stark insulinotrop und fördern die<br />
Lipogenese und eine Insulinresistenz.<br />
– Kohlenhydrate sind oft in Produkten «versteckt» in denen sie<br />
nicht erwartet werden und tragen häufig kryptische Namen.<br />
Quintessenz Kohlenhydrate<br />
• Etwa die Hälfte des Energiebedarfs sollte mit Kohlenhydraten gedeckt werden.<br />
• Verschiedene Kohlenhydratquellen haben einen höchst unterschiedlichen Einfluss auf die Blutzuckerregulation.<br />
Dieser Effekt scheint individuell stark zu variieren.<br />
• Generell sind faserreiche, wenig verarbeitete Kohlenhydratquellen raffinierten Produkten vorzuziehen.<br />
• Nicht nur von zuckergesüssten Getränken sollte abgeraten werden. Süss schmeckende Getränke scheinen generell<br />
problematisch, selbst dann, wenn sie keine Kalorien enthalten.<br />
40<br />
5/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
Perspectives<br />
Ähnlich wie bei den Kohlenhydraten sprechen<br />
Studien, die die HKL-Risiken untersucht<br />
haben, jedoch dafür, die Zufuhr zwischen<br />
20 und 35 Energieprozent zu halten.<br />
Eine zu starke Einschränkung der Fettzufuhr<br />
geht meist mit einer Erhöhung der<br />
Kohlenhydrateinnahme einher, was sich<br />
wiederum negativ auf die Blutfette auswirken<br />
kann [31, 32]. Die ungenügende<br />
Evidenzlage erlaubt es auch nicht, Diabetespatienten<br />
eine Empfehlung für gesättigte<br />
Fette abzugeben. Aber auch hier<br />
spricht einiges dafür, den Anteil an gesättigten<br />
Fetten zugunsten ungesättigter auf<br />
10 Energieprozent oder weniger zu reduzieren<br />
[31]. Diese Beschränkung macht<br />
mehr Sinn, wenn das Fett von Fleisch und<br />
Fleischprodukten stammt, weniger, wenn<br />
es von Milchprodukten (v. a. Joghurt)<br />
stammt [32, 33]. Eine Metaanalyse von<br />
RCTs zeigte bei einer Allgemeinbevölke -<br />
rung eine Reduktion des HKL-Risikos von<br />
17 %, wenn die Zufuhr von gesättigten Fetten<br />
von ca. 17 auf 9 Energieprozent verringert<br />
wurde [32]. Entscheidend für den Effekt<br />
einer Reduktion von gesättigten Fetten<br />
ist, womit deren Energie ersetzt wird.<br />
Der stärkste positive Effekt kann erwartet<br />
werden, wenn gesättigte Fette durch einoder<br />
mehrfach ungesättigte Fette ersetzt<br />
werden [34 – 36].<br />
Bei Diabetes-Patienten kann neben<br />
einem verringerten HKL-Risiko auch eine<br />
verbesserte Blutzucker-Kontrolle / Insulinsensitivität<br />
erwartet werden, wenn der<br />
Anteil an ein- und mehrfach ungesättigter<br />
Fettsäuren in der Ernährung zunimmt [36,<br />
37]. Der Typ der ungesättigten Fettsäuren,<br />
die mit der Nahrung aufgenommen werden,<br />
spielt dabei eine untergeordnete Rolle<br />
[33]. Dies sollte jedoch über eine ausgewogene<br />
Ernährung geschehen und nicht<br />
durch Supplemente. Das Supplementieren<br />
mit ungesättigten Fettsäuren pflanzlichen<br />
oder tierischen Ursprungs brachte keine<br />
Vorteile bezüglich Diabetesprävention<br />
oder -therapie und Glukoseparametern,<br />
wie eine RCT-Metaanalyse gezeigt hat.<br />
Fisch öl in hoher Dosierung (> 4.4 g / Tag)<br />
verschlechterte gar den Glukosestoffwechsel<br />
[38]. Auch fehlen Hinweise für<br />
Vorteile bezüglich HKL-Prävention bei<br />
Diabetespatienten durch Fischöl-Supplemente<br />
gegenüber Olivenöl [39, 40]. Wann<br />
und wie der Einsatz von Nahrungsfett im<br />
Management von Diabetes Sinn macht, ist<br />
in Tabelle 3 zusammengestellt.<br />
Eiweisse<br />
Proteine sind vielleicht die zurzeit am<br />
kontroversesten diskutierten Stoffgruppe.<br />
Das mag daran liegen, dass Eiweisse vor<br />
allem kurz- und mittelfristig Vorteile beim<br />
Diabetes- und Adipositasmanagement<br />
bieten, anderseits Organe belasten und<br />
das Erkrankungs- und Sterberisiko erhöhen<br />
könnten. Dies gilt in erster Linie für<br />
eine hohe Zufuhr über Fleisch und Fleischprodukte<br />
[41, 42]. Da auch hier aufgrund<br />
fehlender Evidenz für die optimale Proteinzufuhr<br />
für Diabetespatienten keine<br />
allgemeinen Richtlinien existieren, muss<br />
eine individuelle Herangehensweise gewählt<br />
werden. Für Diabetes-Patienten ohne<br />
Nephro pathie kann eine Zufuhr von<br />
1 – 1.5 g Eiweiss pro Kilo Körpergewicht<br />
(g / kg / d) Sinn machen. Damit decken Eiweisse<br />
ca. 15 – 20 % des Energiebedarfs.<br />
Generell geht der Trend hin zu höheren<br />
Zufuhr-Empfehlungen (1.2 – 1.6 g / kg / d)<br />
mit dem Argument, dies beeinflusse Körperfettanteil<br />
und -verteilung, die glykämische<br />
Kontrolle, postprandiale Thermogenese<br />
und Energiebereitstellung positiv<br />
[43]. Selbst bei diabetischer Nephropathie<br />
wird eine Reduktion unter 0.8 g / kg / d<br />
nicht empfohlen [31, 44, 45]. Allein aufgrund<br />
ihres Alters haben viele Diabetespatienten<br />
ein höheres Risiko für Protein-<br />
Mangelernährung, Sarkopenie und Frailty<br />
(Gebrechlichkeit), welches durch eine zu<br />
starke Eiweisseinschränkung verschärft<br />
wird [46]. Zudem hat eine Reduktion der<br />
Zufuhr unter 0.8 g /kg / d keine Vorteile bezüglich<br />
Glukoseparameter, HKL-Risiko<br />
und Verlauf der glomerulären Filtrationsrate<br />
[31, 44]. Das Beschränken auf diese<br />
Menge konnte bei Diabetespatienten mit<br />
Nephro pathie indes eine vorzeitige termi-<br />
Tabelle 3. Vor- und Nachteile von Fetten in der Ernährung bei Diabetes mellitus.<br />
Vorteile<br />
+ Lange Magenverweildauer. Verbessert dadurch Sättigungseigenschaften<br />
und verzögert die Glukose- und Insulinantwort<br />
im Blut von stärkereichen Mahlzeiten.<br />
+ Alleine genossen, lässt Fett den Insulinspiegel praktisch<br />
unbeeinflusst.<br />
+ Viele fettreiche Produkte wie Milchprodukte oder Nüsse sind<br />
auch gute Eiweissquellen.<br />
+ V.a. ungesättigte Fette haben einen geringeren Einfluss auf<br />
Blutfett- und -zuckerwerte als Kohlenhydrate.<br />
+ Gewisse pflanzliche Öle wie Olivenöl enthalten Stoffe, die<br />
sättigen, die postprandiale Fettoxidation und die Thermogenese<br />
fördern.<br />
Nachteile<br />
– Hohe Kaloriendichte, geringes Volumen, keine Nahrungsfasern,<br />
niedriger Wasseranteil in fettreichen Lebensmitteln.<br />
Sehr fette Speisen sättigen deshalb im Verhältnis zu den<br />
enthaltenen Kalorien nur mässig.<br />
– Fette kommen oft versteckt vor. Vor allem minderwertige<br />
Fette sind billig und häufig in verarbeiteten Produkten wie<br />
Frittiertem und Paniertem zu finden.<br />
– Der Körper kann Fette komplett verwerten und gut speichern.<br />
Geringste Thermogenese unter den Makronährstoffen.<br />
Quintessenz Fette<br />
• Einschränkung bei der Zufuhr: Fettqualität ist wichtiger als Fettmenge.<br />
• Ersatz von gesättigten durch ein- oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren bringt Vorteile bei Blutzuckerkontrolle und HKL-Risiko.<br />
• Bei gesättigten Fetten tierischen Ursprungs macht es mehr Sinn, bei Fetten aus Fleisch(-produkten) zu reduzieren als bei Fetten<br />
aus Milchprodukten.<br />
• Transfettsäuren kommen in verarbeiteten Produkten per Gesetz nur noch in geringen Mengen vor (< 2 g / 100 g Fett).<br />
Sie können aber beim Zubereiten entstehen.<br />
• Für das Meiden von Omega-6 Fettsäure-Quellen zugunsten von Omega-3 fehlt die Evidenz.<br />
• Omega-3-Fettsäure-Supplemente tierischen oder pflanzlichen Ursprungs bringen keine Vorteile.<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 5/22 41
Perspectives<br />
nale Niereninsuffizienz hinauszögern und<br />
die Mortalität verringern [42], sowie Albuminurie<br />
und HbA1c verbessern [47].<br />
Eiweisse sind bezüglich ihrer Wirkung<br />
wahrscheinlich noch heterogener<br />
als die anderen Makronährstoffe. Dies<br />
betrifft neben dem Effekt auf Mortalität<br />
und Morbidität auch die unmittelbare<br />
Insulinausschüttung nach Ein nahme, die<br />
30 % und mehr der von Glukose entsprechen<br />
kann [43]. Auch die postprandiale<br />
Thermoge nese und Ausschüttung von<br />
Sättigungshormonen, die Magenentleerungsrate<br />
sowie die Stimulation der<br />
Muskelproteinsyn these hängt von der<br />
Zusammensetzung der Aminosäuren ab.<br />
Eine besondere Rolle scheint hierbei der<br />
Gehalt an Leucin zu spielen, welches in<br />
Molke (Whey) in höchster Konzentration<br />
vorkommt. Leucin fungiert als «Triggersubstanz»<br />
für viele der postulierten Mechanismen<br />
[43, 48]. Eine Zusammenfassung<br />
der Vor- und Nachteile von Eiweiss<br />
in Diabetesprävention und -therapie<br />
bietet Tabelle 4.<br />
Alkohol<br />
Obwohl moderater Alkoholkonsum mit einem<br />
niedrigeren Diabetes-Risiko verbunden<br />
ist, muss die Einnahme stets gut abgewogen<br />
und kontrolliert werden, zumal der<br />
Zusammenhang J-förmig ist, mit einem<br />
Anstieg des Risikos ab ca. 30 g Alkohol<br />
/ Tag. Selbst geringer Konsum (1 – 2 Getränke<br />
täglich à 10 g Alkohol) birgt Gesundheitsrisiken<br />
und bringt unter dem<br />
Zusammenfassung<br />
Was für die Allgemeinbevölkerung als ausgewogene Ernährung angeschaut wird, gilt im<br />
Grundsatz auch für Personen mit Diabetes. Die dürftige wissenschaftliche Evidenzlage<br />
rechtfertigt keine dogmatische Haltung mit strikten Ge- und Verboten von Nährstoffen<br />
oder Lebensmitteln. Vielmehr sind in einer ausgewogenen Ernährung alle Makronährstoffgruppen<br />
vertreten, wobei eine Reduktion der Kalorienzufuhr gleichermassen erfolgreich<br />
über Kohlenhydrate oder Fette passieren kann. Ideal sind Produkte hoher Qualität<br />
sowie mit geringer und schonender Verarbeitung wie faserreiche Stärkeprodukte und<br />
kaltgepresste pflanzliche Öle. Der Nutzen einer erhöhten Proteinzufuhr bezüglich Diabetesmanagement<br />
und Gewichtskontrolle kristallisiert sich zunehmend. Als Quellen sollten<br />
jedoch eher pflanzliche oder Milchprodukte herangezogen werden als rotes oder<br />
verarbeitetes Fleisch. Die mediterrane Ernährungsweise und Konzepte mit vergleichbarem<br />
wissenschaftlichem Fundament erfüllen am ehesten die Kriterien einer «geeigneten»<br />
Ernährung für Diabetespatienten. Obwohl Alkohol dicht ist an leeren Kalorien,<br />
spricht nichts dagegen, den Genuss darin eingebettet zu tolerieren. Angesichts der individuell<br />
unterschiedlichen Stoffwechselreaktion auf gleiche Lebensmittel und unter<br />
Berücksichtigung der dürftigen Beweislage ist eine personalisierte Herangehensweise<br />
angebrachter denn je.<br />
Abstract: Which diet is appropriate for patients with<br />
diabetes mellitus?<br />
What is considered a balanced diet for the general population is in principle also true<br />
for people with diabetes. The scarce scientific evidence does not justify a dogmatic<br />
attitude with strict rules and bans on nutrients or foods. Rather, all macronutrient<br />
groups are represented in a balanced diet, whereby a reduction in calorie intake can be<br />
equally successful via carbohydrates or fats. Ideal are products of high quality and with<br />
low and gentle processing, such as starch products rich in fibre and cold-pressed vegetable<br />
oils. The benefits of increased protein intake in terms of diabetes management and<br />
weight control are becoming increasingly clear. However, plant-based or dairy products<br />
should be used as sources rather than red or processed meat. The Mediterranean diet<br />
and concepts with a comparable scientific basis are most likely to meet the criteria of a<br />
“suitable” diet for diabetes patients. Although alcohol is dense with empty calories,<br />
there is no reason not to tolerate the consumption embedded in such a diet. In view of<br />
the individually different metabolic reactions to the same foods and taking into account<br />
the scarce evidence, a personalised approach is more appropriate than ever.<br />
Tabelle 4. Vor- und Nachteile von Eiweiss in der Ernährung bei Diabetes mellitus.<br />
Vorteile<br />
+ Eiweisszufuhr durch pflanzliche Quellen und teilweise<br />
auch über Milchprodukte und weisses Fleisch und Fisch ist<br />
tendenziell mit einem reduzierten Sterberisiko verbunden<br />
+ Eiweisse bewirken einen deutlich geringeren Insulinanstieg<br />
als Kohlenhydrate und schneiden auch bezüglich Thermogenese,<br />
Sättigungsparameter, Gewichtskontrolle, NAFLD / NASH besser ab<br />
+ V.a. Molkeprotein eignet sich gut um – zusammen mit<br />
Widerstandstraining – den Verlust von Muskelmasse zu verlangsamen<br />
+ Ein Teil der Energie aus Eiweissen geht in Form von Harnstoff<br />
mit dem Urin «verloren»<br />
+ Umwandlung in Glukose und Fett ist aufwändig und ineffizient<br />
Nachteile<br />
– Mögliche Erhöhung des Diabetesrisikos und der<br />
Mortalität, v. a. bei Zufuhr an rotem Fleisch und<br />
daraus hergestellten Produkten.<br />
– Rein tierische Quellen liefern keine Fasern<br />
– Stickstoff kann bei Vulnerablen Leber und Nieren<br />
belasten<br />
– Insulinotrope Wirkung muss je nach Quelle<br />
berücksichtigt werden<br />
Quintessenz Eiweisse<br />
• Die Zufuhr sollte 0.8 g / kg / d nicht unterschreiten, selbst bei Vorliegen einer Nephropathie.<br />
• Hinweise für Vorteile einer höheren Zufuhr (1.2 – 1.6 g / kg / d) bei normaler Nierenfunktion verdichten sich.<br />
• Rotes Fleisch und verarbeitetes Fleisch sollten gemieden werden zugunsten von wenig verarbeiteten pflanzlichen Quellen<br />
(Hülsenfrüchte inkl. Soja, Nüsse, Samen, Kerne, eiweissreiche Stärkebeilagen) und ungesüssten Milchprodukten.<br />
• Leucin-reiche Eiweissquellen wie Molke und andere Milchprodukte haben besondere positive Eigenschaften bezüglich<br />
Gewichtskontrolle und Muskelerhalt, beeinflussen den Insulinspiegel aber auch stärker.<br />
42<br />
5/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
Perspectives<br />
Strich keine Vorteile bei der Gesamtmortalität<br />
[49 – 52]. Alkohol erzeugt über den<br />
Energieüberschuss eine Hemmung der<br />
Glukoneogenese und verbessert aufgrund<br />
vermehrter Ausschüttung von Adiponektin<br />
die Insulinsensitivität [51]. Dadurch<br />
kann bei moderater Einnahme (1 Getränk<br />
für Frauen, 2 für Männer) mit geringfügig<br />
verbesserten Nüchternblutzucker- und<br />
HbA1c-Werten gerechnet werden [53, 54].<br />
Allerdings birgt Alkoholkonsum bei Diabetespatienten<br />
auch das Risiko von verzögerten<br />
Hypoglykämien [53, 55, 56]. Die<br />
gleichzeitige Einnahme einer Mahlzeit<br />
verringert dieses Risiko und zudem auch<br />
die Wahrscheinlichkeit, dass der Alkoholkonsum<br />
mit dem metabolischen Syndrom<br />
assoziiert ist [57, 58]. Weitere Hin weise,<br />
wie das Risiko von Alkoholkonsum bei<br />
Diabetes-Pat ienten minimiert werden<br />
kann, stehen in Kasten 1. Weinkonsum<br />
war mit einer doppelt so starken Reduktion<br />
der Diabetesinzidenz verbunden und<br />
korrelierte auch weniger mit dem metabolischen<br />
Syndrom verglichen mit Bierkonsum.<br />
Ob der Getränketyp aber tatsächlich<br />
einen kausalen Effekt auf das Risiko hat<br />
oder lediglich eine Folge von bias und residual<br />
confounding ist, bleibt ungeklärt [52,<br />
58]. Argumente, die für und gegen das Tolerieren<br />
von Alkoholkonsum sprechen,<br />
sind in Tabelle 5 aufgelistet.<br />
Ausgesuchte Lebensmittel<br />
Die Untersuchung des Effekts von einzelnen<br />
Lebensmitteln auf Risiko und Verlauf<br />
von Diabetes ist grundsätzlich problematisch,<br />
da Menschen stets eine Kombination<br />
davon konsumieren. Kommt hinzu,<br />
dass die Evidenzlage lückenhaft und<br />
schwach ist. Deshalb sollten Empfehlungen<br />
für oder gegen ein Lebensmittel mit<br />
entsprechenden Alternativen individuell<br />
und vorsichtig formuliert werden. Die Tabelle<br />
6 soll dabei helfen.<br />
Ernährungsweisen<br />
Die Autoren einer Studie, die die Effizienz<br />
unterschiedlicher Ernährungsansätze<br />
Tabelle 5. Vor- und Nachteile von Alkohol in der Ernährung bei Diabetes mellitus.<br />
Vorteile<br />
+ Eiweisszufuhr Moderater Konsum ist mit einem geringeren<br />
Risiko für Herzinfarkt und Diabetes verbunden<br />
+ Erhöht das HDL-Cholesterin und Adiponektin und verringert<br />
Gerinnungsneigung über die Hemmung von Fibrinogen<br />
+ Moderater Konsum kann Blutzucker und HbA1c geringfügig<br />
senken<br />
Nachteile<br />
– Hat eine hohe Dichte an Kalorien (rund 7 kcal / g)<br />
– Viele alkoholische Getränke enthalten auch Zucker<br />
– Kann Appetit anregen und Essverhalten verschlechtern<br />
und erhöht damit das Risiko für Übergewicht<br />
– Beeinflusst Blutzuckerspiegel. Risiko für Hypoglykämien<br />
v. a. bei Typ 1 Diabetes und unter Einnahme gewisser oraler<br />
Antidiabetika (Sulfonylharnstoffe, Inkretine)<br />
– Kann eine Fettleber verstärken<br />
– Erhöht ab ca. 2 Standardgetränken am Tag den Blutdruck<br />
– Erhöht das Risiko für Hirnschlag, manche Krebsarten,<br />
psychiatrische Erkrankungen<br />
– Entwässert<br />
– Verschlechtert Compliance and Adhärenz an positive<br />
Lebensstilveränderungen<br />
Quintessenz Alkohol<br />
• Selbst bei moderatem Konsum bleibt die Einnahme von Alkohol eine Risikoabwägung.<br />
• Bei sonst unauffälligem Risikoprofil kann moderater Konsum aufgrund möglicher positiver Eigenschaften toleriert werden.<br />
• Dann sollten alkoholische Getränke zusammen mit einer ausgewogenen Mahlzeit konsumiert werden.<br />
• Getränke enthalten viele schlecht sättigende Kalorien und erhöhen dadurch das Adipositasrisiko.<br />
• Ob Wein tatsächlich Vorteile gegenüber Bier und Spirituosen hat, kann nicht restlos bestätigt werden.<br />
Kasten 1. Hinweise und Tipps, um alkoholbedingte Risiken bei Patienten mit Diabetes mellitus zu minimieren.<br />
• Menge limitieren auf 1 Standardgetränk für Frauen<br />
und 2 für Männer.<br />
• Nur innerhalb von ausgewogenen Hauptmahlzeiten<br />
konsumieren, nicht nüchtern. Langsamer Konsum.<br />
• Vorsicht mit Alkoholkonsum bei Problemen mit<br />
Hypoglykämien.<br />
• Auf Alkohol-Medikamenten-Interaktionen achten.<br />
• Wasser zu alkoholischen Getränken trinken, um die Trinkmenge<br />
zu senken und Dehydratation vorzubeugen.<br />
• Schorlegetränke und «gespritzte» Getränke vorziehen.<br />
• Auf Zuckergehalt von alkoholischen Getränken achten.<br />
Herstellerangaben wie «Extra Dry», «Brut» oder «Sec» bei<br />
(Schaum)wein sind irreführend, da solche Getränke immer<br />
noch beträchtliche Mengen an Zucker enthalten können.<br />
Hersteller müssen keine Angaben zum Zuckergehalt<br />
machen, weshalb Interessierte im Internet danach suchen<br />
müssen.<br />
• Varianten mit tiefem Alkoholgehalt (z. B. alkoholarmes<br />
/-freies Bier, Clairette) enthalten oft sehr viel Zucker.<br />
• Bei Alternativen wie alkoholfreien Sekt oder alkoholfreies<br />
Bier auf den Zucker- und Kaloriengehalt achten. Bei<br />
Nichtangabe des Herstellers sind die Information oft im<br />
Internet auffindbar.<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 5/22 43
Perspectives<br />
Tabelle 6. Zusammenhang zwischen dem Konsum ausgesuchter Lebensmittel und Risiko / Verlauf von Diabetes mit entsprechenden Implikationen.<br />
Lebensmittel Eigenschaften / Evidenz Implikation für Diabetes Ref.<br />
Kaffee<br />
Koffein erhöht akut den Nüchtern- und<br />
postprandialen Blutzucker. Längerfristig sind<br />
die Effekte aber eher positiv. Kaffeekonsum ist<br />
dosisabhängig mit einem erniedrigten<br />
Diabetesrisiko verbunden.<br />
Der Konsum von 4 – 5 Tassen Kaffee<br />
am Tag hat wahrscheinlich eher<br />
Vor- als Nachteile.<br />
[59 – 62]<br />
Früchte & Gemüse<br />
Früchte- und Gemüsekonsum ist mit einem<br />
geringfügig kleineren Diabetesrisiko assoziiert.<br />
Beim Gemüse ist der Zusammenhang + / –<br />
linear, bei Früchten U-förmig mit dem<br />
niedrigsten Risiko bei ca. 2 Portionen / Tag.<br />
Empfehlung für täglichen Konsum<br />
von 3 Portionen Gemüse und 2<br />
Portionen Früchte.<br />
[63, 64]<br />
Nüsse & Hülsenfrüchte<br />
Nusskonsum ist teilweise mit einem erniedrigten<br />
Diabetesrisiko verbunden, für Hülsenfrüchte<br />
ist die Evidenz schwächer. Für beide<br />
ist die Studienlage inkonsistent.<br />
Täglich eine Portion (30 g) unverarbeitete<br />
Nüsse auch für Personen<br />
mit Übergewicht, da die Evidenz<br />
für eine Senkung des HKL-Risikos<br />
eher gegeben ist.<br />
[65 – 67]<br />
Fasern / Vollkornprodukte<br />
Einnahme von Nahrungsfasern ist mit einer<br />
geringeren Diabetesinzidenz und bei Diabetespatienten<br />
mit niedriger Mortalität verbunden.<br />
Der Effekt auf Blutzuckerparameter ist aber<br />
gering und inkonsistent.<br />
Personen mit Diabetesrisiko und<br />
Diabetespatienten sollten wenn<br />
immer möglich die Vollkornalternative<br />
wählen.<br />
[21, 68 – 70]<br />
Brot<br />
Brotkonsum ist nicht mit einem erhöhten<br />
Diabetes risiko assoziiert. Sauerteig-/Roggenbrot<br />
und manche Vollkornvarianten bieten<br />
möglicherweise Vorteile bez. Blutzuckerantwort<br />
gegenüber Weissbrot.<br />
Keine generelle Einschränkung<br />
beim Brot nötig. Roggen- / Vollkornbrot<br />
vorziehen.<br />
[71 – 73]<br />
Reis<br />
Konsum von weissem Reis korreliert mit<br />
einem erhöhten Diabetesrisiko. Ersatz von<br />
weissem durch braunen Reis mit Risikosenkung<br />
verbunden.<br />
Einsatz von Alternativen zu<br />
weissem Reis (z. B. brauner Reis,<br />
Quinoa, Buchweizen, Linsen)<br />
macht wahrscheinlich Sinn.<br />
[74 – 77]<br />
Pasta<br />
Pastakonsum hat bei Personen mit und ohne<br />
Diabetes signifikant geringeren Blutzuckeranstieg<br />
zur Folge als der Konsum von Kartoffeln<br />
oder Brot und ist mit geringerem Adipositasrisiko<br />
verbunden.<br />
Es gibt keinen Grund vom Pastakonsum<br />
abzuraten, solange die<br />
Kohlenhydrat zufuhr die Empfehlung<br />
nicht übersteigt.<br />
[78 – 81]<br />
Kartoffeln<br />
Verzehr ist konsistent mit erheblich erhöhtem<br />
Diabetesrisiko verbunden (v. a. Pommes<br />
Frites). Ersatz von Kartoffeln durch Vollkornprodukte<br />
senkt Risiko.<br />
Von häufigem Konsum (fast täglich)<br />
von Kartoffeln sollte eher abgeraten<br />
werden (v. a. von Pommes Frites).<br />
Faserreiche Stärkeprodukte<br />
vorziehen.<br />
[82 – 84]<br />
(Low-Fat, Vegetarisch, Mediterran, High-<br />
Protein, Moderate-Carb, Low-Carb, Control,<br />
Low GI / GL, Paleo) bei Diabetespatienten<br />
miteinander verglich, kam zum<br />
Schluss, dass die mediterrane Ernährungsweise<br />
am besten geeignet ist um den<br />
Blutzucker zu kontrollieren [106]. Es ist<br />
aber davon auszugehen, dass Ernährungsweisen,<br />
die ähnlich aufgebaut sind<br />
wie diese, wie z. B. DASH, vergleichbar gut<br />
geeignet sind [31, 107, 108]. Mithilfe der<br />
mediterranen Ernährungsweise konnte<br />
auch eine nachhaltigere Gewichtsreduktion<br />
erzielt werden als mit einer Low-Carb<br />
oder einer Low-Fat-Diät [9]. Die Adhärenz<br />
an eine mediterrane Ernährungsweise<br />
kann relativ einfach mit einem validierten<br />
Schnellfragebogen erfasst werden<br />
[109]. Ein entsprechendes Tellermodell<br />
für eine möglichst praxisnahe Verwendung<br />
ist ebenfalls verfügbar [110]. Als potenziell<br />
vielversprechend, um das Körpergewicht,<br />
Glukose- und Insulinparameter<br />
bei Allgemeinbevölkerungen positiv zu<br />
beeinflussen hat sich das Intervallfasten<br />
(intermittierendes Fasten) erwiesen [111].<br />
Für eine breite Anwendung bei Diabetes-Patienten<br />
fehlen allerdings noch aussagekräftige<br />
Studien [112].<br />
Prof. Dr. med. David Fäh, MPH<br />
Berner Fachhochschule<br />
Departement Gesundheit<br />
Ernährung und Diätetik<br />
Finkenhubelweg 11<br />
3008 Bern<br />
david.faeh@bfh.ch<br />
44<br />
5/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
Perspectives<br />
Lebensmittel Eigenschaften / Evidenz Implikation für Diabetes Ref.<br />
Milch & Milchprodukte<br />
Erhöhung des Konsums ist mit einer Senkung<br />
des Diabetesrisikos verbunden. Einige Studien<br />
fanden Vorteile von Joghurt und fettreduzierten<br />
Produkten, manche keinen oder einen<br />
negativen Effekt von anderen Milchprodukten<br />
wie Milch oder Käse.<br />
Der regelmässige Konsum von<br />
zucker armen Milchprodukten wie<br />
Nature- Joghurt kann empfohlen<br />
werden.<br />
[85 – 89]<br />
Fleisch<br />
Konsum von rotem und v. a. verarbeitetem<br />
Fleisch, teilweise aber auch von Poulet und<br />
Fisch ist mit einem erhöhten Diabetesrisiko<br />
assoziiert.<br />
Starke Konsumenten von rotem<br />
/ verarbeitetem Fleisch sollten<br />
ihren Protein bedarf teilweise durch<br />
pflanzliche Quellen und Milchprodukte<br />
decken.<br />
[90 – 93]<br />
Vitamin- & andere<br />
Supplemente<br />
Es gibt keine überzeugende Evidenz für<br />
Gesundheitsvorteile bei Diabetespatienten<br />
durch Supplementierung mit Chrom, Magnesium,<br />
Zink, Vitamin D sowie durch Zimt und<br />
ähnliche Produkte.<br />
Mit Ausnahme von spezifischen<br />
Situationen (z. B. Zöliakie, Schwangerschaft,<br />
Veganismus, Metformintherapie)<br />
ist eine Supplementierung<br />
nicht angebracht. Von längerfristiger<br />
Supplementierung mit<br />
Vitamin E und A / Betacarotin sollte<br />
abgeraten werden.<br />
[31,<br />
94 – 102]<br />
Salz<br />
Hohe, aber auch niedrige Urin-Natriumausscheidung<br />
war bei Diabetespatienten mit<br />
erhöhter (HKL-)mortalität verbunden.<br />
Die aktuelle Evidenzlage erlaubt<br />
keine Schlussfolgerung / Empfehlung.<br />
[103 – 105]<br />
Literatur<br />
[1] Ioannidis JPA. The challenge<br />
of reforming nutritional<br />
epidemiologic research. JAMA.<br />
2018; 320: 969 – 70. https://doi.<br />
org/10.1001/jama.2018.11025<br />
[2] Hébert JR, Frongillo EA,<br />
Adams SA, Turner-McGrievy GM,<br />
Hurley TG, Miller DR, et al.<br />
Perspective: Randomized<br />
Controlled Trials Are <strong>No</strong>t a<br />
Panacea for Diet-Related Research.<br />
Adv Nutr. 2016; 7: 423 – 32. https://<br />
doi.org/10.3945/an.115.<br />
011023<br />
[3] Seidelmann SB, Claggett<br />
B, Cheng S, Henglin M, Shah A,<br />
Steffen LM, et al. Dietary<br />
carbohydrate intake and mortality:<br />
a prospective cohort study and<br />
meta-analysis. Lancet Public<br />
Health. 2018; 3: e419 – 28. https://<br />
doi.org/10.1016/S2468-<br />
2667(18)30135-X<br />
[4] Kirk JK, Graves DE,<br />
Craven TE, Lipkin EW, Austin M,<br />
Margolis KL. Restricted-Carbohydrate<br />
Diets in Patients with Type 2<br />
Diabetes: A Meta-Analysis. J Am<br />
Diet Assoc. 2008; 108: 91 – 100.<br />
https://doi.org/10.1016/j.<br />
jada.2007.10.003<br />
[5] Dyson P. Low Carbohydrate<br />
Diets and Type 2 Diabetes:<br />
What is the Latest Evidence?<br />
Diabetes Ther. 2015; 6: 411 – 24.<br />
https://doi.org/10.1007/s13300-015-<br />
0136-9<br />
[6] Johnston BC, Kanters S,<br />
Bandayrel K, Wu P, Naji F,<br />
Siemieniuk RA, et al. Comparison<br />
of weight loss among named diet<br />
programs in overweight and obese<br />
adults: A meta-analysis. JAMA.<br />
2014; 312: 923 – 33. https://doi.<br />
org/10.1001/jama.<br />
2014.10397<br />
[7] van Wyk HJ, Davis RE,<br />
Davies JS. A critical review of<br />
low-carbohydrate diets in people<br />
with Type 2 diabetes. Diabet Med.<br />
2016; 33: 148 – 57. https://doi.<br />
org/10.1111/dme.12964<br />
[8] Shai I, Schwarzfuchs D,<br />
Henkin Y, Shahar DR, Witkow S,<br />
Greenberg I, et al. Weight Loss with<br />
a Low-Carbohydrate, Mediterranean,<br />
or Low-Fat Diet. N Engl J<br />
Med. 2008; 359: 229 – 41. https://<br />
doi.org/10.1056/NEJMoa0708681<br />
[9] Schwarzfuchs D, Golan<br />
R, Shai I. Four-Year Follow-up after<br />
Two-Year Dietary Interventions. N<br />
Engl J Med. 2012; 367: 1373 – 4.<br />
https://doi.org/10.1056/NE-<br />
JMc1204792<br />
[10] Mazidi M, Katsiki N,<br />
Mikhailidis DP, Sattar N, Banach<br />
M. Lower carbohydrate diets and<br />
all-cause and cause-specific<br />
mortality: a population-based<br />
cohort study and pooling of<br />
prospective studies. Eur Heart J.<br />
2019; 40: 2870 – 9.<br />
https://doi.org/10.1093/eurheartj/<br />
ehz174<br />
[11] Yabe D, Iwasaki M,<br />
Kuwata H, Haraguchi T,<br />
Hamamoto Y, Kurose T, et al.<br />
Sodium-glucose co-transporter-2<br />
inhibitor use and dietary<br />
carbohydrate intake in Japanese<br />
individuals with type 2 diabetes: A<br />
randomized, open-label, 3-arm<br />
parallel comparative, exploratory<br />
study. Diabetes, Obes Metab. 2017;<br />
19: 739 – 43. https://doi.org/10.1111/<br />
dom.12848<br />
[12] Opperman AM, Venter<br />
CS, Oosthuizen W, Thompson RL,<br />
Vorster HH. Meta-analysis of the<br />
health effects of using the<br />
glycaemic index in meal-planning.<br />
Br J Nutr. 2004; 92: 367 – 81. https://<br />
doi.org/10.1079/bjn20041203<br />
[13] Goff LM, Cowland DE,<br />
Hooper L, Frost GS. Low glycaemic<br />
index diets and blood lipids: A<br />
systematic review and meta-analysis<br />
of randomised controlled trials.<br />
Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2013;<br />
23: 1 – 10. https://doi.org/10.1016/j.<br />
numecd.<br />
2012.06.002<br />
[14] Ajala O, English P,<br />
Pinkney J. Systematic review and<br />
meta-analysis of different dietary<br />
approaches to the management of<br />
type 2 diabetes1 – 3. Am J Clin Nutr.<br />
2013; 97: 505 – 16.<br />
https://doi.org/10.3945/<br />
ajcn.112.042457<br />
[15] Ojo O, Ojo OO,<br />
Adebowale F, Wang XH. The Effect<br />
of Dietary Glycaemic Index on<br />
Glycaemia in Patients with Type 2<br />
Diabetes: A Systematic Review and<br />
Meta-Analysis of Randomized<br />
Controlled Trials. Nutrients. 2018;<br />
10: 373. https://doi.org/10.3390/<br />
nu10030373<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 5/22 45
Perspectives<br />
Literatur (Fortsetzung)<br />
[16] Korem T, Zeevi D,<br />
Zmora N, Weissbrod O, Bar N,<br />
Lotan-Pompan M, et al. Bread<br />
Affects Clinical Parameters and<br />
Induces Gut Microbiome-Associated<br />
Personal Glycemic Responses.<br />
Cell Metab. 2017; 25: 1243 – 1253.e5.<br />
https://doi.org/<br />
10.1016/j.cmet.2017.05.002<br />
[23] Burger KNJ, Beulens<br />
JWJ, van der Schouw YT, Sluijs I,<br />
Spijkerman AMW, Sluik D, et al.<br />
Dietary Fiber, Carbohydrate<br />
Quality and Quantity, and<br />
Mortality Risk of Individuals with<br />
Diabetes Mellitus. PLoS One. 2012;<br />
7: e43127. https://doi.org/10.1371/<br />
journal.pone.0043127<br />
[30] Mullee A, Romaguera D,<br />
Pearson-Stuttard J, Viallon V,<br />
Stepien M, Freisling H, et al.<br />
Association between Soft Drink<br />
Consumption and Mortality in 10<br />
European Countries. JAMA Intern<br />
Med. 2019; 179: 1479 – 90. https://<br />
doi.org/10.1001/jamainternmed.2019.2478<br />
[37] Brehm BJ, Lattin BL,<br />
Summer SS, Boback JA, Gilchrist<br />
GM, Jandacek RJ, et al. One-year<br />
comparison of a high-monounsaturated<br />
fat diet with a high-carbohydrate<br />
diet in type 2 diabetes.<br />
Diabetes Care. 2009; 32: 215 – 20.<br />
https://doi.org/<br />
10.2337/dc08-0687<br />
[17] Zeevi D, Korem T,<br />
Zmora N, Israeli D, Rothschild D,<br />
Weinberger A, et al. Personalized<br />
Nutrition by Prediction of<br />
Glycemic Responses. Cell. 2015;<br />
163: 1079 – 94. https://doi.org/10.<br />
1016/j.cell.2015.11.001<br />
[18] Srour B, Fezeu LK,<br />
Kesse-Guyot E, Allès B, Debras C,<br />
Druesne-Pecollo N, et al.<br />
Ultraprocessed Food Consumption<br />
and Risk of Type 2 Diabetes among<br />
Participants of the NutriNet-Santé<br />
Prospective Cohort. JAMA Intern<br />
Med. 2020; 180: 283 – 91. https://doi.<br />
org/10.1001/jamainternmed.2019.5942<br />
[19] Hall KD, Ayuketah A,<br />
Brychta R, Walter PJ, Yang S, Zhou<br />
M. Clinical and Translational<br />
Report Ultra-Processed Diets<br />
Cause Excess Calorie Intake and<br />
Weight Gain: An Inpatient<br />
Randomized Controlled Trial of Ad<br />
Libitum Food Intake. Cell Metab.<br />
2019; 30: 67 – 77. https://doi.<br />
org/10.1016/j.cmet.<br />
2019.05.008<br />
[20] Jenkins DJA, Kendall<br />
CWC, Augustin LSA, Mitchell S,<br />
Sahye-Pudaruth S, Blanco Mejia S,<br />
et al. Effect of legumes as part of a<br />
low glycemic index diet on<br />
glycemic control and cardiovascular<br />
risk factors in type 2 diabetes<br />
mellitus: A randomized controlled<br />
trial. Arch Intern Med. 2012; 172:<br />
1653 – 60.<br />
https://doi.org/10.1001/2013.<br />
jamainternmed.70<br />
[21] McRae MP. Dietary<br />
Fiber Intake and Type 2 Diabetes<br />
Mellitus: An Umbrella Review of<br />
Meta-analyses. J Chiropr Med.<br />
2018; 17: 44 – 53. https://doi.<br />
org/10.1016/j.jcm.2017.11.002<br />
[22] He M, van Dam RM,<br />
Rimm E, Hu FB, Qi L. Whole-grain,<br />
cereal fiber, bran, and germ intake<br />
and the risks of all-cause and<br />
cardiovascular disease-specific<br />
mortality among women with type<br />
2 diabetes mellitus. Circulation.<br />
2010; 121: 2162 – 8. https://doi.<br />
org/10.1161/CIRCULATION-<br />
AHA.109.907360<br />
[24] Liljeberg Elmståhl H.<br />
Resistant starch content in a<br />
selection of starchy foods on the<br />
Swedish market. Eur J Clin Nutr.<br />
2002; 56: 500 – 5. https://doi.<br />
org/10.1038/sj.ejcn.1601338<br />
[25] Chiu YT, Stewart ML.<br />
Effect of variety and cooking<br />
method on resistant starch content<br />
of white rice and subsequent<br />
postprandial glucose response and<br />
appetite in humans. Asia Pac J Clin<br />
Nutr. 2013; 22: 372 – 9. https://doi.<br />
org/10.6133/apjcn.2013.22.3.08<br />
[26] Bodinham CL, Smith L,<br />
Thomas EL, Bell JD, Swann JR,<br />
Costabile A, et al. Efficacy of<br />
increased resistant starch<br />
consumption in human type 2<br />
diabetes. Endocr Connect. 2014; 3:<br />
75 – 84. https://doi.org/10.1530/<br />
ec-14-0036<br />
[27] von Philipsborn P,<br />
Stratil JM, Burns J, Busert LK,<br />
Pfadenhauer LM, Polus S, et al.<br />
Environmental interventions to<br />
reduce the consumption of<br />
sugar-sweetened beverages and<br />
their effects on health. Cochrane<br />
Database Syst Rev. 2019; 2019 (6):<br />
CD012292. https://doi.<br />
org/10.1002/14651858.CD012292.<br />
pub2<br />
[28] Imamura F, O›Connor L,<br />
Ye Z, Mursu J, Hayashino Y,<br />
Bhupathiraju SN, et al. Consumption<br />
of sugar sweetened beverages,<br />
artificially sweetened beverages,<br />
and fruit juice and incidence of<br />
type 2 diabetes: Systematic review,<br />
meta-analysis, and estimation of<br />
population attributable fraction.<br />
BMJ. 2015; 351: h3576. https://doi.<br />
org/10.1136/bmj.h3576<br />
[29] Xi B, Li S, Liu Z, Tian H,<br />
Yin X, Huai P, et al. Intake of fruit<br />
juice and incidence of type 2<br />
diabetes: A systematic review and<br />
meta-analysis. PLoS One. 2014; 9:<br />
e93471. https://doi.org/<br />
10.1371/journal.pone.0093471<br />
[31] Evert AB, Dennison M,<br />
Gardner CD, Timothy Garvey W,<br />
Karen Lau KH, MacLeod J, et al.<br />
Nutrition therapy for adults with<br />
diabetes or prediabetes: A<br />
consensus report. Diabetes Care.<br />
2019; 42: 731 – 54. https://doi.<br />
org/10.2337/dci19-0014<br />
[32] Hooper L, Martin N,<br />
Abdelhamid A, Davey Smith G.<br />
Reduction in saturated fat intake<br />
for cardiovascular disease.<br />
Cochrane Database Syst Rev. 2015;<br />
2015: CD011737. https://doi.org/<br />
10.1002/14651858.CD011737<br />
[33] Mozaffarian D. Dietary<br />
and Policy Priorities for Cardiovascular<br />
Disease, Diabetes, and<br />
Obesity. Circulation. 2016; 133:<br />
187 – 225. https://doi.org/10.1161/<br />
CIRCULATIONAHA.115.<br />
018585<br />
[34] Qian F, Korat AA, Malik<br />
V, Hu FB. Metabolic effects of<br />
monounsaturated fatty acid-enriched<br />
diets compared with<br />
carbohydrate or polyunsaturated<br />
fatty acid-enriched diets in<br />
patients with type 2 diabetes: A<br />
systematic review and meta-analysis<br />
of randomized controlled trials.<br />
Diabetes Care. 2016; 39: 1448 – 57.<br />
https://doi.org/10.2337/dc16-0513<br />
[35] Huo R, Du T, Xu Y, Xu<br />
W, Chen X, Sun K, et al. Effects of<br />
Mediterranean-style diet on<br />
glycemic control, weight loss and<br />
cardiovascular risk factors among<br />
type 2 diabetes individuals: A<br />
meta-analysis. Eur J Clin Nutr.<br />
2015; 69: 1200 – 8.<br />
https://doi.org/10.1038/<br />
ejcn.2014.243<br />
[36] Schwingshackl L,<br />
Strasser B, Hoffmann G. Effects of<br />
monounsaturated fatty acids on<br />
glycaemic control in patients with<br />
abnormal glucose metabolism: A<br />
systematic review and meta-analysis.<br />
Ann Nutr Metab. 2011; 58:<br />
290 – 6. https://doi.<br />
org/10.1159/000331214<br />
[38] Brown TJ, Brainard J,<br />
Song F, Wang X, Abdelhamid A,<br />
Hooper L. Omega-3, omega-6, and<br />
total dietary polyunsaturated fat<br />
for prevention and treatment of<br />
type 2 diabetes mellitus: Systematic<br />
review and meta-analysis of<br />
randomised controlled trials. BMJ.<br />
2019; 366: l4697. https://doi.<br />
org/10.1136/bmj.l4697<br />
[39] Bowman L, Mafham M,<br />
Wallendszus K, Stevens W, Buck G,<br />
Barton J, et al. Effects of n − 3 Fatty<br />
Acid Supplements in Diabetes<br />
Mellitus. N Engl J Med. 2018; 379:<br />
1540 – 50.<br />
https://doi.org/10.1056/NEJ-<br />
Moa1804989<br />
[40] Bosch J, Gerstein HC,<br />
Dagenais GR, Díaz R, Dyal L, Jung<br />
H, et al. n–3 Fatty Acids and<br />
Cardiovascular Outcomes in<br />
Patients with Dysglycemia. N Engl<br />
J Med. 2012; 367: 309 – 18.<br />
https://doi.org/10.1056/NEJ-<br />
Moa1203859<br />
[41] Malik VS, Li Y, Tobias<br />
DK, Pan A, Hu FB. Dietary Protein<br />
Intake and Risk of Type 2 Diabetes<br />
in US Men and Women. Am J<br />
Epidemiol. 2016; 183: 715 – 28.<br />
https://doi.org/10.1093/aje/kwv268<br />
[42] Ke Q, Chen C, He F, Ye Y,<br />
Bai X, Cai L, et al. Association<br />
between dietary protein intake and<br />
type 2 diabetes varies by dietary<br />
pattern. Diabetol Metab Syndr.<br />
2018; 10: 48.<br />
https://doi.org/10.1186/<br />
s13098 – 018 – 0350 – 5<br />
[43] Nussbaumer H.<br />
Ernährungstherapie bei Typ-2-Diabetes.<br />
Ernährungsempfehlungen<br />
bei Typ-2-Diabetes. Berlin,<br />
Heidelberg: Springer; 2019, 23 – 50.<br />
https://doi.org/10.1007/978-3-662-<br />
57808-7_4<br />
[44] Sievenpiper JL, Chan<br />
CB, Dworatzek PD, Med CF,<br />
Williams Med SL. 2018 Clinical<br />
Practice Guidelines Nutrition<br />
Therapy Diabetes Canada Clinical<br />
Practice Guidelines Expert<br />
Committee 2018. Can J Diabetes<br />
42; 64 – 79. https://doi.org/10.<br />
1016/j.jcjd.2017.10.009<br />
46<br />
5/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
Perspectives<br />
Literatur (Fortsetzung)<br />
[45] Hamdy O, Horton ES.<br />
Protein content in diabetes<br />
nutrition plan. Curr Diab Rep. 2011;<br />
11: 111 – 9. https://doi.org/10.<br />
1007/s11892-010-0171-x<br />
[46] Brodsky IG, Robbins<br />
DC, Hiser E, Fuller SP, Fillyaw M,<br />
Devlin JT. Effects of low-protein<br />
diets on protein metabolism in<br />
insulin-dependent diabetes<br />
mellitus patients with early<br />
nephropathy. J Clin Endocrinol<br />
Metab. 1992; 75: 351 – 7.<br />
https://doi.org/10.1210/<br />
jcem.75.2.1639934<br />
[47] ASCEND Study<br />
Collaborative Group, Bowman L,<br />
Mafham M, Wallendszus K, Stevens<br />
W, Buck G, et al. Effects of n-3 Fatty<br />
Acid Supplements in Diabetes<br />
Mellitus. N Engl J Med. 2018; 379:<br />
1540 – 50<br />
[48] Jakubowicz D, Froy O.<br />
Biochemical and metabolic<br />
mechanisms by which dietary<br />
whey protein may combat obesity<br />
and Type 2 diabetes. J Nutr<br />
Biochem. 2013; 24: 1 – 5.<br />
https://doi.org/10.1016/j.jnutbio.2012.07.008<br />
[49] Knott C, Bell S, Britton<br />
A. Alcohol consumption and the<br />
risk of type 2 diabetes: A systematic<br />
review and Dose-Response<br />
Meta-analysis of more than 1.9<br />
million individuals from 38<br />
observational studies. Diabetes<br />
Care. 2015; 38: 1804 – 12.<br />
https://doi.org/10.2337/dc15-0710<br />
[50] Wood AM, Kaptoge S,<br />
Butterworth A, Nietert PJ,<br />
Warnakula S, Bolton T, et al. Risk<br />
thresholds for alcohol consumption:<br />
combined analysis of<br />
individual-participant data for<br />
599 912 current drinkers in 83<br />
prospective studies. Lancet. 2018;<br />
391: 1513 – 23. https://doi.<br />
org/10.1016/S0140-6736(18)30134-X<br />
[51] Griswold MG, Fullman<br />
N, Hawley C, Arian N, Zimsen SRM,<br />
Tymeson HD, et al. Alcohol use<br />
and burden for 195 countries and<br />
territories, 1990 – 2016: A<br />
systematic analysis for the Global<br />
Burden of Disease Study 2016.<br />
Lancet. 2018; 392: 1015 – 35. https://<br />
doi.org/10.1016/S0140-6736(18)<br />
31310-2<br />
[52] Huang J, Wang X, Zhang<br />
Y. Specific types of alcoholic<br />
beverage consumption and risk of<br />
type 2 diabetes: A systematic<br />
review and meta-analysis. J<br />
Diabetes Investig. 2017; 8: 56 – 68.<br />
https://doi.org/10.1111/jdi.12537<br />
[53] Schrieks IC, Heil ALJ,<br />
Hendriks HFJ, Mukamal KJ,<br />
Beulens JWJ. The Effect of alcohol<br />
consumption on insulin sensitivity<br />
and glycemic status: A systematic<br />
review and meta-analysis of<br />
intervention studies. Diabetes<br />
Care. 2015; 38: 723 – 32.<br />
https://doi.org/10.2337/dc14-1556<br />
[54] Shai I, Wainstein J,<br />
Harman-Boehm I, Raz I, Fraser D,<br />
Rudich A, et al. Glycemic effects of<br />
moderate alcohol intake among<br />
patients with type 2 diabetes: A<br />
multicenter, randomized, clinical<br />
intervention trial. Diabetes Care.<br />
2007; 30: 3011 – 6.<br />
https://doi.org/10.2337/dc07-1103<br />
[55] Mori TA, Burke V,<br />
Zilkens RR, Hodgson JM, Beilin LJ,<br />
Puddey IB. The effects of alcohol<br />
on ambulatory blood pressure and<br />
other cardiovascular risk factors in<br />
type 2 diabetes: A<br />
randomized intervention. J<br />
Hypertens. 2016; 34: 421 – 8.<br />
https://doi.org/10.1097/<br />
HJH.0000000000000816<br />
[56] Shimomura T,<br />
Wakabayashi I. Inverse associations<br />
between light-to-moderate<br />
alcohol intake and lipid-related<br />
indices in patients with diabetes.<br />
Cardiovasc Diabetol. 2013; 12:104.<br />
https://doi.org/10.1186/1475-2840-<br />
12-104<br />
[57] Tetzschner R, Nørgaard<br />
K, Ranjan A. Effects of alcohol on<br />
plasma glucose and prevention<br />
of alcohol-induced hypoglycemia<br />
in type 1 diabetes—A systematic<br />
review with GRADE. Diabetes<br />
Metab Res Rev. 2018; 34 (3). https://<br />
doi.org/10.1002/dmrr.2965<br />
[58] Vieira BA, Luft VC,<br />
Schmidt MI, Chambless LE, Chor<br />
D, Barreto SM, et al. Timing and<br />
Type of Alcohol Consumption and<br />
the Metabolic Syndrome – EL-<br />
SA-Brasil. PLoS One. 2016; 11:<br />
e0163044. https://doi.org/10.1371/<br />
journal.pone.0163044<br />
[59] Lane JD, Feinglos MN,<br />
Surwit RS. Caffeine increases<br />
ambulatory glucose and postprandial<br />
responses in coffee drinkers<br />
with type 2 diabetes. Diabetes<br />
Care. 2008; 31: 221 – 2.<br />
https://doi.org/10.2337/dc07-1112<br />
[60] Reis CEG, Dórea JG, da<br />
Costa THM. Effects of coffee<br />
consumption on glucose<br />
metabolism: A systematic review<br />
of clinical trials. J Tradit Complement<br />
Med. 2019; 9: 184 – 91.<br />
https://doi.org/10.1016/j.<br />
jtcme.2018.01.001<br />
[61] Ding M, Bhupathiraju<br />
SN, Chen M, Van Dam RM, Hu FB.<br />
Caffeinated and decaffeinated<br />
coffee consumption and risk of<br />
type 2 diabetes: A systematicreview<br />
and a dose-response<br />
meta-analysis. Diabetes Care. 2014;<br />
37: 569 – 86. https://doi.org/10.2337/<br />
dc13-1203<br />
[62] Jiang X, Zhang D, Jiang<br />
W. Coffee and caffeine intake and<br />
incidence of type 2 diabetes<br />
mellitus: A meta-analysis of<br />
prospective studies. Eur J Nutr.<br />
2014; 53: 25 – 38. https://doi.<br />
org/10.1007/s00394-013-0603-x<br />
[63] Li M, Fan Y, Zhang X,<br />
Hou W, Tang Z, Tang Z. Fruit and<br />
vegetable intake and risk of type 2<br />
diabetes mellitus: meta-analysis of<br />
prospective cohort studies. BMJ<br />
Open. 2014; 4: 5497.<br />
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2014<br />
[64] Wu Y, Zhang D, Jiang X,<br />
Jiang W. Fruit and vegetable<br />
consumption and risk of type 2<br />
diabetes mellitus: A dose-response<br />
meta-analysis of prospective<br />
cohort studies. Nutr Metab<br />
Cardiovasc Dis. 2015; 25: 140 – 7.<br />
https://doi.org/<br />
10.1016/j.numecd.2014.10.004<br />
[65] Afshin A, Micha R,<br />
Khatibzadeh S, Mozaffarian D.<br />
Consumption of nuts and legumes<br />
and risk of incident ischemic heart<br />
disease, stroke, and diabetes: A<br />
systematic review and meta-analysis.<br />
Am J Clin Nutr. 2014; 100:<br />
278 – 88. https://doi.org/10.3945/<br />
ajcn.113.076901<br />
[66] Luo C, Zhang Y, Ding Y,<br />
Shan Z, Chen S, Yu M, et al. Nut<br />
consumption and risk of type 2<br />
diabetes, cardiovascular disease,<br />
and all-cause mortality: a<br />
systematic review and meta-analysis.<br />
Am J Clin Nutr. 2014; 100:<br />
256 – 69. https://doi.org/10.3945/<br />
ajcn.113.076109<br />
[67] Viguiliouk E, Glenn AJ,<br />
Nishi SK, Chiavaroli L, Seider M,<br />
Khan T, et al. Associations between<br />
Dietary Pulses Alone or with Other<br />
Legumes and Cardiometabolic<br />
Disease Outcomes: An Umbrella<br />
Review and Updated Systematic<br />
Review and Meta-analysis of<br />
Prospective Cohort Studies. Adv<br />
Nutr. 2019; 10 Suppl 4: S308 – 19.<br />
https://doi.org/10.1093/advances/<br />
nmz113<br />
[68] He M, Van Dam RM,<br />
Rimm E, Hu FB, Qi L. Whole-grain,<br />
cereal fiber, bran, and germ intake<br />
and the risks of all-cause and<br />
cardiovascular disease-specific<br />
mortality among women with type<br />
2 diabetes mellitus. Circulation.<br />
2010; 121: 2162 – 8. https://doi.<br />
org/10.1161/CIRCULATION-<br />
AHA.109.907360<br />
[69] Burger KNJ, Beulens<br />
JWJ, van der Schouw YT, Sluijs I,<br />
Spijkerman AMW, Sluik D, et al.<br />
Dietary fiber, carbohydrate quality<br />
and quantity, and mortality risk of<br />
individuals with diabetes mellitus.<br />
PLoS One. 2012; 7: e43127. https://<br />
doi.org/10.1371/journal.<br />
pone.0043127<br />
[70] Della Pepa G, Vetrani C,<br />
Vitale M, Riccardi G. Wholegrain<br />
intake an risk of type 2 diabetes:<br />
Evidence form epidemiological<br />
and intervention studies.<br />
Nutrients. 2018; 10 (9): 1288. https://<br />
doi.org/10.3390/nu10091288<br />
[71] Papanikolaou Y, Fulgoni<br />
V. Bread Consumption Is <strong>No</strong>t<br />
Associated with Weight-,<br />
Diabetes- and CVD-Risk Related<br />
Health Outcomes in US Adults:<br />
Results from NHANES 2011 – 2014<br />
(P18 – 086 – 19). Curr Dev Nutr.<br />
2019; 3. https://doi.org/10.<br />
1093/CDN/NZZ039.P18-086-19<br />
[72] Mofidi A, Ferraro ZM,<br />
Stewart KA, Tulk HMF, Robinson<br />
LE, Duncan AM, et al. The Acute<br />
Impact of Ingestion of Sourdough<br />
and Whole-Grain Breads on Blood<br />
Glucose, Insulin, and Incretins in<br />
Overweight and Obese Men. J Nutr<br />
Metab. 2012; 2012: 184710. https://<br />
doi.org/10.1155/2012/184710<br />
[73] Reynolds AN, Mann J,<br />
Elbalshy M, Mete E, Robinson C,<br />
Oey I, et al. Wholegrain particle<br />
size influences postprandial<br />
glycemia in type 2 diabetes: A<br />
randomized crossover study<br />
comparing four wholegrain breads.<br />
Diabetes Care. 2020; 43: 476 – 9.<br />
https://doi.org/10.2337/dc19-1466<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 5/22 47
Perspectives<br />
Literatur (Fortsetzung)<br />
[74] Hu EA, Pan A, Malik V,<br />
Sun Q. White rice consumption<br />
and risk of type 2 diabetes:<br />
Meta-analysis and systematic<br />
review. BMJ. 2012; 344: e1454.<br />
https://doi.org/10.1136/bmj.e1454<br />
[75] Sun Q, Spiegelman D,<br />
Van Dam RM, Holmes MD, Malik<br />
VS, Willett WC, et al. White rice,<br />
brown rice, and risk of type 2<br />
diabetes in US men and women.<br />
Arch Intern Med. 2010; 170: 961 – 9.<br />
https://doi.org/10.1001/archinternmed.2010.109<br />
[76] Golozar A, Khalili D,<br />
Etemadi A, Poustchi H, Fazeltabar<br />
A, Hosseini F, et al. White rice<br />
intake and incidence of type-2<br />
diabetes: analysis of two prospective<br />
cohort studies from Iran. BMC<br />
Public Health. 2017; 17: 1 – 11.<br />
https://doi.org/10.<br />
1186/s12889-016-3999-4<br />
[77] Nakayama T, Nagai Y,<br />
Uehara Y, Nakamura Y, Ishii S, Kato<br />
H, et al. Eating glutinous brown<br />
rice twice a day for 8 weeks<br />
improves glycemic control in<br />
Japanese patients with diabetes<br />
mellitus. Nutr Diabetes. 2017; 7:<br />
e273 – e273. https://doi.org/<br />
10.1038/nutd.2017.26<br />
[78] Huang M, Li J, Ha MA,<br />
Riccardi G, Liu S. A systematic<br />
review on the relations between<br />
pasta consumption and cardio-metabolic<br />
risk factors. Nutr<br />
Metab Cardiovasc Dis. 2017; 27:<br />
939 – 48. https://doi.org/10.1016/j.<br />
numecd.2017.07.005<br />
[79] Pounis G, Di Castelnuovo<br />
A, Costanzo S, Persichillo M,<br />
Bonaccio M, Bonanni A, et al.<br />
Association of pasta consumption<br />
with body mass index and<br />
waist-to-hip ratio: Results from<br />
Moli-sani and INHES studies. Nutr<br />
Diabetes. 2016; 6: e218 – e218.<br />
https://doi.org/10.1038/<br />
nutd.2016.20<br />
[80] Chiavaroli L, Kendall<br />
CWC, Braunstein CR, Blanco Mejia<br />
S, Leiter LA, Jenkins DJA, et al.<br />
Effect of pasta in the context of<br />
low-glycaemic index dietary<br />
patterns on body weight and<br />
markers of adiposity: A systematic<br />
review and meta-analysis of<br />
randomised controlled trials in<br />
adults. BMJ Open. 2018; 8:<br />
e019438. https://doi.org/10.1136/<br />
bmjopen-2017-019438<br />
[81] Vitale M, Masulli M,<br />
Rivellese AA, Bonora E, Babini AC,<br />
Sartore G, et al. Pasta consumption<br />
and connected dietary habits:<br />
Associations with glucose control,<br />
adiposity measures, and cardiovascular<br />
risk factors in people with<br />
type 2 diabetes—TOSCA.IT study.<br />
Nutrients. 2020; 12 (1): 101. https://<br />
doi.org/<br />
10.3390/nu12010101<br />
[82] Muraki I, Rimm EB,<br />
Willett WC, Manson JE, Hu FB, Sun<br />
Q. Potato consumption and risk of<br />
type 2 diabetes: Results from three<br />
prospective cohort studies.<br />
Diabetes Care. 2016; 39: 376 – 84.<br />
https://doi.org/10.2337/dc15-0547<br />
[83] Zhang Y, You D, Lu N,<br />
Duan D, Feng X, Astell-Burt TA, et<br />
al. Potatoes Consumption and Risk<br />
of Type 2 Diabetes: A Meta-analysis.<br />
Iran J Public Health. 2018; 47:<br />
1627 – 35.<br />
[84] Bidel Z, Teymoori F,<br />
Davari SJ, Nazarzadeh M. Potato<br />
consumption and risk of type 2<br />
diabetes: A dose–response<br />
meta-analysis of cohort studies.<br />
Clin Nutr ESPEN. 2018; 27: 86 – 91.<br />
https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2018.06.004<br />
[85] Drouin-Chartier J-P, Li<br />
Y, Victor A, Korat A, Ding M,<br />
Lamarche B, et al. Changes in dairy<br />
product consumption and risk of<br />
type 2 diabetes: results from 3 large<br />
prospective cohorts of US men and<br />
women. Am J Clin Nutr. 2019; 110:<br />
1201 – 12. https://doi.org/10.1093/<br />
ajcn/nqz180<br />
[86] Chen M, Sun Q,<br />
Giovannucci E, Mozaffarian D,<br />
Manson JAE, Willett WC, et al.<br />
Dairy consumption and risk of type<br />
2 diabetes: 3 cohorts of US adults<br />
and an updated meta-analysis.<br />
BMC Med. 2014; 12: 215. https://doi.<br />
org/10.1186/s12916-014-0215-1<br />
[87] Aune D, <strong>No</strong>rat T,<br />
Romundstad P, Vatten LJ. Dairy<br />
products and the risk of type 2<br />
diabetes: A systematic review and<br />
dose-response meta-analysis of<br />
cohort studies. Am J Clin Nutr.<br />
2013; 98: 1066 – 83. https://doi.<br />
org/10.3945/ajcn.113.059030<br />
[88] Tong X, Dong JY, Wu<br />
ZW, Li W, Qin LQ. Dairy consumption<br />
and risk of type 2 diabetes<br />
mellitus: A meta-analysis of cohort<br />
studies. Eur J Clin Nutr.<br />
2011;65:1027 – 31. https://doi.<br />
org/10.1038/ejcn.2011.62<br />
[89] Zong G, Sun Q, Yu D,<br />
Zhu J, Sun L, Ye X, et al. Dairy<br />
consumption, type 2 diabetes, and<br />
changes in cardiometabolic traits:<br />
A prospective cohort study of<br />
middle-aged and older chinese in<br />
beijing and shanghai. Diabetes<br />
Care. 2014; 37: 56 – 63.<br />
https://doi.org/10.2337/dc13-0975<br />
[90] Pan A, Sun Q, Bernstein<br />
AM, Schulze MB, Manson JAE, Willett<br />
WC, et al. Red meat consumption<br />
and risk of type 2 diabetes: 3<br />
Cohorts of US adults and an<br />
updated meta-analysis. Am J Clin<br />
Nutr. 2011; 94: 1088 – 96. https://<br />
doi.org/10.3945/ajcn.<br />
111.018978<br />
[91] Talaei M, Wang YL,<br />
Yuan JM, Pan A, Koh WP. Original<br />
Contribution Meat, Dietary Heme<br />
Iron, and Risk of Type 2 Diabetes<br />
Mellitus The Singapore Chinese<br />
Health Study. Am J Epidemiol.<br />
2017; 186: 824 – 33. https://doi.<br />
org/10.1093/aje/kwx156<br />
[92] Du H, Guo Y, Bennett<br />
DA, Bragg F, Bian Z, Chadni M, et<br />
al. Red meat, poultry and fish<br />
consumption and risk of diabetes:<br />
a 9 year prospective cohort study<br />
of the China Kadoorie Biobank.<br />
Diabetologia. 2020; 63: 767 – 79.<br />
https://doi.org/10.<br />
1007/s00125-020-05091-x<br />
[93] Mari-Sanchis A, Gea A,<br />
Basterra-Gortari FJ, Martinez-Gonzalez<br />
MA, Beunza JJ, Bes-Rastrollo<br />
M. Meat Consumption and Risk of<br />
Developing Type 2 Diabetes in the<br />
SUN Project: A Highly Educated<br />
Middle-Class Population. PLoS<br />
One. 2016; 11: e0157990. https://doi.<br />
org/10.1371/journal.pone.<br />
0157990<br />
[94] Balk E, Tatsioni A,<br />
Lichtenstein A, Lau J, Pittas A.<br />
Effect of Chromium Supplementation<br />
on Glucose Metabolism and<br />
Lipids. Diabetes Care. 2007; 30<br />
:2154 – 63. https://doi.org/10.<br />
2337/dc06-0996.Additional<br />
[95] Verma H, Garg R. Effect<br />
of magnesium supplementation on<br />
type 2 diabetes associated<br />
cardiovascular risk factors: a<br />
systematic review and meta-analysis.<br />
J Hum Nutr Diet. 2017; 30:<br />
621 – 33. https://doi.org/10.1111/<br />
jhn.12454<br />
[96] Jayawardena R,<br />
Ranasinghe P, Galappatthy P,<br />
Malkanthi R, Constantine GR,<br />
Katulanda P. Effects of zinc<br />
supplementation on diabetes<br />
mellitus: a systematic review and<br />
meta-analysis. Diabetol Metab<br />
Syndr. 2012; 4: 13.<br />
[97] Suksomboon N, Poolsup<br />
N, Yuwanakorn A. Systematic<br />
review and meta-analysis of the<br />
efficacy and safety of chromium<br />
supplementation in diabetes. J<br />
Clin Pharm Ther. 2014; 39:<br />
292 – 306. https://doi.org/10.1111/<br />
jcpt.12147<br />
[98] Yin R V., Phung OJ.<br />
Effect of chromium supplementation<br />
on glycated hemoglobin and<br />
fasting plasma glucose in patients<br />
with diabetes mellitus. Nutr J.<br />
2015; 14: 14. https://doi.org/<br />
10.1186/1475-2891-14-14<br />
[99] Al Thani M, Sadoun E,<br />
Sofroniou A, Jayyousi A, Baagar<br />
KAM, Al Hammaq A, et al. The<br />
effect of vitamin D supplementation<br />
on the glycemic control of<br />
pre-diabetic Qatari patients in a<br />
randomized control trial. BMC<br />
Nutr. 2019; 5: 46. https://doi.<br />
org/10.1186/s40795-019-0311-x<br />
[100] Davari M, Hashemi R,<br />
Mirmiran P, Hedayati M,<br />
Sahranavard S, Bahreini S, et al.<br />
Effects of cinnamon supplementation<br />
on expression of systemic<br />
inflammation factors, NF-kB and<br />
Sirtuin-1 (SIRT1) in type 2 diabetes:<br />
A randomized, double blind, and<br />
controlled clinical trial. Nutr J.<br />
2020; 19: 1. https://doi.org/10.1186/<br />
s12937-019-0518-3<br />
[101] Santos HO, Da Silva<br />
GAR. To what extent does<br />
cinnamon administration improve<br />
the glycemic and lipid profiles?<br />
Clin Nutr ESPEN. 2018; 27: 1 – 9.<br />
https://doi.org/10.1016/j.<br />
clnesp.2018.07.011<br />
[102] Sollid ST, Hutchinson<br />
MYS, Fuskevåg OM, Figenschau Y,<br />
Joakimsen RM, Schirmer H, et al.<br />
<strong>No</strong> effect of high-dose vitamin D<br />
supplementation on glycemic<br />
status or cardiovascular risk factors<br />
in subjects with prediabetes.<br />
Diabetes Care. 2014; 37: 2123 – 31.<br />
https://doi.org/10.2337/dc14-0218<br />
48<br />
5/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
Perspectives<br />
Literatur (Fortsetzung)<br />
[103] Horikawa C, Yoshimura<br />
Y, Kamada C, Tanaka S, Tanaka S,<br />
Hanyu O, et al. Dietary Sodium<br />
Intake and Incidence of Diabetes<br />
Complications in Japanese<br />
Patients with Type 2 Diabetes:<br />
Analysis of the Japan Diabetes<br />
Complications Study (JDCS). J Clin<br />
Endocrinol Metab. 2014; 99:<br />
3635 – 43. https://doi.org/10.1210/<br />
jc.2013-4315<br />
[104] Ekinci EI, Clarke S,<br />
Thomas MC, Moran JL, Cheong K,<br />
Macisaac RJ, et al. Dietary salt<br />
intake and mortality in patients<br />
with type 2 diabetes. Diabetes<br />
Care. 2011; 34: 703 – 9. https://doi.<br />
org/10.2337/dc10 – 1723<br />
[105] Horikawa C, Sone H.<br />
Dietary salt intake and diabetes<br />
complications in patients with<br />
diabetes: An overview. J Gen Fam<br />
Med. 2017; 18: 16 – 20. https://doi.<br />
org/10.1002/jgf2.10<br />
[106] Schwingshackl L,<br />
Chaimani A, Hoffmann G,<br />
Schwedhelm C, Boeing H. A<br />
network meta-analysis on the<br />
comparative efficacy of different<br />
dietary approaches on glycaemic<br />
control in patients with type 2<br />
diabetes mellitus. Eur J Epidemiol.<br />
2018; 33: 157 – 70. https://doi.<br />
org/10.1007/s10654-017-0352-x<br />
[107] Tangney CC, Staffileno<br />
BA, Rasmussen HE. Healthy<br />
Eating: How Do We Define It and<br />
Measure It? What’s the Evidence? J<br />
Nurse Pract. 2017; 13: e7 – 15. https://<br />
doi.org/10.1016/j.<br />
nurpra.2016.08.026<br />
[108] Campbell AP. DASH<br />
eating plan: An eating pattern for<br />
diabetes management. Diabetes<br />
Spectr. 2017; 30: 76 – 81.<br />
https://doi.org/10.2337/ds16-0084<br />
[109] Schröder H, Benitez<br />
Arciniega A, Soler C, Covas MI,<br />
Baena-Díez JM, Marrugat J.<br />
Validity of two short screeners for<br />
diet quality in time-limited<br />
Settings. Public Health Nutr. 2012;<br />
15: 618 – 26. https://doi.org/10.1017/<br />
S1368980011001923<br />
[110] Fäh D. Stressfrei<br />
Abnehmen. Zürich: Beobachter<br />
Edition; 2019.<br />
[111] Cho Y, Hong N, Kim K,<br />
Cho S, Lee M, Lee Y, et al. The<br />
Effectiveness of Intermittent<br />
Fasting to Reduce Body Mass Index<br />
and Glucose Metabolism: A<br />
Systematic Review and Meta-Analysis.<br />
J Clin Med. 2019; 8: 1645.<br />
https://doi.org/10.3390/jcm<br />
8101645<br />
[112] Grajower MM, Horne<br />
BD. Clinical management of<br />
intermittent fasting in patients<br />
with diabetes mellitus. Nutrients.<br />
2019; 11 (4): 873. https://doi.<br />
org/10.3390/nu11040873<br />
Annonce<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 5/22 49
ACHETER<br />
UN<br />
TICKET<br />
sur ifas-expo.ch<br />
<strong>No</strong>us réunissons les<br />
secteur de la santé.<br />
Bienvenue à l‘IFAS, le plus grand salon professionnel suisse pour le marché de la santé.<br />
et le rendez-vous des professionnels de la santé. Pendant trois jours, les professionnels<br />
de la santé se réunissent dans les halles de Messe Zürich, la compétence concentrée<br />
du secteur de la santé se réunit pour découvrir des innovations, des tendances et des<br />
actualités de la branche. Soyez de la partie et prenez le pouls de l‘actualité.<br />
25 – 27 <strong>octobre</strong> <strong>2022</strong> · Messe Zurich · ifas-expo.ch
Perspectives<br />
Mission pour la Croix-Rouge<br />
Catastrophes, détresse<br />
et miracles<br />
Isabelle Güss, pédiatre en cabinet à Schaffhouse<br />
Photo: màd<br />
J’ai toujours voulu travailler<br />
pour la Croix-Rouge. Après ma<br />
spécialisation en pédiatrie, j’ai<br />
posé ma candidature au Comité<br />
international de la Croix-Rouge (CICR)<br />
en 2004 et j’ai travaillé pendant 15 mois<br />
comme pédiatre au Sud-Soudan. Au<br />
milieu des émeutes et des explosions<br />
fréquentes, nous devions nous mettre à<br />
l’abri à l’hôpital ou dans les logements,<br />
ce qui a contribué à créer des liens forts.<br />
Je suis d’ailleurs toujours en contact avec<br />
certains de mes collègues du CICR aux<br />
quatre coins du monde. Découvrir des<br />
cultures étrangères, travailler avec des<br />
collègues de différentes nations, parler<br />
plusieurs langues, tout cela me fascinait.<br />
Poser des diagnostics avec des moyens<br />
simples, improviser et s’adapter sans<br />
cesse à de nouvelles situations font également<br />
partie de l’attrait de ces missions.<br />
Une formation solide, si possible en<br />
médecine tropicale, ainsi que des connaissances<br />
linguistiques sont par conséquent<br />
une condition préalable essentielle.<br />
Comme je voulais rester enracinée en<br />
Suisse, j’ai posé ma candidature en 2006<br />
auprès de la Croix-Rouge suisse (CRS)<br />
pour le pool de santé ERU. Les Emergency<br />
Response Units (ERU) sont des unités de<br />
secours standardisées qui interviennent<br />
en cas de catastrophe à l’échelle internationale.<br />
Le matériel est stocké sur place,<br />
prêt à être transporté, et peut arriver sur le<br />
lieu d’intervention, personnel compris,<br />
dans les 72 heures. Les interventions<br />
durent de quatre à six semaines et les<br />
équipes doivent être régulièrement remplacées<br />
en raison de la charge de travail<br />
élevée, des conditions climatiques difficiles<br />
et du niveau de stress accru. Dans le<br />
système hospitalier suisse, il est toutefois<br />
difficile de se libérer à court terme pour<br />
des interventions d’urgence. Ce n’est que<br />
lorsque j’ai commencé à travailler dans un<br />
cabinet communautaire en 2008 que j’ai<br />
pu me rendre disponible régulièrement.<br />
Mes trois premières missions (2008–<br />
2011) m’ont menée en Haïti. J’ai soigné<br />
des adultes et des enfants dans une polyclinique<br />
après un ouragan, j’ai travaillé<br />
jour et nuit comme pédiatre dans un hôpital<br />
de campagne après le grand tremblement<br />
de terre et j’ai réhydraté des patients<br />
gravement malades dans l’unité de choléra.<br />
Aucune mission ne ressemble à une<br />
autre, on ne sait jamais ce qui nous attend,<br />
les défis sont à chaque fois énormes.<br />
Mais on recommence toujours avec le<br />
sourire.<br />
La plus grande unité ERU est un<br />
hôpital de campagne de 80 lits. Elle a été<br />
déployée en Haïti en 2010 et au Bangladesh<br />
en 2017. J’ai été très impressionnée<br />
de voir comment, dans la salle d’opération<br />
gonflable, les interventions d’urgence se<br />
succédaient toute la nuit; comment, dans<br />
la tente ICU, par 30 degrés et malgré la<br />
climatisation, des patients gravement<br />
malades survivaient et comment, dans la<br />
tente d’accouchement, trois femmes mettaient<br />
leurs enfants au monde au même<br />
moment, même s’il n’y avait qu’un seul lit.<br />
La mortalité est particulièrement<br />
élevée en pédiatrie. C’est très éprouvant et<br />
il arrive que l’on doute de ses propres<br />
Haïti 2010: le bébé miracle est admis à l’hôpital de campagne.<br />
Personne ne pensait qu’il survivrait.<br />
capacités. Lors de ma dernière mission<br />
au Bangladesh, on déplorait au moins<br />
un décès d’enfant par jour pendant la<br />
première semaine. De nombreux enfants<br />
n’ont survécu que grâce à des soins<br />
dévoués et un talent d’improvisation.<br />
Je me souviens particulièrement<br />
de ce bébé miracle âgé de 3 semaines en<br />
Haïti, qui avait été admis en état de<br />
malnutrition avec une infection grave<br />
et des apnées, et devait être ventilé au<br />
masque jour et nuit dans la tente de soins<br />
intensifs. Grâce à une perfusion intraosseuse,<br />
des antibiotiques ont pu lui être<br />
administrés et lui sauver la vie. Voir ces<br />
enfants quitter l’hôpital avec leurs parents<br />
est la plus belle des récompenses.<br />
De retour à la maison, on apprécie<br />
les infrastructures fonctionnelles, le lit<br />
douillet et la facilité avec laquelle les<br />
petits problèmes peuvent être résolus.<br />
Mais la nostalgie de la prochaine mission<br />
reprend vite le dessus.<br />
Plus d’informations sur le CICR ou la<br />
CRS sur: www.icr.org / www.redcross.ch.<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 5/22 51
mediservice<br />
Boîte aux lettres<br />
Les jeunes et<br />
l’alcool<br />
Plus les enfants grandissent,<br />
plus ils ont des droits, mais<br />
aussi des devoirs et des<br />
responsabilités. Conduire,<br />
quitter le domicile parental, se marier:<br />
tout cela n’est possible qu’à partir de<br />
18 ans. Jusque-là, tout est clair. Mais à<br />
partir de quel âge les jeunes ont-ils le<br />
droit de boire de la bière?<br />
Nils (17 ans) organise une fête chez lui.<br />
Des copains majeurs apportent des<br />
pilules d’ecstasy qu’ils proposent aux<br />
personnes invitées. En distribuant de<br />
l’ecstasy à d’autres personnes, les copains<br />
de Nils enfreignent la loi sur les stupéfiants.<br />
Celle-ci punit non seulement la<br />
remise, la vente et la possession de<br />
stupéfiants, mais également leur consommation.<br />
Par conséquent, tous les jeunes<br />
qui consomment les pilules s’exposent<br />
à des sanctions. Selon les circonstances,<br />
il se peut que Nils commette lui aussi une<br />
infraction dans la mesure où sa «non-intervention»<br />
peut être qualifiée de participation<br />
accessoire (appelée «complicité»)<br />
ou si, sur la base des circonstances, il y a<br />
lieu d’admettre l’existence d’une position<br />
de garant (responsabilité de Nils pour<br />
d’autres personnes). Dès lors, Nils serait<br />
bien inspiré de faire appel à un adulte et<br />
de sommer ses copains de ne pas distribuer<br />
de pilules d’ecstasy à d’autres<br />
invités. Nils peut aussi exiger qu’ils<br />
quittent les lieux. Le cas échéant, il faut<br />
également alerter les services de secours<br />
et la police – par exemple lorsque de<br />
l’ecstasy a déjà été consommée.<br />
Marie a 16 ans et lors d’une sortie,<br />
elle achète dans une station-service des<br />
bières pour ses copines qui n’ont que<br />
15 ans. Le fait que Marie achète des bières<br />
pour ses copines plus jeunes est bien sûr<br />
problématique du point de vue de la<br />
protection des mineurs. Toutefois,<br />
Marie n’est pas nécessairement passible<br />
d’une sanction. L’infraction «Remise à<br />
des enfants de substances pouvant mettre<br />
en danger leur santé» sanctionne la mise<br />
à disposition de boissons alcooliques<br />
dans des quantités pouvant mettre en<br />
danger la santé. S’il s’agit de très faibles<br />
quantités et de boissons à très faible<br />
degré d’alcool (p. ex. un panaché),<br />
l’infraction ne devrait pas être punissable.<br />
Cependant, plus la quantité et/ou<br />
le degré d’alcool est important(e), plus on<br />
se situe dans le domaine du punissable.<br />
Les parents qui, chez eux, proposent<br />
une bière à des jeunes de 15 ans s’exposent -<br />
ils à des sanctions? D’un point de vue<br />
strictement juridique, l’acte devrait relever<br />
de l’infraction de «Remise à des enfants de<br />
substances pouvant mettre en danger leur<br />
santé», pour autant que les parents offrent<br />
aux jeunes une quantité d’alcool suffisamment<br />
importante pour mettre en danger<br />
leur santé. En revanche, la «mise à disposition»<br />
de faibles quantités (p. ex. une gorgée<br />
de bière) n’est pas punissable.<br />
Les jeunes et l’alcool<br />
Selon la protection de la jeunesse,<br />
– il est interdit de vendre ou de servir de<br />
l’alcool à des enfants et adolescents de<br />
moins de 16 ans;<br />
– la bière et le vin ne peuvent être vendus<br />
ou servis qu’à des personnes de plus de<br />
16 ans révolus;<br />
– les spiritueux, apéritifs et alcopops ne<br />
peuvent être vendus ou servis qu’à des<br />
personnes de plus de 18 ans révolus.<br />
Les limites d’âge de 16/18 ans en matière<br />
de vente d’alcool sont inscrites dans la loi<br />
fédérale et sont donc valables pour toute la<br />
Suisse. Certains cantons ont renforcé ces<br />
dispositions. Et certains détaillants –<br />
comme Coop – vont même jusqu’à limiter<br />
la vente d’alcool aux plus de 18 ans.<br />
AXA-ARAG<br />
AXA-ARAG propose aux membres<br />
de mediservice une assurance de<br />
protection juridique à des conditions<br />
avantageuses.<br />
Si vous avez des questions, n’hésitez<br />
pas à vous adresser à votre interlocuteur<br />
chez mediservice vsao-<strong>asmac</strong><br />
par téléphone au 031 350 44 22, ou par<br />
e-mail à l’adresse suivante:<br />
info@mediservice-<strong>asmac</strong>.ch.<br />
Leo Loosli<br />
juriste chez AXA-ARAG,<br />
spécialisé en droit des contrats,<br />
en droit successoral, en droit<br />
de la famille et en droit des<br />
personnes.<br />
Photo: màd<br />
52<br />
5/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
Publireportage<br />
Retour du plus important salon professionnel<br />
dans le domaine de la santé<br />
Le rendez-vous de la branche<br />
pour l’innovation, l’information<br />
et le réseautage<br />
Après deux reports dus à la pandémie,<br />
l’IFAS fait son grand retour en <strong>2022</strong>.<br />
Pendant trois jours, les nouveautés<br />
des exposants qui ont connu un nouvel élan<br />
d’innovation dans le cadre de la transformation<br />
numérique dans le secteur de la santé<br />
et en raison des changements sociaux seront<br />
au centre de l’attention à Messe Zurich.<br />
Dans sa dernière édition, le salon professionnel<br />
intègre également un symposium de<br />
trois jours sur des thèmes d’actualité brûlants.<br />
De plus, il accueillera l’IFAS innovation<br />
Challenge ainsi que le salon suisse de<br />
l’emploi CareFair.<br />
« L’expérience acquise au cours de ces deux<br />
dernières années et demie a montré l’importance<br />
du bon fonctionnement du système<br />
de santé pour la société, » explique<br />
Heinz Salzgeber, directeur du salon depuis<br />
de nombreuses années. « En tant que principal<br />
événement de la branche, l’IFAS est<br />
depuis toujours un lieu de réseautage et de<br />
transmission du savoir qui offre aux professionnels<br />
une plateforme unique pour s’informer<br />
de manière ciblée sur les tendances<br />
et les nouveaux produits. » Le nombre et la<br />
diversité des exposants inscrits le confirment<br />
également. Des fournisseurs leaders<br />
comme des petits niveaux des domaines<br />
de la consommation et de la logistique, de<br />
l’aménagement et de l’équipement, de l’informatique,<br />
des techniques de diagnostic et<br />
de laboratoire, des technologies médicales<br />
et de l’électromédecine, de la physiothérapie,<br />
de la santé physique et du sport, et de<br />
la rééducation assureront une présence<br />
sectorielle complète lors de l’IFAS <strong>2022</strong>.<br />
Symposium : des thèmes d’actualité<br />
brûlants<br />
Cette année, le symposium sera consacré<br />
pour chacun des trois jours du salon à<br />
un thème central qui mettra en lumière les<br />
défis actuels dans le domaine de la santé.<br />
Des représentants du monde politique et<br />
économique proposeront des exposés et<br />
débattront de thèmes très actuels tels que<br />
la protection des données et la sécurité de<br />
l’information dans le secteur de la santé, le<br />
New Health Care Management et l’importance<br />
de l’innovation et de la vision pour la<br />
branche. Ils aborderont entre autres des solutions<br />
pour lutter contre la pénurie de personnel<br />
qualifié dans le domaine de la santé.<br />
IFASinnovation Challenge : un tremplin<br />
pour les jeunes startups innovantes<br />
Après 2018, l’IFAS offre de nouveau, en partenariat<br />
avec la société Cosanum AG, une<br />
plateforme unique pour l’univers des startups<br />
du secteur suisse de la santé. L’objectif<br />
de l’IFASinnovation Challenge est d’encourager<br />
la force d’innovation du secteur suisse<br />
de la santé et de redynamiser le marché<br />
grâce à des approches et des technologies<br />
novatrices. Les 25 meilleures startups parmi<br />
les candidatures reçues auront la chance de<br />
présenter leurs innovations lors d’une exposition<br />
spéciale à l’IFAS. Le vainqueur du<br />
challenge se verra ensuite remettre l’IFA-<br />
Sinnovation Award lors de la remise des prix<br />
qui aura lieu le dernier jour du salon.<br />
CareFair : le salon suisse de l’emploi pour<br />
les professionnels de la santé<br />
La pandémie a mis le personnel de santé à<br />
rude épreuve. Il est désormais d’autant plus<br />
important pour les employeurs de trouver<br />
du personnel de santé qualifié. Le salon<br />
suisse de l’emploi pour les professionnels<br />
de la santé CareFair, intégré à l’IFAS, revient<br />
en <strong>2022</strong> pour la troisième fois déjà et il offre<br />
au secteur une possibilité intéressante de<br />
se positionner sur le marché du travail et<br />
de pourvoir des postes vacants. Il offre aux<br />
demandeurs d’emploi et aux employeurs la<br />
possibilité d’entrer en contact de manière<br />
simple et aisée à l’occasion de l’IFAS <strong>2022</strong>.<br />
Plus d’une vingtaine d’hôpitaux, de cliniques<br />
et d’établissements de soins se présenteront<br />
à l’occasion du CareFair cette année.<br />
IFAS <strong>2022</strong>, 25 – 27 <strong>octobre</strong> <strong>2022</strong> /<br />
Messe Zurich<br />
Horaires d’ouverture :<br />
Du mardi au jeudi de 9 h à 17 h<br />
Du diagnostic au traitement, en passant par la<br />
thérapie, les soins et l4administration : l’IFAS<br />
<strong>2022</strong> offre aux décideurs, aux propriétaires de<br />
cabinet et aux professionnels une scène unique<br />
pour découvrir les innovations et les nouveautés<br />
de la branche. Le symposium de trois jours<br />
est gratuit et présent dans la halle 6 en tant<br />
qu’événement ouvert. Informations sur les<br />
exposants, programme actuel du symposium et<br />
billet d’entrée gratuit à demander en ligne sur :<br />
ifas-expo.ch
mediservice<br />
Financement automobile:<br />
leasing ou crédit?<br />
Peter a besoin d’une voiture. Il aimerait acheter une hybride rechargeable.<br />
Le modèle qui lui plaît coûte 49 000 francs avec options. C’est trop!<br />
C’est pourquoi il se demande s’il vaut mieux prendre sa voiture en leasing ou<br />
l’acheter via un crédit privé. A moins qu’il existe d’autres possibilités?<br />
Yasmine Suter, Zurich Compagnie d’Assurances SA<br />
Leasing automobile<br />
En cas de leasing, Peter verse un acompte<br />
pour une durée et un kilométrage définis.<br />
Chaque mois, il paie le montant restant<br />
pour sa voiture par une mensualité incluant<br />
des intérêts. A l’heure actuelle, ce<br />
taux d’intérêt est compris entre 3,9% et<br />
5,9% en fonction de l’offre, et est parfois<br />
encore plus faible sans actions des fabricants.<br />
Les conditions sont définies dans le<br />
contrat de leasing. La société de leasing<br />
reste propriétaire du véhicule, Peter en est<br />
simplement le détenteur et en paie l’utilisation.<br />
Une fois la durée convenue écoulée,<br />
Peter a trois options:<br />
1. Restitution du véhicule<br />
2. Rachat du véhicule et versement<br />
du montant restant<br />
3. Prolongation du contrat à de nouvelles<br />
conditions<br />
En règle générale, les véhicules en leasing<br />
nécessitent une assurance tous risques.<br />
Les mensualités de leasing sont déductibles<br />
des impôts pour les entreprises qui font un<br />
usage professionnel de leur véhicule, mais<br />
pas pour les particuliers comme Peter.<br />
Crédit privé<br />
Si Peter finance son achat via un crédit, la<br />
voiture lui appartient. Toutefois, il devra<br />
Photos: Adobe Stock; màd<br />
54<br />
5/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
mediservice<br />
rembourser son montant à la banque dans<br />
le délai convenu par contrat, avec des intérêts<br />
en sus. A l’heure actuelle, ces taux d’intérêt<br />
sont compris entre 3,5 et 9,95%. Les<br />
offres varient d’une banque à l’autre et dépendent<br />
de la capacité financière (solvabilité)<br />
du débiteur. En tant que propriétaire,<br />
Peter peut décider lui-même de souscrire<br />
ou non une assurance tous risques.<br />
Contrat de leasing ou de crédit: calculer<br />
les coûts prévisionnels en toute simplicité<br />
via un calculateur de crédit et un calculateur<br />
de leasing.<br />
Si Peter souhaite conserver sa voiture,<br />
le financement par crédit s’avère souvent<br />
plus avantageux, notamment parce qu’il<br />
peut faire des économies d’impôts dans le<br />
cadre d’un achat financé par crédit. Si Peter<br />
a besoin de sa voiture sur une période<br />
limitée et qu’il souhaite régulièrement<br />
conduire des modèles plus récents, le leasing<br />
est pertinent. Par ailleurs, le leasing<br />
protège mieux contre la perte de valeur, ce<br />
qui est particulièrement important avec<br />
les véhicules électriques. Si dans trois ou<br />
quatre ans, il y a de nouvelles batteries<br />
plus compactes qui proposent deux fois<br />
plus d’autonomie, votre modèle actuel ne<br />
vaudra plus grand-chose.<br />
La location plutôt que l’achat ou le<br />
leasing<br />
Il existe d’autres alternatives flexibles au<br />
contrat de crédit ou de leasing: un abonnement<br />
de location automobile avec CARIFY<br />
par exemple. Roulez l’été en cabriolet et<br />
l’hiver en toute sécurité en 4×4: l’abonnement<br />
est plus flexible que l’achat ou le leasing<br />
et est résiliable chaque mois une fois<br />
la durée minimale écoulée.<br />
Leasing:<br />
avantages et<br />
inconvénients<br />
Avantages<br />
––<br />
Flexibilité: durée de 12, 24, 36, 48<br />
ou 60 mois<br />
––<br />
Passage simple à un modèle<br />
plus récent au terme de la durée<br />
(nouveau contrat)<br />
––<br />
Grosses réparations (usure) généralement<br />
limitées dans le cadre du<br />
leasing de véhicules neufs<br />
––<br />
Valeur de rachat fixe, quelle que<br />
soit l’évolution de la valeur<br />
(aucun risque de perte de valeur)<br />
Inconvénients<br />
––<br />
Le leasing automobile peut impacter<br />
la solvabilité et donc les autres<br />
financements.<br />
––<br />
Le véhicule est restitué à l’expiration<br />
du leasing (ou peut être racheté<br />
à la valeur de rachat).<br />
––<br />
Les sinistres sont pris en charge<br />
après la restitution, le client paie<br />
uniquement la franchise.<br />
––<br />
La résiliation du contrat de leasing<br />
est possible mais payante.<br />
Crédit privé:<br />
avantages et<br />
inconvénients<br />
Pour le financement par crédit aussi,<br />
Peter a pesé et noté les principaux<br />
points positifs et négatifs.<br />
Avantages<br />
––<br />
Durées flexibles de 12 à 60 mois<br />
ou plus<br />
––<br />
Le véhicule appartient au preneur<br />
de crédit.<br />
––<br />
En fonction du contrat, possibilité<br />
de rembourser le montant plus<br />
rapidement et de raccourcir la durée<br />
du contrat<br />
––<br />
Libre choix du garage pour le<br />
contrôle technique ou les réparations<br />
Inconvénients<br />
– – Le financement d’une voiture peut<br />
impacter la solvabilité et donc les<br />
autres financements.<br />
– – Les taux d’intérêt sont plus élevés<br />
qu’avec le leasing.<br />
– – Probabilité accrue de coûts de<br />
réparations (usure) élevés au fil<br />
du temps<br />
– – La voiture appartient au détenteur<br />
donc il assume aussi le risque de<br />
perte de valeur.<br />
– – Il faut vendre soi-même son<br />
véhicule.<br />
Chez Zurich, les<br />
membres mediservice<br />
<strong>asmac</strong><br />
bénéficient de conditions préférentielles<br />
supplémentaires.<br />
Accédez facilement et rapidement<br />
à un service hors pair et à des tarifs<br />
attractifs:<br />
zurich.ch/fr/partenaire/login<br />
Votre code d’accès: TqYy4Ucx<br />
0800 33 88 33<br />
Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00<br />
Veuillez indiquer que vous êtes<br />
membre mediservice <strong>asmac</strong>.<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 5/22 55
mediservice<br />
La cuisine saine et savoureuse<br />
Poisson et son<br />
accompagnement<br />
automnal<br />
Martina <strong>No</strong>vak, spécialiste SWICA Communication d’entreprise<br />
Photos: màd; Adobe Stock<br />
56<br />
5/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
mediservice<br />
Truite fumée avec salade tiède de pommes et<br />
de betteraves<br />
Recette pour 4 personnes / Temps de préparation: env. 40 minutes<br />
Ingrédients<br />
La truite et la salade de pommes<br />
et de betteraves<br />
2 morceaux filets de truite, fumée<br />
2 morceaux betteraves rouges, crues<br />
2 morceaux pommes Golden Delicious<br />
1 morceau d’orange<br />
Vinaigre balsamique blanc<br />
Huile d’olive<br />
Quelques graines de moutarde<br />
Aneth<br />
Cresson<br />
Aromate<br />
L’aromate<br />
150 g de céleri-rave<br />
250 g de carottes jaunes<br />
200 g de sel<br />
15 g de poudre de moutarde<br />
10 g de poudre d’oignon<br />
5 g de poudre d’ail<br />
1 g de curcuma<br />
20 g de sucre brut<br />
Pour la truite et la salade de pommes<br />
et de betteraves<br />
Cuire les betteraves à l’eau ou à la vapeur<br />
jusqu’à ce qu’elles soient tendres et les<br />
laisser refroidir un peu. Peler les betteraves<br />
cuites et les couper comme souhaité.<br />
Faire mariner les betteraves coupées<br />
avec le vinaigre balsamique, l’huile<br />
d’olive, les graines de moutarde et l’aromate.<br />
Couper les pommes de la même<br />
taille et les ajouter. Couper les truites<br />
fumées en quatre morceaux de taille<br />
égale. Rectifier l’assaisonnement de la<br />
salade avant de la servir et affiner avec<br />
de l’aneth.<br />
Conseil<br />
Les betteraves peuvent aussi être utilisées<br />
déjà cuites. Ce plat peut éventuellement<br />
être accompagné de mousse de raifort.<br />
Pour l’assaisonnement, il est possible de<br />
remplacer l’aromate par du sel et du<br />
poivre.<br />
Rabais de primes<br />
multiples<br />
En tant que membre de mediservice<br />
vsao-<strong>asmac</strong>, vous bénéficiez chez<br />
SWICA de rabais de primes intéressants<br />
sur les assurances d’hospitalisation<br />
et complémentaires grâce au<br />
contrat collectif et au programme de<br />
bonus BENEVITA. En outre, SWICA<br />
soutient vos activités dans les domaines<br />
de l’activité physique, de<br />
l’alimentation et de la détente avec<br />
jusqu’à 800 francs par année.<br />
www.swica.ch/fr/mediservice<br />
Préparation<br />
Pour l’aromate<br />
Râper le céleri-rave et les carottes jaunes à<br />
l’aide d’une râpe à bircher et les mélanger<br />
avec du sel. Faire sécher le mélange au<br />
four à 80 °C. Ajouter tous les autres ingrédients<br />
et passer le tout au mixeur pour<br />
obtenir un sel fin aux épices.<br />
Dressage<br />
Placer le filet de truite dans l’assiette.<br />
Dresser la salade de betteraves et de<br />
pommes encore tiède en longueur sur le<br />
côté, ajouter un peu de zeste d’orange sur<br />
la salade. Garnir la salade de quartiers<br />
d’orange, de tranches de pomme et de<br />
cresson.<br />
L’organisation de santé SWICA sponsorise l’équipe nationale suisse de cuisine, qui est l’auteur<br />
de cette recette.<br />
vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 5/22 57
Impressum<br />
Adresses de contact des sections<br />
N o 5 • 41 e année • Octobre <strong>2022</strong><br />
Editeur<br />
AG<br />
VSAO Sektion Aargau, Geschäftsstelle: lic. iur. Eric Vultier,<br />
Auf der Mauer 2, 8001 Zurich, vultier@schai-vultier.ch,<br />
tél. 044 250 43 23, fax 044 250 43 20<br />
mediservice vsao-<strong>asmac</strong><br />
Bollwerk 10, case postale, 3001 Berne<br />
Téléphone 031 350 44 88<br />
journal@<strong>asmac</strong>.ch, journal@vsao.ch<br />
www.<strong>asmac</strong>.ch, www.vsao.ch<br />
Sur mandat de l’<strong>asmac</strong><br />
Rédaction<br />
Catherine Aeschbacher (rédactrice en chef),<br />
Kerstin Jost, Fabian Kraxner, Bianca Molnar,<br />
Patricia Palten, Léo Pavlopoulos, Lukas Staub,<br />
Anna Wang<br />
Comité directeur <strong>asmac</strong><br />
Angelo Barrile ( président), <strong>No</strong>ra Bienz<br />
(vice- présidente), Severin Baerlocher,<br />
Christoph Bosshard (invité permanent),<br />
Marius Grädel, Patrizia Kündig, Richard<br />
Mansky, Gert Printzen, Svenja Ravioli,<br />
Patrizia Rölli, Martin Sailer, Jana Siroka,<br />
Clara Ehrenzeller (swimsa)<br />
Impression et expédition<br />
Stämpfli SA, entreprise de communication,<br />
Wölflistrasse 1, 3001 Berne, tél. 031 300 66 66,<br />
info@staempfli.com, www.staempfli.com<br />
Maquette<br />
Oliver Graf<br />
Illustration de la page de couverture<br />
Stephan Schmitz<br />
Annonces<br />
Zürichsee Werbe AG, Fachmedien,<br />
Markus Haas, Laubisrütistrasse 44, 8712 Stäfa<br />
Téléphone 044 928 56 53<br />
E-mail vsao@fachmedien.ch<br />
Tirage<br />
Exemplaires imprimés: 22 500<br />
Certification des tirages par la REMP/FRP<br />
<strong>2022</strong>: 21 679 exemplaires<br />
Fréquence de parution: 6 numéros par année<br />
L’abonnement est inclus dans la contribution<br />
annuelle pour les membres de l’<strong>asmac</strong><br />
ISSN 1422-2086<br />
L’édition n o 6/<strong>2022</strong> paraîtra en<br />
décembre <strong>2022</strong>. Sujet: Lumière.<br />
© <strong>2022</strong> by <strong>asmac</strong>, 3001 Berne<br />
Printed in Switzerland<br />
BL/BS<br />
VSAO Sektion beider Basel, Geschäftsleiterin und Sekretariat:<br />
lic. iur. Claudia von Wartburg, Advokatin, Hauptstrasse 104,<br />
4102 Binningen, tél. 061 421 05 95, fax 061 421 25 60,<br />
sekretariat@vsao-basel.ch, www.vsao-basel.ch<br />
BE VSAO Sektion Bern, Schwarztorstrasse 7, 3007 Berne, tél. 031 381 39 39,<br />
info@vsao-bern.ch, www.vsao-bern.ch<br />
FR<br />
ASMAC section fribourgeoise, Gabriela Kaufmann-Hostettler,<br />
Wattenwylweg 21, 3006 Berne, tél. 031 332 41 10, fax 031 332 41 12,<br />
info@gkaufmann.ch<br />
GE Associations des Médecins d’Institutions de Genève, case postale 23,<br />
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14, amig@amig.ch, www.amig.ch<br />
GR<br />
JU<br />
NE<br />
VSAO Sektion Graubünden, 7000 Coire, Samuel B. Nadig, lic. iur. HSG,<br />
RA Geschäftsführer/Sektionsjurist, tél. 081 256 55 55, info@vsao-gr.ch,<br />
www.vsao-gr.ch<br />
ASMAC Jura, 6, Chemin des Fontaines, 2800 Delémont,<br />
marie.maulini@h-ju.ch<br />
ASMAC section neuchâteloise, Joël Vuilleumier, avocat,<br />
Rue du Musée 6, case postale 2247, 2001 Neuchâtel,<br />
tél. 032 725 10 11, vuilleumier@valegal.ch<br />
SG/AI/AR VSAO Sektion St. Gallen-Appenzell, Bettina Surber, Oberer Graben 44,<br />
9000 St-Gall, tél. 071 228 41 11, fax 071 228 41 12,<br />
Surber@anwaelte44.ch<br />
SO<br />
TI<br />
TG<br />
VD<br />
VS<br />
VSAO Sektion Solothurn, Geschäftsstelle: lic. iur. Eric Vultier,<br />
Auf der Mauer 2, 8001 Zurich, vultier@schai-vultier.ch,<br />
tél. 044 250 43 23, fax 044 250 43 20<br />
ASMAC Ticino, Via Cantonale 8-Stabile Qi, 6805 Mezzovico-Vira,<br />
segretariato@<strong>asmac</strong>t.ch<br />
VSAO Sektion Thurgau, Geschäftsstelle: lic. iur. Eric Vultier,<br />
Auf der Mauer 2, 8001 Zurich, vultier@schai-vultier.ch,<br />
tél. 044 250 43 23, fax 044 250 43 20<br />
ASMAV, case postale 9, 1011 Lausanne-CHUV,<br />
asmav@asmav.ch, www.asmav.ch<br />
ASMAVal, p.a. Maître Valentine Gétaz Kunz,<br />
Ruelle du Temple 4, CP 20, 1096 Cully, contact@asmaval.ch<br />
Suisse centrale (LU, ZG, SZ, GL, OW, NW, UR)<br />
VSAO Sektion Zentralschweiz, Geschäftsstelle: lic. iur. Eric Vultier,<br />
Auf der Mauer 2, 8001 Zurich, vultier@schai-vultier.ch,<br />
tél. 044 250 43 23, fax 044 250 43 20<br />
ZH/SH<br />
VSAO ZH/SH, RA lic. iur. Susanne Hasse,<br />
Geschäftsführerin, <strong>No</strong>rdstrasse 15, 8006 Zurich, tél. 044 941 46 78,<br />
susanne.hasse@vsao-zh.ch, www.vsao-zh.ch<br />
Publication<strong>2022</strong><br />
CIBLÉ<br />
COMPÉTENT<br />
TRANSPARENT<br />
Label de qualité Q-publication<br />
de l’association médias suisses<br />
58<br />
5/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>
POURQUOI<br />
MEDISERVICE ASMAC<br />
FAIT-ELLE CONFIANCE<br />
AU NUMÉRO 1?<br />
SWICA est le partenaire fiable lorsqu‘il est question de solutions<br />
d‘assurance de premier ordre. Grâce au partenariat existant entre<br />
mediservice vsao-<strong>asmac</strong> et SWICA et au système de bonus<br />
BENEVITA, vous bénéficiez d‘une remise sur les primes d‘une<br />
sélection d‘assurances complémentaires pouvant atteindre 30 %*.<br />
*Pour en savoir plus sur les avantages et pour accéder aux<br />
conditions détaillées, rendez-vous sur www.swica.ch/fr/mediservice<br />
En partenariat avec
PLUS<br />
RÉELLEMENT*<br />
DE POSSIBILITÉS<br />
SANS CONTRÔLE<br />
CAPILLAIRE +<br />
SANS SCANNER<br />
ALERTES ET ALARME<br />
COMPATIBLE AVEC<br />
SMARTPHONE #<br />
PETIT APPAREIL<br />
RÉSISTANT À L’ EAU §<br />
Partenariat avec plusieurs<br />
fabricants de pompes établis.<br />
En savoir plus :<br />
www.dexcom.com/pompe<br />
PEUT ÊTRE<br />
COMBINÉ DÈS<br />
MAINTENANT AVEC<br />
CERTAINES POMPES<br />
À INSULINE<br />
APPLICATEUR SIMPLE<br />
D’UTILISATION<br />
SEUL CGM POUR UNE<br />
CONNEXION INTEROPÉRABLE<br />
AVEC PLUSIEURS<br />
SYSTÈMES DE DAI<br />
PARTAGE DES DONNÉES<br />
GLYCÉMIQUES *<br />
POUR LES ENFANTS DÈS<br />
L’ÂGE DE DEUX ANS<br />
UTILISATION POSSIBLE<br />
EN CAS DE DIABÈTE<br />
PENDANT LA GROSSESSE <br />
MOINS PENSER<br />
AU DIABÈTE<br />
JOUR APRÈS JOUR,<br />
II, 1, 2<br />
NUIT APRÈS NUIT<br />
Connaissez à tout moment votre<br />
niveau glycémique et son évolution<br />
d’un simple coup d’oeil sur votre<br />
smartphone ou votre montre #** .<br />
Vous souhaitez obtenir plus d’informations,<br />
notre service clientèle se fera un plaisir de vous aider<br />
Dexcom International Switzerland · Allmendstr. 18 ·<br />
6048 Horw · www.dexcom.com · ch.info@dexcom.com<br />
Dexcom Hotline : 0800 002 810<br />
Mia B. (diabète de type 1)<br />
+<br />
Si vos alertes et vos lectures du G6 ne correspondent<br />
pas à vos symptômes ou à vos attentes, utilisez un<br />
lecteur de glycémie sanguine pour prendre les décisions<br />
relatives au traitement du diabète.<br />
*<br />
Dexcom G6 – La mesure continue du glucose interstitiel<br />
en temps réel (CGM)<br />
II<br />
Des études confirment que les systèmes CGM de Dexcom peuvent<br />
améliorer de façon décisive la qualité de vie des utilisateurs. 1<br />
Des hypoglycémies et des hyperglycémies sont plus rares<br />
et le temps en plage cible peut être maintenu plus longtemps. 2<br />
#<br />
Pour une liste d’appareils compatibles, consultez<br />
www.dexcom.com/compatibility.<br />
§<br />
Le capteur et l’émetteur Dexcom G6 sont résistants à l’eau<br />
et peuvent être immergés à une profondeur de deux mètres<br />
pendant 24 heures maximum, à condition d’avoir été<br />
correctement installés.<br />
**<br />
Une connexion Internet est nécessaire pour la transmission<br />
des données. L’utilisation de l’application Follow est nécessaire<br />
pour le suivi. Les followers doivent toujours vérifier les mesures<br />
fournies par l’application Dexcom G6 ou par le récepteur avant de<br />
prendre des décisions de traitement. Le fait de ne pas utiliser le<br />
Système Dexcom G6 conformément au mode d’emploi fourni avec<br />
votre appareil et disponible sur www.dexcom.com et de ne pas<br />
suivre tous les indications, contre-indications, avertissements,<br />
précautions et mises en garde peut entrainer la non détection<br />
d’une hypogly cémie (faible taux de glucose dans le sang) ou d’une<br />
hyperglycémie (excès de glucose dans le sang) grave et/ou la<br />
prise d’une décision thérapeutique pouvant causer un dommage<br />
corporel. Si vos alertes et vos lectures du G6 ne correspondent<br />
pas à vos symptômes, utilisez un lecteur de glycémie sanguine<br />
pour prendre les décisions relatives au traitement du diabète.<br />
Consultez un médecin si nécessaire, notamment en cas d’urgence<br />
médicale.<br />
Mode d’emploi Dexcom G6 : Dexcom G6 - l’utilisation de votre<br />
G6. © 2018 Dexcom Inc. Tous droits réservés.<br />
1<br />
Gilbert TR et al. Change in Hemoglobin A1c and Quality of Life<br />
with Real-Time Continuous Glucose Monitoring Use by People<br />
with Insulin-Treated Diabetes in the Landmark Study. Diabetes<br />
Technology & Therapeutics 2021; 23(S1): 35–39<br />
2<br />
Beck RW et al. Effect of Continuous Glucose Monitoring on<br />
Glycemic Control in Adults With Type 1 Diabetes Using Insulin<br />
Injections – The DIAMOND Randomized Clinical Trial. JAMA. 2017;<br />
317(4): 371-378<br />
Dexcom, Dexcom G6, Dexcom Follow, Dexcom Share et Dexcom<br />
CLARITY sont des marques déposées de Dexcom, Inc. aux États-<br />
Unis et peuvent être déposées dans d’autres pays. © 2021 Dexcom<br />
Inc. Tous droits réservés. | www.dexcom.com | +1.858.200.0200 |<br />
Dexcom, Inc. 6340 Sequence Drive San Diego, CA 92121 USA |<br />
MDSS GmbH, Schiffgraben 41,30175 Hannover, Germany |<br />
Dexcom International Switzerland = Dexcom International Limited,<br />
Nicosia, Zweigniederlassung Horw | LBL021213 Rev001