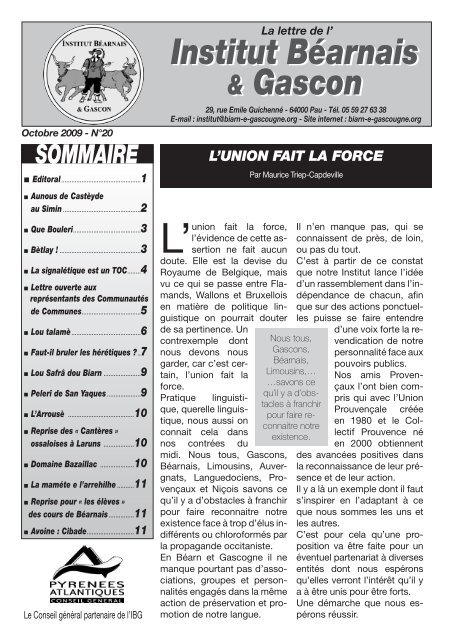La lettre de l - Institut Béarnais Gascon
La lettre de l - Institut Béarnais Gascon
La lettre de l - Institut Béarnais Gascon
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Octobre 2009 - N°20<br />
SOMMAIRE<br />
■ Editoral ...............................................1<br />
■ Aunous <strong>de</strong> Castèy<strong>de</strong><br />
au Simin ..............................................2<br />
■ Que Bouleri ........................................3<br />
■ Bètlay ! ................................................3<br />
■ <strong>La</strong> signalétique est un TOC ........4<br />
■ Lettre ouverte aux<br />
représentants <strong>de</strong>s Communautés<br />
<strong>de</strong> Communes...................................5<br />
■ Lou talamè .........................................6<br />
■ Faut-il bruler les hérétiques ? ..7<br />
■ Lou Safrâ dou Biarn ......................9<br />
■ Pelerî <strong>de</strong> San Yaques ....................9<br />
■ L’Arrousè .......................................10<br />
■ Reprise <strong>de</strong>s « Cantères »<br />
ossaloises à <strong>La</strong>runs ..................10<br />
■ Domaine Bazaillac ....................10<br />
■ <strong>La</strong> maméte e l’arrehilhe ..........11<br />
■ Reprise pour « les élèves »<br />
<strong>de</strong>s cours <strong>de</strong> <strong>Béarnais</strong> ...............11<br />
■ Avoine : Ciba<strong>de</strong>............................11<br />
Le Conseil général partenaire <strong>de</strong> l’IBG<br />
<strong>La</strong> <strong>lettre</strong> <strong>de</strong> l’<br />
<strong>Institut</strong> <strong>Béarnais</strong><br />
& <strong>Gascon</strong><br />
29, rue Emile Guichenné - 64000 Pau - Tél. 05 59 27 63 38<br />
E-mail : institut@biarn-e-gascougne.org - Site internet : biarn-e-gascougne.org<br />
L’UNION FAIT LA FORCE<br />
fait la force,<br />
l’évi<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> cette as-<br />
L’union<br />
sertion ne fait aucun<br />
doute. Elle est la <strong>de</strong>vise du<br />
Royaume <strong>de</strong> Belgique, mais<br />
vu ce qui se passe entre Flamands,<br />
Wallons et Bruxellois<br />
en matière <strong>de</strong> politique linguistique<br />
on pourrait douter<br />
<strong>de</strong> sa pertinence. Un<br />
contrexemple dont<br />
nous <strong>de</strong>vons nous<br />
gar<strong>de</strong>r, car c’est certain,<br />
l’union fait la<br />
force.<br />
Pratique linguistique,<br />
querelle linguistique,<br />
nous aussi on<br />
connait cela dans<br />
nos contrées du<br />
midi. Nous tous, <strong>Gascon</strong>s,<br />
<strong>Béarnais</strong>, Limousins, Auvergnats,<br />
<strong>La</strong>nguedociens, Provençaux<br />
et Niçois savons ce<br />
qu’il y a d’obstacles à franchir<br />
pour faire reconnaitre notre<br />
existence face à trop d’élus indifférents<br />
ou chloroformés par<br />
la propagan<strong>de</strong> occitaniste.<br />
En Béarn et Gascogne il ne<br />
manque pourtant pas d’associations,<br />
groupes et personnalités<br />
engagés dans la même<br />
action <strong>de</strong> préservation et promotion<br />
<strong>de</strong> notre langue.<br />
Par Maurice Triep-Cap<strong>de</strong>ville<br />
Nous tous,<br />
<strong>Gascon</strong>s,<br />
<strong>Béarnais</strong>,<br />
Limousins,…<br />
…savons ce<br />
qu’il y a d’obstacles<br />
à franchir<br />
pour faire reconnaitre<br />
notre<br />
existence.<br />
Il n’en manque pas, qui se<br />
connaissent <strong>de</strong> près, <strong>de</strong> loin,<br />
ou pas du tout.<br />
C’est à partir <strong>de</strong> ce constat<br />
que notre <strong>Institut</strong> lance l’idée<br />
d’un rassemblement dans l’indépendance<br />
<strong>de</strong> chacun, afin<br />
que sur <strong>de</strong>s actions ponctuelles<br />
puisse se faire entendre<br />
d’une voix forte la revendication<br />
<strong>de</strong> notre<br />
personnalité face aux<br />
pouvoirs publics.<br />
Nos amis Provençaux<br />
l’ont bien compris<br />
qui avec l’Union<br />
Prouvençale créée<br />
en 1980 et le Collectif<br />
Prouvence né<br />
en 2000 obtiennent<br />
<strong>de</strong>s avancées positives dans<br />
la reconnaissance <strong>de</strong> leur présence<br />
et <strong>de</strong> leur action.<br />
Il y a là un exemple dont il faut<br />
s’inspirer en l’adaptant à ce<br />
que nous sommes les uns et<br />
les autres.<br />
C’est pour cela qu’une proposition<br />
va être faite pour un<br />
éventuel partenariat à diverses<br />
entités dont nous espérons<br />
qu’elles verront l’intérêt qu’il y<br />
a à être unis pour être forts.<br />
Une démarche que nous espérons<br />
réussir.
2 <strong>La</strong> létre <strong>de</strong> l’Enstitut Biarnés e Gascoû<br />
2009<br />
Aunous <strong>de</strong> Castèy<strong>de</strong> au Simin<br />
Au bèt ras <strong>de</strong> Bic <strong>de</strong> Bigorre, lou bilàdye . <strong>de</strong><br />
Castèy<strong>de</strong>-Doat, en Mountanerés, qu’éy fièr<br />
d’abé bist bà<strong>de</strong> . e neurit Simin Palay. Dab<br />
lous amics dou castèt <strong>de</strong> Mountanè, la coumune<br />
qu’a boulut ourganisa û brespau <strong>de</strong><br />
hèste en la soûe maysoû d’amassa<strong>de</strong>s<br />
toute nabe. Qu’an hèyt apera ûe antropologue<br />
<strong>de</strong> l’Unibersitat <strong>de</strong> Pau, Patricia<br />
Heinigier-Casteret, qui a estudiat la familhe<br />
dous Palay en escoutan lous qui<br />
<strong>de</strong>mouren e lous escriuts. Méy que las<br />
obres literàris, que l’interessabe la bite e<br />
l’ana dou pay Yan e dou hilh Simin. Qu’a<br />
muchat sustout quin lou mestié <strong>de</strong> talhur<br />
qui tribalhabe à las maysoûs e dabe aucasiou<br />
<strong>de</strong> sàbe . noubèles e <strong>de</strong> las<br />
ha coùrre . . Atau qu’abèn lou<br />
parat <strong>de</strong> counta las hèytes e<br />
lou bìbe . dou moùn<strong>de</strong> . , soubén<br />
adoubats à la sauce trufandère.<br />
En ha coùrre . l’agulhe, que<br />
cantourleyaben las cansous à<br />
la mo<strong>de</strong>, ou las qui-s hasèn<br />
entad arrì<strong>de</strong> . . Atau qu’abèn<br />
tout ço qui cau ta <strong>de</strong>berti lou<br />
bilàdye . quoan s’amassaben<br />
enta ha ûe Pastourale.<br />
Lou Yan <strong>de</strong> Palay qu’abè<br />
hère d’esprit e la soue renouma<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> countàyre . que l’abè<br />
hèyt amigalha-s dab lous « <strong>de</strong><br />
la haute » à Bic, Zabiè <strong>de</strong> Cardalhac<br />
e Norbert Rosapelli.<br />
Drins à drins, que prenè méy <strong>de</strong> plasé à-s acounsia<br />
dab éts qu’à coùse . camises e culotes. Aco qu’ou<br />
hé ha counechénces dab lous òmis <strong>de</strong> létres e <strong>de</strong><br />
tiàtre . per Tarbe, Toulouse e Bourdèu. En 1990 daban<br />
lous felìbre . s <strong>de</strong> Paris e <strong>de</strong> Proubénce, bienguts<br />
à Tarbe, qu’abou lou parat <strong>de</strong> presenta pouesies<br />
<strong>de</strong> las soûes. Mistral qu’ou hé ûe létre-preface enta<br />
la purmère tira<strong>de</strong> dous soûs « Coùn<strong>de</strong> . s biarnés ».<br />
Edouard Bouciez, proufessou <strong>de</strong> léngues roumanes<br />
à Bourdèu, qu’ou banta plâ beroy. <strong>La</strong>béts la familhe<br />
Palay que-s en ana enta Bic e que coumença<br />
ûe tempoura<strong>de</strong> d’escadénces <strong>de</strong> las bounes…e <strong>de</strong><br />
las àute . s ! En aquéres, lou Simin tabé que-s ère<br />
boutat à escrìbe . e qu’abou prèts, coum tabé lou<br />
Miquèu <strong>de</strong> Camelat d’Arréns. Atau aquéts gouyats<br />
qu’estén à la foundacioû <strong>de</strong> l’Escole Gastoû Febus<br />
en 1896, dab la rebiste « Reclams <strong>de</strong> Biarn e Gas-<br />
A tau qu’abèn<br />
lou parat <strong>de</strong><br />
counta las<br />
hèytes e lou bìbe .<br />
dou moùn<strong>de</strong> . ,<br />
soubén adoubats<br />
à la sauce<br />
trufandère.<br />
cougne » e, méy tard, « <strong>La</strong> Bouts <strong>de</strong> la terre ». Lou<br />
Yan <strong>de</strong> Palay que-s ère enteressat à la poulitique<br />
coum lous pouètes-oubrès <strong>de</strong> 1848, e à la bère bite<br />
qui-s poudè mia per Bourdèu. Lou Simin, emplegat<br />
au Patriote <strong>de</strong> Pau, que <strong>de</strong>biengou yournalìste<br />
. , counferenciàyre . , autou dramatic (lou<br />
« Franchiman »), cansoè, roumanciè (« Lous<br />
très gouyats <strong>de</strong> Bor<strong>de</strong>biélhe »). En 1899, la<br />
Filadèlfe <strong>de</strong> Yèr<strong>de</strong> qu’ou hé l’aunou d’ûe<br />
preface qui poudét léye . en aquéste « Létre<br />
<strong>de</strong> l’I.B.G. » entau soû purmè lìbe . « Bercets<br />
<strong>de</strong> youenésse e coùn<strong>de</strong> . s enta rìse . ». En<br />
suberpés <strong>de</strong> las soûes Batalères dou Talhur<br />
<strong>de</strong> Pau toutes semmanes, <strong>de</strong> pouesies<br />
en gran aboùn<strong>de</strong> . , que goardam l’obre màye . dou<br />
« Dicciounàri dou Biarnés<br />
e dou Gascoû mo<strong>de</strong>rnes »<br />
encoère publicat per lou<br />
Centre National <strong>de</strong> la Recherche<br />
Scientifique.<br />
<strong>La</strong> counferencière <strong>de</strong><br />
Castèy<strong>de</strong> qu’essaya d’esplica<br />
quin lou Yan, permou<br />
dou soû estat <strong>de</strong> mestierau,<br />
nou-s poudè goàyre .<br />
enteressa aus paysâs,<br />
e quin lou Simin – atau<br />
coum lou Mistral – e-s ère<br />
emplegat à ha bàle . lou<br />
parla dou petit moùn<strong>de</strong> . ,<br />
tan diferén <strong>de</strong> la balée<br />
d’Aspe au Mountanerés,<br />
més coumprés per tout<br />
lou Biarn. Dab l’Escole Gastoû Febus, que boulou<br />
apita ûe léngue escriute, tau coum la léye . n adàyse<br />
encoère oéy, lous d’Ortès ou <strong>de</strong> Pountac, lous<br />
d’Aussau ou d’Arzac. Malurousamén, <strong>de</strong>spuch quis<br />
soun horabiats, lous Reclams (qui nou soun pas<br />
méy <strong>de</strong> noùste . ) qu’an hèyt à Palay l’escàrni <strong>de</strong> l’arrebira<br />
en û gnìrgou <strong>de</strong> Nousèyoun.<br />
L’Enstitut Biarnés e Gascoû que presentabe à<br />
Castèy<strong>de</strong> las tira<strong>de</strong>s purmères <strong>de</strong> las obres dou Simin<br />
e que benou tabé las darrères tira<strong>de</strong>s qui hé<br />
paréche . auganasses : Lous trés gouyats <strong>de</strong> Bor<strong>de</strong>biélhe,<br />
Case, <strong>La</strong> qui a troubat û mèste . …<br />
Puch que nou poudoum pas enténe . ad aquére<br />
aucasioû, que publicam oéy aci la pouesie hèyte<br />
per lou Simin <strong>de</strong> Palay en l’aunou <strong>de</strong> Castèy<strong>de</strong>.<br />
Que coumprenerat perqué lou soû bilàdye . boulè<br />
tourna l’aumenance.
2009 <strong>La</strong> létre <strong>de</strong> l’Enstitut Biarnés e Gascoû<br />
3<br />
Que bouleri bètlAy !<br />
Filadèlfo <strong>de</strong> Yèrdo<br />
Que bouleri tourna tau mé petit bilàdye . ,<br />
Saya d’y retrouba lous més oélhs <strong>de</strong> maynàdye .<br />
E l’arrì<strong>de</strong> . tout nau e frésc dous més dèts ans,<br />
Lous cascaréts 1 dous pouts 2 qui cantaben matîes 3<br />
E la tringuéte 4 , s’ous camîs, dous boéus pesans.<br />
O ! rebé<strong>de</strong> . l’arriu à l’aygue beroy néte .<br />
E refresqui-m lous pots au briu <strong>de</strong> la canéte<br />
Qui déu chourra toustém au penén dou coustoû,<br />
Cerca céps per las héus luséntes <strong>de</strong> rousa<strong>de</strong>,<br />
Per <strong>de</strong>bat lous castagns ha drin <strong>de</strong> repausa<strong>de</strong><br />
En aleda l’auréy qui bién <strong>de</strong> Moungastoû 5 !...<br />
Que bouleri, tabé, tourna bé<strong>de</strong> . l’escole…<br />
Oun éy da<strong>de</strong>, Segnou, la gaye patricole 6<br />
Qui, d’à bèts cops, hasè ‘nmali 7 moussu-u reyén ?<br />
Adare qu’èm touts biélhs, au méns lous qui <strong>de</strong>mouren ;<br />
Quin la passen, aquéts, e quins parsâs e houren ?...<br />
Éy toustém drét lou càssou oun cantabe lou bén ?<br />
E la glèyse arpoeyta<strong>de</strong> au candau 8 <strong>de</strong> la coste,<br />
Qui goar<strong>de</strong> noùste . s mourts tranquìle . s à l’endoste<br />
Be-m haré gay d’y ana encoère prega Diu,<br />
D’y canta lou Credo <strong>de</strong> ma bouts tremoulénte,<br />
D’enténe . trangalha 9 la campane balénte<br />
Doun lou clam 10 e tremibe 11 au cèu arrayadiu 12 !<br />
Qui sap si tournarèy, abans la fî dou biàdye .<br />
Rebé<strong>de</strong> . encoère û cop lou mé petit bilàdye .<br />
Qui-s arraye, acera, tranquìle . , au sou lheban,<br />
Oun perpite 13 toustém l’amne dous mourts <strong>de</strong> case,<br />
Lou mé bilàdye . , au miéy dous castagns, qui s’alase 14<br />
Héns lou càlme . e la pats dous dies qui se-n ban ?<br />
Simin Palay – (1944)<br />
1 cris aigrelets (semblables au son d’une crécelle).<br />
2 coqs.<br />
3 matines.<br />
4 drelin (<strong>de</strong>s sonnailles).<br />
5 Mongaston, village voisin.<br />
6 joyeuse assemblée.<br />
7 Enmali --- mettre en colère.<br />
8 accrochée au versant.<br />
9 dreliner, sonner à petits coups répétés.<br />
10 écho.<br />
11 tremblait, vibrait.<br />
12 ensoleillé.<br />
13 palpite.<br />
14 s’étale.<br />
(graphie <strong>de</strong> l’auteur)<br />
Si you counechéy ra migueto<br />
Que, d’uo bouts tan heresqueto,<br />
N’este libe a cantat Palay,<br />
Qu’òu diseri : Bètlay ! Migueto, bètlay !<br />
Mies coumplimens, bèro maynado !<br />
Aro èt celèbro àutan que nado,<br />
S’òu diseri sense <strong>de</strong>slay,<br />
Bètlay ! bètlay ara maynado ! bètlay!<br />
Qu’abet enspirat uo canto<br />
Douço e heresco è musicanto<br />
Coumo u sounyis <strong>de</strong> du Bellay…<br />
Bètlay ! bètlay à r’encantanto ! bètlay !<br />
E bous pou<strong>de</strong>t banta, r’artisto,<br />
D’abé hèyt béroyo counquisto,<br />
S’ou diseri d’u frans eslay,<br />
Bètlay ! bètlay hòu ! à r’artisto, bètlay !<br />
« à Simin Palay, entat sue libe »<br />
Ce poème-préface a été offert par la déjà célèbre<br />
poétesse bigourdane, pour le livre publié<br />
en 1899<br />
« Bercets <strong>de</strong> yoénésse e coun<strong>de</strong>s enta rise »<br />
Bètlay : bravo à la jeune fille <strong>de</strong>stinataire <strong>de</strong>s poèmes,<br />
puis à l’auteur-artiste (<strong>de</strong>rnier couplet)<br />
parla biarnés dou Mountanerés (graphie <strong>de</strong> l’auteur)<br />
Découvrez sans plus tar<strong>de</strong>r<br />
le nouveau site <strong>de</strong><br />
l’<strong>Institut</strong> <strong>Béarnais</strong> et <strong>Gascon</strong><br />
Il est accessible avec les liens ci-<strong>de</strong>ssous :<br />
www.languebéarnaise.com<br />
ou<br />
www.languegasconne.com<br />
Vous y trouverez l’agenda<br />
<strong>de</strong> nos manifestations,<br />
nos récentes publications,<br />
les anciens numéros <strong>de</strong> la Lettre <strong>de</strong> l’IBG.<br />
Différents liens vers<br />
<strong>de</strong>s associations partenaires.<br />
Prochainement un blog sera ouvert.
4 <strong>La</strong> létre <strong>de</strong> l’Enstitut Biarnés e Gascoû<br />
2009<br />
qu’il est question<br />
<strong>de</strong> placer un panneau por-<br />
J’apprends<br />
tant l’inscription «Valensun »<br />
à l’entrée du village <strong>de</strong> Balansun.<br />
Et comme un malheur n’arrive jamais<br />
seul, il est à craindre que ce<br />
même panneau sera pieusement<br />
orné d’une dévote petite croix occitane,<br />
à l’intention <strong>de</strong>s fidèles <strong>de</strong><br />
la sainte Église occitaniste, apostolique<br />
et rocambolesque.<br />
Faut-il que je produise une copie<br />
<strong>de</strong> toutes les <strong>lettre</strong>s, <strong>de</strong> tous<br />
les poèmes que Roger <strong>La</strong>passa<strong>de</strong><br />
m’a envoyés quand je<br />
vivais encore à Balansun<br />
? C’est toujours<br />
« Balansun » et non «<br />
Valensun » qui apparaît<br />
sous sa plume, quand il<br />
évoque en béarnais, au<br />
fil <strong>de</strong>s saisons, le village<br />
d’où ma famille est originaire.<br />
Et Balansun est<br />
aussi le titre d’une <strong>de</strong> mes toutes<br />
premières chansons, où j’égrenais<br />
les vieux noms béarnais <strong>de</strong>s maisons<br />
<strong>de</strong> mon village.<br />
Nous considérions l’un et l’autre<br />
que les noms propres pouvaient<br />
échapper quelque peu à la normalisation<br />
<strong>de</strong> toutes choses,<br />
graphie, langue, mentalités, qui<br />
est <strong>de</strong>venue la priorité <strong>de</strong> l’occitanisme.<br />
Car tout doit désormais<br />
recevoir l’estampille occitaniste.<br />
J’ai entendu récemment un salarié<br />
<strong>de</strong> l’<strong>Institut</strong> Occitan annoncer<br />
le plus sérieusement du mon<strong>de</strong><br />
qu’il avait l’intention <strong>de</strong> placer <strong>de</strong>s<br />
panonceaux en occitan au pied <strong>de</strong><br />
quelques grands et beaux arbres<br />
du département (pour que les promeneurs<br />
ne meurent pas idiots,<br />
probablement ?). Si nous n’y prenons<br />
pas gar<strong>de</strong>, tout ce qui nous<br />
la signalétique est un toC<br />
Par Marilis Orionaa<br />
[Envoyé à <strong>La</strong> République <strong>de</strong>s Pyrénées début juin pour la rubrique « Sous la plume <strong>de</strong> »,<br />
cet article n’a pas été publié et je n’ai reçu aucune réponse. M.O.]<br />
…la graphie<br />
traditionnelle<br />
du béarnais<br />
fait partie<br />
intégrante<br />
<strong>de</strong> notre<br />
patrimoine…<br />
entoure sera bientôt étiqueté par<br />
nos lexicomanes occitanopathes,<br />
la passion <strong>de</strong> la nomenclature<br />
s’apparentant chez eux à un trouble<br />
obsessionnel compulsif.<br />
Et ils ne sont pas près <strong>de</strong> se calmer,<br />
ayant reçu le soutien <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins<br />
légistes <strong>de</strong> l’onomastique<br />
occitane, qui autopsient les noms<br />
<strong>de</strong> lieux comme <strong>de</strong>s cadavres, et<br />
harcèlent les élus pour que soit<br />
exposé aux yeux <strong>de</strong> tous, sur un<br />
panneau en bonne graphie, comme<br />
dans un bocal rempli <strong>de</strong> for-<br />
mol, le résultat <strong>de</strong> leurs<br />
précieuses recherches.<br />
Le découragement me<br />
gagne à la pensée <strong>de</strong><br />
tous les touristes à qui<br />
il va falloir expliquer que<br />
ça s’écrit « va » mais que<br />
ça se prononce « ba ». De<br />
guerre lasse, dans quelques<br />
années, quand plus<br />
personne n’aura le courage <strong>de</strong><br />
rectifier, on entendra les nouveaux<br />
venus prononcer « Valensun» avec<br />
un v comme dans victoire, drôle<br />
<strong>de</strong> victoire en vérité, au lieu du<br />
béarnais « Balansû ».<br />
On m’objectera que j’ai moi-même<br />
utilisé la graphie normalisée<br />
jusqu’à maintenant. Avais-je vraiment<br />
le choix, intoxiquée comme<br />
je l’ai été par un père occitaniste ?<br />
Il n’est pas si facile <strong>de</strong> passer d’une<br />
graphie à l’autre. Et il m’aura fallu<br />
beaucoup <strong>de</strong> temps, et <strong>de</strong> doutes,<br />
pour comprendre cette évi<strong>de</strong>nce,<br />
à savoir que la graphie traditionnelle<br />
du béarnais fait partie intégrante<br />
<strong>de</strong> notre patrimoine, et mérite<br />
d’être protégée <strong>de</strong>s attaques<br />
<strong>de</strong>s occitanistes qui la traitent <strong>de</strong><br />
« honteuse », alors que ce sont<br />
eux les « bergougnous », eux qui<br />
<strong>de</strong>vraient avoir honte <strong>de</strong> brandir<br />
<strong>de</strong>puis quarante ans une graphie<br />
pédante, discriminante, déstabilisante<br />
à seule fin <strong>de</strong> ringardiser et<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>ssaisir <strong>de</strong> sa propre langue<br />
une population béarnophone peu<br />
encline à embrasser la foi occitane.<br />
<strong>La</strong> pédagogie a bon dos. On<br />
nous dit que ça traumatiserait le<br />
pourcentage dérisoire d’enfants<br />
scolarisés en graphie occitane<br />
s’ils apercevaient une autre graphie<br />
sur les panneaux. Mais qu’on<br />
bafoue <strong>de</strong>s vivants et <strong>de</strong>s morts,<br />
ça ne gêne personne apparemment.<br />
Je pense à Bernard <strong>de</strong><br />
Massiòu, paysan <strong>de</strong> Balansun, qui<br />
nous a quittés il y a peu (il avait<br />
cinquante-six ans). Pendant six ou<br />
sept ans, jusqu’en 2007, il a animé<br />
bénévolement chaque semaine<br />
une savoureuse émission en béarnais<br />
sur Radio Orthez, totalement<br />
improvisée et anarchique, avec le<br />
matériel souvent défectueux d’un<br />
petit studio <strong>de</strong> fortune, mais dans<br />
une langue béarnaise vigoureuse,<br />
d’une éloquence à laquelle fort<br />
peu d’occitanistes peuvent prétendre<br />
aujourd’hui, catéchisme<br />
et bredouillage leur tenant lieu <strong>de</strong><br />
langue le plus souvent. Bernard <strong>de</strong><br />
Massiòu n’appréciait pas beaucoup<br />
l’arrogance occitaniste subventionnée,<br />
c’est le moins qu’on<br />
puisse dire.<br />
À Balansun, comme partout, il<br />
y a <strong>de</strong> plus en plus <strong>de</strong> maisons<br />
neuves et <strong>de</strong> moins en moins <strong>de</strong><br />
paysans. Balansun n’a déjà plus<br />
grand-chose à voir avec ce qu’il a<br />
été jusque dans les année soixante,<br />
le plus beau village du mon<strong>de</strong>,<br />
celui <strong>de</strong> mon enfance. Qu’on lui<br />
laisse au moins son nom.
2009 <strong>La</strong> létre <strong>de</strong> l’Enstitut Biarnés e Gascoû<br />
5<br />
Monsieur le Prési<strong>de</strong>nt,<br />
Vous avez manifesté le désir <strong>de</strong> pourvoir nos<br />
agglomérations <strong>de</strong> plaques indicatrices présentant<br />
les noms <strong>de</strong> lieu en « langue régionale».<br />
Par cette démarche, vous désirez, avec raison,<br />
souligner le caractère particulier <strong>de</strong>s noms <strong>de</strong> nos<br />
villes, villages et autres lieux habités, par rapport au<br />
français.<br />
Dans cette matière, qui touche si profondément<br />
notre patrimoine culturel, le souci <strong>de</strong> l’authenticité et<br />
<strong>de</strong> la justesse <strong>de</strong>s appellations paraît essentiel. Sans<br />
une parfaite adéquation <strong>de</strong> la forme <strong>de</strong>s noms affichés<br />
avec la réalité philologique, toponymique et historique,<br />
les indications données manqueraient totalement<br />
leur but. Plus grave encore, elles dévoieraient<br />
lour<strong>de</strong>ment l’intention première.<br />
Or tel semble être le cas <strong>de</strong>s formes orthographiques<br />
<strong>de</strong> nos noms <strong>de</strong> villes et <strong>de</strong><br />
lieux dans l’orthographe dite « occitane ».<br />
Le terme « occitan(e) » tente <strong>de</strong> passer<br />
dans l’usage commun <strong>de</strong>puis quelques<br />
décennies sans un examen critique suffisant,<br />
ou suffisamment entendu. <strong>La</strong> caractéristique<br />
essentielle <strong>de</strong>s langues qualifiées<br />
abusivement d’« occitanes », est <strong>de</strong><br />
reposer sur un principe orthographique<br />
inadéquat. Par imitation primaire <strong>de</strong>s écritures<br />
médiévales — d’ailleurs mal connues<br />
et mal interprétées — la graphie « occitane<br />
» recherche une normalisation graphique<br />
pour l’ensemble du domaine d’oc.<br />
Cette normalisation imposée défigure par<br />
l’écrit la langue réelle <strong>de</strong>s différents dialectes<br />
dans leur développement historique<br />
jusqu’à nos jours.<br />
Il en résulte <strong>de</strong>ux graves inconvénients :<br />
1° Les spécificités <strong>de</strong> chacun <strong>de</strong>s dialectes, transcrites<br />
dans la graphie « occitane », disparaissent.<br />
Comme le montrent diverses étu<strong>de</strong>s, cette graphie,<br />
importée à la fin <strong>de</strong>s années 1960, est dépourvue <strong>de</strong><br />
réalité scientifique et sociologique. Elle est purement<br />
imaginaire.<br />
2° Entravés par une orthographe reconstruite sur<br />
<strong>de</strong>s principes linguistiquement douteux, les lecteurs<br />
<strong>de</strong>s transcriptions en graphie « occitane », ne<br />
reconnaissent pas la langue qu’ils parlent ou qu’ils<br />
connaissent parce qu’elles ne répon<strong>de</strong>nt pas à la réalité<br />
langagière. Elles mettent entre le nom écrit et la<br />
LETTRE OUVERTE<br />
AUX REPRÉSENTANTS DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES<br />
Dans cette<br />
matière, qui<br />
touche si<br />
profondément<br />
notre<br />
patrimoine<br />
culturel, le<br />
souci <strong>de</strong><br />
l’authenticité<br />
et <strong>de</strong> la<br />
justesse <strong>de</strong>s<br />
appellations<br />
paraît<br />
essentiel.<br />
ville elle-même l’obstacle d’une orthographe difficile,<br />
pour ne pas dire étrange, aux gens du pays et du<br />
temps présent.<br />
En revanche, au cours <strong>de</strong> normalisations et <strong>de</strong> retouches<br />
successives <strong>de</strong>puis le milieu du XIX e siècle<br />
(Lespy, Bourciez, l’Escole Gastoû Febùs, Simin Palay<br />
et son monumental Dictionnaire du béarnais et<br />
du gascon mo<strong>de</strong>rnes, réédité par le CNRS en 1991,<br />
André Sarrailh), l’écriture béarnaise et gasconne<br />
s’inscrit dans la continuité réelle <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong> la<br />
langue en Béarn.<br />
C’est pourquoi, nous vous sollicitons <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r<br />
ou <strong>de</strong> faire procé<strong>de</strong>r à une étu<strong>de</strong> philologique, pragmatique<br />
et sérieuse, avant <strong>de</strong> prendre <strong>de</strong>s décisions<br />
et <strong>de</strong> placer <strong>de</strong>s panneaux signalétiques à<br />
l’entrée <strong>de</strong> nos villages et <strong>de</strong> nos villes. Nous<br />
nous tenons à votre disposition pour fournir<br />
aux membres <strong>de</strong>s commissions responsables<br />
en la matière la documentation que<br />
vous jugerez utile.<br />
Restant donc à votre disposition pour tout<br />
complément d’information et dans l’espoir<br />
d’être entendus, nous vous prions d’agréer,<br />
Monsieur le Prési<strong>de</strong>nt, l’expression <strong>de</strong> notre<br />
considération,<br />
Juin 2009<br />
• André Joly-Subervielle<br />
professeur émérite, linguistique générale<br />
Université <strong>de</strong> Paris IV-Sorbonne<br />
courriel : jolygurs@yahoo.fr<br />
• Bernard Moreux<br />
Agrégé <strong>de</strong>s Lettres, Docteur en Linguistique,<br />
coauteur <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux dictionnaires français-béarnais,<br />
béarnais-français reposant sur une enquête prolongée<br />
<strong>de</strong>s locuteurs natifs,<br />
ex-professeur agrégé à l’Université <strong>de</strong> Montréal,<br />
ex-maître <strong>de</strong> conférence à l’Université <strong>de</strong> Pau et <strong>de</strong>s<br />
Pays <strong>de</strong> l’Adour,<br />
ex-membre <strong>de</strong> l’équipe «Syntaxe et Sémantique» <strong>de</strong><br />
l’Université <strong>de</strong> Toulouse-Le Mirail-CNRS.
6 <strong>La</strong> létre <strong>de</strong> l’Enstitut Biarnés e Gascoû<br />
2009<br />
Que-s y brounibe lè aquéste . matî e qu’anabe<br />
prou mau tau pràube . Yan dou Talamè,<br />
après ûe pataca<strong>de</strong> dap la Rameline ! Que<br />
l’abè pregat d’ana préne . lou frés <strong>de</strong>hore. Qu’ère<br />
sourtit, chéns se tourna bira.<br />
Permou, esmali<strong>de</strong> coum ère, la<br />
Rameline ne-n aberé pas hèyt<br />
qu’û boussî, dou pràube . Yan.<br />
Qu’ère l’ibèr, que hasè rét, labéts<br />
que-s en anè ta-s hica<br />
à l’endoste à l’estanguét, au<br />
camî <strong>de</strong> Palassét. Que y anabe<br />
soubén <strong>de</strong>sempuch quauque . s<br />
dies, sustout que y abè arribat<br />
ûe beroye gouye, charmante<br />
e pas trop saubàdye . . Aci que<br />
couménce l’istoère.<br />
Isidore <strong>de</strong> Bouhebén qu’ère<br />
talamè. Mantûs cops que l’abèn aperat ta trouba<br />
ûe gouyate ta quàuque . eretè ou û caddèt ta ûe<br />
eretère. Que cau dìse . que n’ère pas tout cop aysit<br />
: ou la gouyate n’ère pas prou rìche . e beroye,<br />
ou lou garçoû qu’ère méy chuque-doèles que tribalhadou.<br />
Més tout cop qui hasè û aha, qu’ère<br />
pagat dap û pa <strong>de</strong> souliès. Qu’ère lou prèts ! <strong>La</strong><br />
Marie qu’ère la soûe hémne, tribalhadoure, que<br />
sabè ha <strong>de</strong> boune garbure. Que disèn tabé que<br />
n’abè pas embentat l’aygue clare – lou moùn<strong>de</strong> .<br />
qu’éy machan – qu’ère ûe boune hémne. N’abèn<br />
pas familhe, toutû qu’abèn hèyt ço qui calè. Isidore<br />
qu’abè hèyt lou camî <strong>de</strong> Lour<strong>de</strong>s à pè, ta ha<br />
brusla û cièrye . à la « Grotte ». Arré n’y abè hèyt.<br />
Û matî, en ana soâ l’aubéte, Sidonie, la Brouche,<br />
que trouba û paquét au pè <strong>de</strong> la porte <strong>de</strong><br />
la glìsi : qu’ère û maynadot badut <strong>de</strong> la noéyt,<br />
troussat déns ûe bourrasséte. Ûe brouche qu’éy<br />
au courén <strong>de</strong> tout ço qui-s passe au pèys. Bìste .<br />
qu’anè pourta lou paquetot à la Marie dou Talamè.<br />
Aquére hémne qu’arcoelhou aquét maynadot<br />
coum û doû dou Boun Diu. Isidore qu’esté<br />
méy retrèyt, més que hasou coum si ère countén,<br />
que-n ère segu, que sabou ha lou beroy. Coum<br />
ère û troubét, que l’aperèn « Yan dou Talamè ».<br />
lou talamè<br />
Par <strong>La</strong>urent CAMGUILHEM<br />
Quoan estou<br />
segure da la<br />
soûe infourtune,<br />
qu’entrè héns<br />
ûe grane malìcie.<br />
Que y abou<br />
ûe grane batsarre.<br />
Touts lous<br />
noums que-y<br />
passèn, mème<br />
lous qui nou<br />
soun pas trop<br />
beroys à dìse .<br />
Aquét maynat qu’esté ensegnat coum si ère<br />
lou lou. Qu’anè ta l’escole <strong>de</strong> las surs à Mourlane<br />
enta apréne . à léye . e à escrìbe . . Quoan arribè au<br />
reyimén, qu’esté hicat aus burèus e aquiu, que<br />
<strong>de</strong>biengou engoère méy sapién. Que tourna ta<br />
case, que-s hica à coumerceya dap lou catalogue<br />
<strong>de</strong> Manufrance, e lous ahas que marchèn<br />
prou plâ. Que pensa tabé à-s marida. Que y abè<br />
ûe bère gouyate qui-s aperabe Rameline dou<br />
Bousquetoû. Qu’ère cousturère, que-s maridèn<br />
touts dus, e que cau dìse . que ne mancaben pas<br />
d’arré. <strong>La</strong> Rameline qu’ère balénte, qu’abè ûe<br />
maysoû ad ére e tout que-s passabe plâ. N’èren<br />
pas déns la rèyte. Qu’èren urous, e que durè bèt<br />
téms… Més toutû la Rameline que troubabe que<br />
lou Yan que la <strong>de</strong>chabe hère tranquìle . au lhéyt <strong>de</strong>sempuch<br />
quàuque . téms. Que-s meshida que-s y<br />
passabe quàuqu’arré. Quoan estou segure da la<br />
soûe infourtune, qu’entrè héns ûe grane malìcie.<br />
Que y abou ûe grane batsarre. Touts lous noums<br />
que-y passèn, mème lous qui nou soun pas trop<br />
beroys à dìse . (fegnan, sac à bî, putassè, t’at minyeras<br />
tout, n’ès pas boû que ta coùrre . ) e que-n<br />
pàssi. Ne parlè pas <strong>de</strong> cournar permou que la<br />
praubote, dap lou soû quin-<br />
Mantûs cops<br />
que l’abèn<br />
aperat ta trouba<br />
ûe gouyate ta<br />
quàuque . eretè<br />
ou û caddèt ta<br />
ûe eretère.<br />
tau e lou soû mentoû plé <strong>de</strong><br />
barbe, que hasè meylèu pòu<br />
aus òmis.<br />
Lou praùbe . Yan que-s <strong>de</strong>fendè<br />
coum poudè. « Més,<br />
Rameline, si hèy aco, si bau<br />
bé<strong>de</strong> . la gouye, qu’éy ta que tu<br />
ne sies pas méy fatiga<strong>de</strong>, que<br />
bouy que sies toustém beroye e frésque, e si bau<br />
bé<strong>de</strong> . la gouye à l’estanguét <strong>de</strong> quoan en quoan,<br />
qu’éy ta-t espargna à tu ». <strong>La</strong> malìcie qu’esté encoère<br />
méy horte. « Que saberas, gran fegnan,<br />
que ne souy pas fatiga<strong>de</strong> e que ne bouy pas esta<br />
espargna<strong>de</strong> ! »<br />
Qu’éy permou d’aco qui abét troubat lou Yan,<br />
pas trop fièr, tout curt, aquéste . matî, parti ta l’estanguét<br />
ta-s hica à l’endoste.
2009 <strong>La</strong> létre <strong>de</strong> l’Enstitut Biarnés e Gascoû<br />
7<br />
Faut-il bruler les hérétiques ?<br />
En feuilletant au hasard la Petite encyclopédie<br />
occitane d’André Dupuy, 1972, je suis tombé,<br />
p. 227, sur un texte <strong>de</strong> Charles CAMPROUX,<br />
intéressant à plusieurs titres :<br />
L’œuvre <strong>de</strong> Louis Alibert (titre <strong>de</strong> la page, au<br />
<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> la photo d’Alibert en 1935).<br />
« Elle nous a donné d’abord et essentiellement<br />
une graphie qui débarrasse la langue d’oc<br />
<strong>de</strong> l’hérésie linguistique qui consiste à adapter<br />
la graphie d’une langue différente à une langue<br />
pour laquelle elle n’est point faite ; ce faisant elle<br />
renoue la tradition occitane et lie le passé à l’avenir;<br />
ce faisant également, elle a reforgé l’unité<br />
relative <strong>de</strong> l’occitan, que j’appellerai limousin,<br />
celui <strong>de</strong>s troubadours, et qui comprend grosso<br />
modo les parlers provençaux, languedociens,<br />
dauphinois ou alpins, auvergnats et limousins.<br />
Enfin elle a resserré les liens avec l’occitan que<br />
j’appellerai « estranh » : le catalan d’une part, les<br />
parlers gascons d’autre part; ce faisant, elle a<br />
rendu possible une compénétration plus intime<br />
qui nous rappelle celle qui exista du XI e au XVI e<br />
siècle encore (dans les textes <strong>de</strong>s <strong>lettre</strong>s <strong>de</strong>s rois<br />
<strong>de</strong> Navarre et <strong>de</strong> Béarn, par exemple). »<br />
Charles CAMPROUX<br />
Comme d’habitu<strong>de</strong>, Dupuy ne donne aucune référence<br />
et je n’ai pu encore localiser ce texte, et<br />
mes <strong>de</strong>ux courriels à M. Dupuy pour en savoir plus<br />
sont restés sans réponse.<br />
Je ne m’arrête ici que sur le passage souligné,<br />
tellement il laisse abasourdi quiconque a la moindre<br />
ouverture sur l’histoire <strong>de</strong>s écritures. Comment<br />
un agrégé <strong>de</strong> <strong>lettre</strong>s, qui fut chargé <strong>de</strong> cours <strong>de</strong><br />
langue et <strong>de</strong> littérature occitanes à la faculté <strong>de</strong><br />
Montpellier, a-t-il pu écrire une telle ineptie ?<br />
Il ignore donc que l’alphabet grec (langue indoeuropéenne)<br />
est une adaptation <strong>de</strong> l’alphabet phéni-<br />
Par Jean <strong>La</strong>fitte (27 avril 2009)<br />
Car il faut distinguer<br />
la notation<br />
phonétique qui<br />
relève <strong>de</strong> la<br />
science folklorique<br />
et la structure<br />
grammaticale<br />
qui relève <strong>de</strong> l’art<br />
<strong>de</strong> l’écriture.<br />
cien (langue sémitique) ; que<br />
l’étrusque est une adaptation<br />
du grec, le latin <strong>de</strong> l’étrusque,<br />
et celui <strong>de</strong> toutes les langues<br />
romanes, du latin ?<br />
Et <strong>de</strong> même que le vietnamien<br />
a adopté l’alphabet latin grâce<br />
au père jésuite Alexandre <strong>de</strong><br />
Rho<strong>de</strong>s, au XVII e s. ; <strong>de</strong> même<br />
le basque, et le breton… Et que<br />
le turc, après avoir adopté l’alphabet arabe, l’a abandonné<br />
au profit <strong>de</strong> l’alphabet latin sous le régime <strong>de</strong><br />
Mustapha Kemal Ataturk dans les années 1920 …<br />
Mais l’essentiel pour un occitaniste est d’inculquer<br />
l’idée que l’« occitan » a eu une graphie<br />
propre et originale du temps <strong>de</strong>s Troubadours,<br />
et que la déca<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> la langue consécutive à<br />
la croisa<strong>de</strong> albigeoise a inféodé l’écriture occitane<br />
à la française. C’est faux jusqu’au XVIe s. inclus,<br />
et même après, car beaucoup d’auteurs ont<br />
gardé les graphèmes originaux, dont le lh pour<br />
[ ] (ll castillan). Mais ça, c’est une autre histoire !<br />
Y<br />
Il est en tout cas piquant <strong>de</strong> voir que ces bons<br />
occitanistes, si ouverts et <strong>de</strong> ce fait contempteurs<br />
<strong>de</strong> l’intolérance <strong>de</strong> l’Église médiévale à l’égard <strong>de</strong>s<br />
hérétiques, sont si prompts à qualifier d’hérétiques<br />
ceux qui n’adhèrent pas à leurs dogmes ! Sans<br />
compter ceux qui organisent la gran<strong>de</strong> réjouissance<br />
populaire qu’est le Carnaval béarnais, largement<br />
subventionné par nos impôts, et qui s’achève par<br />
l’exécution <strong>de</strong> Carnaval sur un bucher !<br />
Dans le domaine <strong>de</strong> la cohérence <strong>de</strong> pensée <strong>de</strong><br />
ces gens-là, il me plait aussi <strong>de</strong> citer l’abbé Louis<br />
Combes (1925-2006) — Dieu l’accueille en sa sainte<br />
<strong>de</strong>meure ! — , qui fut certainement un bon prêtre<br />
et un bon enseignant, mais qui est <strong>de</strong>venu sur le<br />
tard l’un <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong> la cohorte ecclésiastique<br />
<strong>de</strong>s occitanistes les plus fanatiques ; avec Cantalausa<br />
pour gracieux nom <strong>de</strong> plume.
8 <strong>La</strong> létre <strong>de</strong> l’Enstitut Biarnés e Gascoû<br />
2009<br />
Ainsi, dans son monumental et si méritoire Diccionari<br />
general occitan [en <strong>lettre</strong>s énormes] a partir<br />
<strong>de</strong>ls parlars lengadocians [en caractères 6 fois<br />
moins hauts] (2003), Cantalausa donne dans le<br />
néologisme occitaniste patesejaire [patoisayre oserais-je<br />
traduire, pour rendre le caractère péjoratif<br />
du suffixe], avec pour troisième acception : « qui<br />
écrit sa langue maternelle avec une graphie étrangère<br />
». Pour l’auteur, cela vise évi<strong>de</strong>mment l’« occitanophone<br />
» naturel qui use <strong>de</strong>s conventions<br />
orthographiques du français, notamment selon la<br />
graphie mistralienne, donc Mistral lui-même ! Mais<br />
certainement, pas, malgré la généralité <strong>de</strong>s termes,<br />
le Breton bretonnant <strong>de</strong> naissance qui écrit<br />
biniou (forme “officielle” chez les défenseurs <strong>de</strong><br />
la langue bretonne) avec le graphème “français”<br />
ou. Et c’est ignorer en 2003 qu’il y a <strong>de</strong> moins en<br />
moins <strong>de</strong> locuteurs naturels <strong>de</strong>s langues d’oc, que<br />
les graphèmes honnis (ou pour /u/, gn pour /n/)<br />
sont aussi anciens en oc que le besoin <strong>de</strong> noter<br />
les prononciations correspondantes et que pour un<br />
<strong>Béarnais</strong>, par exemple, sh pour / / (ch français) selon<br />
la norme occitaniste est une graphie tout à fait<br />
étrangère !<br />
Ce mot patesejaire, je ne l’ai heureusement jamais<br />
rencontré sous la plume <strong>de</strong>s occitanistes gascons,<br />
mais il est pour moi emblématique du climat <strong>de</strong><br />
combat et <strong>de</strong> mépris dans lequel se situe le débat<br />
orthographique, alors que l’on ne <strong>de</strong>vrait avoir en<br />
vue que le maintien et la transmission <strong>de</strong>s langues<br />
vivantes du mon<strong>de</strong> d’oc.<br />
Les <strong>de</strong>ux alinéas ci-<strong>de</strong>ssus sont tirés <strong>de</strong> ma thèse,<br />
et tant qu’à faire, pour conclure, je vous donne les<br />
sept qui les précè<strong>de</strong>nt :<br />
…, le désir probable <strong>de</strong> se démarquer <strong>de</strong>s “patoisants<br />
ignorants” a conduit une certaine bourgeoisie<br />
latinisante <strong>de</strong>s XIX e et XX e s. à imiter le vieux<br />
modèle académique du français. Voici par exemple<br />
comment le Dr. Ismaël Girard justifiait le recours à<br />
<strong>de</strong>s graphies étymologiques :<br />
« Le rétablissement <strong>de</strong>s étymologies possè<strong>de</strong><br />
un intérêt pédagogique que les maîtres <strong>de</strong> l’enseignement<br />
apprécieront. Ce rétablissement permet<br />
<strong>de</strong> mieux comprendre à la fois la similitu<strong>de</strong> et les<br />
particularités <strong>de</strong> la langue d’oc au sein <strong>de</strong>s langues<br />
latines, la similitu<strong>de</strong> et les particularités <strong>de</strong> la<br />
langue d’oc vis-à-vis du français. Quand on écrit<br />
temps avec un p, <strong>de</strong> tempus, on est plus près du<br />
mot français temps, du mot espagnol tiempo, que<br />
si l’on écrit tems ou même tens, comme le font<br />
certains patoisants. Car il faut distinguer la notation<br />
phonétique qui relève <strong>de</strong> la science folklorique<br />
et la structure grammaticale qui relève <strong>de</strong> l’art <strong>de</strong><br />
l’écriture. » (Anthologie <strong>de</strong>s poètes gascons d’Armagnac,<br />
d’Astarac, <strong>de</strong> Lomagne, d’Albret et <strong>de</strong><br />
Bas-Comminges, Auch, 1942, p. 89, note n° 6).<br />
Il ne <strong>de</strong>vait pourtant pas ignorer que l’anglais<br />
times se passe fort bien <strong>de</strong> p sans nuire à la compréhension<br />
et que tiempo est parfaitement phonétique,<br />
comme la majeure partie <strong>de</strong> la graphie du<br />
castillan; <strong>de</strong> là à dire que l’espagnol est folklorique<br />
!<br />
Plus réaliste me semble Georg Kremnitz (« Per un<br />
estudi <strong>de</strong> la codificacion lingüistica », Obradors, 2,<br />
nouvelle série, été 1973) cité par Xavier <strong>La</strong>muela<br />
(Lo caractèr simbolic <strong>de</strong> las convencions graficas e<br />
l’i<strong>de</strong>ntitat aranesa », Actes du Colloque <strong>de</strong> la Section<br />
française <strong>de</strong> l’A.I.E.O. <strong>de</strong> Septembre 1986,<br />
1990, p. 161) :<br />
« <strong>La</strong> codification d’Alibert est un enfant <strong>de</strong> son<br />
temps : influence catalane, influence <strong>de</strong> la bourgeoisie<br />
latinisante, influence <strong>de</strong>s théories linguistiques<br />
<strong>de</strong> son époque, étymologismes, historicismes,<br />
la ren<strong>de</strong>nt relativement difficile à employer. Il<br />
faudrait se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r aujourd’hui, avant qu’elle ne<br />
soit trop fixée et traditionnelle, si l’on ne peut pas<br />
admettre quelques recodifications, dans une direction<br />
plus phonologique et morphonologique. »<br />
Même opinion chez Roger Teulat (« Per un occitan<br />
modèrne », Lo Gai Saber n° 483, 2001, p. 189),<br />
jugeant <strong>de</strong> l’incapacité <strong>de</strong> l’occitanisme pour réformer<br />
la graphie :<br />
« Ajoutez à cela une sorte <strong>de</strong> pédantisme, un mépris<br />
<strong>de</strong> tout ce qui est populaire, le modèle français<br />
<strong>de</strong> culture, la soif d’unanimisme et le culte du maitre<br />
(gourouïsme). Autant <strong>de</strong> traits négatifs dont il<br />
faut s’éloigner comme on ferme la parenthèse sur<br />
les erreurs du XX e siècle. »<br />
Inutile d’en dire plus !
2009 <strong>La</strong> létre <strong>de</strong> l’Enstitut Biarnés e Gascoû<br />
9<br />
lou SAFr Dou<br />
biArN<br />
Le Safran, Crocus Sativus<br />
est connu et<br />
cultivé comme épice<br />
<strong>de</strong>puis la plus haute antiquité.<br />
Il apparaît dans <strong>de</strong>s<br />
recettes méridionales dès<br />
le xv siècle avant J.C. notamment<br />
dans le papyrus<br />
Ebers découvert en Egypte<br />
en 1872 et daté <strong>de</strong> 1550<br />
avant J.C. Il fut sans doute<br />
rapporté par les Croisés qui<br />
avaient découvert son parfum<br />
puissant en Asie Mineure.<br />
Il était alors <strong>de</strong> production<br />
courante en Perse,<br />
au Cachemire et en Macédoine.<br />
Le mot vient <strong>de</strong> l’Arabe-<br />
Persan ‘’za’farân’’ qui signifie<br />
jaune.<br />
Dans la<br />
mythologiegrecque,<br />
on raconte<br />
que<br />
Crocos et<br />
H e r m è s<br />
j o u a i e n t<br />
ensemble<br />
à lancer<br />
le disque, lorsque Crocos,<br />
ébloui par le soleil, fût frappé<br />
par le disque en plein<br />
front d’une blessure mortelle.<br />
A l’endroit ou avait coulé<br />
le sang, sortit une belle fleur<br />
qui fût appelée ‘’Crocus’’.<br />
Pigment aromatique ?<br />
Epice colorée? Le safran<br />
possè<strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux qualités.<br />
Depuis très longtemps, les<br />
moines bouddhistes l’utilisent<br />
pour teinter leurs vêtements.<br />
Si le safran n’a pas<br />
beaucoup <strong>de</strong> goût, il dégage<br />
un délicieux parfum.<br />
Par Pierre Cazenave<br />
Il est incontournable tant<br />
dans la paella que dans la<br />
bouillabaisse. Il accompagne<br />
très bien les fruits <strong>de</strong><br />
mer, les poissons, les currys<br />
et aromatise un grand nombre<br />
<strong>de</strong> liqueurs. Il fut pendant<br />
<strong>de</strong>s décennies l’épice<br />
la plus chère du mon<strong>de</strong>. Il<br />
faut en effet cueillir entre<br />
150000 et 200000 fleurs <strong>de</strong><br />
crocus pour obtenir 1 kg <strong>de</strong><br />
safran sec.<br />
Le safran aime la Gascogne,<br />
et plus particulièrement<br />
le Béarn.<br />
A Estos, commune proche<br />
d’Oloron-Sainte-Marie,<br />
Derry Connally, un Béarno-<br />
Irlandais, cultive une safranière<br />
<strong>de</strong><br />
1000 m 2<br />
qui compte<br />
pas moins<br />
<strong>de</strong> 15000<br />
b u l b e s .<br />
<strong>La</strong> récolte<br />
se fera au<br />
mois <strong>de</strong><br />
novembre.<br />
Si<br />
vous souhaitez avoir plus<br />
<strong>de</strong> détails, contactez-le<br />
<strong>de</strong>rryconnolly@gmail.com<br />
il se fera un plaisir <strong>de</strong> vous<br />
parler <strong>de</strong> sa passion.<br />
Il ne vous restera plus<br />
qu’à découvrir une recette<br />
d’Alexandre Dumas, autour<br />
d’un plat que vous aurez<br />
le plaisir <strong>de</strong> confectionner<br />
vous-même… A moins que<br />
vous ne préfériez à l’approche<br />
<strong>de</strong> l’hiver redonner <strong>de</strong><br />
l’éclat à votre vieux par<strong>de</strong>ssus.<br />
Peleri De SAN<br />
yAQueS<br />
Hort loégn dou soû oustau, oun se fenéch la tèrre,<br />
Estéles héns lou cap, lou pelerî s’en ba,<br />
Soulét e hardidét, chéns pòu d’y arriba,<br />
Lou téms ne sera pas, tad ét ûe termière.<br />
Sus la régne û gran sac, <strong>de</strong>héns ûe capère,<br />
Dap <strong>de</strong> machans souliès, atau qu’éy plâ caussat,<br />
Lou barrot à la mâ, û chapèu escrasat,<br />
Que camine en pourtan, ûe gauyou nabère.<br />
Traucan <strong>de</strong> touts parsâs, sus la tèrre estranyère,<br />
Lou camî qu’éy hort lounc, ta minya û boussî,<br />
Que s’arrèste quoan pot, au bilàdye . besî,<br />
E que tourne parti, la cama<strong>de</strong> leuyère.<br />
Compostelle éy lou cap, d’aquét tarrìble . biàdye . ,<br />
Ta-u poudé acaba, qu’abance d’û boû pas,<br />
Dap hangue aus cabilhas, dap proube, ou dap glas,<br />
Coum an hèyt abans ét, pelerîs <strong>de</strong> tout àdye . .<br />
Lou sé ta-s repausa, <strong>de</strong>’quére gran courru<strong>de</strong>,<br />
Ta droumi n’aura pas, û hort boû matelas,<br />
Û téyt enta la noéyt, n’en hera pas nat cas,<br />
<strong>La</strong> fatigue qui a, ne sera pas perdu<strong>de</strong>.<br />
Quoau dounc, e pot esta, aquére gran ahi<strong>de</strong> ?<br />
Soul ét e pot sabé, ta qué hè tout aco.<br />
Aquét secrét segu, que l’a au houns dou co,<br />
E, méy ou peseré, que lou soû sac, bahi<strong>de</strong> ?<br />
Quoan apercéut urous, la catedrale grane,<br />
À yenous tout d’û cop, lou bràbe . San-Yaquè 1 ,<br />
Goarit <strong>de</strong> touts lous maus, <strong>de</strong>sbroumban lou flaquè,<br />
Que-s hique à ploura, d’ûe doulou hort sane.<br />
Amics, se-n bedét û, passa héns lou bilàdye . ,<br />
Aydat-lou se poudét, à fresqueya-s û drin,<br />
De urous que-n sera, labéts aquét praubin,<br />
Partadyera dap bous, lou soû pelerinàdye . .<br />
1 Pèlerin (<strong>de</strong> St Jacques)<br />
Jean BOUSQUET<br />
Sault-<strong>de</strong>-Navailles
10 <strong>La</strong> létre <strong>de</strong> l’Enstitut Biarnés e Gascoû<br />
2009<br />
l’ArrouSè<br />
Par Marielle LUCATS<br />
Aquéste hèyte que-s éy passa<strong>de</strong> au més <strong>de</strong> may, que y a<br />
hère lountéms, quoan badouy. À noùste . n’y abè soùnque .<br />
cauléts, ûs-quoàn<strong>de</strong> . s cauléts, au casau, héns la cantère,<br />
héns la lane oun n’y abè pas méy d’aubiscoûs, e dinque enço<br />
dou besî. E o ! À noùste . qu’èren cauletès !<br />
<strong>La</strong> mama que pretendè que dap touts aquéts cauléts lou soû<br />
petit escarrét que seré û maynat ? Més lou papa que <strong>de</strong>mourabe<br />
abùgle . e chourt. Qu’ère meylèu escarre-padère e n’aymabe<br />
pas lou disna <strong>de</strong> l’àsou. Qu’ère û drin bentourrut e lou soû bénte .<br />
qu’ou hasè <strong>de</strong>sestruc enta-s bacha ta tèrre.<br />
Soun amne qu’ère turmenta<strong>de</strong>. Ûe noéyt oun la lûe passabe<br />
au plé, ne-s adroumibe pas. Tout d’û cop que-s broumbè qu’au<br />
houns <strong>de</strong> la barte, au miéy <strong>de</strong> las sègues, autescops qu’y abè<br />
û arrousè. Que-s gahe lou dalhot, que saute per <strong>de</strong>ssus lou cledoû,<br />
que passe à trubès <strong>de</strong> la heuguère, que bache lou pitè e au<br />
bèt houns, à l’auyou <strong>de</strong> la lûe, que bedou ûe arrose !<br />
Que-s arrebire la camise e, goalhart, l’òmi que truque las sègues,<br />
e ric e rac, ta tu e ta you, que s’y hasè beroy. Quoan arriba,<br />
qu’ère tout esperrecat, la pélhe esquissa<strong>de</strong> e lous bras en sanc.<br />
Alabéts que s’arresta tout d’û cop. Aquiu au miéy <strong>de</strong> l’arrose,<br />
oun abi lou clot tout hèyt, que-m bedou ! Si ère urous l’òmi !<br />
Tout embisaglat, l’oélh ardoun coum ûe siète, que-s esclaquère<br />
d’arrì<strong>de</strong> . : « Ah, toutû, qu’ès aquiu ! E seré au toû grat <strong>de</strong>-m tiéne .<br />
<strong>de</strong> tole à case ? » Que respounouy : « E perqué nou ? » E que-m<br />
hesou segui ta case soûe, ûe cante gauyouse aus pots.<br />
En se han die, qu’arrecoutim. Lou papé que hasè lou saut dou<br />
lhéyt abans lou crit dou hasâ. N’ère pas tegnè : autalèu que-s<br />
embespa e dap eslambrécs héns lous oélhs e tounèr héns la<br />
bouts que digou : « Més macarèu, qu’éy ço qu’as hèyt, gouyat ?<br />
Dap touts lous cauléts que y a à noùste . , oun as anat coélhe .<br />
aco ? » Lou papa, hère fièr, qu’ou respounou : « qu’éy la saubadyîe<br />
1 qui bouyadye 2 qui l’a mia<strong>de</strong> ! N’éy pas berouyine ? – Més,<br />
qu’éy ço qui bam ha d’ére ? – Que l’embieram enta Nay, dap las<br />
àute . s flous. »<br />
Qu’éy atau, e atau qu’éy. Quàuque . s ana<strong>de</strong>s <strong>de</strong>sempuch<br />
aquét aha, à noùste . , <strong>de</strong> cauletès qui èren, que soun <strong>de</strong>bienguts<br />
« flourìste . s »…<br />
1 Ici, « les oiseaux sauvages ».<br />
2 Verbe bouyadya → « voyager ».<br />
Marielle LUCATS, 10 mars 2008<br />
Le 10 octobre reprise<br />
<strong>de</strong>s « Cantères »<br />
ossaloises à <strong>La</strong>runs<br />
Lors <strong>de</strong> la <strong>de</strong>rnière séance du mois <strong>de</strong><br />
juin <strong>de</strong>rnier, le ren<strong>de</strong>z-vous avait été pris<br />
pour une nouvelle saison <strong>de</strong> « Cantère ».<br />
L’ambition <strong>de</strong>s organisateurs s’attache à maintenir<br />
et plus encore à développer la tradition<br />
ossaloise du chant et par ce biais <strong>de</strong> faire vivre<br />
notre langue béarnaise. Rappelons que ce mot<br />
très béarnais <strong>de</strong> « cantère » signifie l’habitu<strong>de</strong><br />
(ou la manie) <strong>de</strong> se retrouver pour chanter.<br />
Les ossalois et plus largement toutes les personnes<br />
souhaitant participer à ces « cantères<br />
» peuvent rejoindre le groupe en place, il suffit<br />
<strong>de</strong> se présenter au bar/restaurant Le Youkoulélé,<br />
bien connu à <strong>La</strong>runs, le samedi 10 ou le<br />
samedi 17 octobre, c’est là que se dérouleront<br />
les premières répétitions. Jean-Luc Mongaugé<br />
comme l’an <strong>de</strong>rnier animera chaque séance.<br />
Afin que tous les participants puissent chanter<br />
aisément, lors <strong>de</strong> chaque soirée <strong>de</strong>s feuillets<br />
avec les paroles sont distribués.<br />
Domaine bazaillac<br />
Les élèves qui suivent les cours <strong>de</strong> langue<br />
béarnaise à Gan ont souhaité clôturer<br />
l’année scolaire par une réunion<br />
amicale. C’est dans les tous premiers jours<br />
du mois <strong>de</strong> juillet qu’ils se sont retrouvés<br />
au Domaine viticole Bazaillac <strong>de</strong> Jurançon<br />
pour mettre en pratique les acquis linguistiques<br />
<strong>de</strong> l’année d’étu<strong>de</strong> et… passer un moment<br />
autour <strong>de</strong>s produits régionaux et <strong>de</strong><br />
quelques bouteilles du Domaine.<br />
C’est en langue « mayrane » que l’hôte <strong>de</strong><br />
la soirée nous accueillait et nous expliquait<br />
son travail dans les vignes et dans les chais.<br />
Travail familial ininterrompu <strong>de</strong>s premiers<br />
travaux préparatoires, suivi <strong>de</strong> la récolte, <strong>de</strong><br />
la vinification, <strong>de</strong> la mise en bouteilles pour<br />
se terminer par la commercialisation, toutes<br />
ces étapes sont effectuées sur la propriété.<br />
C’est ici l’assurance <strong>de</strong> trouver un<br />
produit authentique et <strong>de</strong> qualité. Car seuls<br />
les meilleurs <strong>de</strong> la profession maitrisent cet<br />
ensemble et commercialisent la totalité <strong>de</strong><br />
leur production.<br />
Les cours <strong>de</strong> Gan, commencés cette année<br />
ont pris un envol remarquable, autant<br />
avec <strong>de</strong>s habitués du <strong>Béarnais</strong>, qu’auprès<br />
d’apprentis passionnés.
2009 <strong>La</strong> létre <strong>de</strong> l’Enstitut Biarnés e Gascoû<br />
11<br />
la maméte 1 e l’arrehilhe.<br />
Cesàri Daugé « Fables gascounes »<br />
(Graphie <strong>de</strong> l’auteur)<br />
En un oustau ne j’abè pas qu’u hilhe<br />
Besia<strong>de</strong>, Diu qu’at sap.<br />
Lou pelhot dinc’au joulh, péus oundulats au cap,<br />
À l’estoumac, cadéne d’or en pen<strong>de</strong>rilhe,<br />
Bint cops lou jour que-s pintrabe lous pots.<br />
Poudre <strong>de</strong> riz à la machère,<br />
Bras <strong>de</strong>scaussats dinc’à <strong>de</strong>bat l’echère,<br />
Au gatot qu’abè prou balha 2 ribans e pots.<br />
Mé la maméte, es<strong>de</strong>nta<strong>de</strong> e crouchi<strong>de</strong>,<br />
À trabalha qu’ère la <strong>de</strong> daban,<br />
E que-s gahabe à tout, trabalh prope ou cascan,<br />
Coum <strong>de</strong> guida lous boéus ou megna per la bri<strong>de</strong><br />
Lou chibau que la joéne aperabe « Carcan ».<br />
Toute biélhe coum ère, arré nou l’eschentabe 3 ,<br />
À la baque autaplan que passabe la trabe<br />
Coum pourtabe au casau lou héms <strong>de</strong> planta habe.<br />
Dab boutines aus pès la joéne que-n anabe.<br />
Mé la maméte abèbe, coum d’auts cops,<br />
Lou diménche escloupéte e la semmane esclops.<br />
<strong>La</strong> joéne, en coumanda, disè : « <strong>La</strong> nouste biélhe,<br />
Alucats-me lou hoéc, hèts sarra lou pourtau ;<br />
Au puts anats plegna la sélhe 4 .<br />
Amassats-me lou méng ditau 5 . »<br />
Lou pay qu’ou dit : « Dèche aquét èr barbau.<br />
Miélhe qu’aco parle à l’anciène.<br />
D’ére qu’abous besouy quoan ères nène.<br />
Tan qu’a poudut, qu’a hèyt lusi l’oustau<br />
E ne bouy pas que la mégnis atau.<br />
− Més espiats-lé : n’é pas brigue à la mo<strong>de</strong>,<br />
Dit la joéne. – Care-t ! Saube-t lous touns counsélhs.<br />
Enta tu, coum aus auts, que birera l’arro<strong>de</strong><br />
E qui sap coum seram nous autis quoan sim biélhs !<br />
1 grand-mère.<br />
2 elle était bien assez occupée à donner.<br />
3 l’effrayait.<br />
4 seau.<br />
5 dé à coudre.<br />
ADHÉSioN 2010<br />
rePriSe Pour leS « eleVeS »<br />
DeS CourS De beArNAiS<br />
Si les enfants scolarisés ont repris le chemin <strong>de</strong><br />
l’école <strong>de</strong>puis quelques semaines, nos apprenants<br />
<strong>de</strong> béarnais se remettent <strong>de</strong>puis quelques<br />
jours à la tâche. Les motivations sont autres et<br />
les « cours », rassemblant uniquement <strong>de</strong>s volontaires,<br />
sont surtout <strong>de</strong>s moments ludiques <strong>de</strong> découverte<br />
et <strong>de</strong> mise en contact avec la langue béarnaise<br />
ou gasconne. Nous nous félicitons du succès rencontré<br />
par ces ren<strong>de</strong>z-vous hebdomadaires, avec<br />
près <strong>de</strong> 150 élèves répartis dans les différents lieux<br />
<strong>de</strong> rassemblement, nous pouvons affirmer <strong>de</strong> l’engouement<br />
témoigné pour notre culture régionale.<br />
Chacun peut rejoindre un <strong>de</strong>s groupes existant :<br />
à Pau, Arzacq, Gan, Gelos, Nay, Oloron, Pontacq.<br />
Pour connaître les jours et les horaires vous pouvez<br />
appeler le secrétaire au 06.22.11.67.43.<br />
AVOINE : CIBADE<br />
Dans l’antiquité, on tenait le pain d’avoine comme<br />
ayant <strong>de</strong>s qualités particulières et Tacite semble indiquer<br />
que les « barbares » germaniques <strong>de</strong>vaient<br />
leur force et leur longévité à la bouillie d’avoine. Au<br />
Moyen-âge on préconisait pour se débarrasser <strong>de</strong><br />
certaines maladies <strong>de</strong> peau comme la gale <strong>de</strong> passer,<br />
nu <strong>de</strong> préférence, dans les champs d’avoine, le<br />
jour <strong>de</strong> la Saint-Jean en prononçant cette formule :<br />
« Netéye-m hort, frésc arrous, <strong>de</strong> la prudère, tan<br />
turmentàble . misère.<br />
Boulhe-me-n plâ <strong>de</strong>sbarrassa héns aquéste . cibada<br />
! »<br />
Traduction : Nettoie-moi bien, fraîche rosée, <strong>de</strong> ma<br />
démangeaison. Misère tant tourmenteuse ! Veuille<br />
bien m’en débarrasser dans ce champ d’avoine.<br />
Ce commentaire sur l’avoine est extrait du livre « Nos Fleurs<br />
d’Aquitaine » d’Alexis Arette, édité par l’<strong>Institut</strong> <strong>Béarnais</strong> et<br />
<strong>Gascon</strong>.<br />
Les cartes d’adhésion pour l’année 2010 sont d’ores et déjà disponibles auprès <strong>de</strong>s dirigeants <strong>de</strong> l’<strong>Institut</strong><br />
<strong>Béarnais</strong> et <strong>Gascon</strong>. Nous rappelons que l’adhésion à notre institut est toujours fixée à 8 euros. Cette somme,<br />
par sa modicité, permet au plus grand nombre <strong>de</strong> s’intéresser à notre action <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> la langue<br />
béarnaise-gasconne. Plus <strong>de</strong> 90 % <strong>de</strong> nos adhérents renouvellent régulièrement leur cotisation et un bon nombre<br />
participe activement à la promotion <strong>de</strong> notre association et aux convictions qui animent ses dirigeants. Comme<br />
toutes ces <strong>de</strong>rnières années l’adhésion 2010 permettra <strong>de</strong> recevoir le bulletin trimestriel : « <strong>La</strong> Lettre <strong>de</strong> l’IBG ».<br />
C’est un lien indispensable qui apporte les <strong>de</strong>rnières informations, les comptes-rendus <strong>de</strong>s différentes activités et<br />
qui ouvre ses colonnes aux auteurs du passé mais également aux écrivains contemporains. Ainsi il apporte la preuve<br />
d’une tradition littéraire maintenue <strong>de</strong>puis près <strong>de</strong> 150 ans et ce dans la graphie dite béarnaise ou gasconne. Le<br />
N° 20 que vous lisez comporte plusieurs <strong>de</strong> ces textes contemporains.<br />
Merci donc <strong>de</strong> renouveler, dès ce <strong>de</strong>rnier trimestre 2009, l’adhésion pour 2010. Pour ce faire vous pouvez découper<br />
et compléter le bulletin d’adhésion que vous trouverez en <strong>de</strong>rnière page.
Une étu<strong>de</strong> passionnante sur tout ce qui touche aux mœurs,<br />
coutumes, habitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la table et du (bien) manger en<br />
Béarn : les traditions culinaires, les liens avec l’histoire<br />
<strong>de</strong> la société béarnaise traditionnelle, la terminologie employée,<br />
les mots <strong>de</strong> tous les jours, les proverbes, dictons,<br />
chansons qui s’y rapportent. Toute une « philosophie » du<br />
manger « vrai » que l’on (re)découvre, quelques soixantedix<br />
ans plus tard et bien <strong>de</strong>s changements… un livre à déguster<br />
et à méditer…<br />
Le Professeur Desplat, dans une préface brillante, remet<br />
dans une perspective historique cet essai qui dépasse, <strong>de</strong><br />
loin, le simple ouvrage culinaire.<br />
Simin Palay est l’homme qui aura le plus marqué, au cours<br />
du XXe siècle, la renaissance et l’illustration <strong>de</strong> la langue<br />
gasconne. Tout ce qui se fait en gascon et sur le gascon,<br />
sa langue et sa culture, n’aurait pas été possible sans son<br />
immense contribution. Et que cela soit <strong>de</strong> la linguistique…<br />
à la cuisine<br />
En français et béarnais (graphie béarnaise)<br />
Prix : 12,95 euros<br />
Enfin une métho<strong>de</strong> d’apprentissage du<br />
béarnais… Cet ouvrage qui vous invite<br />
à oser pratiquer la langue ancestrale du<br />
Béarn, la plus authentique possible – et ce<br />
en partant <strong>de</strong> la situation <strong>de</strong> la vie courante<br />
- est placé sous le signe d’une ouverture<br />
sans complexe sur le mon<strong>de</strong>.<br />
En effet, une vaillante <strong>de</strong>scendante<br />
d’émigrés béarnais (partis travailler à la<br />
construction <strong>de</strong>s chemins <strong>de</strong> fer à Porte<br />
Alegre, capitale <strong>de</strong> l’état du Rio Gran<strong>de</strong> do<br />
Sul, au Brésil, Maria Suzana Marc-Amoretti,<br />
professeur <strong>de</strong> linguistique, nous a fait<br />
l’honneur <strong>de</strong> rédiger la préface <strong>de</strong> ce livre.<br />
<strong>La</strong> métho<strong>de</strong> se compose <strong>de</strong> 21 leçons à l’issue <strong>de</strong>squelles, nous vous proposons un chapitre consacré<br />
au verbe béarnais avec <strong>de</strong> nombreux tableaux <strong>de</strong> conjugaisons. Pour terminer, un double lexique<br />
vous attend à la fin <strong>de</strong> ce manuel. Vous y trouverez plus <strong>de</strong> 1000 mots et expressions français<br />
traduits en béarnais et plus <strong>de</strong> 1500 mots et expressions béarnais traduits en français. Nouveauté,<br />
la version audio <strong>de</strong> ce manuel d’apprentissage <strong>de</strong> la langue béarnaise est proposée en option. Elle<br />
vous distillera une voix authentique, béarnaise cap e tout, pour vous ai<strong>de</strong>r à mémoriser et reproduire<br />
la langue avec son accent naturel, tel que vous pouvez encore l’entendre sur les marchés ou les<br />
lieux <strong>de</strong> vie du Béarn.<br />
Ecrit en graphie béarnaise<br />
Prix 18,95 euros<br />
En retraçant l’histoire inconnue <strong>de</strong>s trois peuples qui, au<br />
terme <strong>de</strong> leurs migrations, ont fait <strong>de</strong> l’Aquitaine un pays<br />
différent, Alexis Arette semble s’être voué à la tâche <strong>de</strong><br />
surprendre, peut-être d’irriter, mais aussi d’enthousiasmer,<br />
en mettant à mal quelques tabous <strong>de</strong> l’Histoire ! Par <strong>de</strong>s<br />
itinéraires lointains, mais combien riches d’aventures, et<br />
après avoir abordé dans d’autres ouvrages les mystères du<br />
<strong>de</strong>venir humain, le voici qui se voue à nous montrer « cette<br />
autre façon <strong>de</strong> comprendre » <strong>de</strong>s anciens, lesquels à travers<br />
les symboles et les acci<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> parcours, saisissaient<br />
les mystères <strong>de</strong> la terre et du ciel…<br />
Un livre pour être à la fois « quelqu’un <strong>de</strong> quelque part », et<br />
pour s’enraciner dans l’universel…<br />
Alexis Arette, prési<strong>de</strong>nt fondateur <strong>de</strong> la Renaissance Aquitaine,<br />
a été le plus jeune maître « en gay sabé » du félibrige.<br />
Il fut également un prési<strong>de</strong>nt atypique et iconoclaste <strong>de</strong> la<br />
commission culturelle du Conseil Régional d’Aquitaine, où<br />
il fit, plus d’une fois, souffler un « vent <strong>de</strong> panique » au sein<br />
d’une certaine Nomenklatura régionale…<br />
Prix : 28,95 euros<br />
Aqui qu’abém ûe cante esmabente e noustalgique enta<br />
touts lous utìs, mubles e autes causes <strong>de</strong> CASE.<br />
Cantes d’û òmi encoère yoen (qu’estou publicat permè en<br />
1909) mès d’û òmi qui nou-s pot pas aysidamen « <strong>de</strong>sgaha<br />
» <strong>de</strong> tout ço qui hasou lou soû yoenè, tèms urous,<br />
passat e arrepassat qui, ailas ! nou tournera pas mey yamey…<br />
U sègle mey tar, aci qu’abém ûe garbe estraour<strong>de</strong>narì<br />
d’aquéres pouesies escriutes en ûe lengue mestreya<strong>de</strong>,<br />
classique en û mout…<br />
U beroy cap-d’obre !<br />
Simin Palay est l’homme qui aura le plus marqué, au cours<br />
du XX e siècle, la renaissance et l’illustration <strong>de</strong> la langue<br />
gasconne. Tout ce qui se fait en gascon et sur le gascon, sa<br />
langue et sa culture, n’aurait été possible sans son immense<br />
contribution et son grand talent. Que ce soit en linguistique,<br />
en théâtre, en poésie… ou en cuisine !<br />
En graphie béarnaise<br />
Prix : 17,95 euros<br />
Depuis 1932, date <strong>de</strong> la parution du monumental Dictionnaire<br />
du <strong>Béarnais</strong> et du <strong>Gascon</strong> mo<strong>de</strong>rne <strong>de</strong> Simin Palay,<br />
personne ne s’était risqué à la rédaction d’un dictionnaire<br />
béarnais-français. L’équipe qui avait déjà réalisé, en 2002,<br />
le dictionnaire français-béarnais « que-s y es doun heyt ! »<br />
Toute l’équipe <strong>de</strong> collaborateurs sont <strong>de</strong> celles et ceux<br />
qui « an poupat la loengue <strong>de</strong> case », tous béarnophones<br />
authentiques.<br />
Le présent ouvrage qui comprend 12000 mots se veut le reflet<br />
fidèle <strong>de</strong> la réalité <strong>de</strong> la langue béarnaise en ce début <strong>de</strong><br />
XXI e siècle. Il n’occulte point les emprunts fait au français ;<br />
il mentionne également les mots vieillis ou oubliés : ce n’est<br />
donc, en aucune sorte, un dictionnaire dogmatique.<br />
Les auteurs ont opté pour une orthographe « mo<strong>de</strong>rne »,<br />
celle dite aussi <strong>de</strong> « Palay », graphie mise au point au début<br />
du XX e siècle par l’ESCOLE GASTOU FEBUS : moyen <strong>de</strong><br />
présenter la langue béarnaise et son vocabulaire dans une<br />
écriture immédiatement accessible à tous, pratiquants, curieux<br />
ou amoureux <strong>de</strong> cette « Loengue <strong>de</strong> case ».<br />
Un souhait : que ce mo<strong>de</strong>ste dictionnaire puisse servir à<br />
maintenir et, espérons-le <strong>de</strong> tout cœur, à faire renaître l’emploi<br />
du béarnais en Béarn.<br />
Prix : 22,95 euros<br />
JEAN-BAPTISTE BEGARIE<br />
(1892 – 1915)<br />
<strong>La</strong> vie, l’oeuvre et le <strong>de</strong>stin<br />
d’un poète gascon<br />
combattant <strong>de</strong> la Gran<strong>de</strong> Guerre<br />
Né à Bénéjacq en Béarn, à la toute fin du XIX e siècle, ce<br />
jeune et ar<strong>de</strong>nt défenseur <strong>de</strong> la langue gasconne – qui écrit<br />
déjà dans <strong>La</strong> bouts <strong>de</strong> la Terre – ami et compagnon <strong>de</strong>s Palay,<br />
Camelat et Bouzet (qui compteront tant dans la renaissance<br />
gasconne du XX e siècle) ce « Prince <strong>de</strong> l’esprit » est<br />
porté disparu, en première ligne, dans l’enfer <strong>de</strong>s tranchées<br />
du Nord, en 1915. A tout juste 23 ans !<br />
Dans un minutieux, émouvant et imposant travail <strong>de</strong> recherche,<br />
Jean-Albert Trouilhet nous offre une reconstitution<br />
époustouflante <strong>de</strong> la vie et <strong>de</strong> l’œuvre originale en gascon<br />
(avec traduction) <strong>de</strong> ce poète béarnais trop tôt disparu. Un<br />
ouvrage abondamment illustré qui nous mène du Béarn <strong>de</strong><br />
l’enfance à l’Algérie du service militaire (J.-B. Bégarie servit<br />
dans un régiment <strong>de</strong> Zouaves), puis à l’enfer <strong>de</strong> la Gran<strong>de</strong><br />
Guerre en Artois.<br />
Un travail <strong>de</strong> mémoire qui honore l’<strong>Institut</strong> <strong>Béarnais</strong> et<br />
<strong>Gascon</strong>.<br />
Prix : 32,95 euros<br />
NOS FLEURS D’AQUITAINE dans la langue, la sorcellerie<br />
et la mé<strong>de</strong>cine gasconnes. Un dictionnaire<br />
atypique qui répertorie tout ce qui a trait à la flore<br />
domestique ou sauvages <strong>de</strong> nos régions<br />
Prix : 36,95 euros<br />
Pour l’expédition <strong>de</strong> tous<br />
ces ouvrages,<br />
il faudra ajouter les frais<br />
<strong>de</strong> port et d’emballage.<br />
4,50 euro par envoi.