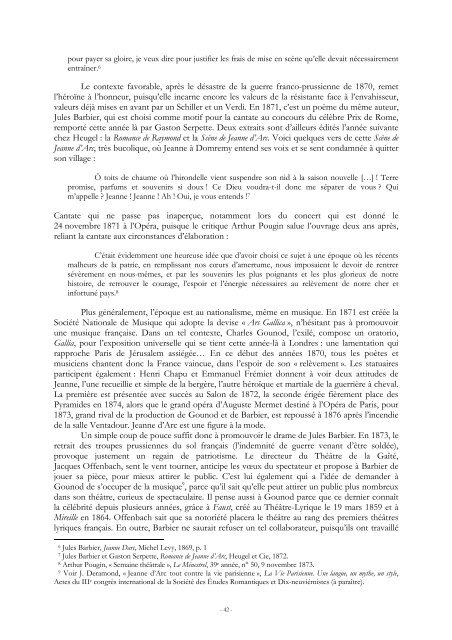You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
pour payer sa gloire, je veux dire pour justifier les frais de mise en scène qu’elle devait nécessairement<br />
entraîner. 6<br />
<strong>Le</strong> con<strong>texte</strong> favorable, après le désastre de la guerre franco-prussienne de 1870, remet<br />
l’héroïne à l’honneur, puisqu’elle incarne encore les valeurs de la résistante face à l’envahisseur,<br />
valeurs déjà mises en avant par un Schiller et un Verdi. En 1871, c’est un poème du même auteur,<br />
Jules Barbier, qui est choisi comme motif pour la cantate au concours du célèbre Prix de Rome,<br />
remporté cette année là par Gaston Serpette. Deux extraits sont d’ailleurs édités l’année suivante<br />
chez Heugel : la Romance de Raymond et la Scène de Jeanne d’Arc. Voici quelques vers de cette Scène de<br />
Jeanne d’Arc, très bucolique, où Jeanne à Domremy entend ses voix et se sent condamnée à quitter<br />
son village :<br />
Ô toits de chaume où l’hirondelle vient suspendre son nid à la saison nouvelle […] ! Terre<br />
promise, parfums et souvenirs si doux ! Ce Dieu voudra-t-il donc me séparer de vous ? Qui<br />
m’appelle ? Jeanne ! Jeanne ! Ah ! Oui, je vous entends ! 7<br />
Cantate qui ne passe pas inaperçue, notamment lors du concert qui est donné le<br />
24 novembre 1871 à l’Opéra, puisque le critique Arthur Pougin salue l’ouvrage deux ans après,<br />
reliant la cantate aux circonstances d’élaboration :<br />
C’était évidemment une heureuse idée que d’avoir choisi ce sujet à une époque où les récents<br />
malheurs de la patrie, en remplissant nos cœurs d’amertume, nous imposaient le devoir de rentrer<br />
sévèrement en nous-mêmes, et par les souvenirs les plus poignants et les plus glorieux de notre<br />
histoire, de retrouver le courage, l’espoir et l’énergie nécessaires au relèvement de notre cher et<br />
infortuné pays. 8<br />
Plus généralement, l’époque est au nationalisme, même en musique. En 1871 est créée la<br />
Société Nationale de Musique qui adopte la devise « Ars Gallica », n’hésitant pas à promouvoir<br />
une musique française. Dans un tel con<strong>texte</strong>, Charles Gounod, l’exilé, compose un oratorio,<br />
Gallia, pour l’exposition universelle qui se tient cette année-là à Londres : une lamentation qui<br />
rapproche Paris de Jérusalem assiégée… En ce début des années 1870, tous les poètes et<br />
musiciens chantent donc la France vaincue, dans l’espoir de son « relèvement ». <strong>Le</strong>s statuaires<br />
participent également : Henri Chapu et Emmanuel Frémiet donnent à voir deux attitudes de<br />
Jeanne, l’une recueillie et simple de la bergère, l’autre héroïque et martiale de la guerrière à cheval.<br />
La première est présentée avec succès au Salon de 1872, la seconde érigée fièrement place des<br />
Pyramides en 1874, alors que le grand opéra d’Auguste Mermet destiné à l’Opéra de Paris, pour<br />
1873, grand rival de la production de Gounod et de Barbier, est repoussé à 1876 après l’incendie<br />
de la salle Ventadour. Jeanne d’Arc est une figure à la mode.<br />
Un simple coup de pouce suffit donc à promouvoir le drame de Jules Barbier. En 1873, le<br />
retrait des troupes prussiennes du sol français (l’indemnité de guerre venant d’être soldée),<br />
provoque justement un regain de patriotisme. <strong>Le</strong> directeur du Théâtre de la Gaîté,<br />
Jacques Offenbach, sent le vent tourner, anticipe les vœux du spectateur et propose à Barbier de<br />
jouer sa pièce, pour mieux attirer le public. C’est lui également qui a l’idée de demander à<br />
Gounod de s’occuper de la musique 9 , parce qu’il sait qu’elle peut attirer un public plus nombreux<br />
dans son théâtre, curieux de spectaculaire. Il pense aussi à Gounod parce que ce dernier connaît<br />
la célébrité depuis plusieurs années, grâce à Faust, créé au Théâtre-Lyrique le 19 mars 1859 et à<br />
Mireille en 1864. Offenbach sait que sa notoriété placera le théâtre au rang des premiers théâtres<br />
lyriques français. En outre, Barbier ne saurait refuser un tel collaborateur, puisqu’ils ont travaillé<br />
6 Jules Barbier, Jeanne Darc, Michel <strong>Le</strong>vy, 1869, p. 1<br />
7 Jules Barbier et Gaston Serpette, Romance de Jeanne d’Arc, Heugel et Cie, 1872.<br />
8 Arthur Pougin, « Semaine théâtrale », <strong>Le</strong> Ménestrel, 39 e année, n° 50, 9 novembre 1873.<br />
9 Voir J. Deramond, « Jeanne d’Arc tout contre la vie parisienne », La Vie Parisienne. Une langue, un mythe, un style,<br />
Actes du III e congrès international de la Société des Études Romantiques et Dix-neuviémistes (à paraître).<br />
- 42 -