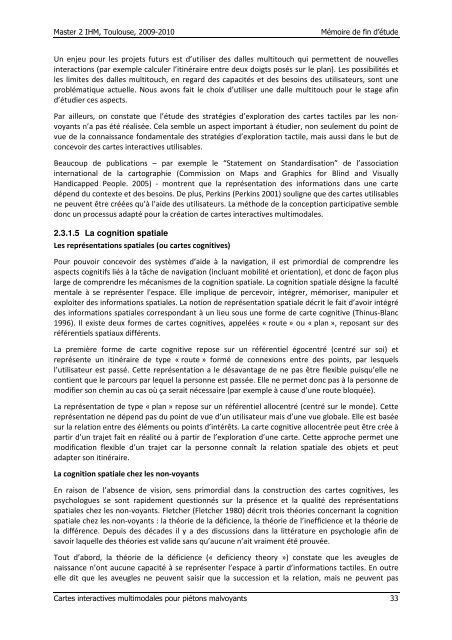« Cartes interactives multimodales pour piétons malvoyants » - FIRAH
« Cartes interactives multimodales pour piétons malvoyants » - FIRAH
« Cartes interactives multimodales pour piétons malvoyants » - FIRAH
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Master 2 IHM, Toulouse, 2009-2010 Mémoire de fin d’étude<br />
Un enjeu <strong>pour</strong> les projets futurs est d’utiliser des dalles multitouch qui permettent de nouvelles<br />
interactions (par exemple calculer l’itinéraire entre deux doigts posés sur le plan). Les possibilités et<br />
les limites des dalles multitouch, en regard des capacités et des besoins des utilisateurs, sont une<br />
problématique actuelle. Nous avons fait le choix d’utiliser une dalle multitouch <strong>pour</strong> le stage afin<br />
d’étudier ces aspects.<br />
Par ailleurs, on constate que l’étude des stratégies d’exploration des cartes tactiles par les nonvoyants<br />
n’a pas été réalisée. Cela semble un aspect important à étudier, non seulement du point de<br />
vue de la connaissance fondamentale des stratégies d’exploration tactile, mais aussi dans le but de<br />
concevoir des cartes <strong>interactives</strong> utilisables.<br />
Beaucoup de publications – par exemple le “Statement on Standardisation” de l’association<br />
international de la cartographie (Commission on Maps and Graphics for Blind and Visually<br />
Handicapped People. 2005) - montrent que la représentation des informations dans une carte<br />
dépend du contexte et des besoins. De plus, Perkins (Perkins 2001) souligne que des cartes utilisables<br />
ne peuvent être créées qu’à l’aide des utilisateurs. La méthode de la conception participative semble<br />
donc un processus adapté <strong>pour</strong> la création de cartes <strong>interactives</strong> <strong>multimodales</strong>.<br />
2.3.1.5 La cognition spatiale<br />
Les représentations spatiales (ou cartes cognitives)<br />
Pour pouvoir concevoir des systèmes d’aide à la navigation, il est primordial de comprendre les<br />
aspects cognitifs liés à la tâche de navigation (incluant mobilité et orientation), et donc de façon plus<br />
large de comprendre les mécanismes de la cognition spatiale. La cognition spatiale désigne la faculté<br />
mentale à se représenter l'espace. Elle implique de percevoir, intégrer, mémoriser, manipuler et<br />
exploiter des informations spatiales. La notion de représentation spatiale décrit le fait d’avoir intégré<br />
des informations spatiales correspondant à un lieu sous une forme de carte cognitive (Thinus-Blanc<br />
1996). Il existe deux formes de cartes cognitives, appelées <strong>«</strong> route <strong>»</strong> ou <strong>«</strong> plan <strong>»</strong>, reposant sur des<br />
référentiels spatiaux différents.<br />
La première forme de carte cognitive repose sur un référentiel égocentré (centré sur soi) et<br />
représente un itinéraire de type <strong>«</strong> route <strong>»</strong> formé de connexions entre des points, par lesquels<br />
l’utilisateur est passé. Cette représentation a le désavantage de ne pas être flexible puisqu’elle ne<br />
contient que le parcours par lequel la personne est passée. Elle ne permet donc pas à la personne de<br />
modifier son chemin au cas où ça serait nécessaire (par exemple à cause d’une route bloquée).<br />
La représentation de type <strong>«</strong> plan <strong>»</strong> repose sur un référentiel allocentré (centré sur le monde). Cette<br />
représentation ne dépend pas du point de vue d’un utilisateur mais d’une vue globale. Elle est basée<br />
sur la relation entre des éléments ou points d’intérêts. La carte cognitive allocentrée peut être crée à<br />
partir d’un trajet fait en réalité ou à partir de l’exploration d’une carte. Cette approche permet une<br />
modification flexible d’un trajet car la personne connaît la relation spatiale des objets et peut<br />
adapter son itinéraire.<br />
La cognition spatiale chez les non-voyants<br />
En raison de l’absence de vision, sens primordial dans la construction des cartes cognitives, les<br />
psychologues se sont rapidement questionnés sur la présence et la qualité des représentations<br />
spatiales chez les non-voyants. Fletcher (Fletcher 1980) décrit trois théories concernant la cognition<br />
spatiale chez les non-voyants : la théorie de la déficience, la théorie de l’inefficience et la théorie de<br />
la différence. Depuis des décades il y a des discussions dans la littérature en psychologie afin de<br />
savoir laquelle des théories est valide sans qu’aucune n’ait vraiment été prouvée.<br />
Tout d’abord, la théorie de la déficience (<strong>«</strong> deficiency theory <strong>»</strong>) constate que les aveugles de<br />
naissance n’ont aucune capacité à se représenter l’espace à partir d’informations tactiles. En outre<br />
elle dit que les aveugles ne peuvent saisir que la succession et la relation, mais ne peuvent pas<br />
<strong>Cartes</strong> <strong>interactives</strong> <strong>multimodales</strong> <strong>pour</strong> <strong>piétons</strong> <strong>malvoyants</strong> 33