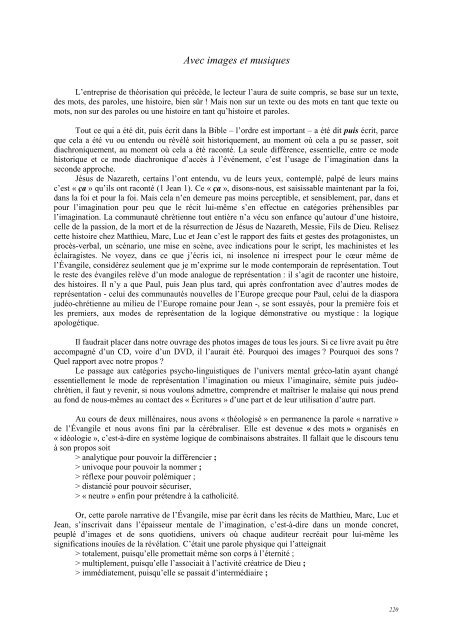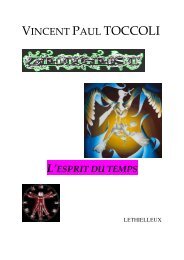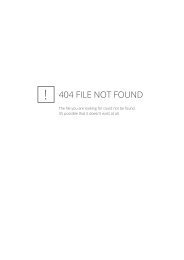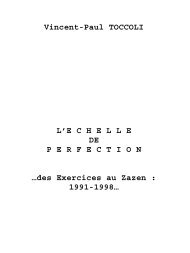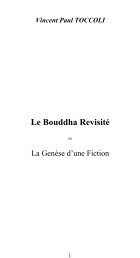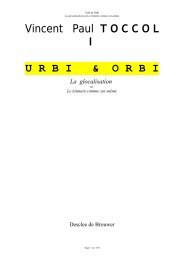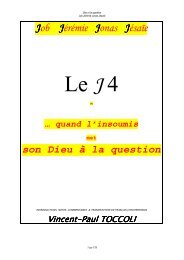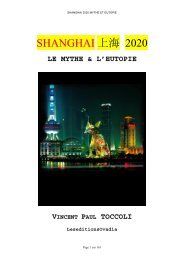dis raconte moi la bible pdf - Vincent-Paul Toccoli a-nous-dieu-toccoli
dis raconte moi la bible pdf - Vincent-Paul Toccoli a-nous-dieu-toccoli
dis raconte moi la bible pdf - Vincent-Paul Toccoli a-nous-dieu-toccoli
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Avec images et musiques<br />
L’entreprise de théorisation qui précède, le lecteur l’aura de suite compris, se base sur un texte,<br />
des mots, des paroles, une histoire, bien sûr ! Mais non sur un texte ou des mots en tant que texte ou<br />
mots, non sur des paroles ou une histoire en tant qu’histoire et paroles.<br />
Tout ce qui a été dit, puis écrit dans <strong>la</strong> Bible – l’ordre est important – a été dit puis écrit, parce<br />
que ce<strong>la</strong> a été vu ou entendu ou révélé soit historiquement, au moment où ce<strong>la</strong> a pu se passer, soit<br />
diachroniquement, au moment où ce<strong>la</strong> a été raconté. La seule différence, essentielle, entre ce mode<br />
historique et ce mode diachronique d’accès à l’événement, c’est l’usage de l’imagination dans <strong>la</strong><br />
seconde approche.<br />
Jésus de Nazareth, certains l’ont entendu, vu de leurs yeux, contemplé, palpé de leurs mains<br />
c’est « ça » qu’ils ont raconté (1 Jean 1). Ce « ça », <strong>dis</strong>ons-<strong>nous</strong>, est saisissable maintenant par <strong>la</strong> foi,<br />
dans <strong>la</strong> foi et pour <strong>la</strong> foi. Mais ce<strong>la</strong> n’en demeure pas <strong>moi</strong>ns perceptible, et sensiblement, par, dans et<br />
pour l’imagination pour peu que le récit lui-même s’en effectue en catégories préhensibles par<br />
l’imagination. La communauté chrétienne tout entière n’a vécu son enfance qu’autour d’une histoire,<br />
celle de <strong>la</strong> passion, de <strong>la</strong> mort et de <strong>la</strong> résurrection de Jésus de Nazareth, Messie, Fils de Dieu. Relisez<br />
cette histoire chez Matthieu, Marc, Luc et Jean c’est le rapport des faits et gestes des protagonistes, un<br />
procès-verbal, un scénario, une mise en scène, avec indications pour le script, les machinistes et les<br />
éc<strong>la</strong>iragistes. Ne voyez, dans ce que j’écris ici, ni insolence ni irrespect pour le cœur même de<br />
l’Évangile, considérez seulement que je m’exprime sur le mode contemporain de représentation. Tout<br />
le reste des évangiles relève d’un mode analogue de représentation : il s’agit de <strong>raconte</strong>r une histoire,<br />
des histoires. Il n’y a que <strong>Paul</strong>, puis Jean plus tard, qui après confrontation avec d’autres modes de<br />
représentation - celui des communautés nouvelles de l’Europe grecque pour <strong>Paul</strong>, celui de <strong>la</strong> diaspora<br />
judéo-chrétienne au milieu de l’Europe romaine pour Jean -, se sont essayés, pour <strong>la</strong> première fois et<br />
les premiers, aux modes de représentation de <strong>la</strong> logique démonstrative ou mystique : <strong>la</strong> logique<br />
apologétique.<br />
Il faudrait p<strong>la</strong>cer dans notre ouvrage des photos images de tous les jours. Si ce livre avait pu être<br />
accompagné d’un CD, voire d’un DVD, il l’aurait été. Pourquoi des images ? Pourquoi des sons ?<br />
Quel rapport avec notre propos ?<br />
Le passage aux catégories psycho-linguistiques de l’univers mental gréco-<strong>la</strong>tin ayant changé<br />
essentiellement le mode de représentation l’imagination ou mieux l’imaginaire, sémite puis judéochrétien,<br />
il faut y revenir, si <strong>nous</strong> voulons admettre, comprendre et maîtriser le ma<strong>la</strong>ise qui <strong>nous</strong> prend<br />
au fond de <strong>nous</strong>-mêmes au contact des « Écritures » d’une part et de leur utilisation d’autre part.<br />
Au cours de deux millénaires, <strong>nous</strong> avons « théologisé » en permanence <strong>la</strong> parole « narrative »<br />
de l’Évangile et <strong>nous</strong> avons fini par <strong>la</strong> cérébraliser. Elle est devenue « des mots » organisés en<br />
« idéologie », c’est-à-dire en système logique de combinaisons abstraites. Il fal<strong>la</strong>it que le <strong>dis</strong>cours tenu<br />
à son propos soit<br />
> analytique pour pouvoir <strong>la</strong> différencier ;<br />
> univoque pour pouvoir <strong>la</strong> nommer ;<br />
> réflexe pour pouvoir polémiquer ;<br />
> <strong>dis</strong>tancié pour pouvoir sécuriser,<br />
> « neutre » enfin pour prétendre à <strong>la</strong> catholicité.<br />
Or, cette parole narrative de l’Évangile, mise par écrit dans les récits de Matthieu, Marc, Luc et<br />
Jean, s’inscrivait dans l’épaisseur mentale de l’imagination, c’est-à-dire dans un monde concret,<br />
peuplé d’images et de sons quotidiens, univers où chaque auditeur recréait pour lui-même les<br />
significations inouïes de <strong>la</strong> révé<strong>la</strong>tion. C’était une parole physique qui l’atteignait<br />
> totalement, puisqu’elle promettait même son corps à l’éternité ;<br />
> multiplement, puisqu’elle l’associait à l’activité créatrice de Dieu ;<br />
> immédiatement, puisqu’elle se passait d’intermédiaire ;<br />
220