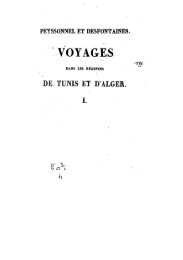BOUNFOUR, Abdellah, « Hemmu u Namir ou l'Œdipe berbère
BOUNFOUR, Abdellah, « Hemmu u Namir ou l'Œdipe berbère
BOUNFOUR, Abdellah, « Hemmu u Namir ou l'Œdipe berbère
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
fille (chien, m<strong>ou</strong>ton) humilient davantage son ép<strong>ou</strong>se et, au lieu d’ad<strong>ou</strong>cir la<br />
pulsion maternelle, elle l’aiguise davantage au point que la me` re peut voir dans<br />
cette protection paternelle le signe du statut privile´ gié de la fille aupre` sdupe` re.<br />
En d’autres termes, la rivalite´ est telle que la fille peut eˆ tre perc¸ ue par la me` re<br />
comme une co-e´ p<strong>ou</strong>se et la pre´ fe´ re´ e de son mari. En la cachant, dans un coffre,<br />
dans une chambre, évoque l’enfermement de Tanirt par H. emmu et,<br />
par conse´ quent, peut consolider le phantasme maternel. L’exigence maternelle<br />
– que ce soit le père qui exe´ cute la fille – consolide cette interpre´ tation. Ainsi la<br />
confusion des ge´ nérations irait-elle jusqu’a` sugge´ rer un inceste entre le père et<br />
sa fille, a` moins que cela ne soit une projection de la me` re. Ce qui montre bien<br />
que celle-ci prend son phantasme p<strong>ou</strong>r de la re´ alité. Face a` cette pathologie, les<br />
ruses du pe` re ne suffisent plus. A défaut d’eˆ tre le support d’une parole qui<br />
tranche dans le mensonge incestueux et mortife` re de la mère, il se re´ s<strong>ou</strong>d à<br />
abandonner sa fille dans la forêt p<strong>ou</strong>r la sauver de la mort. Ainsi l’abandon<br />
d’enfant apparaıˆ t-il, ici, comme une <strong>ou</strong>verture par rapport au cercle infernal<br />
du triangle familial. Grande et muˆ re, Tanirt peut maintenant voler de ses<br />
propres ailes et s’e´ loigner de sa me` re-ogresse.<br />
2. La famille ambivalente<br />
On sait que les c<strong>ou</strong>ples d’ogres sont la figure ne´ gative du cercle familial dans<br />
les contes berbe` res 9 . T<strong>ou</strong>tefois, ce n’est pas le cas dans cette version :<br />
– En n<strong>ou</strong>rrissant les petits ogres, en leur donnant des friandises et en j<strong>ou</strong>ant<br />
avec eux, Tanirt se comporte non seulement comme une sœur aıˆ née – elle est<br />
ainsi nomme´ e par les petits ogres –, mais en femme muˆ re et potentiellement<br />
me` re. Elle est n<strong>ou</strong>rricie` re, éducatrice et donneuse de plaisir aux petits des<br />
autres. Tanirt, contrairement a` sa me` re, est <strong>ou</strong>verte sur l’alte´ rite´ la plus<br />
sauvage et la plus dangereuse p<strong>ou</strong>r elle-meˆ me ; elle l’apprivoise. A cette<br />
<strong>ou</strong>verture elle devra son salut.<br />
– En effet, l’ogresse, en bonne me` re, l’épargnera et la sauvera de son mari<br />
qui, contrairement au pe` re de Tanirt, v<strong>ou</strong>drait la manger. Elle lui indiquera<br />
comment retr<strong>ou</strong>ver son chemin vers un ailleurs plus cle´ ment. Second abandon<br />
qui apparaît, la` aussi, comme une <strong>ou</strong>verture par rapport a` un cercle familial<br />
mortifie´ et sans issue. C’est dans ce chemin qu’elle rencontrera H. emmu.<br />
Que conclure de ces deux épisodes ?<br />
– Tanirt apparaît comme un sujet <strong>«</strong> apathique ». Elle n’a de re´ action propre,<br />
lors des deux e´ pisodes, que lorsqu’elle s’occupe des enfants des ogres. Ce qui<br />
9. E. La<strong>ou</strong>st, Contes berbe`res du Maroc, Institut des Hautes Etudes Marocaines, 1945,<br />
volume 2, <strong>«</strong> Des noms <strong>berbère</strong>s de l’ogre et de l’ogresse », p. XVII-XXVIII. L’auteur conclut<br />
que le <strong>«</strong> concept » d’ogre en <strong>berbère</strong> retient essentiellement deux traits, la férocité et le cannibalisme.<br />
127