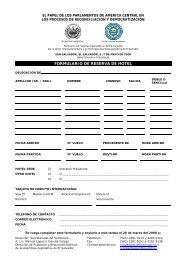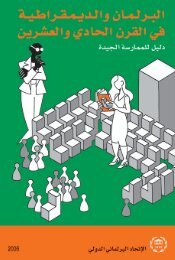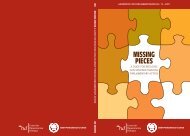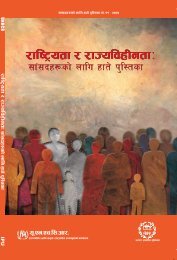Les femmes rwandaises et la campagne électorale - Inter ...
Les femmes rwandaises et la campagne électorale - Inter ...
Les femmes rwandaises et la campagne électorale - Inter ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Les</strong> <strong>femmes</strong> <strong>rwandaises</strong> <strong>et</strong> <strong>la</strong> <strong>campagne</strong> électorale • 30 - 31 juill<strong>et</strong> 2003<br />
des pratiques destinées à favoriser l'égalité des chances, à corriger des discriminations dont souffrent des<br />
minorités. Mais, même dans c<strong>et</strong>te tradition, des mesures contraignantes destinées à améliorer <strong>la</strong> représentation<br />
politique des <strong>femmes</strong> se heurtent à des résistances.<br />
<strong>Les</strong> <strong>femmes</strong>, en tout état de cause, ne constituent pas une minorité. Elles sont généralement un peu plus<br />
nombreuses que les hommes dans toutes les sociétés <strong>et</strong> sont présentes dans toutes les catégories sociales,<br />
religieuses, <strong>et</strong>hniques ou encore d’âge <strong>et</strong>, dans toutes, discriminées (en droit ou en fait) en raison de leur sexe.<br />
Elles sont ainsi susceptibles de souffrir de multiples discriminations. Celle qui est liée à leur sexe biologique doit<br />
donc être considérée de façon spécifique. Ce<strong>la</strong> ne voudra pas dire que les autres causes de discrimination<br />
disparaîtront mais que, dans chaque autre catégorie, le fait d’être une femme sera pris en considération.<br />
Dans <strong>la</strong> Charte de l’ONU de 1945 <strong>et</strong> dans <strong>la</strong> Déc<strong>la</strong>ration Universelle des droits de l’homme de 1948, <strong>la</strong><br />
prohibition de <strong>la</strong> discrimination en raison du sexe est inscrite. Il a cependant fallu attendre 1993 pour que soit<br />
affirmé, à <strong>la</strong> Conférence de Vienne sur les Droits de l'Homme, que « les droits fondamentaux de <strong>la</strong> femme <strong>et</strong> de<br />
<strong>la</strong> fill<strong>et</strong>te sont une part inaliénable, intégrale <strong>et</strong> indivisible des droits universels de <strong>la</strong> personne humaine ».<br />
La Convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination (dite Convention CEDAW), adoptée par l'ONU<br />
en 1979 <strong>et</strong> en application depuis 1981, est l'un des instruments fondamentaux de <strong>la</strong> mise en œuvre d'une<br />
politique d'égalité. C<strong>et</strong>te Convention a opéré un saut qualitatif entre égalité formelle <strong>et</strong> égalité des chances, entre<br />
proc<strong>la</strong>mation d'égalité des chances <strong>et</strong> pratique de l'égalité. L'Article 4 de <strong>la</strong> Convention précise que « L'adoption<br />
par les Etats parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre<br />
les hommes <strong>et</strong> les <strong>femmes</strong> n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini par <strong>la</strong><br />
présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou<br />
distinctes. Ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité des chances ont été<br />
atteints ». Ajoutons enfin que l'Article 7 de <strong>la</strong> même Convention développe <strong>la</strong> légitimité d'actions positives dans <strong>la</strong><br />
vie publique : « <strong>Les</strong> Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer <strong>la</strong> discrimination des<br />
<strong>femmes</strong> dans <strong>la</strong> vie politique <strong>et</strong> publique du pays, <strong>et</strong> en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité<br />
avec les hommes, le droit : ... De prendre part à l'é<strong>la</strong>boration de <strong>la</strong> politique de l'Etat <strong>et</strong> à son exécution, occuper<br />
des emplois publics <strong>et</strong> exercer des fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement ... ».<br />
A ce jour, cent soixante-quatorze pays, dont le Rwanda, ont ratifié <strong>la</strong> Convention CEDAW. Ils se sont donc<br />
autorisés à prendre des mesures constitutionnelles <strong>et</strong>/ou légis<strong>la</strong>tives en faveur d'une participation équilibrée des<br />
<strong>femmes</strong> <strong>et</strong> des hommes dans tous les domaines de <strong>la</strong> vie publique. Ces mesures peuvent être diverses. Elles<br />
peuvent être incitatives, à travers des <strong>campagne</strong>s d’opinions, ou contraignantes, à travers des lois. En ce qui<br />
concerne ces dernières, il peut s’agir de quotas imposés aux partis ou même de l’absolue parité de candidatures,<br />
ou même encore une obligation de résultat. Des pays aussi différents que, par exemple, l’Ouganda ou <strong>la</strong><br />
Belgique, le Costa Rica, <strong>la</strong> France <strong>et</strong> l’Argentine, ou encore l’Inde <strong>et</strong> <strong>la</strong> Grèce (pour les seules élections<br />
municipales en ce qui concerne ces deux pays), se sont engagés dans <strong>la</strong> voie de <strong>la</strong> contrainte que doivent<br />
respecter les partis <strong>et</strong> groupements politiques d’un seuil de <strong>femmes</strong> candidates. Il convient de saluer le fait que<br />
<strong>la</strong> Constitution adoptée par le peuple rwandais inclus, dans le corps de son texte, <strong>la</strong> référence aux Conventions<br />
internationales que le Rwanda a ratifiées, <strong>et</strong> en particulier <strong>la</strong> Convention CEDAW. De nombreux articles de <strong>la</strong><br />
Constitution traitent en outre de l’égalité des <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> des hommes <strong>et</strong> prévoient notamment un seuil minimum<br />
de représentation des <strong>femmes</strong> dans les fonctions électives. <strong>Les</strong> lois électorales confirment c<strong>et</strong>te volonté. Le<br />
Rwanda figure aujourd’hui, pour son Assemblée nationale de transition, au 23 ème rang mondial en ce qui<br />
concerne <strong>la</strong> participation des <strong>femmes</strong>. <strong>Les</strong> prochaines élections devraient lui faire monter encore quelques rangs<br />
au p<strong>la</strong>n mondial.<br />
La parité hommes/<strong>femmes</strong> constitue une exigence démocratique <strong>et</strong> un gage de bonne gouvernance. Elle ne<br />
saurait cependant suffire. Il est, en outre, nécessaire que les élus, hommes <strong>et</strong> <strong>femmes</strong>, représentent <strong>la</strong> diversité<br />
de <strong>la</strong> société. Ils <strong>et</strong> elles sont divers, <strong>et</strong> leur diversité représente une richesse pour chaque nation, pour le<br />
développement de <strong>la</strong> démocratie <strong>et</strong> pour <strong>la</strong> cohésion nationale. On l’a souvent répété : une démocratie sans les<br />
<strong>femmes</strong> (ou avec seulement quelques <strong>femmes</strong> servant d’alibi) n’est pas une démocratie. <strong>Les</strong> Rwandaises<br />
seront, on ne peut en douter, des partenaires incontournables <strong>et</strong> efficaces de l’avenir du pays, à tous les<br />
niveaux, <strong>et</strong> d’abord au sein du Parlement. •<br />
42