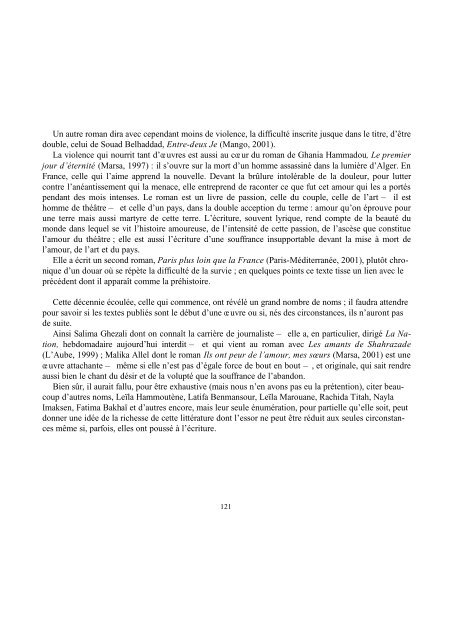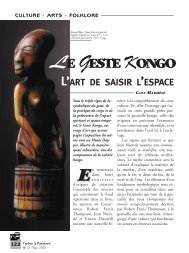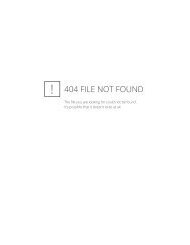ÃTUDE Regard sur la littérature féminine algérienne
ÃTUDE Regard sur la littérature féminine algérienne
ÃTUDE Regard sur la littérature féminine algérienne
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Un autre roman dira avec cependant moins de violence, <strong>la</strong> difficulté inscrite jusque dans le titre, d’être<br />
double, celui de Souad Belhaddad, Entre-deux Je (Mango, 2001).<br />
La violence qui nourrit tant d’œuvres est aussi au cœur du roman de Ghania Hammadou, Le premier<br />
jour d’éternité (Marsa, 1997) : il s’ouvre <strong>sur</strong> <strong>la</strong> mort d’un homme assassiné dans <strong>la</strong> lumière d’Alger. En<br />
France, celle qui l’aime apprend <strong>la</strong> nouvelle. Devant <strong>la</strong> brûlure intolérable de <strong>la</strong> douleur, pour lutter<br />
contre l’anéantissement qui <strong>la</strong> menace, elle entreprend de raconter ce que fut cet amour qui les a portés<br />
pendant des mois intenses. Le roman est un livre de passion, celle du couple, celle de l’art — il est<br />
homme de théâtre — et celle d’un pays, dans <strong>la</strong> double acception du terme : amour qu’on éprouve pour<br />
une terre mais aussi martyre de cette terre. L’écriture, souvent lyrique, rend compte de <strong>la</strong> beauté du<br />
monde dans lequel se vit l’histoire amoureuse, de l’intensité de cette passion, de l’ascèse que constitue<br />
l’amour du théâtre ; elle est aussi l’écriture d’une souffrance insupportable devant <strong>la</strong> mise à mort de<br />
l’amour, de l’art et du pays.<br />
Elle a écrit un second roman, Paris plus loin que <strong>la</strong> France (Paris-Méditerranée, 2001), plutôt chronique<br />
d’un douar où se répète <strong>la</strong> difficulté de <strong>la</strong> <strong>sur</strong>vie ; en quelques points ce texte tisse un lien avec le<br />
précédent dont il apparaît comme <strong>la</strong> préhistoire.<br />
Cette décennie écoulée, celle qui commence, ont révélé un grand nombre de noms ; il faudra attendre<br />
pour savoir si les textes publiés sont le début d’une œuvre ou si, nés des circonstances, ils n’auront pas<br />
de suite.<br />
Ainsi Salima Ghezali dont on connaît <strong>la</strong> carrière de journaliste — elle a, en particulier, dirigé La Nation,<br />
hebdomadaire aujourd’hui interdit — et qui vient au roman avec Les amants de Shahrazade<br />
(L’Aube, 1999) ; Malika Allel dont le roman Ils ont peur de l’amour, mes sœurs (Marsa, 2001) est une<br />
œuvre attachante — même si elle n’est pas d’égale force de bout en bout — , et originale, qui sait rendre<br />
aussi bien le chant du désir et de <strong>la</strong> volupté que <strong>la</strong> souffrance de l’abandon.<br />
Bien sûr, il aurait fallu, pour être exhaustive (mais nous n’en avons pas eu <strong>la</strong> prétention), citer beaucoup<br />
d’autres noms, Leï<strong>la</strong> Hammoutène, Latifa Benmansour, Leï<strong>la</strong> Marouane, Rachida Titah, Nay<strong>la</strong><br />
Imaksen, Fatima Bakhaï et d’autres encore, mais leur seule énumération, pour partielle qu’elle soit, peut<br />
donner une idée de <strong>la</strong> richesse de cette littérature dont l’essor ne peut être réduit aux seules circonstances<br />
même si, parfois, elles ont poussé à l’écriture.<br />
121