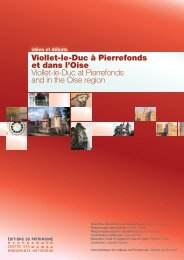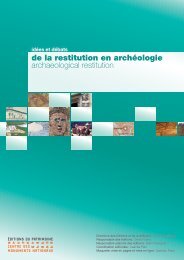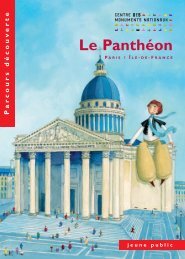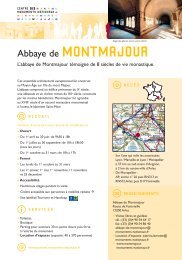Le château de Pont-d'Ain, place militaire et résidence comtale ...
Le château de Pont-d'Ain, place militaire et résidence comtale ...
Le château de Pont-d'Ain, place militaire et résidence comtale ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Le</strong> château <strong>de</strong> <strong>Pont</strong>-d’Ain, <strong>place</strong> <strong>militaire</strong><br />
<strong>et</strong> rési<strong>de</strong>nce <strong>comtale</strong> : nouvelles données<br />
livrées par les textes <strong>et</strong> l’archéologie du bâti<br />
Chantal Delomier <strong>et</strong> Alain Kersuzan<br />
Son très grand intérêt rési<strong>de</strong>ntiel tenait à plusieurs qualités : son ampleur, les vastes espaces<br />
<strong>de</strong> ses cours en étages, les forêts giboyeuses aux alentours, sa vue sur la rivière <strong>et</strong> la plaine, la<br />
qualité <strong>de</strong> son air, sa situation au passage <strong>de</strong>s marchands <strong>et</strong> <strong>de</strong>s voyageurs qui y apportaient<br />
<strong>de</strong> la vie <strong>et</strong> <strong>de</strong>s nouvelles. Par ses dimensions <strong>et</strong> ses décors, l’aula <strong>de</strong> <strong>Pont</strong>-d’Ain avait en<br />
outre tout pour plaire <strong>et</strong> pour perm<strong>et</strong>tre d’y mener une vie « <strong>de</strong> château ».<br />
<strong>Le</strong>s comptes <strong>de</strong> la châtellenie recèlent une anecdote amusante : à l’ouest du château, au- <strong>de</strong>là<br />
du grand fossé, se trouvaient <strong>de</strong>s vignes <strong>et</strong> un verger. <strong>Le</strong>s comtesses aimaient s’y promener<br />
mais, par peur <strong>de</strong>s araignées qui nichaient dans les arbres <strong>et</strong> redoutant que les toiles se<br />
prennent dans leur haut hennin, coiffure dont la mo<strong>de</strong> faisait rage au xv e siècle, elles faisaient<br />
n<strong>et</strong>toyer, au moyen <strong>de</strong> grands bâtons, les branches par les paysans dont les salaires sont<br />
consignés dans les comptes. Voilà <strong>de</strong> quoi imaginer la vie quotidienne <strong>et</strong> animée <strong>de</strong> bâtiments<br />
qui, sans cela, ne sont <strong>de</strong>s amas <strong>de</strong> pierres bien agencées…<br />
A. K.<br />
Quelques résultats <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> archéologique <strong>de</strong> l’aula<br />
par Chantal Delomier<br />
Du château médiéval <strong>de</strong> <strong>Pont</strong>-d’Ain subsiste une vaste <strong>de</strong>meure rectangulaire, mesurant<br />
46,60 m <strong>de</strong> long sur 15,20 m <strong>de</strong> large, implantée sur une terrasse dominant la ville, installée<br />
sur la rive droite <strong>de</strong> la rivière 16 . La fouille archéologique <strong>de</strong>s élévations a démontré que c<strong>et</strong>te<br />
enveloppe bâtie actuelle recouvre exactement les contours <strong>de</strong> l’aula médiévale, cœur du<br />
complexe castral érigé par les comtes <strong>de</strong> Savoie au début du xiv e siècle. <strong>Le</strong> creusement d’un<br />
large fossé commence en eff<strong>et</strong> dès 1305, à l’ouest <strong>et</strong> au nord du site castral, sur un terrain<br />
plat. Dans le même temps, la construction d’une courtine crénelée constitue le premier horizon<br />
archéologique bâti avéré. L’exercice comptable exécuté <strong>de</strong> mars 1335 à août 1336 apparaît<br />
comme l’un <strong>de</strong>s plus fournis parmi les comptes <strong>de</strong> châtellenie publiés ; l’aula est alors dite<br />
« refaite », associée à « la réfection <strong>de</strong>s cuisines <strong>et</strong> toute la maison du cellier, détruits à cause<br />
<strong>de</strong> la vétusté […] refaits à neuf pour la venue du seigneur <strong>et</strong> <strong>de</strong> Madame ». Ces états successifs<br />
<strong>de</strong> reconstruction furent r<strong>et</strong>rouvés dans les sondages ouverts dans les murs, apparaissant en<br />
« bruit <strong>de</strong> fond », <strong>et</strong> dont les reprises restent parfois extrêmement difficiles à dissocier les unes<br />
<strong>de</strong>s autres. <strong>Le</strong>s données livrées par l’opération archéologique éclairent certaines mentions<br />
textuelles restées obscures, concernant par exemple la taille <strong>et</strong> le processus <strong>de</strong> mise en œuvre<br />
<strong>de</strong>s matériaux, le phasage <strong>de</strong>s constructions, les contours <strong>et</strong> la répartition du décor peint (ill. 3),<br />
la morphologie <strong>de</strong>s baies (issues <strong>de</strong> 8 campagnes <strong>de</strong> construction, ill. 4), le module exact du<br />
crénelage <strong>de</strong> la courtine ou la datation <strong>de</strong> sa suppression. Cependant, l’altération, la disparition<br />
ou les très nombreuses perturbations enregistrées dans le bâti interdisent toute corrélation<br />
systématique <strong>de</strong>s résultats archéologiques aux détails <strong>de</strong>s comptes <strong>de</strong> châtellenie. On pense<br />
notamment exemple à la disparition totale <strong>de</strong> tout élément stratigraphique se rapportant peu ou<br />
prou à l’escalier d’accès extérieur mentionné dans les comptes, aux arcs structurants le cellier, aux<br />
cheminées <strong>de</strong> l’étage ou à la séparation <strong>de</strong>s espaces intérieurs. L’historien <strong>et</strong> l’archéologue usent<br />
<strong>de</strong> registres différenciés <strong>et</strong> complémentaires dans un temps inégal. Et l’opération archéologique<br />
reste toujours soumise à <strong>de</strong> multiples contraintes d’intervention <strong>et</strong> aux aléas <strong>de</strong> chantiers ; elle<br />
s’est ici essentiellement concentrée à la fouille <strong>de</strong> la moitié intérieure nord <strong>de</strong> l’édifice, en un point<br />
où les intrusions du xviii e siècle étaient rémanentes (horizon 9). En eff<strong>et</strong>, la fouille entreprise sur les<br />
élévations intérieures <strong>et</strong> extérieures <strong>de</strong> l’aula a permis <strong>de</strong> proposer une stratigraphie composée<br />
<strong>de</strong> dix phases chronologiques, se succédant du Moyen Âge à nos jours. L’aula <strong>comtale</strong> est le<br />
lieu emblématique <strong>de</strong> l’exercice du pouvoir qui constitue le cœur <strong>de</strong> l’ensemble castral. Dans la<br />
première moitié du xiv e siècle, son rez-<strong>de</strong>-chaussée comprend un cellier, ponctuel lement transformé<br />
en écurie lors <strong>de</strong> chevauchées guerrières, <strong>et</strong> éclairé à l’est par <strong>de</strong>s fenêtres étroites :<br />
quatre d’entre elles furent r<strong>et</strong>rouvées lors <strong>de</strong> la fouille.<br />
16. Kersuzan 2005, p. 45.


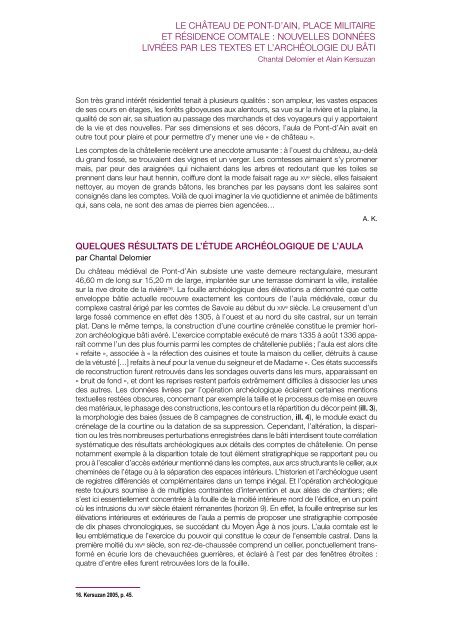
![I a @aj pna `ao i k j q i aj po j ] pek j ] q t l nųoaj pa ] q _d Špa] q `a I ...](https://img.yumpu.com/26991655/1/184x260/i-a-aj-pna-ao-i-k-j-q-i-aj-po-j-pek-j-q-t-l-naoaj-pa-q-d-a-pa-q-a-i-.jpg?quality=85)

![I a @ aj pna ` ao i k j q i aj po j ]pek j ]q t lnùoaj pa au château de ...](https://img.yumpu.com/26991649/1/184x260/i-a-aj-pna-ao-i-k-j-q-i-aj-po-j-pek-j-q-t-lnaoaj-pa-au-chateau-de-.jpg?quality=85)