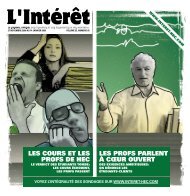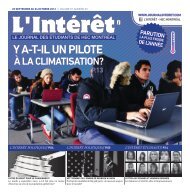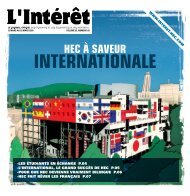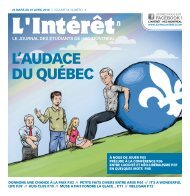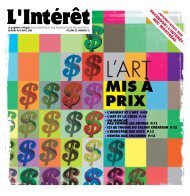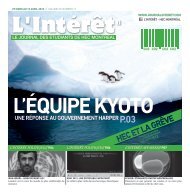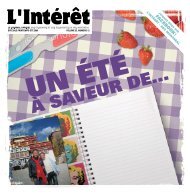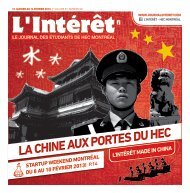Parution 9 - L'Intérêt
Parution 9 - L'Intérêt
Parution 9 - L'Intérêt
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
DOSSIER// Au diable les BABY-BOOMERS !<br />
Personnalité invitée<br />
Joseph Facal<br />
Dans<br />
le cadre de notre dossier sur la guerre des générations,<br />
<strong>L'Intérêt</strong> publie un extrait du dernier livre de M. Joseph<br />
Facal, ex-politique québécois et professeur à HEC Montréal.<br />
«Douze générations ont fait du Québec ce qu’il est<br />
aujourd’hui. Elles ont admirablement bien travaillé, surtout si<br />
on considère l’adversité qu’elles ont affrontée. À intervalles<br />
irréguliers, nos prédécesseurs sont périodiquement parvenus<br />
à des carrefours déterminants pour l’avenir de notre nation.<br />
À quelques nuances près, ils ont toujours fait les bons choix,<br />
qui n’étaient à peu près jamais les plus faciles.<br />
Le Québec d’aujourd’hui, j’en suis absolument persuadé, est parvenu<br />
à un autre de ces moments-charnière de son histoire. J’ai essayé<br />
de documenter de mon mieux, sans prétention à l’exhaustivité et<br />
en essayant de ne pas accoucher d’un ouvrage dont l’épaisseur<br />
aurait découragée, cette constellation de facteurs démographiques,<br />
économiques, politiques, culturels, technologiques, éthiques, qui<br />
nous imposent aujourd’hui de faire, à nouveau, des choix collectifs<br />
exigeants, dont j’ai aussi dessiné les contours.<br />
Notre peuple ressent tout cela. Il<br />
voit bien ce qui ne tourne plus rond<br />
du tout, mais aussi ce à quoi il est<br />
attaché et qu’il veut préserver.<br />
Il reçoit aussi de ses élites<br />
des messages contradictoires.<br />
Jusqu’à un certain point, c’est le<br />
propre du débat démocratique.<br />
Nous faisons cependant face à<br />
un certain nombre de réalités si<br />
indiscutables, dans leurs grandes<br />
lignes en tout cas, qu’elles<br />
s’imposent progressivement à tous<br />
les courants de pensée, sauf les<br />
plus marginaux.<br />
Évidemment, si notre peuple<br />
montre des signes d’ambivalence,<br />
c’est non seulement parce que<br />
celle-ci est la fille de notre<br />
histoire compliquée, mais aussi<br />
parce que nous sentons tous que<br />
les réformes dont le Québec a<br />
besoin seraient très exigeantes.<br />
Je n’ai d’ailleurs pas cherché à<br />
en minimiser les difficultés. Il y a<br />
donc comme une part de nous qui<br />
hésite, très naturellement, à s’y engager. Presque par définition,<br />
des gains escomptés sont aussi plus intangibles que des sacrifices<br />
concrets et immédiats. Nous craignons donc plus les seconds que<br />
nous ne désirons les premiers.<br />
J’ose tout de même penser<br />
que nous voudrons offrir<br />
à ceux qui nous suivront<br />
autre chose que des<br />
excuses.<br />
J’ose tout de même penser que nous voudrons offrir à ceux qui<br />
nous suivront autre chose que des excuses. Il faudra donc nous<br />
décider à poser résolument la culture de la majorité francophone<br />
comme culture de référence, à protéger les valeurs et les traditions<br />
qui le méritent, à nous soucier<br />
de productivité économique,<br />
à refonder nos mécanismes<br />
institutionnels de solidarité, à<br />
cesser d’hypothéquer notre avenir<br />
financier, à faire ce qu’il faut<br />
pour atténuer le bouleversement<br />
démographique dans lequel nous<br />
sommes engagés, et, bien sûr, à<br />
regarder lucidement notre rapide<br />
perte d’influence politique dans le<br />
Canada et en tirer des conclusions.<br />
Je répète que je mesure pleinement<br />
les immenses difficultés de tous<br />
ces chantiers. D’autant plus<br />
immenses que le Québec est<br />
traversé, comme toutes les sociétés<br />
occidentales, par des sensibilités<br />
qui compliquent bien plus qu’elles<br />
ne facilitent les redressements<br />
collectifs : un matérialisme forcené,<br />
un individualisme amnésique, un<br />
cynisme galopant, une idolâtrie<br />
de la nouveauté confondue avec<br />
le progrès, un relativisme dont on<br />
cherche parfois les limites.<br />
Je reste pourtant d’un optimisme prudent. D’une part, parce que notre<br />
peuple a déjà fait, dans le passé, la démonstration de sa capacité à<br />
se ressaisir, et qu’il dispose encore aujourd’hui, et même plus que<br />
jamais, de tous les atouts requis pour cela. D’autre part, parce que<br />
l’alternative serait une sorte de consentement à notre propre déclin,<br />
qui me semble proprement impensable, bien que la vérité oblige ici<br />
à dire que l’histoire est remplie d’exemples de peuples qui n’ont pas<br />
su éviter la folklorisation.<br />
Dans l’immédiat, ce sont ceux qui nous tiennent lieu d’élites qui sont<br />
évidemment les premiers interpellés. On trouve certes dans l’histoire<br />
des exemples d’accélération subite des événements qui placent<br />
les peuples en avant, en quelque sorte, de leurs propres élites, qui<br />
se retrouvent alors comme dépassées par la situation. Mais c’est<br />
plutôt l’inverse qui est la norme. Quand les nations parviennent à<br />
des carrefours décisifs, ce sont leurs dirigeants politiques qui sont<br />
les premiers convoqués à la barre.<br />
À cet égard, il me semble que nous fait défaut en ce moment un<br />
leadership politique qui, plutôt que de se soucier de questions<br />
d’intendance, de l’apparence des choses ou de simplement durer,<br />
proposerait à notre peuple un récit de lui-même, de sa trajectoire<br />
historique jusqu’ici et du monde qui se dessine devant nous, qui serait<br />
porteur de sens et dans lequel nos concitoyens se reconnaîtraient.<br />
Mais croyez-moi, il est trop facile de blâmer nos dirigeants, de<br />
les taxer de lâches ou d’incompétents quand ils n’ont, démocratie<br />
oblige, d’autres espaces de manœuvre que ceux que nous-mêmes<br />
leur laissons.<br />
Nous disons vouloir entendre d’eux la vérité, mais nous ne<br />
l’acceptons vraiment que si elle est plaisante. Nous trouvons normal<br />
qu’ils aillent faire les pitres dans des émissions de variété, et nous<br />
leur reprochons ensuite de manquer d’envergure. Trop souvent, nous<br />
récompensons aux urnes ceux qu’ils veulent durer plutôt que ceux<br />
qui veulent faire. Nous leur demandons de se rendre «populaires»<br />
pour récolter nos votes, alors qu’il nous faudrait ensuite accepter<br />
qu’ils doivent parfois se rendre impopulaires pour bien gouverner.<br />
Dans l’histoire des peuples, rien n’est jamais écrit d’avance, sauf<br />
dans les cas où la loi du nombre prend la forme d’un courant trop<br />
fort pour être remonté et devient implacable. Nous approchons de ce<br />
moment. Nous y sommes presque. Nous y entrons à vrai dire.»<br />
EXTRAIT TIRÉ DE : J.FACAL, QUELQUE CHOSE COMME UN GRAND PEUPLE,<br />
Boréal, 2010, pp. 289-292.<br />
VOLUME 54, NUMÉRO 09 // 11 Février au 10 mars 2010 // 011