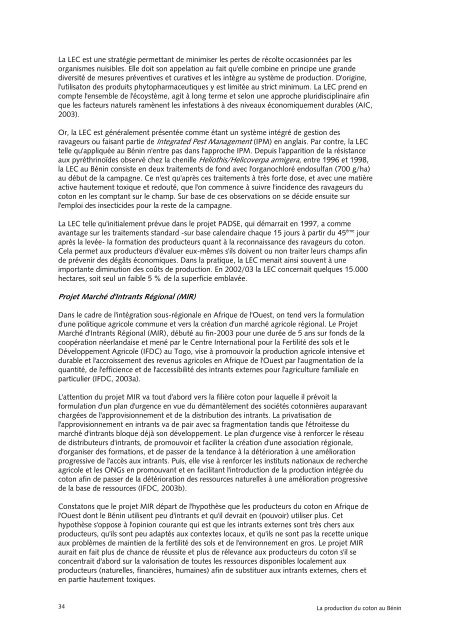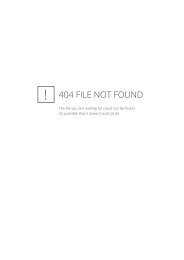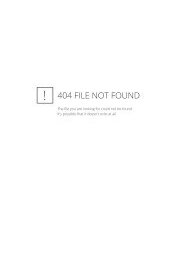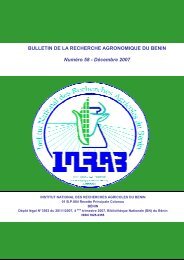LA PRODUCTION DU COTON AU BENIN Projet d'analyse d ... - Slire
LA PRODUCTION DU COTON AU BENIN Projet d'analyse d ... - Slire
LA PRODUCTION DU COTON AU BENIN Projet d'analyse d ... - Slire
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
La LEC est une stratégie permettant de minimiser les pertes de récolte occasionnées par lesorganismes nuisibles. Elle doit son appelation au fait qu'elle combine en principe une grandediversité de mesures préventives et curatives et les intègre au système de production. D'origine,l'utilisaton des produits phytopharmaceutiques y est limitée au strict minimum. La LEC prend encompte l'ensemble de l'écoystème, agit à long terme et selon une approche pluridisciplinaire afinque les facteurs naturels ramènent les infestations à des niveaux économiquement durables (AIC,2003).Or, la LEC est généralement présentée comme étant un système intégré de gestion desravageurs ou faisant partie de Integrated Pest Management (IPM) en anglais. Par contre, la LECtelle qu'appliquée au Bénin n'entre pas dans l'approche IPM. Depuis l'apparition de la résistanceaux pyréthrinoïdes observé chez la chenille Heliothis/Helicoverpa armigera, entre 1996 et 1998,la LEC au Bénin consiste en deux traitements de fond avec l'organochloré endosulfan (700 g/ha)au début de la campagne. Ce n'est qu'après ces traitements à très forte dose, et avec une matièreactive hautement toxique et redouté, que l'on commence à suivre l'incidence des ravageurs ducoton en les comptant sur le champ. Sur base de ces observations on se décide ensuite surl'emploi des insecticides pour la reste de la campagne.La LEC telle qu'initialement prévue dans le projet PADSE, qui démarrait en 1997, a commeavantage sur les traitements standard -sur base calendaire chaque 15 jours à partir du 45 ème jouraprès la levée- la formation des producteurs quant à la reconnaissance des ravageurs du coton.Cela permet aux producteurs d'évaluer eux-mêmes s'ils doivent ou non traiter leurs champs afinde prévenir des dégâts économiques. Dans la pratique, la LEC menait ainsi souvent à uneimportante diminution des coûts de production. En 2002/03 la LEC concernait quelques 15.000hectares, soit seul un faible 5 % de la superficie emblavée.<strong>Projet</strong> Marché d'Intrants Régional (MIR)Dans le cadre de l'intégration sous-régionale en Afrique de l'Ouest, on tend vers la formulationd'une politique agricole commune et vers la création d'un marché agricole régional. Le <strong>Projet</strong>Marché d'Intrants Régional (MIR), débuté au fin-2003 pour une durée de 5 ans sur fonds de lacoopération néerlandaise et mené par le Centre International pour la Fertilité des sols et leDéveloppement Agricole (IFDC) au Togo, vise à promouvoir la production agricole intensive etdurable et l'accroissement des revenus agricoles en Afrique de l'Ouest par l'augmentation de laquantité, de l'efficience et de l'accessibilité des intrants externes pour l'agriculture familiale enparticulier (IFDC, 2003a).L'attention du projet MIR va tout d'abord vers la filière coton pour laquelle il prévoit laformulation d'un plan d'urgence en vue du démantèlement des sociétés cotonnières auparavantchargées de l'approvisionnement et de la distribution des intrants. La privatisation del'approvisionnement en intrants va de pair avec sa fragmentation tandis que l'étroitesse dumarché d'intrants bloque déjà son développement. Le plan d'urgence vise à renforcer le réseaude distributeurs d'intrants, de promouvoir et faciliter la création d'une association régionale,d'organiser des formations, et de passer de la tendance à la détérioration à une améliorationprogressive de l'accès aux intrants. Puis, elle vise à renforcer les instituts nationaux de rechercheagricole et les ONGs en promouvant et en facilitant l'introduction de la production intégrée ducoton afin de passer de la détérioration des ressources naturelles à une amélioration progressivede la base de ressources (IFDC, 2003b).Constatons que le projet MIR départ de l'hypothèse que les producteurs du coton en Afrique del'Ouest dont le Bénin utilisent peu d'intrants et qu'il devrait en (pouvoir) utiliser plus. Cethypothèse s'oppose à l'opinion courante qui est que les intrants externes sont très chers auxproducteurs, qu'ils sont peu adaptés aux contextes locaux, et qu'ils ne sont pas la recette uniqueaux problèmes de maintien de la fertilité des sols et de l'environnement en gros. Le projet MIRaurait en fait plus de chance de réussite et plus de rélevance aux producteurs du coton s'il seconcentrait d'abord sur la valorisation de toutes les ressources disponibles localement auxproducteurs (naturelles, financières, humaines) afin de substituer aux intrants externes, chers eten partie hautement toxiques.34 La production du coton au Bénin