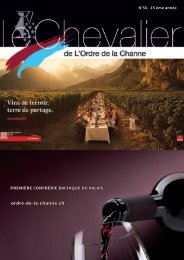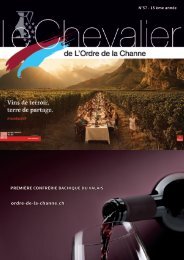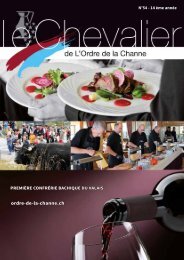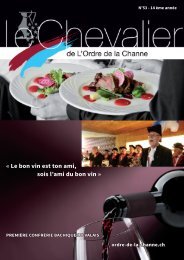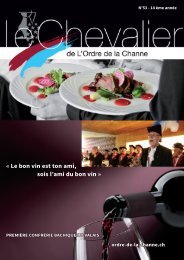Le Chevalier - N°45
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
N° 45<br />
12 ème année<br />
<strong>Le</strong> billet<br />
du Procureur<br />
<strong>Le</strong> Nouvelliste, seul journal encore lisible<br />
d’Europe Centrale, nous apprend, dans<br />
son édition du 16 mars dernier, et sous<br />
la plume de J.-Y. Gabbud, que dans un<br />
très proche avenir les vignes seront<br />
sulfatées au petit lait et qu’il s’agit là<br />
d’une recette empruntée à nos grandsparents.<br />
En effet, selon des essais effectués,<br />
les résultats de cette nouvelle<br />
méthode de traitement sont des plus<br />
prometteurs car «le lait permet d’utiliser<br />
jusqu’à la moitié moins de cuivre<br />
<strong>Le</strong> bon vin et la jolie femme<br />
sont deux agréables<br />
poisons qui font tourner la<br />
tête (proverbe turc).<br />
puisque les sucres contenus dans le lait<br />
collent le cuivre, ce qui augmente son<br />
efficacité». Ainsi il est possible de lutter<br />
avec une certaine efficacité contre le<br />
mildiou et l’oïdium grâce à un mélange<br />
de cuivre, de soufre mouillable et de lait<br />
maigre, bien entendu. Actuellement ce<br />
sont 50 hectares de vignes réparties<br />
de Suisse romande qui participent aux<br />
essais de ce traitement révolutionnaire<br />
qui pourrait être suivi par d’autres expérimentations<br />
comme par exemple l’emploi<br />
d’un antibotrytis à base d’algue.<br />
donc, selon ce qui précède, pour être<br />
«bio» non seulement le produit lui-même<br />
doit-il être bio mais aussi le véhicule qui<br />
le transporte. Il s’ensuit que, selon la logique<br />
de ce raisonnement étonnant, les<br />
bananes bio du Brésil ou de Colombie<br />
ne peuvent plus être «bio» puisqu’elles<br />
nous parviennent pas avion (!!!) à moins<br />
que cet avion soit….le Solar Impulse de<br />
Bertrand Piccard.<br />
J’applaudis des deux mains mais je<br />
m’interroge lorsque je lis: «Même si des<br />
produits naturels sont utilisés, il n’est<br />
pas possible de parler de bio en raison<br />
de l’utilisation de l’hélicoptère». Ainsi<br />
Fernand Schalbetter<br />
Procureur de l’Ordre
Du chapitre précédent....<br />
Chapitre de l’Abbaye<br />
de Saint-Maurice<br />
2<br />
<strong>Le</strong>s vins du Chapitre<br />
Humagne Blanche les Seilles, AOC Valais 2014<br />
Cave les Follaterres, Samuel Roduit, Fully<br />
HAUT PATRONAGE<br />
M. Damien Revaz,<br />
Président de la Commune de Saint-Maurice<br />
M. Nicolas Voide<br />
Président du Grand-Conseil du Canton du<br />
Valais<br />
Mgr Jean Scarcella<br />
Père-Abbé de Saint-Maurice<br />
CHEVALIERS<br />
M. Michel Crépin, Troistorrents<br />
M. Jean-François de Preux, Grône<br />
M. Claude Thiery, Salquenen<br />
Fendant l’Orpailleur, AOC Valais 2015<br />
Frédéric Dumoulin, Uvrier<br />
Fendant <strong>Le</strong>ukersonne, AOC Valais 2015<br />
Damian & Jörg Seewer, Susten<br />
Fendant de Martigny, AOC Valais 2015<br />
Alexis Jacquérioz, Martigny<br />
Malvoisie flétrie, AOC Valais 2013<br />
Rouvinez Vins, Sierre<br />
Heïda Maître de Chais, AOC Valais 2014<br />
Provins, Sion<br />
Un Vin de Vigneron, assemblage de raisins rouges,<br />
AOC Valais 2013<br />
Gamay de Fully, Vieilles Vignes, Grand Cru, AOC<br />
Valais 2014<br />
Clos Château Barrique Liquoreuse, AOC Valais<br />
2012
... au chapitre suivant<br />
Chapitre de Zermatt<br />
Chacun d’entre nous connaît plus ou moins<br />
bien la localité de Zermatt soit parce qu’il<br />
y a passé quelques jours de vacances, soit<br />
parce qu’il a vu des centaines de fois des<br />
illustrations du lieu et de son illustre représentant:<br />
le Cervin.<br />
Loin de cette image d’Epinal, il se trouve<br />
sur les hauteurs de Zermatt, une étable<br />
ordinaire, visible de tous. Cette bâtisse,<br />
datant de 1811, est le résultat de circonstances<br />
historiques mondiales. En<br />
effet, cette étable rappelle Napoléon et la<br />
bataille de la Bérézina, située aujourd’hui<br />
sur la frontière avec le Bélarus, d’où son<br />
nom de «Beresinahaus», la maison de la<br />
Bérésina.<br />
Alors que Napoléon Bonaparte prépare<br />
sa campagne de Russie, il recrute, pour<br />
son armée, des soldats de Suisse et du<br />
Valais. Tout village valaisan est alors tenu<br />
de mettre à disposition au moins un soldat.<br />
Dans certaines bourgades, des volontaires<br />
s’engagent, souvent par nécessité.<br />
A Zermatt, aucun volontaire ne répond à<br />
l’appel. Pour ne forcer aucun citoyen à<br />
s’engager dans l’expédition incertaine de<br />
Napoléon ou pour éviter d’en déterminer<br />
un au hasard, les habitants de Zermatt<br />
optent pour une autre méthode: si un soldat<br />
accepte de s’engager volontairement,<br />
il reçoit une étable avec pâturage sur le<br />
«Fad de Turuwang». De cette manière,<br />
les habitants de Zermatt de l’époque sont<br />
sûrs de trouver un volontaire - vu la détresse<br />
économique et la pauvreté - à qui<br />
remettre, à son retour, l’étable promise.<br />
La bâtisse construite, le volontaire part en<br />
guerre. Mais il ne reviendra jamais de Russie<br />
et ne pourra jamais prendre possession<br />
des lieux. Comme près de mille Suisses<br />
ont péri dans la bataille de la Bérézina,<br />
l’étable reste, dans le langage populaire,<br />
la «Beresinahaus».<br />
LE CERVIN: UN MYTHE<br />
<strong>Le</strong> Cervin a toujours inspiré les alpinistes:<br />
nombre d’entre eux avaient, durant la<br />
première partie du XIXe siècle, tenté de<br />
rejoindre la cime de la montagne, que ce<br />
soit du côté italien ou du côté valaisan. <strong>Le</strong><br />
14 juillet 1865, une cordée de sept personnes,<br />
sous la direction d’Edward Wymper,<br />
atteignit le sommet. A la descente, les<br />
quatre premiers de cordée (Croz, Hadow,<br />
Hudson et Douglas) firent une chute mortelle<br />
en amont de l’»Epaule», dans la face<br />
nord. Trois corps furent dégagés quelques<br />
jours plus tard du glacier du Cervin: la<br />
dépouille de Lord Francis Douglas ne fut<br />
jamais retrouvée.<br />
A la suite du décès de Lord Francis Douglas,<br />
la reine britannique, Queen Victoria,<br />
souhaita promulguer une interdiction:<br />
elle déclara ne plus vouloir que du sang<br />
de nobles anglais soit gaspillé au Cervin.<br />
Ses exigences suscitèrent la curiosité et<br />
attirèrent les alpinistes anglais en masse.<br />
Ainsi naquit le développement touristique<br />
de Zermatt.<br />
<strong>Le</strong> Parc Hôtel<br />
Beau-Site<br />
Cet hôtel 4 étoiles supérieur compte parmi<br />
les tout meilleurs établissements de la station.<br />
Il doit cette distinction à sa situation<br />
qui offre, à cinq minutes du centre de la<br />
bourgade, une vue unique et imprenable<br />
sur Zermatt et sur le Cervin. En outre, et<br />
ceci est particulièrement important pour<br />
les membres de l’Ordre de la Channe, la<br />
qualité de son offre gastronomique est<br />
digne des meilleures tables du Valais.
Vin du Valais: d’où viens-tu?<br />
4<br />
<strong>Le</strong>s Vignes<br />
Communales<br />
et Paroissiales<br />
Voici les vignes de deux institutions très<br />
proches du monde paysan: la communauté villageoise<br />
et la paroisse. Depuis fort longtemps,<br />
la vigne fait partie du «bénéfice» dont le clergé<br />
paroissial vit plus ou moins décemment. De leur<br />
côté, les communautés ont en général attendu<br />
le XVIe siècle pour acquérir des vignes.<br />
Dans les deux cas, la documentation conservée<br />
permet des coups d’oeil assez précis, dont<br />
l’enjeu est double. Comme les vignes paroissiales<br />
et communautaires sont cultivées par les<br />
paysans eux-mêmes, les sources renseignent<br />
sur des pratiques viticoles courantes. D’un<br />
autre côté, les plus aisées de ces institutions<br />
caressent des ambitions commerciales, ce<br />
qui les a sans doute incitées à améliorer leurs<br />
façons de cultiver.<br />
Venthône, riche communauté<br />
viticole<br />
Venthône représente bien les riches villages de<br />
la rive droite du Valais central, entre la Morge<br />
et la Raspille. Témoigne de cette aisance un<br />
magnifique registre de comptes bourgeoisiaux<br />
du XVIIIe siècle, rédigé avec soin dans un latin<br />
fort acceptable. Il permet une observation précise<br />
des liens que cette communauté entretient<br />
avec la vigne et le vin. La période 1702-1760<br />
a été privilégiée.<br />
<strong>Le</strong> domaine viticole de la Bourgeoisie de Venthône<br />
se trouvait alors à Villa, en particulier aux<br />
Corles, ainsi qu’à Musot, où se situe la «grande<br />
vigne». Ce domaine se constitue en plusieurs<br />
séries d’achats, dans les années 1620-1660<br />
et 1860, dans un vignoble ancien, dont les<br />
bourgeois connaissent les qualités. Ces achats<br />
indiquent une volonté de constituer un domaine<br />
aussi groupé que possible: les vignes achetées<br />
ont souvent pour voisines immédiates d’autres<br />
vignes bourgeoisiales. Dans la même optique,<br />
la Bourgeoisie allège ses charges en achetant,<br />
en 1760, sa part de la dîme due chaque année<br />
au curé de Saint-Maurice-de-Laques. En 1884,<br />
ce domaine viticole consiste en 5845 m2, répartis<br />
dans cinq vignes aux Corles, et 962 m2 à<br />
Anchettes-Allemand.<br />
Travaux et calendrier<br />
<strong>Le</strong>s travaux viticoles sont effectués par les<br />
bourgeois eux-mêmes, dans le cadre de corvées<br />
communales. De ce fait, ils n’apparaissent<br />
dans les comptes qu’à travers la fourniture de<br />
pain, de fromage et de vin.<br />
Ces travaux sont les suivants, dans leur ordre<br />
chronologique annuel. On taille et le même<br />
jour, semble-t-il, des femmes ramassent les<br />
sarments coupés. Une journée est ensuite<br />
consacrée au «travail» des vignes. Il s’agit sans<br />
doute du travail du sol. Des femmes attachent<br />
ensuite la vigne. On mentionne parfois un sarclage,<br />
mais pas le provignage. Il est vraisemblablement<br />
inclus sous les rubriques «taille» ou<br />
«travail du sol».<br />
<strong>Le</strong>s comptes de Venthône donnent parfois les<br />
dates de ces travaux. Sur cette base se des-
5<br />
sinent les éléments de calendrier suivant. Pour<br />
la taille, les treize dates disponibles s’étalent<br />
entre le 6 mars et le 5 avril, mais huit d’entre<br />
elles se placent entre le 12 et le 18 mars. Pour<br />
la «laboratio» (travail) des vignes, les quinze<br />
dates repérées se situent entre le 29 mars et<br />
le 19 avril et dix d’entre elles entre le 3 et le<br />
14 avril. Ainsi dans les dix années où le calcul<br />
est possible, il s’écoule en moyenne 20 jours<br />
entre le «laboratio» et l’attache, il s’écoule<br />
moins d’une semaine dans trois cas et deux<br />
dans le dernier cas. L’unique désherbage daté<br />
s’effectue un 3 juillet.<br />
Corvée des vendanges<br />
<strong>Le</strong>s vendanges se préparent avant tout par la<br />
remise en état des cuves et des tonneaux. A<br />
plusieurs reprises, les comptes font état d’un<br />
jour consacré au recyclage des tonneaux. En<br />
1718, ce travail a lieu le 4 octobre. Parfois, un<br />
spécialiste intervient, comme maître Kieffer, qui<br />
passe deux jours de 1731 à réparer une cuve et<br />
un grand tonneau, pour 30 bat de salaire avec<br />
ses frais. En 1759, la Bourgeoisie achète un<br />
pressoir à l’hoirie de feu Joseph Zufferey, le 5<br />
mars, des hommes ont «transporté ce pressoir<br />
du Glaret jusqu’ici» et reçoivent du pain et du<br />
fromage.<br />
<strong>Le</strong>s vendanges semblent être, comme la taille<br />
et la «laboratio», l’affaire d’une journée de corvée,<br />
manifestée dans les comptes par des frais<br />
de bouche et le salaire de ceux qui transportent<br />
la vendange des vignes vers la cave bourgeoisiale.<br />
La récolte subit deux ou trois pressées. En<br />
1712, on trouve «le jour de pressée du vin»<br />
puis «la pressée du vin pour la seconde fois».<br />
En 1729, on indique deux pressées pour la<br />
vendange de la communauté, mais le pressoir<br />
sert aussi pour traiter le contenu de la cuve du<br />
châtelain Masserey.<br />
Assez pour boire et<br />
pour vendre<br />
<strong>Le</strong>s comptables ne disent rien qui permette<br />
d’identifier les vins produits par la Bourgeoisie<br />
de Venthône. En revanche, on voit assez bien<br />
ce qu’ils deviennent. Comme le rappelle très<br />
clairement le Règlement de la Bourgeoisie, en<br />
1881, on met de côté chaque année 40 setiers<br />
(environ 1400 litres) de vin pour les besoins de<br />
l’institution. <strong>Le</strong> reste est vendu au mieux par le<br />
Conseil. Par exemple, le vin bourgeoisial clôt les<br />
séances du Conseil, il désaltère ceux qui participent<br />
à la procession faite à Chippis et à celle<br />
de la Fête-Dieu, aux corvées des vignes ou à<br />
l’entretien des chemins; on en boit lors de la<br />
visite des forêts ou de la chambre des poudres<br />
ainsi que pendant l’inalpe des moutons.<br />
Extraits de textes provenant de «Histoire de la<br />
Vigne et du Vin du Valais» publiés avec l’aimable<br />
autorisation de Mme Anne-Dominique<br />
Zufferey, directrice du Musée Valaisan de la<br />
Vigne et du Vin)
Marché du vin<br />
Ce qu’il faut retenir de l’étude 2013<br />
6<br />
<strong>Le</strong>s commentaires et conclusions ci-après sont<br />
tirés d’une étude sur le marché du vin en Suisse<br />
réalisée en 2013 par l’institut M.I.S. Trend sur<br />
mandat de Swiss Wine Promotion auprès de<br />
3002 personnes âgées de 18 à 74 ans représentatives<br />
de la population. <strong>Le</strong> résultat de ces<br />
consultations a ensuite été comparé à celui des<br />
enquêtes précédentes.<br />
Consommation du vin<br />
-La part de la population buvant du vin reste<br />
parfaitement constante par rapport à 2008<br />
ainsi qu’aux précédentes mesures de 2004 et<br />
1999.<br />
-<strong>Le</strong> vin se trouve en forte concurrence avec<br />
les autres catégories de boissons alcoolisées<br />
dans la classe d’âge 18-29 ans alors qu’il est<br />
clairement la première boisson alcoolisée chez<br />
les personnes plus âgées. (en % de consommateurs).<br />
-L’âge auquel on commence à consommer du<br />
vin continue à augmenter et se situe désormais<br />
à 25 ans en moyenne.<br />
Profil des consommateurs<br />
et rythme<br />
de consommation<br />
<strong>Le</strong> rythme auquel on consomme du vin n’a<br />
guère subi de changements depuis 2008. Toutefois,<br />
une légère tendance à la disparition des<br />
buveurs quotidiens semble se dessiner sur le<br />
long terme.<br />
<strong>Le</strong> Tessin continue à abriter un groupe particulièrement<br />
important de consommateurs quotidiens<br />
(17%).<br />
La fréquence de la consommation hebdomadaire<br />
augmente au fil de l’âge, cumulant à 53%<br />
chez les personnes âgées de 60 ans et plus.<br />
<strong>Le</strong>s quantités<br />
consommées<br />
-Même si la comparaison des données entre<br />
les différentes études surestime certainement<br />
l’ampleur du phénomène, une baisse des<br />
quantités consommées a certainement eu lieu,<br />
ce que confirment les chiffres officiels (Office<br />
fédéral de l’agriculture).<br />
-<strong>Le</strong>s profils de consommation n’ont cependant<br />
pas changé: le niveau des quantités consommées<br />
augmente avec l’âge, les hommes continuent<br />
à se démarquer des femmes.<br />
-<strong>Le</strong>s écarts entre régions linguistiques sont les<br />
mêmes qu’auparavant.<br />
L’autoqualification en<br />
matière de vin<br />
-La notoriété spontanée de la Suisse comme<br />
pays producteur de vins s’est accrue et se<br />
trouve au plus haut depuis 1999.<br />
-La quasi totalité des cantons et régions suisses<br />
sont un peu mieux connus pour leur production<br />
viticole qu’il y a cinq ans.<br />
-<strong>Le</strong>s cépages du Valais sont légèrement mieux<br />
connus qu’en 2008. <strong>Le</strong>s vins phares du canton<br />
restent les mêmes.<br />
-<strong>Le</strong> canton de Vaud est spontanément connu<br />
avant tout pour ses régions et appellations<br />
(Lavaux, La Côte ensuite).<br />
-Genève est toujours très peu connu dans le<br />
reste de la Suisse.<br />
-L’image du Tessin reste fortement lié au cépage<br />
Merlot.<br />
L’AOC et les grands crus<br />
-<strong>Le</strong>s connaissances du terme «AOC» se consolident<br />
en 2013 après une forte progression<br />
entre 2004 et 2008.<br />
-Contrairement à l’AOC, la notoriété du terme<br />
«Grand cru» a reculé depuis la dernière étude.<br />
-<strong>Le</strong>s attentes au niveau qualité restent stables<br />
pour les deux termes, et par conséquent plus<br />
élevées pour un Grand cru.
7<br />
Habitudes<br />
de consommation<br />
-La consommatin de vin reste fortement associée<br />
au week-end.<br />
-Une érosion de la consommation de vin lors<br />
du repas de midi et en week-end peut être<br />
constatée.<br />
-La distribution de la consommation entre<br />
domiciles et restaurants reste stable depuis 15<br />
ans.<br />
Proportion et consommation<br />
de vins suisses<br />
et étrangers<br />
-La répartition de la consommation entre vins<br />
suisses et étrangers reste stable.<br />
-Depuis 2004, les plus jeunes se sont progressivement<br />
éloignés d’une consommation à très<br />
forte connotation étrangère.<br />
-<strong>Le</strong> Valais est un des seuls cantons à afficher<br />
une progression, confortant ainsi encore sa<br />
position de leader des vins suisses.<br />
-Parmi les vins étrangers, c’est l’Italie qui occupe<br />
la tête du classement, la France étant en<br />
net recul et distancée également par l’Espagne.<br />
La consommation en<br />
circuit HORECA<br />
-La grande distribution parvient, au fil des<br />
années, depuis la première étude en 1999, à<br />
grignoter des parts du marché.<br />
-<strong>Le</strong> commerce de vin par Internet s’est légèrement<br />
développé, tout en restant confidentiel par<br />
rapport aux autres canaux de vente.<br />
-<strong>Le</strong> prix moyen axé lors de l’achat d’une bouteille<br />
de vin pour soi-même est resté stable en<br />
comparaison avec l’étude 2008, celui pour une<br />
bouteille en cadeau a très légèrement reculé.<br />
-En comparaison avec les vins d’Italie, de<br />
France et d’Outre-Mer, les prix des vins suisses<br />
continuent à être perçus défavorablement et ce<br />
jugement a, aussi bien pour le vin rouge que<br />
pour le blanc, même encore gagné un peu en<br />
importance depuis 2008.<br />
-La comparaison défavorable par rapport aux<br />
vins étrangers n’implique pas que les vins<br />
suisses sont inévitablement estimés trop chers.<br />
Image des vins suisses,<br />
des régions<br />
-Même si les consommateurs réguliers de vin<br />
sont assez attachés au paysage viticole suisse,<br />
ils ne peuvent, en partie, pas cacher une<br />
certaine lassitude vis-à-vis de la production<br />
domestique, tout en ne reconnaissant aucun<br />
avantage qualitatif clair ni aux vins suisses, ni<br />
aux vins étrangers.<br />
-En l’absence d’une différence de prix, l’on préfère<br />
plutôt acheter un vin suisse.<br />
Publicité<br />
-<strong>Le</strong>s consommateurs de vin ayant remarqué de<br />
la publicité pour le vin sont plus nombreux que<br />
lors des vagues précédentes de l’étude.<br />
-Parmi les répondants ayant vu de la publicité<br />
pour des vins suisses, celle pour les vins suisses<br />
en général (30%) est la plus remarquée, devant<br />
celle pour le Valais (25%) et, nettement moins<br />
fréquente, celle pour les vins vaudois (13%).
Innovation<br />
Bienvenue aux «Jeunes <strong>Chevalier</strong>s»<br />
8<br />
Selon Eugène Labiche « La jeunesse n’a<br />
qu’un temps» voilà pourquoi s’appuyant<br />
sur cette citation, les Officiers du Conseil<br />
de l’Ordre de la Channe ont mis sur pied<br />
un concept de recrutement auprès des<br />
jeunes en général.<br />
Cette opération a pour but de permettre<br />
aux jeunes hommes et jeunes filles comptant<br />
26 printemps et moins d’adhérer à la<br />
Confrérie et d’ainsi de leur permettre de<br />
faire plus ample connaissance avec le vin,<br />
avec son histoire et le respect qui lui est<br />
dû.<br />
Ces nouveaux membres, outre le fait<br />
qu’ils porteront le titre et le sautoir jaune<br />
Cette édition du «<strong>Chevalier</strong>» vous est offerte par:<br />
de «Jeune <strong>Chevalier</strong>», se verront offrir de<br />
substantiels avantages financiers soit,<br />
d’une manière générale, une réduction<br />
de 50% sur toutes les prestations de la<br />
confrérie comme, par exemple, sur le<br />
montant de la cotisation annuelle qui, pour<br />
les «Jeunes <strong>Chevalier</strong>s» se montera à 60.-<br />
francs au lieu des 120-- francs habituels.<br />
Autre exemple: une intronisation avec repas<br />
s’élèvera à 150-- francs et non plus<br />
à 300.-- francs. Bien entendu et toujours<br />
pour les «Jeunes <strong>Chevalier</strong>s», la participation<br />
aux repas des Chapitres de la Confrérie<br />
seront également réduits de 50%.<br />
Dès que le «Jeune <strong>Chevalier</strong>» entre dans<br />
sa vingt-septième année, il est automatiquement<br />
élevé à la dignité de «<strong>Chevalier</strong>»<br />
sans devoir se soumettre à une nouvelle<br />
cérémonie d’intronisation mais en perdant<br />
les avantages liés à l’appellation de<br />
«Jeune <strong>Chevalier</strong>».<br />
<strong>Le</strong>s Officiers du Conseil se réjouissent déjà<br />
d’accueillir les candidats «Jeune <strong>Chevalier</strong>»<br />
et, tout en les félicitant pour leur décision,<br />
leur souhaitent la plus cordiale des<br />
bienvenues.<br />
Remarque:<br />
Des formulaires d’adhésion sont disponibles<br />
sur le site internet de la Confrérie<br />
(www.ordre-de-la-channe.ch) ou peuvent<br />
être commandés au secrétariat.<br />
Ordre de la Channe > Case postale 1007 > 1951 Sion ><br />
Tél: 027 323 76 02 / 079 569 23 58<br />
info@ordre-de-la-channe.ch<br />
www.ordre-de-la-channe.ch