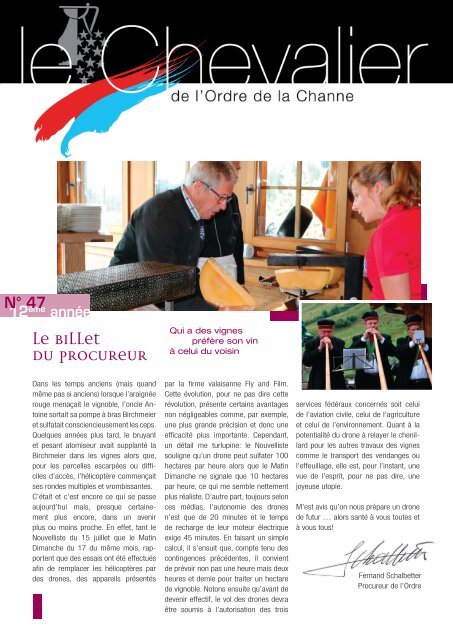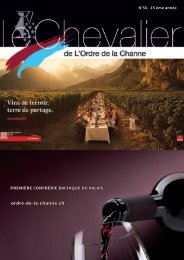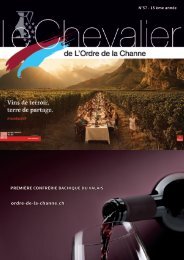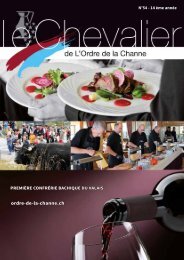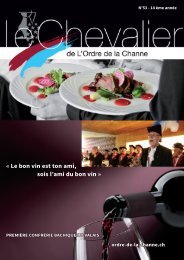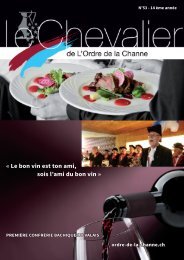You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
N° 47<br />
12 ème année<br />
<strong>Le</strong> billet<br />
du Procureur<br />
Dans les temps anciens (mais quand<br />
même pas si anciens) lorsque l’araignée<br />
rouge menaçait le vignoble, l’oncle Antoine<br />
sortait sa pompe à bras Birchmeier<br />
et sulfatait consciencieusement les ceps.<br />
Quelques années plus tard, le bruyant<br />
et pesant atomiseur avait supplanté la<br />
Birchmeier dans les vignes alors que,<br />
pour les parcelles escarpées ou difficiles<br />
d’accès, l’hélicoptère commençait<br />
ses rondes multiples et vrombissantes.<br />
C’était et c’est encore ce qui se passe<br />
aujourd’hui mais, presque certainement<br />
plus encore, dans un avenir<br />
plus ou moins proche. En effet, tant le<br />
Nouvelliste du 15 juillet que le Matin<br />
Dimanche du 17 du même mois, rapportent<br />
que des essais ont été effectués<br />
afin de remplacer les hélicoptères par<br />
des drones, des appareils présentés<br />
Qui a des vignes<br />
préfère son vin<br />
à celui du voisin<br />
par la firme valaisanne Fly and Film.<br />
Cette évolution, pour ne pas dire cette<br />
révolution, présente certains avantages<br />
non négligeables comme, par exemple,<br />
une plus grande précision et donc une<br />
efficacité plus importante. Cependant,<br />
un détail me turlupine: le Nouvelliste<br />
souligne qu’un drone peut sulfater 100<br />
hectares par heure alors que le Matin<br />
Dimanche ne signale que 10 hectares<br />
par heure, ce qui me semble nettement<br />
plus réaliste. D’autre part, toujours selon<br />
ces médias, l’autonomie des drones<br />
n’est que de 20 minutes et le temps<br />
de recharge de leur moteur électrique<br />
exige 45 minutes. En faisant un simple<br />
calcul, il s’ensuit que, compte tenu des<br />
contingences précédentes, il convient<br />
de prévoir non pas une heure mais deux<br />
heures et demie pour traiter un hectare<br />
de vignoble. Notons ensuite qu’avant de<br />
devenir effectif, le vol des drones devra<br />
être soumis à l’autorisation des trois<br />
services fédéraux concernés soit celui<br />
de l’aviation civile, celui de l’agriculture<br />
et celui de l’environnement. Quant à la<br />
potentialité du drone à relayer le chenillard<br />
pour les autres travaux des vignes<br />
comme le transport des vendanges ou<br />
l’effeuillage, elle est, pour l’instant, une<br />
vue de l’esprit, pour ne pas dire, une<br />
joyeuse utopie.<br />
M’est avis qu’on nous prépare un drone<br />
de futur … alors santé à vous toutes et<br />
à vous tous!<br />
Fernand Schalbetter<br />
Procureur de l’Ordre
Du chapitre précédent....<br />
Chapitre de l’Authentique Raclette du<br />
Valais AOP à Champoussin<br />
2<br />
<strong>Le</strong>s vins du Chapitre<br />
Muscat <strong>Le</strong>s Landes, AOC Valais 2015<br />
<strong>Le</strong>s fils Maye, Riddes<br />
Johannisberg Hurlevent, AOC Valais 2015<br />
<strong>Le</strong>s Fils de Charles Favre, Sion<br />
Petite Arvine <strong>Le</strong>s Perles du Valais, AOC Valais<br />
2015<br />
Maison Gilliard, Sion<br />
<strong>Chevalier</strong>s Chanteurs:<br />
Christian Albasini, Ardon<br />
Jean-Luc Bétrisey, St-Léonard<br />
Nicolas Carruzzo, Chamoson<br />
Haut Patronage:<br />
Mme Géraldine Marchand-Balet<br />
Conseillère Nationale du Canton du Valais<br />
Gamay Vieille Vigne, AOC Valais 2015<br />
Thierry Constantin, Pont-de-la-Morge<br />
Fendant Sans Culotte, AOC Valais 2015<br />
Charles Bonvin, Sion<br />
Humagne Blanche, AOC Valais 2015<br />
Château Constellation, Sion<br />
Blandice Blanc, AOC Valais 2013<br />
Varone Vins, Sion<br />
M. Philippe Nantermod<br />
Conseiller National du Canton du Valais
... au chapitre suivant<br />
Chapitre du Château de Chillon<br />
Chillon, édifié sur un îlot rocheux constituant<br />
une protection naturelle et un emplacement<br />
stratégique entre le nord et le<br />
sud de l’Europe, doit-il sa renommée à sa<br />
situation particulière, au poème de lord<br />
Byron ou au prisonnier François Bonivard,<br />
l’inspirateur du lord précité ? Sans<br />
doute un peu à la conjugaison de ces trois<br />
causes.<br />
Quoi qu’il en soit, l’histoire du Château de<br />
Chillon est caractérisée par trois périodes<br />
importantes:<br />
- La période savoyarde (du XIIe siècle à<br />
1536). La mention la plus ancienne écrite<br />
du château date de 1150 et nous informe<br />
que la famille de la maison de Savoye<br />
contrôlait déjà le passage le long du Léman.<br />
Au XIIIe siècle, Pierre II de Savoye fit<br />
reconstruire le château qui devint la résidence<br />
d’été des comtes.<br />
-La période bernoise (de 1536 à 1798).<br />
<strong>Le</strong>s Bernois conquirent le Pays de Vaud et<br />
occupèrent Chillon en 1536. <strong>Le</strong> château<br />
conserva son rôle de forteresse, d’arsenal<br />
et de prison durant plus de 260 ans. En<br />
1785, on songea à transformer la partie<br />
nord de la bâtisse en un grenier à blé,<br />
mais ce projet ne fut pas réalisé, peut-être<br />
du fait de sa démesure et de l’humidité<br />
ambiante.<br />
- La période vaudoise (de 1798 à nos<br />
jours). En 1798, à la révolution vaudoise,<br />
les Bernois quittèrent Chillon puis, en<br />
1803, le château devint propriété du canton<br />
de Vaud, lors de sa fondation. Mais il<br />
revint à lord Byron et à son fameux poème<br />
«The prisonnier of Chillon», rédigé en 1816<br />
lors d’un pèlerinage sur les lieux décrits<br />
par Rousseau, d’avoir donné au château<br />
sa dimension mythique.<br />
Aux ordres d’un chef<br />
exceptionnel:<br />
Edgar Bovier<br />
Afin de mettre tous les atouts de son côté,<br />
l’Ordre de la Channe a confié à Edgar Bovier<br />
la responsabilité du repas lors du Chapitre<br />
du 22 octobre 2016. La cuisine du<br />
chef du Lausanne Palace & Spa respire le<br />
bonheur de vivre: Edgar Bovier résume sa<br />
philosophie gastronomique en une phrase:<br />
«La star c’est le produit, le beau produit.<br />
<strong>Le</strong> rôle du cuisinier est de le rendre bon».<br />
Promu cuisinier de l’année par Gault &<br />
Millau en 2008 en Suisse romande, Edgar<br />
Bovier s’enorgueillit de 18 points sur un<br />
maximum de 20, ce qui n’a absolument<br />
pas besoin d’explications complémentaires.<br />
Que dire de plus si ce n’est que son<br />
talent soulèvera l’enthousiasme gustatif<br />
des participants au Chapitre du Château<br />
de Chillon.
4<br />
personnalité<br />
Claude Crittin et la SEVV<br />
- Quel vin du Valais vous inspire?<br />
Un vin au célèbre passé pour lequel on doit<br />
écrire son avenir : la Dôle<br />
- Qu’aimeriez-vous que le Père Noël vous<br />
apporte dans sa hotte?<br />
Une nature moins capricieuse, mais on doit<br />
toujours accepter ce que l’on nous offre.<br />
- Pour vous, le nirvana c’est quoi?<br />
Ces petits moments de calme que l’on arrive<br />
chaque jour à s’aménager.<br />
En Valais, sur la rive droite du Rhône, à équidistance<br />
de Martigny et de Sion et englobé à<br />
la commune de Chamoson, le village de St-<br />
Pierre-de-Clages est célèbre pour son église<br />
du XIe siècle à clocher octogonal. Il est également<br />
connu comme étant «<strong>Le</strong> Village suisse du<br />
Livre» dont la manifestation phare, la «Fête du<br />
Livre», se déroule généralement du vendredi au<br />
dimanche du dernier week-end du mois d’août.<br />
- Avec qui aimeriez-vous passer un mois<br />
sur une île déserte?<br />
Avec tous ceux pour qui je n’ai pas assez de<br />
temps.<br />
- Que feriez-vous si votre baguette magique<br />
pouvait changer le monde?<br />
Une confédération mondiale organisée sur le<br />
modèle de la confédération helvétique.<br />
- Qui inviteriez-vous pour partager une<br />
soirée «raclette»?<br />
Mes meilleurs ennemis.<br />
C’est dans cette attrayante localité qu’il y a cinquante<br />
ans, le 17 mai 1966 pour être précis, la<br />
famille de Pierre Crittin accueillait avec émotion<br />
et fierté la venue d’un fils qu’elle appela<br />
Pierre. Il est bien entendu que quand on nait<br />
et qu’on demeure dans la plus grande et donc<br />
plus importante commune viticole du Valais et<br />
qu’en plus quand ses grands-pères du côté paternel<br />
et maternel sont encaveurs ou vignerons,<br />
quand son père est lui-même encaveur, on ne<br />
peut aspirer qu’à suivre la tradition familiale.<br />
C’est donc en toute logique que la carrière<br />
professionnelle de Claude commence en tant<br />
qu’apprenti de commerce à la cave Maurice<br />
Gay à Sion avant que Claude Crittin ne séjourne<br />
durant une année en Allemagne et à Baden-<br />
Baden dans la maison de commerce de vin<br />
Schenk. Aimant les langues et les voyages, il<br />
traverse la Manche pour avoir droit à un First<br />
puis revient s’installer, durant 10 ans, dans le<br />
canton de Vaud et plus particulièrement à la<br />
Maison Schenk à Rolle.<br />
Poursuivant une période de formation continue<br />
en cours d’emploi, Claude se plonge durant 5<br />
ans dans l’informatique en faisant un brevet fédéral<br />
d’analyste-programmeur et en devenant<br />
développeur de logiciels dans le vin puis en<br />
obtenant un diplôme ES d’économiste d’entreprise.<br />
A la fin des années 90, Claude Crittin regagne<br />
le Valais pour effectuer un apprentissage chez<br />
l’encaveur Maurice Gay qui, depuis, a déménagé<br />
de Sion à Chamoson. C’est ce retour aux<br />
sources qui lui permet de succéder, quelques<br />
années plus tard à son père qui lui passe les<br />
rênes de cette société, la troisième plus grande<br />
entreprise viticole du Valais.<br />
Toujours aussi passionné par le monde de la<br />
vigne et du vin, Claude participe activement à<br />
la bonne marche des associations professionnelles<br />
en ayant été membre du comité puis président<br />
de l’IVV (Interprofession du Vin du Valais)<br />
et en étant actuellement président de la SEVV.<br />
Homme pondéré, dynamique et très sociable,<br />
Claude Crittin, en 2012, a été choisi par ses<br />
concitoyens pour présider au destin des<br />
quelque 3’500 habitants de la commune de<br />
Chamoson, capitale incontestée du Johannisberg.<br />
- Selon vous, quel personnage célèbre<br />
incarne le mieux notre pays?<br />
Patrick Aebischer le président de l’Ecole polytechnique<br />
fédérale de Lausanne (EPFL) .<br />
- Quels sont les qualificatifs qui caractérisent<br />
la Suisse?<br />
<strong>Le</strong> pays le plus malin du monde. Respect de la<br />
différence, compromis dans l’action, qualité et<br />
capacité à commercer avec tous.<br />
- Quel défaut vous exaspère le plus chez<br />
les autres?<br />
L’orgueil.<br />
- Pour vous un Valaisan c’est qui?<br />
Quelqu’un qui se laisse imprégner par la nature<br />
alpine qui l’entoure et par ses valeurs.<br />
- Quelle est l’une de vos principales qualités?<br />
Mon obstination à négocier un bon arrangement<br />
- Préférez-vous le verre à moitié vide ou<br />
celui à moitié plein?<br />
Je préfère le verre quand il est plein.<br />
- Quelle est votre devise préférée?<br />
« <strong>Le</strong>s choses devraient être aussi simples que<br />
possible, mais pas simplistes. (Albert Einstein)
La SEVV : acteur incontournable<br />
de l’économie viti-vinicole valaisanne<br />
5<br />
La SEVV – société des Encaveurs de Vins du Valais<br />
– (autrefois UNVV – Union des Négociants<br />
en Vins du Valais) est un acteur important de<br />
l’économie viti-vinicole valaisanne. Cette association<br />
professionnelle, dont les fondements<br />
remontent à 1930, a pour mission de défendre<br />
les intérêts de l’encavage et du commerce des<br />
vins du Valais.<br />
Un peu d’histoire<br />
La création du premier groupement de marchands<br />
de vins date des années 1920.<br />
Quelques commerces se réunissent sous la<br />
bannière « Pavillon valaisan » pour faire la promotion<br />
des vins valaisans au Comptoir de Lausanne.<br />
C’est en 1930 qu’est constituée l’Union<br />
des Négociants en vins du Valais comme section<br />
de l’Union des Négociants en vins Vaud-<br />
Valais-Fribourg.<br />
La fondation de l’UNVV coïncide avec la création<br />
des premières Caves coopératives : dans<br />
une période de marasme, les marchands de<br />
vins ressentent la nécessité de définir une<br />
politique commune envers l’Etat et les Caves<br />
coopératives.<br />
<strong>Le</strong>s intérêts des négociants en vins valaisans<br />
n’étant pas les mêmes que ceux des Vaudois,<br />
les commerces valaisans créent une section<br />
indépendante de la Fédération suisse des Négociants<br />
en vins (FSNV) au 1er janvier 1941.<br />
En 1999, l’UNVV change d’étiquette et devient<br />
la SEVV, laquelle constitue une section de la<br />
Société des Encaveurs de vins suisses (SEVS).<br />
En plus de 80 ans, l’UNVV-SEVV a connu 15<br />
présidents et 3 secrétaires. Elle est actuellement<br />
présidée par Claude Crittin tandis que le<br />
secrétariat est assumé par Jean-Pierre Guidoux<br />
depuis 1981.<br />
Rôle de la SEVV<br />
Depuis sa création, l’UNVV-SEVV a joué un rôle<br />
majeur dans l’évolution de l’économie viti-vinicole<br />
valaisanne. En 1981, les 63 membres<br />
de l’UNVV encavaient plus de la moitié de la<br />
production valaisanne. Malgré l’évolution des<br />
structures de l’encavage et du marché des<br />
vins, la SEVV poursuit son rôle de défenseur<br />
du commerce libre et indépendant. <strong>Le</strong>s principaux<br />
commerces du canton, et surtout les plus<br />
anciens, se retrouvent au sein de la SEVV.<br />
La SEVV constitue aujourd’hui un acteur incontournable<br />
de l’Interprofession de la vigne et du<br />
vin du Valais. La mission de la SEVV a évolué<br />
dans le sens que les recommandations en matière<br />
de paiement de la vendange et de prix de<br />
vente ont passé au second plan. La première<br />
tâche de la SEVV consiste à participer à la définition<br />
du cadre législatif dans lequel s’exerce la<br />
profession, tant au niveau de la production que<br />
de l’encavage et de la commercialisation.<br />
<strong>Le</strong>s commerces membres de la SEVV sont<br />
désormais propriétaires ou responsables d’une<br />
part importante de la surface du vignoble valaisan.<br />
La SEVV représente dès lors un facteur<br />
d’équilibre tant pour les producteurs de raisins<br />
que pour les acheteurs de vins.<br />
En première ligne dans la vente des vins valaisans,<br />
la SEVV ouvre la voie à l’adaptation de la<br />
viti-viniculture valaisanne aux nouvelles conditions<br />
du marché.<br />
Enfin, la SEVV joue un rôle important dans la<br />
lutte contre les manœuvres déloyales dans le<br />
commerce des vins, surtout depuis l’apparition<br />
de nouveaux commerces qui n’en sont pas<br />
membres.
Vin du Valais: d’où viens-tu ?<br />
<strong>Le</strong>s vignes de l’Abbaye de Saint-Maurice<br />
6<br />
Au Moyen Age et durant tout l’Ancien Régime,<br />
l’Abbaye de Saint-Maurice est un considérable<br />
propriétaire de vignes. Son vignoble doit<br />
répondre aux besoins d’une communauté religieuse,<br />
de son abbé et de sa domesticité ainsi<br />
qu’à ceux des hôtes de passage, qu’il faut recevoir<br />
dignement, à ceux des pèlerins, qu’il faut<br />
recevoir charitablement.<br />
Des domaines viticoles<br />
imposants<br />
Dans les vignobles de Saint-Maurice, l’Abbaye<br />
apparaît surtout comme un important seigneur<br />
foncier. Vers 1660, elle possède 33 poses de<br />
vigne dans le seul territoire de Cries, entre Bex<br />
et Agaune. Une partie des vignes abbatiales<br />
sont encensées à des particuliers, comme on<br />
peut l’observer assez précisément entre 1640<br />
et 1660: le monastère reçoit des cens sur<br />
une cinquantaine de vignes situées à Cries, à<br />
l’Arzilier, au Châble, à la Crêta, à Lavey, et à<br />
Vérollier. <strong>Le</strong>urs tenanciers versent le cens aux<br />
vendanges, en raisin ou en moût. <strong>Le</strong>s quantités<br />
s’échelonnent, pour le blanc, entre 1/4 de<br />
setier (ca 9 litres) et 2 setiers (ca 140 litres).<br />
L’ensemble de ces cens rapporte au monastère<br />
43 setiers (ca 1350 litres). <strong>Le</strong> blanc domine largement<br />
avec 38 setiers (ca 1350 litres), contre<br />
5 setiers (ca 170 litres) de rouge. <strong>Le</strong>s choses<br />
ont bien changé depuis la fin du Moyen Age,<br />
lorsqu’on observait une solide domination des<br />
rouges. Comme, au XIVe siècle aussi bien qu’au<br />
XVIIe, ces cens se prélèvent aux vendanges sur<br />
la récolte de la vigne encensée. On doit prendre<br />
ce changement au sérieux et admettre qu’il révèle<br />
une réelle modification du choix des plants<br />
cultivés. Pour l’expliquer, on peut imaginer deux<br />
facteurs, aux effets combinés: une adaptation<br />
de l’offre à une modification des besoins ou des<br />
goûts; une adaptation des plants choisis aux<br />
conditions de l’environnement dans le contexte<br />
du Petit Age glaciaire.<br />
Un pressoir à Martigny<br />
Très logiquement, vu la difficulté des transports,<br />
le domaine viticole qu’exploitent les chanoines,<br />
se trouvent à proximité de l’Abbaye, dans les<br />
collines. <strong>Le</strong>s chanoines ont cependant aussi<br />
des vignes dans les belles zones viticoles du<br />
Valais. En 1645, un inventaire révèle aussi<br />
«environ 22 fissurées de vigne en divers endroits<br />
de Martigny», avec un bâtiment, dans<br />
lequel un pressoir a été installé. Ce bâtiment<br />
a été acheté à un prêtre nommé Nicolas Cornut.<br />
Il est ensuite reconstruit: on refait le toit<br />
et des maçons travaillent aux murs. On veille<br />
à un certain confort et à un peu de décorum:<br />
trois ouvertures reçoivent des fenêtres et les<br />
ventaux des trois portes sont refaits; on renforce<br />
de ferrure celui de la porte principale, qui<br />
ferme un «portail de marbre bien beau, fait avec<br />
ses armes», on installe un râtelier et une crèche<br />
pour les chevaux. <strong>Le</strong> bâtiment est aussi adapté<br />
et équipé pour mieux servir aux travaux de la<br />
vigne et du vin.<br />
<strong>Le</strong>s vignes confiées à un<br />
chef vigneron<br />
Un état des dépenses abbatiales établi vers<br />
1660 donne une vision synthétique des frais<br />
d’exploitation viticole. L’abbé paie les gardes<br />
nommés par la ville pour surveiller les vignes,<br />
dépense 500 florins pour leur culture et 300<br />
florins pour leur vendange. De plus, le chef<br />
vigneron (vinitor), un membre du personnel<br />
technique du monastère, reçoit 100 florins de<br />
salaire annuel (plus que le barbier et autant<br />
que le charretier). <strong>Le</strong> rapport détaille ce qui se<br />
cache derrière les 500 florins dépensés pour<br />
la culture des vignes: «pour chaque pose de<br />
vigne effeuillée et levée, on donne, de dépense,<br />
deux quarterons de vin, deux pots de fèves,<br />
un quarteron de grains, mi-orge mi seigle, et<br />
deux livres de fromage, et pour trois poses, un<br />
pain de sel et 21 batz d’argent». <strong>Le</strong> ramassage<br />
des sarments «coûte» 4 florins et un bichet<br />
de fèves», et le désherbage «un quarteron de<br />
céréales par pose, mi-orge, mi-seigle, et rien<br />
d’autre».
Au milieu du XVIIe siècle, les vignes se trouvent<br />
donc entre les mains d’un spécialiste. Cela<br />
indique de la part des chanoines, une volonté<br />
de profiter au mieux de leurs vastes vignobles.<br />
Un livre de raison tenu dans le dernier quart du<br />
XVIIe siècle entrouvre une fenêtre sur la ruche<br />
abbatiale. On y voit plusieurs personnages<br />
travailler dans les vignes, participer aux vendanges<br />
et oeuvrer à la cave. Certains ne font<br />
que passer, d’autres sont là régulièrement. Par<br />
exemple, Humbert Munier travaille dans les<br />
vignes en octobre 1678. En 1679, il vendange<br />
5 jours à Saint-Maurice et 3 jours à Martigny.<br />
Faire le vin et le<br />
conserver<br />
Il semblerait logique que la chaîne d’opérations<br />
tendue entre l’extraction du jus des grappes<br />
et le soin du vin soit concentrée à l’Abbaye,<br />
à proximité des consommateurs. Cela ne se<br />
vérifie que partiellement. Un inventaire dressé<br />
en1646 décrit dans le monastère un local<br />
appelé «le pressoir». On y trouve «le pressoir<br />
fait par l’abbé Odet» ainsi que «quatre grandes<br />
et belles tines pour réduire la vendange, l’une<br />
d’elle est toutefois moindre que les autres». La<br />
cure de Notre-Dame de Sous-le-Bourg possède<br />
une de ces cuves, une autre appartient à<br />
l’aumônier du monastère et les deux dernières<br />
à son chantre. L’inventaire mentionne aussi des<br />
ustensiles de vendange dans la cave abbatiale:<br />
«cinq gerles pour la vendange, tant grandes<br />
que petites, dont trois sont en mélèze et deux<br />
en sapin», quatre brantes «propres à porter<br />
vendanges» et deux entonnoirs.<br />
Cuver et presser sur<br />
place<br />
<strong>Le</strong>s chanoines préfèrent cependant adopter,<br />
pour organiser le temps et les déplacements,<br />
une logique différente, assez courante dans<br />
le Valais médiéval. Comme les ‘vignobles les<br />
plus importants se trouvent à quelque distance<br />
du monastère, dans les collines qui séparent<br />
Saint-Maurice et Bex, on y construit des installations<br />
de cuvage et de pressage, que les textes<br />
signalent depuis le XIIIe siècle en ces lieux. L’un<br />
de ces édifices élevé dans le vignoble de Cries,<br />
ressort assez bien des textes modernes. L’inventaire<br />
abbatiale de 1646 y recense «quatre<br />
grandes tines ou cuves, dont l’une est d’environ<br />
17 ou 18 chars, l’autre de 12, l’autre de 8,<br />
l’autre de 5 ou de 6», et un «grand pressoir»<br />
installé par Martin Duplâtre, abbé de 1527 à<br />
1587. <strong>Le</strong> bâtiment abrite aussi huit brantes et<br />
six «grandes et moyennes».<strong>Le</strong>s brantes servent<br />
à transporter le raisin de la vigne vers un lieu<br />
de collecte où on les vide dans les gerles. Une<br />
fois pleines, celles-ci seront vidées dans des<br />
récipients montés sur des chars qui conduiront<br />
la vendange vers les cuves et le pressoir.<br />
Une cave de 50’000<br />
litres en 1646<br />
<strong>Le</strong>s vins tirés des vignes du monastère et des<br />
redevances foncières s’élèvent et reposent<br />
dans la vaste cave de l’Abbaye. En 1646, un<br />
inventaire recense 29 tonneaux dénommés<br />
«bosses» et «22 tonneaux de charge». <strong>Le</strong>ur<br />
capacité est donnée parfois en setiers, mais le<br />
plus souvent en «charrets de vin», sans doute<br />
des tonneaux construits pour être installés<br />
sur un char. <strong>Le</strong>ur contenance est grossièrement<br />
mesurable: cet inventaire signale trois<br />
pièces de tonnellerie «faites à façon de demichar<br />
contenant chacune 8 setiers», le tonneau<br />
de charge contiendrait donc 16 setiers,<br />
soit quelque 550 litres. Cette cave peut donc<br />
accueillir quelque 28’000 litres dans ses tonneaux<br />
ordinaires, plus14’000 litres environ<br />
dans les «22 tonneaux de charge», soit en tout<br />
42’000 litres; les adjonctions représentent au<br />
minimum 5’800 litres, ce qui amène la capacité<br />
de la cave à environ 50’000 litres.<br />
Extraits de textes provenant de «Histoire de la<br />
Vigne et du Vin du Valais» publiés avec l’aimable<br />
autorisation de Mme Anne-Dominique<br />
Zufferey, directrice du Musée Valaisan de la<br />
Vigne et du Vin)<br />
7
Innovation<br />
Bienvenue aux «Jeunes <strong>Chevalier</strong>s»<br />
8<br />
Selon Eugène Labiche « La jeunesse n’a<br />
qu’un temps». Voilà pourquoi, s’appuyant<br />
sur cette citation, les Officiers du Conseil<br />
de l’Ordre de la Channe ont mis sur pied<br />
un concept de recrutement auprès des<br />
jeunes en général.<br />
Cette opération a pour but de permettre<br />
aux jeunes hommes et jeunes filles comptant<br />
26 printemps et moins d’adhérer à la<br />
Confrérie et de leur permettre ainsi de faire<br />
plus ample connaissance avec le vin, avec<br />
son histoire et le respect qui lui est dû.<br />
Ces nouveaux membres, outre le fait<br />
qu’ils porteront le titre et le sautoir jaune<br />
de «Jeune <strong>Chevalier</strong>», se verront donc<br />
Cette édition du «<strong>Chevalier</strong>» vous est offerte par:<br />
offrir de substantiels avantages financiers<br />
soit, d’une manière générale, une réduction<br />
de 50% sur toutes les prestations<br />
de la confrérie comme, par exemple, sur<br />
le montant de la cotisation annuelle qui,<br />
pour les «Jeunes <strong>Chevalier</strong>s» se montera<br />
à 60.-- francs au lieu des 120.-- francs<br />
habituels. Autre exemple: une intronisation<br />
avec repas s’élèvera à 150.-- francs<br />
et non plus à 300.-- francs. Bien entendu<br />
et toujours pour les «Jeunes <strong>Chevalier</strong>s»,<br />
la participation aux repas des Chapitres de<br />
la Confrérie seront également réduits de<br />
50%.<br />
Dès que le «Jeune <strong>Chevalier</strong>» entre dans<br />
sa vingt-septième année, il est automatiquement<br />
élevé à la dignité de «<strong>Chevalier</strong>»<br />
sans devoir se soumettre à une nouvelle<br />
cérémonie d’intronisation mais en perdant<br />
les avantages liés à l’appellation de<br />
«Jeune <strong>Chevalier</strong>».<br />
<strong>Le</strong>s Officiers du Conseil se réjouissent déjà<br />
d’accueillir les candidats «Jeune <strong>Chevalier</strong>»<br />
et, tout en les félicitant pour leur décision,<br />
leur souhaitent la plus cordiale des<br />
bienvenues.<br />
Remarque:<br />
Des formulaires d’adhésion sont disponibles<br />
sur le site internet de la Confrérie<br />
(www.ordre-de-la-channe.ch) ou peuvent<br />
être commandés au secrétariat.<br />
Ordre de la Channe > Case postale 1007 > 1951 Sion ><br />
Tél: 027 323 76 02 / 079 569 23 58<br />
info@ordre-de-la-channe.ch<br />
www.ordre-de-la-channe.ch