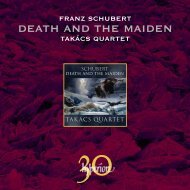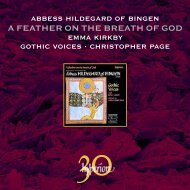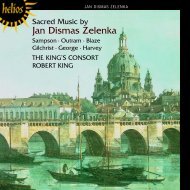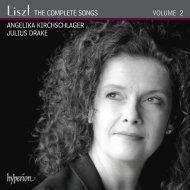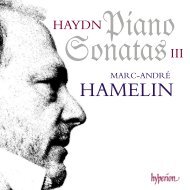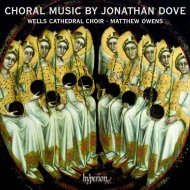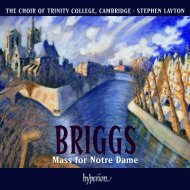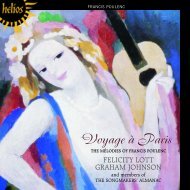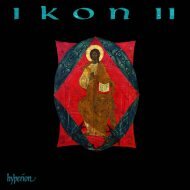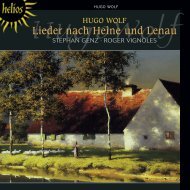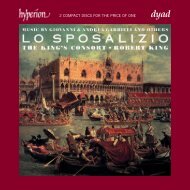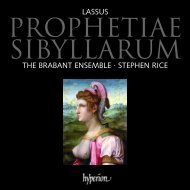application/pdf : 241 Ko - Abeille Musique
application/pdf : 241 Ko - Abeille Musique
application/pdf : 241 Ko - Abeille Musique
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
place sur ce disque, mérite un enregistrement à lui seul.) Les<br />
pièces proposées ici sont toutes des ballate polyphoniques,<br />
genre qui prit une importance croissante à partir des années<br />
1360. Comme la plupart des formes médiévales de poésie<br />
lyrique vernaculaire mises en polyphonie, la ballata obéit<br />
à deux grands principes d’organisation : primo, la forme<br />
musicale est créée en arrangeant deux unités musicales selon<br />
un schéma de répétition et de variation ; secundo, jamais une<br />
section textuelle n’est reprise juste après avoir été chantée.<br />
Comme l’attestent les œuvres enregistrées ici, le schéma de<br />
la ballata peut être présenté ainsi : A (ripresa)–bb (deux<br />
piedi)–a (volta)–A (ripresa).<br />
Entré dans l’ordre des Servi di Maria à Florence en 1375,<br />
Andreas de Florentia fut organiste, comme Landini. Sa ballata<br />
Per la ver’onestà 2 affiche un style à deux voix abouti, où les<br />
parties ont un caractère davantage homogène que dans des<br />
pièces antérieures comme Quando la stella. Per la ver’onestà<br />
est un dialogue fluide où les voix sont unies par des passages<br />
imitatifs et par l’échange de motifs. Il en va un peu de même<br />
pour Ochi dolenti mie 8 de Landini, où presque aucune note<br />
n’est gâchée.<br />
La sélection de pièces (à partir de bl) issues du manuscrit<br />
italien (probablement vénitien) Canonici misc. 213 s’ouvre sur<br />
un motet latin à la Vierge—indubitablement l’œuvre d’un<br />
compositeur d’Europe du Nord. Sa texture à cinq parties, tout<br />
à fait exceptionnelle pour l’époque (probablement les années<br />
1420), ne se retrouve que dans le manuscrit anglais d’Old<br />
Hall ou dans les motets de Dufay. Il est isorythmique dans<br />
l’ensemble des cinq parties et remarquablement consonant.<br />
Cette superbe pièce anonyme pourrait-elle être l’œuvre du<br />
plus grand compositeur de l’époque, Guillaume Dufay ?<br />
Toutes les autres compositions sont coulées dans la forme<br />
qui domina la chanson du XV e siècle : le rondeau. Toutes, sauf<br />
une, sont des pièces à trois parties où un contratenor vient<br />
conférer à un duo cantus/ténor un surcroît de couleur<br />
harmonique et d’élan rythmique. L’éventail stylistique est<br />
considérable. Plaindre m’estuet bp de Hugo de Lantins (mise<br />
11<br />
en musique d’un poème à l’acrostiche éhonté) comporte<br />
plusieurs longs passages imitatifs, surtout entre le cantus et le<br />
ténor, que l’on peut signifier lors de l’interprétation (comme ici)<br />
par un texte approprié ; les trois parties de la chanson sont<br />
toutes cum littera dans le manuscrit. Le style harmonique,<br />
gorgé de triades complètes, est riche et sonore. Confort<br />
d’amours br, une pièce anonyme à quatre parties, présente<br />
un style rythmique courant dans le misc. Canonici 213 ;<br />
la mensuration équivaut à un moderne et les rythmes<br />
des parties supérieures alternent nerveusement entre noire–<br />
croche et croche–noire, en sorte que (et c’est un point clé de<br />
ce style) ils se synchronisent rarement ; d’insistants modèles<br />
d’hémiole (où la mesure à est comblée par trois noires)<br />
varient également le rythme. Il en résulte, tout au long de la<br />
pièce, un mouvement sur presque chaque temps de la mesure<br />
à et donc une impression de mouvement incessant. Cette<br />
pièce vaut tout particulièrement (et nous ne sommes pas<br />
parvenus à trouver son exact équivalent) pour son large<br />
ambitus (dix-sept notes en tout) et pour les légères<br />
expérimentations chromatiques du compositeur.<br />
Tous les compositeurs de ces pièces étaient des gens<br />
du Nord. Richard Loqueville devint maître des choristes à<br />
la cathédrale de Cambrai en 1413 ; il jouait de la harpe,<br />
et plusieurs de ses chansons sont exécutées ici sur la<br />
reproduction d’un instrument qu’il aurait pu utiliser. Ces<br />
chansons gracieuses, dont l’économie de moyens contraste<br />
étonnamment avec les pièces italiennes antérieures, conviennent<br />
parfaitement à la sonorité et à l’articulation de la<br />
harpe. On sait peu de choses sur Hugo de Lantins, hormis qu’il<br />
prospéra de 1420 environ à 1430 et que, comme Loqueville, il<br />
a pu avoir des liens avec Guillaume Dufay. Et de Dufay, la fleur<br />
de tous les musiciens de son siècle, que dire qui n’ait déjà<br />
été dit ? Son Quel fronte signorille in paradiso bm illustre à<br />
merveille la douceur italienne a la Francesca.<br />
CHRISTOPHER PAGE © 1988<br />
Traduction HYPERION, 2006