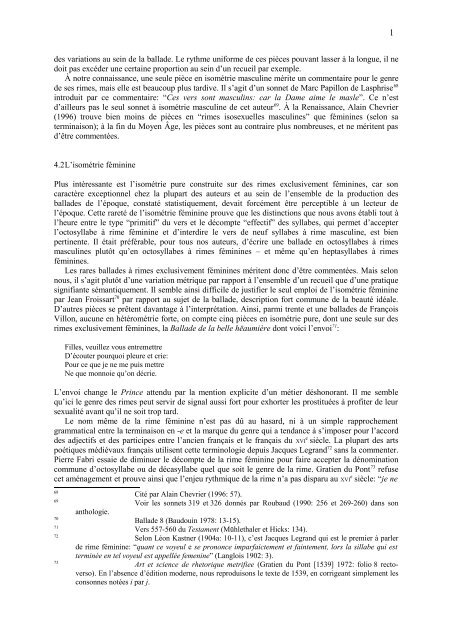L'Hétérométrie “faible”, l'hétérométrie “forte” et l'isométrie “pure”: les ...
L'Hétérométrie “faible”, l'hétérométrie “forte” et l'isométrie “pure”: les ...
L'Hétérométrie “faible”, l'hétérométrie “forte” et l'isométrie “pure”: les ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
des variations au sein de la ballade. Le rythme uniforme de ces pièces pouvant lasser à la longue, il ne<br />
doit pas excéder une certaine proportion au sein d’un recueil par exemple.<br />
À notre connaissance, une seule pièce en isométrie masculine mérite un commentaire pour le genre<br />
de ses rimes, mais elle est beaucoup plus tardive. Il s’agit d’un sonn<strong>et</strong> de Marc Papillon de Lasphrise 68<br />
introduit par ce commentaire: “Ces vers sont masculins: car la Dame aime le masle”. Ce n’est<br />
d’ailleurs pas le seul sonn<strong>et</strong> à isométrie masculine de c<strong>et</strong> auteur 69 . À la Renaissance, Alain Chevrier<br />
(1996) trouve bien moins de pièces en “rimes isosexuel<strong>les</strong> masculines” que féminines (selon sa<br />
terminaison); à la fin du Moyen Âge, <strong>les</strong> pièces sont au contraire plus nombreuses, <strong>et</strong> ne méritent pas<br />
d’être commentées.<br />
4.2L’isométrie féminine<br />
Plus intéressante est l’isométrie pure construite sur des rimes exclusivement féminines, car son<br />
caractère exceptionnel chez la plupart des auteurs <strong>et</strong> au sein de l’ensemble de la production des<br />
ballades de l’époque, constaté statistiquement, devait forcément être perceptible à un lecteur de<br />
l’époque. C<strong>et</strong>te rar<strong>et</strong>é de l’isométrie féminine prouve que <strong>les</strong> distinctions que nous avons établi tout à<br />
l’heure entre le type “primitif” du vers <strong>et</strong> le décompte “effectif” des syllabes, qui perm<strong>et</strong> d’accepter<br />
l’octosyllabe à rime féminine <strong>et</strong> d’interdire le vers de neuf syllabes à rime masculine, est bien<br />
pertinente. Il était préférable, pour tous nos auteurs, d’écrire une ballade en octosyllabes à rimes<br />
masculines plutôt qu’en octosyllabes à rimes féminines – <strong>et</strong> même qu’en heptasyllabes à rimes<br />
féminines.<br />
Les rares ballades à rimes exclusivement féminines méritent donc d’être commentées. Mais selon<br />
nous, il s’agit plutôt d’une variation métrique par rapport à l’ensemble d’un recueil que d’une pratique<br />
signifiante sémantiquement. Il semble ainsi difficile de justifier le seul emploi de l’isométrie féminine<br />
par Jean Froissart 70 par rapport au suj<strong>et</strong> de la ballade, description fort commune de la beauté idéale.<br />
D’autres pièces se prêtent davantage à l’interprétation. Ainsi, parmi trente <strong>et</strong> une ballades de François<br />
Villon, aucune en hétérométrie forte, on compte cinq pièces en isométrie pure, dont une seule sur des<br />
rimes exclusivement féminines, la Ballade de la belle hëaumière dont voici l’envoi 71 :<br />
Fil<strong>les</strong>, veuillez vous entrem<strong>et</strong>tre<br />
D’écouter pourquoi pleure <strong>et</strong> crie:<br />
Pour ce que je ne me puis m<strong>et</strong>tre<br />
Ne que monnoie qu’on décrie.<br />
L’envoi change le Prince attendu par la mention explicite d’un métier déshonorant. Il me semble<br />
qu’ici le genre des rimes peut servir de signal aussi fort pour exhorter <strong>les</strong> prostituées à profiter de leur<br />
sexualité avant qu’il ne soit trop tard.<br />
Le nom même de la rime féminine n’est pas dû au hasard, ni à un simple rapprochement<br />
grammatical entre la terminaison en -e <strong>et</strong> la marque du genre qui a tendance à s’imposer pour l’accord<br />
des adjectifs <strong>et</strong> des participes entre l’ancien français <strong>et</strong> le français du XVI e siècle. La plupart des arts<br />
poétiques médiévaux français utilisent c<strong>et</strong>te terminologie depuis Jacques Legrand 72 sans la commenter.<br />
Pierre Fabri essaie de diminuer le décompte de la rime féminine pour faire accepter la dénomination<br />
commune d’octosyllabe ou de décasyllabe quel que soit le genre de la rime. Gratien du Pont 73 refuse<br />
c<strong>et</strong> aménagement <strong>et</strong> prouve ainsi que l’enjeu rythmique de la rime n’a pas disparu au XVI e siècle: “je ne<br />
68 Cité par Alain Chevrier (1996: 57).<br />
69<br />
anthologie.<br />
Voir <strong>les</strong> sonn<strong>et</strong>s 319 <strong>et</strong> 326 donnés par Roubaud (1990: 256 <strong>et</strong> 269-260) dans son<br />
70 Ballade 8 (Baudouin 1978: 13-15).<br />
71 Vers 557-560 du Testament (Mühl<strong>et</strong>haler <strong>et</strong> Hicks: 134).<br />
72 Selon Léon Kastner (1904a: 10-11), c’est Jacques Legrand qui est le premier à parler<br />
de rime féminine: “quant ce voyeul e se prononce imparfaictement <strong>et</strong> faintement, lors la sillabe qui est<br />
terminée en tel voyeul est appellée femenine” (Langlois 1902: 3).<br />
73 Art <strong>et</strong> science de rh<strong>et</strong>orique m<strong>et</strong>rifiee (Gratien du Pont [1539] 1972: folio 8 rectoverso).<br />
En l’absence d’édition moderne, nous reproduisons le texte de 1539, en corrigeant simplement <strong>les</strong><br />
consonnes notées i par j.<br />
1