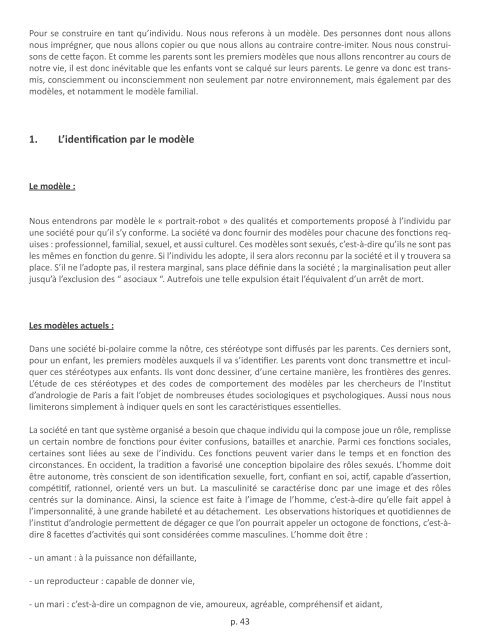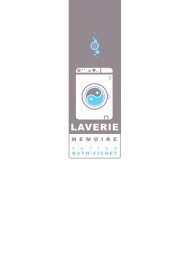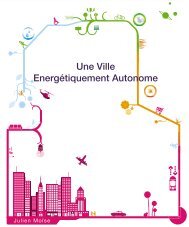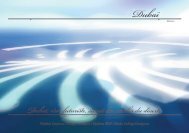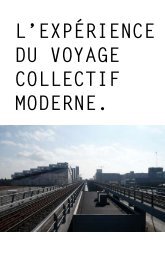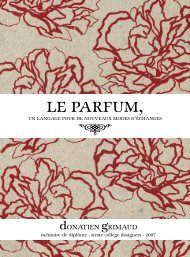Mémoire Jonathan Lejeune - Strate Collège
Mémoire Jonathan Lejeune - Strate Collège
Mémoire Jonathan Lejeune - Strate Collège
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Pour se construire en tant qu’individu. Nous nous referons à un modèle. Des personnes dont nous allons<br />
nous imprégner, que nous allons copier ou que nous allons au contraire contre-imiter. Nous nous construisons<br />
de cette façon. Et comme les parents sont les premiers modèles que nous allons rencontrer au cours de<br />
notre vie, il est donc inévitable que les enfants vont se calqué sur leurs parents. Le genre va donc est transmis,<br />
consciemment ou inconsciemment non seulement par notre environnement, mais également par des<br />
modèles, et notamment le modèle familial.<br />
1. L’identification par le modèle<br />
Le modèle :<br />
Nous entendrons par modèle le « portrait-robot » des qualités et comportements proposé à l’individu par<br />
une société pour qu’il s’y conforme. La société va donc fournir des modèles pour chacune des fonctions requises<br />
: professionnel, familial, sexuel, et aussi culturel. Ces modèles sont sexués, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas<br />
les mêmes en fonction du genre. Si l’individu les adopte, il sera alors reconnu par la société et il y trouvera sa<br />
place. S’il ne l’adopte pas, il restera marginal, sans place définie dans la société ; la marginalisation peut aller<br />
jusqu’à l’exclusion des “ asociaux “. Autrefois une telle expulsion était l’équivalent d’un arrêt de mort.<br />
Les modèles actuels :<br />
Dans une société bi-polaire comme la nôtre, ces stéréotype sont diffusés par les parents. Ces derniers sont,<br />
pour un enfant, les premiers modèles auxquels il va s’identifier. Les parents vont donc transmettre et inculquer<br />
ces stéréotypes aux enfants. Ils vont donc dessiner, d’une certaine manière, les frontières des genres.<br />
L’étude de ces stéréotypes et des codes de comportement des modèles par les chercheurs de l’Institut<br />
d’andrologie de Paris a fait l’objet de nombreuses études sociologiques et psychologiques. Aussi nous nous<br />
limiterons simplement à indiquer quels en sont les caractéristiques essentielles.<br />
La société en tant que système organisé a besoin que chaque individu qui la compose joue un rôle, remplisse<br />
un certain nombre de fonctions pour éviter confusions, batailles et anarchie. Parmi ces fonctions sociales,<br />
certaines sont liées au sexe de l’individu. Ces fonctions peuvent varier dans le temps et en fonction des<br />
circonstances. En occident, la tradition a favorisé une conception bipolaire des rôles sexués. L’homme doit<br />
être autonome, très conscient de son identification sexuelle, fort, confiant en soi, actif, capable d’assertion,<br />
compétitif, rationnel, orienté vers un but. La masculinité se caractérise donc par une image et des rôles<br />
centrés sur la dominance. Ainsi, la science est faite à l’image de l’homme, c’est-à-dire qu’elle fait appel à<br />
l’impersonnalité, à une grande habileté et au détachement. Les observations historiques et quotidiennes de<br />
l’institut d’andrologie permettent de dégager ce que l’on pourrait appeler un octogone de fonctions, c’est-àdire<br />
8 facettes d’activités qui sont considérées comme masculines. L’homme doit être :<br />
- un amant : à la puissance non défaillante,<br />
- un reproducteur : capable de donner vie,<br />
- un mari : c’est-à-dire un compagnon de vie, amoureux, agréable, compréhensif et aidant,<br />
p. 43