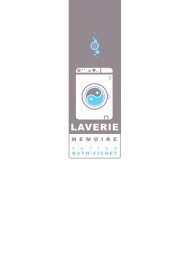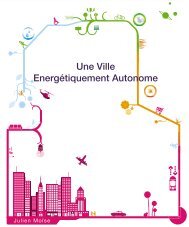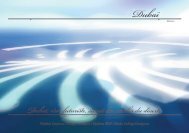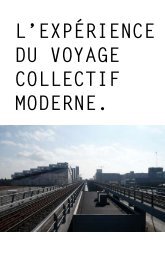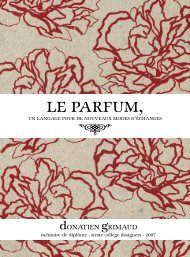Mémoire Jonathan Lejeune - Strate Collège
Mémoire Jonathan Lejeune - Strate Collège
Mémoire Jonathan Lejeune - Strate Collège
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
4. La métamorphose des modèles<br />
Les nouvelles familles et l’homoparentalité :<br />
Avec le recul que l’on peut avoir sur notre société, on se rend compte que certaines valeurs, certains codes,<br />
sont en train de voler en éclat. Le changement du statut de la femme, l’évolution de pensée des hommes<br />
ainsi que le changement même des rôles au sein d’une famille font exploser le schéma classique de la famille<br />
traditionnelle (patriarcale et matriarcale). Que se soit par le divorce avec les familles recomposées, la famille<br />
monoparentale ou alors la famille homoparentale, la famille traditionnelle a du mal à s’imposer. L’émergence<br />
de la question de l’homoparentalité se situe au carrefour de l’évolution du regard porté sur l’homosexualité<br />
depuis une vingtaine d’années, et de la transformation du regard social sur la famille. L’homosexualité est de<br />
plus en plus considérée comme « un comportement comme un autre ». L’enquête sur l’évolution de 1980 à<br />
2000 des valeurs des Français, réalisée par Bréchon en 2000 confirme cette tendance. L’évolution du regard<br />
porté sur l’homosexualité a probablement démarré avec la « libération sexuelle » des années 1970. Elle va<br />
de paire avec l’évolution de la condition des femmes, due à l’accès à la contraception et à légalisation de<br />
l’avortement.<br />
Néanmoins si l’homoparentalité peut s’avérer acquise chez nos voisins européens, la France reste timide sur<br />
le sujet. Elle ne parvient pas à prendre position. Parmi les partisans du contre, nous retrouvons une majorité<br />
des psychanalystes qui prône un discours normatif. Au sein de la Société de psychanalyse Freudienne, le débat<br />
a cependant commencé à avoir lieu sur les positions prises publiquement par certains psychanalystes. Ces<br />
discours ont été dénoncés comme ceux de leurs auteurs et non ceux de la discipline tout entière. Néanmoins<br />
certains n’hésitent pas à considérer l’homosexualité comme une pathologie narcissique (Anatrella, 1996,<br />
peut-on légitimer l’homosexualité ?, document Episcopat) dont serait exclue toute relation véritable à autrui,<br />
ce qui leur interdit la parentalité. D’autres comme Flavingy en 2002 estime que « le vrai parent serait celui<br />
qui se met en position de pouvoir procréer. L’infertilité de l’homosexuel serait le désir inconscient de ne pas<br />
procréer. Il ajoute que « créer une parentalité non calquée sur la procréation représenterait un danger social,<br />
une usurpation du pouvoir social de créer du symbolique. Et pour finir, selon Korff-Sausse dans « le PACS et<br />
clones, la logique même », des éditions Libération en 1999, « L’homosexualité serait synonyme de déni de la<br />
différence des sexes, déni qui conduirait nécessairement sur l’amour du même, voire au clonage».<br />
Les détracteurs de l’homoparentalité ont évoqué, selon Martine Gross, principalement trois arguments :<br />
l’intérêt de l’enfant, l’ordre social, l’universalisme de la République.<br />
Selon le premier argument, l’homoparentalité nuirait aux enfants. Ceux-ci souffriraient de troubles de développement<br />
personnel et particulièrement de troubles de l’identité sexuelle. On a vu, selon les études anglosaxonnes,<br />
que ces craintes ne reposaient sur aucun fondement scientifique. Aucune des centaines d’études<br />
publiées sur le devenir des enfants élevés par des parents homosexuels ne confirme que l’homoparentalité<br />
nuirait aux enfants.<br />
Il est important de noter que la plupart des risques évoqués sont liés sûrement au bouleversement provoqué<br />
par une évolution des fonctions parentales qui, pour être extrêmement visible dans l’homoparentalité, n’en<br />
est pas moins une évolution à l’échelle de la société. Christine Castellain-Meunir (2002, la place des hommes<br />
et les métamorphoses de la famille, Paris, PUF) décrit cette mutation qui se traduit selon elle par l’apparition<br />
d’une culture de la paternité et la perte simultanée de légitimité des modèles traditionnels d’affirmation du<br />
masculin. Les « homo-pères », comme mini-laboratoire social, illustrent cette métamorphose. Aujourd’hui,<br />
les fonctions parentales peuvent être exercées aussi bien par un homme que par une femme. Les soins du<br />
p. 51