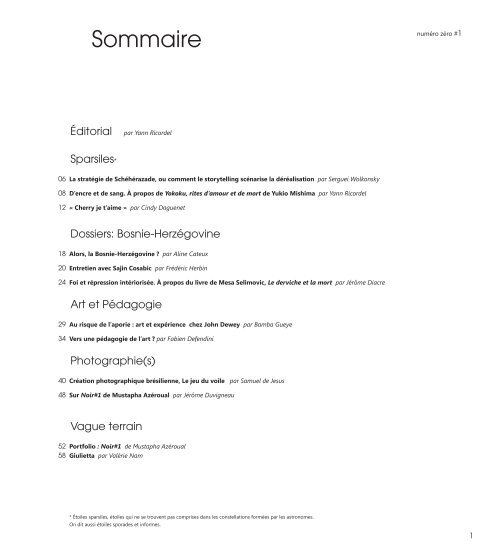PDF - 7.1 Mo - Numéro Zéro #1
PDF - 7.1 Mo - Numéro Zéro #1
PDF - 7.1 Mo - Numéro Zéro #1
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Sommaire<br />
Éditorial par Yann Ricordel<br />
Sparsiles*<br />
06 La stratégie de Schéhérazade, ou comment le storytelling scénarise la déréalisation par Serguei Wolkonsky<br />
08 D’encre et de sang. À propos de Yokoku, rites d’amour et de mort de Yukio Mishima par Yann Ricordel<br />
12 « Cherry je t’aime » par Cindy Daguenet<br />
Dossiers: Bosnie-Herzégovine<br />
18 Alors, la Bosnie-Herzégovine ? par Aline Cateux<br />
20 Entretien avec Sajin Cosabic par Frédéric Herbin<br />
24 Foi et répression intériorisée. À propos du livre de Mesa Selimovic, Le derviche et la mort par Jérôme Diacre<br />
Art et Pédagogie<br />
29 Au risque de l’aporie : art et expérience chez John Dewey par Bamba Gueye<br />
34 Vers une pédagogie de l’art ? par Fabien Defendini<br />
Photographie(s)<br />
40 Création photographique brésilienne, Le jeu du voile par Samuel de Jesus<br />
48 Sur Noir<strong>#1</strong> de Mustapha Azéroual par Jérôme Duvigneau<br />
Vague terrain<br />
52 Portfolio : Noir<strong>#1</strong> de Mustapha Azéroual<br />
58 Giulietta par Valérie Nam<br />
* Étoiles sparsiles, étoiles qui ne se trouvent pas comprises dans les constellations formées par les astronomes.<br />
On dit aussi étoiles sporades et informes.<br />
numéro zéro <strong>#1</strong><br />
1
É d i t o r i a l<br />
«Vers le milieu de la deuxième nuit, Thomas se leva et descendit sans bruit.<br />
Personne ne l’aperçut qu’un chat presque aveugle qui, voyant la nuit changer de forme,<br />
courut derrière cette nouvelle nuit qu’il ne voyait pas.»<br />
Maurice Blanchot, Thomas l’Obscur, 1950<br />
C’est de manière non concertée que ce premier numéro de <strong>Numéro</strong> <strong>Zéro</strong> est venu se placer sous le signe du noir. Les peintures noires de<br />
Sanjin Cosabic. Puis le noir d’encre de Yukio Mishima. Enfin les photographies de Mustapha Azéroual et le texte de Jérôme Duvigneau qui les<br />
introduit. Funeste présage ? Rien de moins sûr : le noir n’est pas à considérer ici comme post-apocalyptique, mais plutôt comme la nullité,<br />
le degré zéro, la neutralité à partir desquels quelque chose peut se construire, émerger. À l’image du procédé que l’on appelle en gravure,<br />
précisément, la manière noire : enduire la plaque métallique de vernis couleur mélasse, graver son dessin, passer au bain d’acide — les parties<br />
nue sont alors attaquées —, passer à l’encre, essuyer… Sortie de la presse, le trait apparaît sur le papier blanc. « Back in Black », « Paint<br />
it Black », « Noir c’est noir ». Noir, noir, noir.<br />
Le noir porte en lui cette ambivalence : il peut tout à la fois représenter la vacuité, la vacance de signifié, ou au contraire concentrer toutes les<br />
images possibles, le signifiant dans sa totalité. À ce propos, Lawrence Alloway a rapporté qu’à l’occasion d’une exposition d’aquarelles en 1949<br />
à la Betty Parsons Gallery, l’un des représentants majeurs de l’abstraction géométrique aux États-Unis, Ad Reinhardt, insistait avec humour<br />
dans le catalogue sur le caractère non figuratif de son travail : « La plupart des peintures ont été faites dans les Îles Vierges Américaines,<br />
sur une petite île au large de St. John. Elles ne contiennent ni coquillages, ni grottes subaquatiques, ni sable aveuglant ni vents sauvages ni<br />
superstitions, ni peur des profondeurs, ni magie de l’Ouest indien, ni zombies ni oursins. Il n’y a en elles ni trace ni goût de langouste ou<br />
de tortue, de mangue ou de mangouste, ni rhum ni Coca-Cola, pas de bambou ni de barracuda ni de moteur hors-bord. Pas de poisson<br />
tropical ou de volaille, pas de caricatures humaines, pas de terre ou de mer natives, pas de ciel, pas d’abstractions de la nature, pas de nature<br />
mortes « high » ou « low », pas d’histoires caribéennes camouflées, pas de fonds religieux régionaux, pas de mythes raciaux ou politiques<br />
locaux. » Alloway poursuit en rapportant l’anecdote suivante : « Je dis à Reihardt combien j’aimais cette liste exubérante de dénégations, il<br />
dit alors : “Certes, mais ce qu’il y a d’amusant c’est que toutes ces choses sont dans les peintures.” » On peut très bien imaginer que les Black<br />
Paintings, qu’évoque Jérôme Duvigneau dans son texte, ou même les Ultimate Paintings des années 1960, qui firent la célébrité du peintre,<br />
soient porteuses de la même équivocité.<br />
Le choix du noir est peut-être ici aussi une réaction à l’ère de la « une », de la couverture indexée sur les effets de surprise et de choc. Ici pas<br />
de belle photo sur papier glacé, mais un noir sans doute cousin de celui du drapeau anarchiste. Ce choix consonne avec le parti pris initial de<br />
ne pas faire de la nouveauté une contrainte, de ne pas s’inféoder à l’actualité. <strong>Numéro</strong> <strong>Zéro</strong> s’arroge le droit d’être anachronique, uchronique,<br />
diachronique. Pas de belle image pour interpeller le chaland, mais un noir qui dit que ce qui est intéressant est à l’intérieur. « Peut-être le mal<br />
du siècle c’est l’emballage », dit une chanson du groupe Diabologum : <strong>Numéro</strong> <strong>Zéro</strong> n’a aucune vocation décorative, il n’est pas un accessoire :<br />
<strong>Numéro</strong> <strong>Zéro</strong> c’est de la pensée qui demande à être repensée, mise en activité.<br />
Enfin, le noir représente peut-être l’ultime angoisse d’une époque obsessionnellement écranique, continuellement perfusée de signes en<br />
tous genres. La coupure du signal, la solitude et l’isolement, la fin de l’existence virtuelle, l’écran d’un noir abyssal — avec comme point de<br />
fuite la mort numérique… Freud raconte l’histoire d’un enfant qui a peur du noir : il s’adresse à sa tante qui est dans la pièce à côté et lui<br />
dit « parle moi car j’ai peur ». La tante répond : « A quoi cela te servirait-il puisque tu ne me vois pas ? ». Alors l’enfant dit : « Il fait plus clair<br />
lorsque quelqu’un parle ». Le noir pourrait ouvrir une niche temporelle propice à la pensée, à la concentration, à la reconsidération de ce<br />
que sont nos vies.<br />
N’ayons pas peur du noir.<br />
Yann Ricordel, Rédacteur en chef<br />
3
SPARSILES<br />
5
La Stratégie de Schéhérazade<br />
ou Comment le storytelling scénarise la déréalisation<br />
par Serguei Wolkonsky<br />
« Quand elle est régie par des rapports de production capitalistes, l’histoire<br />
est comparable à l’action inconsciente de l’individu qui rêve : elle est certes<br />
faite par les hommes, mais sans plan ni conscience, pour ainsi dire comme<br />
dans un rêve. » Rolf Tiedemann<br />
Mythomanie ou « mythographie » ?<br />
Dans la société du rêve, chaque destin se voit affublé d’un capital « mythographique<br />
». Chacun a son histoire et toutes se valent. Le récit se nourrit de la<br />
participation de ses personnages et de leur capacité à faire valoir un itinéraire<br />
dans la narration. Le récit maintient les personnages dans une égalité rêvée. La<br />
consommation devient aventure, l’acte d’achat une communion au mythe de<br />
la marque. Les problèmes eux-mêmes sont « mythologisés », ce qui permet<br />
d’éviter d’avoir à regarder en face les phénomènes qui sont critiqués comme<br />
participant de la crise du capitalisme, ou de présenter cette société du rêve<br />
qu’est devenu le capitalisme sous une forme si dénaturée que la critique<br />
favorise finalement une complaisance parasitaire à son égard.<br />
L’invention du « métasilence »<br />
Le storytelling redécouvre le mythe en tant que structure fondamentale permettant<br />
à l’homme d’agir sur le monde et de rassembler les éléments nécessaires<br />
à la construction de son point de vue, mais à la différence du mythe,<br />
il cesse d’être parole. Si le mythe est un métalangage, le storytelling est un<br />
« métasilence », c’est-à-dire un silence qui nous parle de notre incapacité à<br />
formuler des projets véritables, car, en définitive, ce recours systématique aux<br />
supposés bienfaits du récit est un leurre, une « stratégie de Schéhérazade »<br />
qui vise à gagner du temps.<br />
La forme d’oubli du mensonge<br />
L’opacité des grands mythes hérités de l’Histoire se reconstruit dans le plein<br />
jour des petites histoires liées à nos croyances ultramodernes. Quand tout<br />
devient mythe, du baril de lessive au burger en passant par une galaxie d’objets,<br />
de marques et d’ego reboostés au récit de leur illusoire unicité, tout<br />
devient alors vérité, le mythe n’étant plus lui-même que la forme d’oubli du<br />
mensonge.<br />
Le pouvoir qui se voit réduit dans son exercice à faire adopter des décisions<br />
techniques prises par des instances extra-démocratiques, voire extra-nationales,<br />
a trouvé dans la pensée narrative un moyen d’administrer ses propres<br />
vacances. Dès lors, l’activité pseudo-décisionnelle de l’état sera scénarisée,<br />
tout comme la vie de ceux qui ont été élus pour gouverner à l’intérieur de<br />
leur propre récit.<br />
Il est à cet égard assez significatif que le storytelling ait fait son apparition<br />
aux États-Unis sous la présidence d’un ancien acteur d’Hollywood : ce fait<br />
autorise les gourous du storytelling à nous faire croire qu’ils pouvaient faire<br />
élire à la Maison Blanche n’importe quel homme, pourvu qu’il sache raconter<br />
des histoires ou les interpréter.<br />
Dans « narration », il y a « nation »<br />
Le rêve américain n’est sans doute que l’assemblage des success-stories<br />
d’hommes et de femmes exemplaires, élevés au rang de légendes, dont les<br />
noms clignotent comme des enseignes entre deux rangées de gratte-ciels.<br />
Ceux-là ont créé leurs propres récits. Ils ont vendu leurs marchandises dans un<br />
emballage de rêves grand public. Ils sont devenus des marques ou ont marqué<br />
leur temps. Dans un pays où le récit s’est emparé, à tous les niveaux de la vie<br />
sociale, de l’imaginaire individuel et collectif, un homme sans histoire a en effet<br />
peu de chance de se faire entendre et d’être élu. L’horizon du récit américain,<br />
c’est la nation de tous les possibles, où l’émigré va pouvoir, chapitre après<br />
chapitre, vivre et se raconter. Peu importe le destin. C’est le récit qui compte.<br />
Un destin qui ne se raconte pas est improductif. Ce qui fonde la légitimité d’un<br />
récit, à notre époque, c’est sa valeur d’usage : le récit doit servir un profit, une<br />
plus-value de narration qui tend à devenir monnaie. En dépit de son inscription<br />
très marquée dans le temps présent, l’imaginaire du storyteller n’est pas très<br />
éloigné de celui du mage-lieur. Sa conception du pouvoir est éminemment<br />
magique. Il en va des entreprises et des nations comme des hommes. Après<br />
l’Histoire, les États-nations ont compris qu’ils devaient se raconter pour être.<br />
Les États-Unis ont inventé, en ce qui les concerne, l’état-narration. Devenir<br />
américain, c’est entrer dans une légende. Réalise socialement le rêve américain<br />
celui qui le réalise au sens hollywoodien du terme, c’est-à-dire celui qui le met<br />
en récit au moyen de sa propre réussite, en dirigeant ainsi le rêve des autres.<br />
La réalité comme enjeu de pouvoir<br />
Historiens, juristes, pédagogues, physiciens, économistes, psychologues…<br />
Aujourd’hui, chacun veut mettre en récit sa participation au monde avec l’intention<br />
plus ou moins déclarée de constituer ainsi une réalité. Chacun y va de<br />
sa petite histoire en espérant augmenter sa propre crédibilité et peu importe<br />
si ces récits juxtaposés deviennent un substitut aux faits et aux arguments<br />
rationnels. Il y a une prime à l’émotion pour celui qui sait raconter la bonne<br />
histoire au bon moment. Bien plus que s’assurer une prise sur le réel, cette<br />
gymnastique est présentée dans les manuels de storytelling comme l’une des<br />
clefs du pouvoir. Scénariser la réalité selon ses propres désirs, voilà le grand<br />
fantasme à une époque où l’avènement du jeu célèbre dans ses fictions nos<br />
qualités de personnages, en endormant, sur le plan de la consistance, notre<br />
vitalité de citoyens. La story n’est aucunement philanthrope. Elle vise à nous
convaincre, à orienter, à diriger nos actes. L’émotion qu’elle véhicule ne vise<br />
aucune libération. Ainsi, notre réalité apparaît comme un champ de bataille où<br />
s’affrontent des récits concurrents. Dans ce contexte, l’efficacité d’une story se<br />
mesure au nombre des personnages qu’elle annexe. Est réelle et mythique l’histoire<br />
qui sait émouvoir et soumettre le plus grand nombre de personnages.<br />
La communion narrative<br />
Après la grande purge des utopies du siècle précédent, notre société est<br />
aujourd’hui prête pour une reconfiguration des croyances. Nombreux sont ceux<br />
qui entendent répondre à la prétendue quête de sens de nos contemporains en<br />
lançant leurs nouvelles campagnes de rédemption. Les nouveaux récits conduisent<br />
les individus « égarés » dans un monde indéchiffrable à s’identifier à des<br />
modèles simples tout en se conformant, sur le chemin de la conversion, aux<br />
protocoles émouvants imposés par leurs maîtres. L’émotion elle-même devient<br />
l’objet d’un management décomplexé. Le nouveau sujet du capitalisme peut<br />
bien afficher son âme, puisque l’on reconnaît de prime abord les souffrances<br />
de son « moi émotionnel ». Là encore, grande découverte du marketing : les<br />
consommateurs sont des êtres sensibles et l’on peut stimuler efficacement leurs<br />
émotions par une histoire pour déclencher un acte d’achat ou une adhésion<br />
inconditionnelle de leur part. À cette insistante question de la quête de sens, les<br />
storytellers ont trouvé une réponse d’une étonnante modernité : la communion<br />
narrative. La société entière est prête à communier au récit, puisque les individus<br />
qui la composent ont intégré malgré eux, et depuis longtemps, les schémas et<br />
les usages du marketing jusque dans leur vie intime.<br />
Nous communions au récit de notre propre dissolution dans la trame d’une<br />
intrigue qui nous assigne un rôle de figurant en nous faisant croire que nous<br />
sommes acteurs. Nous faisons corps avec la machine narrative et la réalité que<br />
nous consommons dans les médias n’est qu’un plan ajouté aux histoires qui<br />
nous bercent. Nous communions au récit et nous sommes communiés, car nos<br />
corps et notre sang alimentent ce récit, sans lequel la vraie vie ne serait qu’une<br />
réalité froide, c’est-à-dire une survie éloignée de la chaleur des projecteurs. Le<br />
récit devient anthropophage quand nous devenons incapables de lui opposer<br />
nos rêves et d’assumer ces derniers sans nous raconter d’histoires. Il y a déréalisation<br />
quand les récits se contaminent et se confondent, quand ma vie entre<br />
dans la série télévisée et inversement, quand la langue dans laquelle je me<br />
raconte n’est plus la mienne, mais celle du récit qui me mange.<br />
La possibilité d’un « antirécit »<br />
Grande catégorie de la connaissance pour Roland Barthes, le récit, dans l’utilisation<br />
abusive qu’en fait le storytelling, est aussi une arme d’ignorance massive<br />
qui peut autoriser toute incursion dans le réel. La réalité elle-même, écrasée<br />
sous un empilement d’histoires, n’est plus directement perceptible. Le récit,<br />
tel que le conçoit Jorge Luis Borges à l’ère de la littérature, doit être considéré<br />
dans son économie propre et contient sa part de réalité. Au sortir du récit<br />
borgésien, l’effet de mise en doute de la réalité autorise un dialogue avec les<br />
formes environnantes, ce que ne permettent pas les certitudes confortables<br />
que nous suggèrent habilement les récits dominants à l’ère du storytelling. La<br />
réalité est aujourd’hui vécue comme danger tant qu’elle échappe au scénario<br />
qu’on lui destine. Pierre Macherey, dans sa théorie de la production littéraire,<br />
explique que « tout récit, dans le temps même où il est formulé, est la révélation<br />
d’une reprise contradictoire de lui-même. Libérer la réalité de la pollution<br />
des mythes contemporains et des marques auxquelles ils sont assujettis<br />
revient à chercher dans les entreprises narratives du storytelling le négatif<br />
du scénario, c’est-à-dire de remonter le cours du récit jusqu’aux mobiles<br />
du scénariste, ou plus loin encore, dans ceux du producteur. J. L. Borges,<br />
dans son art, ne se contente pas de tracer la ligne d’un récit. Il en marque<br />
la possibilité même, presque indépendamment de sa qualité d’auteur, tant<br />
et si bien que l’on a pu mettre en doute son existence, mais pas celle de<br />
ses récits, lesquels contiennent explicitement leur propre critique, ce que<br />
n’autorise jamais le storytelling qui stimule, dans ses enchaînements narratifs,<br />
des émotions sensées être utiles.<br />
Récit libérateur vs expériences tracées<br />
Le seul récit qui mériterait le rang de mythe serait, dans l’idéal, celui qui<br />
nous libérerait de nos propres histoires, c’est-à-dire de nos mensonges, des<br />
fictions rassurantes qui nous empêchent de vivre véritablement le caractère<br />
dérisoire et vain de notre présence au monde. L’un des dangers majeurs<br />
que représentent ces fictions, c’est la simplification abusive qu’elles véhiculent,<br />
quand il s’agit d’appréhender l’inquiétante complexité de notre<br />
environnement. Que le storytelling soit utilisé par les psychologues pour<br />
guérir des traumatismes, cela peut se concevoir ; qu’il prétende constituer<br />
une réponse à la crise du sens de nos sociétés, certainement pas. Ce serait<br />
oublier que nos sociétés se sont précisément construites sur cette perte de<br />
sens et qu’elles procèdent elles-mêmes d’une rupture avec les grands récits<br />
du siècle dernier. Le récit instrumentalisé dans la conquête du pouvoir est<br />
de sinistre mémoire, et l’argument de la quête du sens a déjà été utilisé<br />
par les entreprises les plus insensées dans des temps de crise antérieurs au<br />
nôtre. Que nous fantasmions un monde simplifié « profitera » plus sûrement<br />
aux acteurs de la complexité contemporaine qu’à nos petites entreprises<br />
désintéressées. Le storytelling ne propose rien de plus qu’un retour à la<br />
propagande et à la désinformation, mais avec l’efficacité redoutable de<br />
méthodes rodées dans le marketing et le management, à l’appui de ce<br />
que Christian Salmon appelle « des expériences tracées », c’est-à-dire des<br />
conduites soumises à protocoles d’expérimentation qui nous transforment<br />
inévitablement en sujets.<br />
La société du rêve<br />
La société du rêve est paradoxalement privée de ressources pour s’imaginer<br />
un avenir ou un présent. Elle rêve le rêve avec une inquiétante constance.<br />
C’est une société qui, faisant face à ses propres désillusions, voudrait encore<br />
les fuir dans le sommeil… Mais le rêve est un texte auquel elle n’a plus accès.<br />
Le storytelling est le rêve d’une société qui voudrait encore rêver, mais qui,<br />
n’en étant plus capable, se voit contrainte d’entretenir sa propre fiction pour<br />
survivre. Le storytelling est le rêve d’une société sans texte.<br />
7
D’encre et de sang<br />
À propos de Yûkoku, rites d’amour et de mort (1966) de Yukio Mishima<br />
par Yann Ricordel<br />
« Quand les Occidentaux parlent des «mystères de l’Orient», il est<br />
bien possible qu’ils entendent par là ce calme un peu inquiétant<br />
que secrète l’ombre. »<br />
Junichiro Tanizaki, Éloge de l’ombre (1933)<br />
Je partirai d’un constat simple : dans le cinéma en noir et blanc, l’encre<br />
et le sang sont d’une seule et même couleur : noire. Je pense<br />
que là où ailleurs il ne s’agit que d’une détermination technique, ce<br />
constat, dans le film de Mishima, fait sens. Je songe au sang noir de<br />
la fameuse scène de l’assassinat de Psycho (1960) d’Hitchcock : l’effet<br />
de réel, de persuasion, l’hypnose cinématographique ne nous fait<br />
pas douter un instant que ce noir dilué qui s’écoule dans le siphon<br />
de la douche soit autre chose que du sang, il ne saurait se confondre<br />
à l’atrabile du mélancolique ; et dans l’adaptation, quasiment plan<br />
par plan, qu’en fait Gus Van Sant en 1998, la couleur, le sang rouge,<br />
n’ajoute ni ne retire rien à l’horreur. Le sang est cette substance qui au<br />
cinéma annonce sa couleur ; on voit « noir » et on pense « rouge »,<br />
car il n’y a pas de sang, pas même celui de ceux qu’on appelle les<br />
« sangs bleus », qui ne soit rouge. Laurent Gervereau en fournit la<br />
démonstration lorsqu’il évoque le film The Thing from Another World<br />
(1951) de Christian Niby (où la couleur rouge prend un connotation<br />
politique) : « portant une sorte d’uniforme, c’est un soldat. Seul, il<br />
incarne une armée entière. C’est un singulier-multiple à l’instar du<br />
soldat-militant. Il évoque aussi bien le nazi que le Soviétique. Mais<br />
comment suggérer sa couleur ? Sa couleur véritable dans ce film noir<br />
et blanc ? Il survit en buvant du sang. Il se reconstitue grâce au sang<br />
humain. Il pend ses victimes, tête en bas, dans un monde à l’envers, leur<br />
tranche la gorge pour aspirer le plasma 1 . » Le sang est rouge, et bien<br />
que la langue française abonde en mots pour en qualifier les nuances 2 ,<br />
cela reste comme un invariant du règne animal.<br />
L’argument du film est simple. Son temps diégétique coïncide avec les<br />
derniers moments de la vie du lieutenant Shinji Takeyama (interprété<br />
par Yukio Mishima lui-même) et de son épouse Reiko. Déshonoré de<br />
n’avoir pu participer au coup d’état du 26 février 1936 mené par des<br />
officiers à Tôkyô, Takeyama se fait seppuku. Reiko le suit peu après dans<br />
la mort. Il s’agit-là, comme nous l’indique Maurice Pinguet, d’un topos de<br />
la littérature et du théâtre japonais : le shinjû, double suicide amoureux,<br />
que l’on voit par exemple dans les drames domestiques (sewamono)<br />
pour marionnettes de Chikamatsu au début du 18ème siècle 3 . Maurice<br />
Pinguet commente : « tout au cours de l’époque Edo, les principes de<br />
subordination et d’autorité formulés par le confucianisme officiel ne<br />
dominèrent pas moins la vie familiale que la vie publique : le même<br />
était censé régner dans la maison et dans l’État.<br />
La politique de la famille, traversée de conflits et de crises, eut aussi<br />
ses vainqueurs et ses vaincus, ses rebelles et ses victimes. Dans tous<br />
ces menus jeux de pouvoir, la mort volontaire offrait la tentation d’une<br />
solution dernière, admise par les mœurs et présente aux esprits. L’amour<br />
partagé en était souvent la motivation décisive : la mort à deux semble<br />
deux fois moins difficile, la solitude fatale au suicide est conjurée. Le<br />
cœur accablé par l’adversité parachève en mourant l’amour dont il vécut<br />
: il s’y sacrifie, libre enfin sinon de vivre, au moins d’aimer. Comment<br />
davantage aimer qu’en mourant d’amour. »
Yûkoku (« patriotisme » en japonais), c’est déjà du signe, de l’écrit, du<br />
langage naturel mis en effet, puisque le film s’inspire d’une nouvelle<br />
du même nom écrite par Mishima. Roland Barthes, sur le cinéma, a dit<br />
l’impossibilité de le considérer comme un langage, et l’inféodation du<br />
signe filmique à la médiation du mot, du langage dit naturel : « ce signe<br />
visuel rencontre fatalement un signe verbal (intérieur): il y a un « droit<br />
de reprise » du langage sur le signe filmique 4 .» Barthes parle d’un «<br />
logomorphisme » du cinéma au détriment que d’un véritable langage : «<br />
disons que le cinéma est un logos, ce n’est pas un langage 5 . » Si Yûkoku<br />
n’est pas structurellement « langagier », on y trouve, à l’image, de multiples<br />
occurrences du caractère écrit, de l’idéogramme kanji. Dans le livre<br />
qu’il a consacré au Japon, Roland Barthes nous parle dans le menu détail<br />
de sa quotidienneté d’un « Autre signitif » qui nous renvoie comme un<br />
miroir à nos propres zones d’opacité :<br />
« Ce qui peut être visé, dans la considération de l’Orient, ce ne sont pas<br />
d’autres symboles, une autre métaphysique, une autre sagesse (encore<br />
que celle-ci apparaisse bien désirable) ; c’est la possibilité d’une différence,<br />
d’une mutation, d’une révolution dans la propriété des systèmes<br />
symboliques. Il faudrait un jour faire l’histoire de notre propre obscurité,<br />
manifester la compacité de notre narcissisme, recenser le long des<br />
siècles les quelques appels de différence que nous avons pu parfois<br />
entendre, les récupérations idéologiques qui ont immanquablement<br />
suivi et qui consistent à toujours acclimater notre inconnaissance de<br />
l’Asie grâce à des langages connus (l’Orient de Voltaire, de la Revue<br />
asiatique, de Loti ou d’Air France). Aujourd’hui il y a sans doute mille<br />
choses à apprendre de l’Orient : un énorme travail de connaissance<br />
est, sera nécessaire (son retard ne peut être que le résultat d’une occultation<br />
idéologique) ; mais il faut aussi que, acceptant de laisser de<br />
part et d’autre d’immense zones d’ombre (le Japon capitaliste, l’acculturation<br />
américaine, le développement technique), un mince filet<br />
de lumière cherche, non d’autres symboles, mais la fissure même du<br />
symbolique 6 . »<br />
Il ne faudra pas chercher dans Yûkoku cette « vérité » du Japon que le<br />
sémiologue français appelle de ses vœux ; Yûkoku renvoie au Japon<br />
fantasmatique de Mishima : c’est le Japon et ses valeurs héritées de l’ère<br />
médiévale, d’avant la modernisation exponentielle de l’ère Meiji.<br />
Dès le générique il est question d’écriture et de signes : une main gantée<br />
ouvre et fait défiler de bas en haut les premiers éléments de narration, à<br />
la manière du carton dans le cinéma muet. Et dès les premières images,<br />
nous voyons Reiko, sur la scène de théâtre nô sur laquelle se déroule le<br />
film, tracer au pinceau des signes d’encre noir sur la blancheur — qui<br />
consonne avec la pâleur de Reiko et le blanc de son kimono — de papier<br />
de riz, tandis que la hantent en surimpressions des images de Shinji. Au<br />
fond de la scène, une sorte de natte accrochée au mur où sont tracés<br />
des caractères kanji, « sishei », signifiant « sincérité » ou « dévotion 7 ».<br />
Pendant le rituel d’amour qui précède le rituel de mort (et avant lequel<br />
les amants trace des idéogrammes sur du papier : mot d’adieu ? Pacte ?),<br />
ces caractères surdimensionnés sont omniprésent à l’image, et leur polysémie<br />
joue à plein : c’est par « sincérité », pour se montrer la sincérité<br />
de leur amour que Reiko et Shinji font une dernière fois l’amour ; c’est<br />
par « dévotion » au code d’honneur samouraï que le rituel de mort va<br />
s’accomplir. Vue de loin, l’image photographique en noir et blanc est<br />
peut-être, comme on l’a dit, « moyenne 8 » ou encore « précaire 9 » ;<br />
mais elle est précieuse dans le plus fin détail de sa matière : ce sont des<br />
sels d’argent qui sensibilisent le film à la lumière, qui en composent<br />
le grain quasi microscopique : en cela la photographie participe, au<br />
niveau de sa poïésis, de l’alchimie.<br />
Et cela s’exprime pleinement dans Yûkoku : dans la scène d’amour,<br />
le subtil noir et blanc restitue de manière pourrait-on dire hyperréaliste<br />
le détail le plus infime des carnations — peau mate, poils d’une<br />
barbe de trois jours, pores, points noirs de Shinji ; peau plus claire et<br />
lisse de Reiko. Il rend vivant le tact, la caresse, le contact des peaux<br />
sensibilisées par l’amour, érotisées. Mais toujours ce « sishei » : à un<br />
moment précis un habile artifice de montage et de technique cinématographique<br />
nous montre comment le « sishei » revient incessamment<br />
rappeler Shinji à son devoir : en bas de l’écran le ventre net de Reïko,<br />
brusquement un changement de la focale fait apparaître le « sishei »,<br />
puis insert en contrechamp sur le regard de Shinji…<br />
Puis vient le moment d’accomplir le rituel de mort. Shinji revêt son<br />
uniforme, s’agenouille, dénude son abdomen, teste le tranchant de la<br />
lame du sabre sur le haut de sa cuisse, puis s’éventre : le sang perle,<br />
puis s’écoule, puis s’épanche, laissant sur le sol une tache qui très vite<br />
devient flaque. À ce moment du film se joue une véritable poétique<br />
des fluides : gouttes de sang giclant sur le kimono de Reiko, larme<br />
dans ses yeux, sueur perlant sur le visage de Shinji agonisant. Le sang<br />
versé, quand bien même il se repend sans autre règle que celle du<br />
chaos, il ne l’est pas en pure perte : il répond à un impératif écrit,<br />
consigné. C’est précisément là que s’établit dans Yûkoku la jonction<br />
de l’encre et du sang, du signe prescripteur et de la tache qui vaut<br />
comme sceau d’obéissance — je saigne, je signe, comme Taro, Jiro et<br />
Saburo apposant la tache du sang de leurs pouces coupés au fil du<br />
sabre le partage du fief du patriarche Hidetora dans Ran (1985) d’Akira<br />
Kurosawa. On pense à Bataille, à l’indissociabilité de l’amour et de la<br />
mort, à Éros et Thanatos.<br />
Mais ici s’arrête la comparaison avec Bataille. Le verdict de son brillant<br />
biographe Michel Surya est sans appel : « l’érotique bataillienne est<br />
noire, elle est malheureuse, elle est maudite 10 . » La mort de Shinji et<br />
Reïko est une mort heureuse, comme l’est leur amour : le rouleau du<br />
générique réapparaît pour dire : « leurs sourires involontaires reflétèrent<br />
une infinie confiance mutuelle. La mort n’est plus terrifiante. Reiko<br />
éprouve les mêmes sentiments que la nuit de ses noces… » Le corps<br />
sexué de Shinji-Mishima est celui d’un samouraï, fort, solaire, dionysiaque<br />
— l’homoérotisme n’est pas loin. Et pourtant : en lui peuvent<br />
cohabiter, même se compénétrer le bonheur comme force vitale et<br />
la mort, l’appel autoritaire de l’autolyse. N’acceptant aucune autorité<br />
extérieure à l’éthique samouraï, le guerrier se soumet sans frayeur à<br />
l’ultime sanction, au suicide, à la mort quand le code guerrier l’impose.<br />
Et bien sûr, c’est la préfiguration du suicide de Mishima, dont les circonstances<br />
sont remarquablement décrites par Maurice Pinguet 11 ,<br />
qu’il faut voir dans Yûkoku. Conspué, mis au pilon par un Japon meurtri<br />
(et miraculeusement retrouvé en 2005), reniant violemment les valeurs<br />
du bushido dispensatrices de malheur, Yûkoku témoigne de l’attirance<br />
trouble de Mishima pour l’éthique samouraï, qui se manifeste également<br />
dans son commentaire du Hagakuré, le guide pratique et spiri-<br />
9
tuel du guerrier, consignation de la parole de Jocho Yamamoto par le<br />
jeune scribe Mitsushige Nabeshima au début du 18ème siècle.<br />
Mishima écrit : « peu de livres apportent autant que le Hagakuré<br />
des fondements éthiques à l’épanouissement de la fierté individuelle.<br />
Impossible, en effet, de valoriser l’énergie si l’on condamne la fierté. Et<br />
dans cette direction, on ne saurait aller trop loin. L’arrogance elle-même<br />
revêt un caractère moral (mais dans le Hagakuré il ne s’agit pas d’une<br />
arrogance abstraite). « Le samouraï doit avoir la certitude d’être le guerrier<br />
le plus expert et le plus brave du Japon tout entier. » « Le samouraï<br />
doit tirer un grand orgueil de sa valeur militaire ; sa résolution suprême<br />
doit être de mourir en fanatique. » Et le fanatisme ignore absolument le<br />
sens de la correction ou de la bienséance 12 . » On pense à l’Übermensch<br />
nietzschéen. Philosophie de la vie et de l’action, le Hagakuré est aussi<br />
philosophie de l’amour, dont Mishima dit qu’ « au Japon, il n’est guère<br />
exagéré de dire qu’il n’existe rien qui ressemble à l’amour de la patrie.<br />
Rien non plus qui puisse s’appeler amour pour une femme. La mentalité<br />
japonaise élémentaire confond éros et agapè. L’amour pour une femme<br />
ou pour un jeune homme, s’il est pur et chaste, ne diffère en rien de<br />
la loyauté et du dévouement dus au seigneur 13 . » Il semble que dans<br />
Yûkoku enfreignent ce principe de loyauté pour vivre, pour la première<br />
et la dernière fois, l’amour véritable.<br />
À Alexandre Blin.<br />
1 Laurent Gervereau, Histoire du visuel au 20ème siècle, Paris, Éditions<br />
du Seuil, 2003, p. 331.<br />
2 Voir Annie <strong>Mo</strong>llard-Desfour, Le rouge : dictionnaire de la couleur,<br />
mots et expressions d’aujourd’hui, 20ème et 21ème siècles, Paris, CNRS,<br />
2009.<br />
3 Voir Robert Pinguet, La mort volontaire au Japon, Paris, Gaillimard,<br />
1984, chap. X, « Aimer et mourir », pp. 173-211.<br />
4 Roland Barthes, «Les "unités traumatiques" au cinéma. Principes de<br />
recherche», in Œuvres complètes, tome I, Paris, Seuil 1993, p 877.<br />
5 Ibid.<br />
6 Roland Barthes, L’empire de signes, Genève, Paris, Skira, Flammarion,<br />
coll. « Les sentiers de la création », 1970, pp. 7-8.<br />
7 Je remercie Étienne Boisnier pour son aide à la traduction.<br />
8 Pierre Bourdieu, Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la<br />
photographie, Paris, Éditions de Minuit, 1965.<br />
9 Jean-Marie Schaeffer, L’image précaire. Du dispositif photographi-<br />
que, Paris, Éditions du Seuil, 1987.<br />
10 Michel surya, Georges Bataille. La mort à l’œuvre, Paris, Éditions<br />
Garamont, Librairie Séguier, 1987, p. 432.<br />
11 Maurice Pinguet, op. cit., chap. XIV, « L’acte Mishima », pp. 293-<br />
316.<br />
12 Yukio Mishima, Le Japon moderne et l’éthique samouraï. La voie du<br />
Hagakuré, traduction de l’anglais d’Émile Jean, Paris, Gallimard, 1985,<br />
p. 47.<br />
13<br />
Ibid., p. 45.
© TOHO Corp., courtesy Éditions <strong>Mo</strong>ntparnasse<br />
11
« CHERRY,<br />
JE T’AIME »<br />
par Cindy Daguenet<br />
Le 20ème siècle a vu la formation d’une pensée de la répétition dans des<br />
domaines comme l’esthétique et la psychanalyse. La créatrice, pour le philosophe<br />
Heidegger, est la répétition du retour aux origines pour puiser aux<br />
racines, les sources même de la fécondité. Comme s’il fallait sans cesse se<br />
reconquérir, se rappeler à soi-même, construire, déconstruire, se répéter,<br />
revenir, toujours à son origine perdue.<br />
S’il y a une origine perdue chez Jacques Halbert, c’est celle de l’irruption<br />
incongrue et presque autant mystérieuse de la cerise dans son œuvre. Il a<br />
seulement 19 ans, fréquente la section peinture des Beaux-arts de Bourges<br />
où il y rencontre l’artiste Daniel Dezeuze, qui y est enseignant. Fin 1974, un<br />
architecte lui propose de réaliser une peinture sur une palissade de plus de<br />
soixante dix mètres de long dans l’espace public. Jacques Halbert décide de<br />
peindre une cerise par planche et en alignement sur fond bleu clair. L’artiste<br />
ne s’explique pas sur ce choix. Qu’importe, les mystères sont autorisés. Cette<br />
première réalisation le presse aussitôt à une deuxième mais sur une grande<br />
toile souple. Le motif est multiplié sur la palissade, il est solitaire sur la toile,<br />
la technique est publicitaire par les aplats de couleur formant les cerises et<br />
le fond bleu. Les premières cerises sont surdimensionnées, elles seront rapidement<br />
peintes à taille réelle. Dès lors, l’artiste engage ce qu’il compare « à<br />
une véritable folie, peindre des cerises partout, tout le temps, et ne penser<br />
qu’à ça », Jacques Halbert, 1978.<br />
Jacques Halbert revendique très rapidement sa peinture comme une réaction<br />
au Groupe Support Surface qui est omniprésent dans l’environnement<br />
artistique des années 70 en France. Sa cerise est un clin d’œil humoristique<br />
à certains artistes de ce groupe, à leur rejet de la personnalité de l’artiste et<br />
à quelques textes publiés dans la revue Peinture/Cahiers Théoriques qu’il<br />
détourne en Cuisine/Cahiers Théoriques. Jacques Halbert dynamite cette<br />
tendance, et quel sacré souffle que de se positionner si adroitement entre<br />
un protocole radical qui passe par la répétition d’un motif figuratif ad vitam<br />
æternam et ce zeste d'humour dont la cerise est à la fois le conducteur<br />
mais aussi le court-circuit des mouvements radicaux des années 70. Car<br />
cette oeuvre ne s'arrête pas seulement au degré zéro de la peinture, à sa<br />
propre matérialité, elle renferme en elle une bonne dose d'illusionnisme,<br />
d'humour et d'ironie la distinguant ainsi du mouvement support/surface<br />
mais aussi des artistes de BMPT. Car la peinture peut sourire même à travers<br />
un protocole radical et elle ne tarde pas longtemps à l'affirmer en formant<br />
en 1975 le mot « fraise ». Et n’oublions pas que Jacques Halbert utilise<br />
un motif purement figuratif contrairement aux artistes de BMPT qui eux<br />
utilisent des signes abstraits. La cerise comme provocation à la fois à la<br />
peinture abstraite mais également à la peinture figurative car l’œuvre de<br />
Jacques Halbert se situe à la frontière de ses deux courants ni tout à fait<br />
abstraite ni tout à fait figurative.<br />
Cette œuvre s’est toujours située entre l’art issu de la culture populaire<br />
et les avant-gardes conceptuelles. Dès l’apparition de la cerise dans son<br />
œuvre, Jacques Halbert entame plusieurs séries d’interventions sur ce<br />
qu’il présente comme sa collection d’images populaires. Cet ensemble<br />
est constitué de boîtes de camembert, de posters chinois de propagande<br />
maoïste, de bons points distribués aux enfants méritants à l’école, de photos<br />
de la vie quotidienne découpées dans des magazines, et des publicités<br />
« <strong>Mo</strong>n Chéri ». Il utilise une partie de cette collection, il choisit, découpe<br />
des petits détails ou des ensembles d’images et intervient sur tout ce qui<br />
ne contient pas de cerise car tout doit devenir cerise. Il en peint sur une<br />
bouche, dans une main, dans une corbeille de fruits, sur un gâteau. La<br />
cerise est toujours peinte à l’échelle de l’image, minuscule, taille réelle, ou<br />
surdimensionnée. Il se contente parfois de ne rien rajouter à l’image si une<br />
cerise est déjà représentée. Jacques Halbert réalise, en même temps, une<br />
autre série constituée d’interventions sur des reproductions de peintures<br />
de musée, format pleine page, qu’il découpe dans des revues depuis son<br />
enfance. Il peint simplement mais grandement sur une partie de l’image<br />
ce qui est devenu son empreinte, son outil visuel à l’instar du bâton de son<br />
ami Andre Cadere — une cerise sur un fond bleu. Une manière d’intervenir<br />
sur l’œuvre d’un autre artiste, démarche proche de l'artiste COBRA Asger<br />
John qui réalise dans les années 50 plusieurs séries de "modifications" de<br />
peintures anciennes achetées sur les marchés aux puces.
Mais elle rappelle bien plus encore, la démarche du Capitaine Lonchamps,<br />
artiste belge, peintre "neigiste" qui lui aussi développe depuis 1987 une<br />
oeuvre et une pensée de la répétition à travers un motif "le flocon de neige"<br />
qu'il projette sur des fonds noirs, tels que de couvertures, des pneus neiges,<br />
des bidons de mazout et également sur des photos et des peintures trouvées<br />
ici et là. Il s'agit pour ces artistes de réinterpréter, rafraîchir, réveiller<br />
la peinture avec humour et ironie grâce à des hommages revivifiants. En<br />
1980, Jacques Halbert intervient directement sur une peinture en collant un<br />
sticker cerise sur une oeuvre de Francis Picabia exposée au Grand Palais.<br />
Il faudra plusieurs jours avant que quelqu’un s’en aperçoive et l’enlève. En<br />
1975, Jacques Halbert débute des petits formats à la manière des grands<br />
peintres, Picasso, Calder, Pollock, Léger, Kandinsky, Soutine, et bien d’autres.<br />
Il reproduit à l’identique la manière de peindre de ces artistes tant observés<br />
et admirés mais il ajoute la cerise, sa cerise comme figure centrale ou<br />
anecdotique. Et pourquoi Jacques Halbert devrait choisir entre la culture<br />
populaire et la grande peinture de musée ? Cette position constitue une<br />
singularité, une anomalie de l’histoire de l’art, oui, mais bien belle. Dès l’apparition<br />
des premières cerises, Jacques Halbert s’autorise un entre deux, et<br />
choisit d’être dans son époque, celle des années 70 où les deux chefs de file<br />
sont pour lui Joseph Beuys et Andy Warhol, entre l’art conceptuel et l’art issu<br />
de la culture populaire, dans cet intervalle entre l’art et la vie.<br />
Depuis plus de trente cinq ans, l’œuvre de Jacques Halbert se développe<br />
comme un ensemble de recherches illimitées et atemporelles à partir d’un<br />
même motif. À observer de près ou de loin cette œuvre composée de plus<br />
de mille peintures, un constat nous interpelle : la répétition a des nuances<br />
et la différence existe. Ceci n’explique pas cela. Ceci explique la capacité de<br />
résistance de cette œuvre et cela ne suffit pas à expliquer sa réelle force<br />
picturale. Car Jacques Halbert peint sur de multiples supports tels que des<br />
toiles, des toiles libres, du papier, du papier peint, du carton, de la nourriture,<br />
des autocollants (stickers), des murs, des vêtements, selon des rythmes<br />
réguliers ou aléatoires et presque toujours sur une surface monochrome de<br />
préférence bleue. Jacques Halbert n’explique ce choix, cette évidence pour<br />
le bleu comme fond — qui n’est lui pas un mystère — que par le fait que<br />
dans sa collection d’images, les cerises étaient représentées accrochées à<br />
une branche avec le ciel comme arrière-plan, comme fond d’image. Jacques<br />
Halbert peint principalement à l’acrylique et par aplats ce qui consiste à<br />
appliquer des champs colorés et uniformes. Cette technique picturale par<br />
aplats met en avant une réalité chromatique dont le rouge et le bleu sont<br />
les assises fondamentales.<br />
Outre la répétition d'un même motif, en 1975, Jacques Halbert écrit son manifeste<br />
"Comment peindre une cerise" décrivant ainsi toutes les étapes d'un<br />
protocole qui le rapproche ici fondamentalement des artistes de BMPT.<br />
« Comment peindre une cerise » (1975)<br />
Pour mener à bien cette entreprise, il est conseillé d’être habile et patient.<br />
Le travail s’effectue en huit phases et temps de séchage:<br />
1 - Vous dessinez un cercle vaguement ovale que vous remplissez de<br />
carmin<br />
2 – Vous appliquez sur la partie gauche de la cerise une lune de terre de<br />
sienne brûlée<br />
3 – Vous mettez du rouge vermillon sur le bout de votre index droit et<br />
vous l’appliquez sur le milieu de la cerise, un peu à droite<br />
4 – Vous mettez maintenant du rose sur le même doigt, très peu, et vous<br />
le posez au centre de la tâche rouge vermillon<br />
5 – A l’aide d’un pinceau fin, vous appliquez un point blanc sur la tâche<br />
rose<br />
6 – Toujours avec ce pinceau fin, vous mettez un filet de terre d’ombre<br />
brûlée sur l’extrémité gauche de votre cerise<br />
7 – Vous dessinez au pinceau fin chargé de vert émeraude la queue du<br />
fruit<br />
8 – Vous éclaircissez, avec du blanc, votre vert émeraude et vous en mettez<br />
un filet sur la queue.<br />
Si vous avez suivi à la lettre ces conseils, vous avez sous les yeux une cerise<br />
peinte par vous. Vous êtes donc un artiste. »<br />
Mais n’oublions pas qu’à la grande différence de BMPT, Jacques Halbert<br />
répète un motif purement figuratif. La technique par aplats décrite plus<br />
haut dans le manifeste « Comment peindre une cerise » permet à cette<br />
œuvre de rentrer dans une véritable démarche d’abstraction, processus<br />
qui délie la cerise en un véritable cercle chromatique. Une ombre portée<br />
à gauche est additionnée au motif, ce qui lui donne du volume dans la<br />
surface de la toile sans toutefois le détacher du fond car il n’y a ni perspective,<br />
ni lignes de fuite, le motif étant peint et répété à son échelle réelle.<br />
La surface monochrome permet à Jacques Halbert de rentrer dans une<br />
spatialité infinie et donner une dimension all-over grâce au motif parsemé<br />
sur l'ensemble de la toile. Cet effet all over est renforcé par le contraste<br />
entre le rouge et le bleu, il nous confronte à un phénomène physique<br />
nommé la persistance rétinienne. Cette rémanence consiste à mettre en<br />
activité une image dominée par des couleurs primaires même après la<br />
disparition de celle-ci dans notre champ de vision.<br />
Jacques Halbert réalise en 1979, une série de peintures sur papier où<br />
les cerises sont peintes de la même couleur que le fond - c’est à dire :<br />
« Cerises bleues sur fond bleu », « Cerises blanches sur fond blanc »,<br />
« Cerises vertes sur fond vert », « Cerises rouges sur fond rouge », et<br />
« Cerises jaunes sur fond jaune ». Et sur toiles, les cerises sont de temps à<br />
autres, vertes, jaunes, rouges sur un fond bleu intense. Autant dire qu’en<br />
présence des trois couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu, le cercle<br />
chromatique d’un point de vu physique est brillamment interrogé et mis<br />
en évidence pour en saisir tous ses accords ou ses désaccords. « Les dites<br />
figures nous apprennent plus sur la peinture que n’importe quel traité ne<br />
le ferait », Pierre Giquel, 2003. Les cerises sont peintes suivant plusieurs<br />
compositions, de manière aléatoire, en alignement régulier ou en suite,<br />
formant une ligne droite, ou bien encore une ou des courbes.<br />
A la fin des années 70, Jacques Halbert part vivre aux Etats-Unis, à New<br />
York. Il faut attendre plus de vingt ans pour qu’il rentre en France, en<br />
Touraine, sa région natale. Son retour en 2003 est annoncé par l’artiste<br />
comme « le retour du merle moqueur » vers ses origines, cette origine perdue<br />
dont parle Heidegger. En 2006, le Centre de Création Contemporaine<br />
de Tours présente la première rétrospective « cerisiste » de l’artiste. Outre<br />
une vingtaine d’œuvres de toutes périodes exposées, le peintre réalise<br />
pour cette exposition de nouvelles productions aux formats monumentaux<br />
mettant ainsi plus que jamais en évidence les aplats de couleurs,<br />
les variations entre les fonds bleus des toiles et le motif, l’effet all-over,<br />
13
la démarche d’abstraction et les nuances implacables de cette œuvre<br />
fondée sur la répétition d’un même motif. Depuis quelques mois, Jacques<br />
Halbert réalise des installations dans différents lieux, privés ou public, en<br />
interaction avec l'espace environnant, avec l'architecture, et proposant<br />
ainsi au spectateur une expérience physique de son œuvre.<br />
La cerise n’a pas seulement mené Jacques Halbert vers une démarche<br />
picturale mais également vers un art d’attitude qui lui permet de réaliser<br />
de nombreuses performances. En 1976, il transforme un triporteur de<br />
boulanger en « Galerie Cerise ». Il peint sur l’ensemble de la structure<br />
des cerises sur un fond bleu nuit. Des petites toiles sont accrochées sur<br />
la structure haute et des tartelettes aux cerises sont présentées sur la surface<br />
plane de cette galerie nomade. Habillé en chef pâtissier, coiffé d’une<br />
toque blanche, et désireux d’aller à la rencontre des gens et du milieu<br />
de l’art, Jacques Halbert circule avec son triporteur dans les vernissages<br />
parisiens, les foires de l’art, et dans la rue. Il pratique un art d’attitude et<br />
fréquente rapidement des artistes liés à Fluxus comme Jean Dupuy, Ben<br />
Vautier, mais surtout, Jacques Halbert trouve sa famille artistique au sein<br />
du mouvement Eat Art, courant artistique qui sous l'impulsion de Daniel<br />
Spoerri dès les années 60 met à l'honneur le repas, la nourriture, l'aliment<br />
au cœur de la création artistique.<br />
Jacques Halbert réalise de nombreuses performances en France et aux<br />
Etats-Unis. Il participe en 1978, à l'incroyable performance collective<br />
« Art performance/minutes » organisé par Jean Dupuy au Musée du<br />
Louvre, et qui réunit une quarantaine d'artistes dont Jacques <strong>Mo</strong>nory,<br />
ORLAN, Martine Aballéa, Charles Dreyfus, UNTEL, Olga Adorno. Habillé<br />
en chef pâtissier, Jacques Halbert s'installe devant les « Noces de Cana »<br />
de Véronèse et lit avec délectation un menu "cerisiste". La performance<br />
collective s’arrête brutalement lorsque trois étudiants lâchent un produit<br />
très fumigène dans la galerie de la Reine Médicis. Les artistes et le public<br />
sont expulsés du Louvre. Il participe également en 1980 à « Une idée en<br />
l’air » à New York et au « Festival Eat-Art » organisé par Daniel Spoerri<br />
à Chalon-sur-Saône. A cette occasion, Jacques Halbert réalise plusieurs<br />
performances devant une tablée de cent convives et en garde encore<br />
aujourd’hui un souvenir partagé.<br />
« Le public attendait de moi un Jacques Halbert jovial qui offrait des<br />
tartelettes. Et là, je suis arrivé avec des musiciens qui jouaient du rock. Je<br />
chantais des recettes en les exécutants. J’étripais un canard, pendant que<br />
les gens mangeaient du canard aux griottes, et j’exécutais la recette du<br />
canard aux griottes en la chantant sur du mauvais rock. Ainsi, j’étripais<br />
le canard, je le préparais et le mettait au four, c’était une folie car je me<br />
suis rendu compte que c’était le troisième âge qui était là. On m’a jeté des<br />
croutons de pain et des os de canard dans la figure. A la fin je faisais une<br />
performance qui s’appelait "le Pâtissier Pâtissé" où je me faisais recouvrir<br />
de vingt cinq litres de crème chantilly, de crème chocolat. J’avais réalisé<br />
cette performance à New York quelques mois auparavant pour "Une idée<br />
en l’air". Les gens venaient me manger à l’aide de boudoirs. Et là à Chalon<br />
sur Saône, un type s’est levé et m’a renversé la gamelle sur la tête. »<br />
Entretien entre Ben et Jacques Halbert, sept. 1980.<br />
En juillet dernier, et à l’invitation de l’Abbaye de Fontevraud, l’artiste réalise<br />
un diner performance, pour 150 convives, tous invités à partager un<br />
repas aux couleurs de ses peintures, rouge et bleue. Ponctué tout le long par<br />
des performances, Jacques Halbert a réitéré sa performance « Le Pâtissier<br />
Pâtissé ». «Comment partager ces exclamations sans apercevoir l’ombre qui<br />
les parcourt, l’ombre folle, tragique et nerveuse, sous la farine et la chantilly,<br />
quand le pitre fait l’ange, comment ne pas apercevoir, dans les saluts amicaux,<br />
les mains qui allument les chairs, le rire, le rare, le seul qui n’est jamais<br />
repu, qui tranche, rebelle » 1 .<br />
Depuis 1974, Jacques Halbert interroge, entre radicalité et jeu, son œuvre<br />
« cerisiste ». Il reste en constant flux et passe avec brio de la peinture à la<br />
performance, de Paris à New York, des cerises aux « patates à fumer ». Car<br />
Jacques Halbert s’autorise quelques souffles heureux en conduisant à certains<br />
moments sa peinture vers d’autres sujets tout aussi culinaires, tels que les<br />
« patates à fumer » en 1985, les « Petits pois » en 2003, et les « Peintures gratinées<br />
» en 2004. La liberté de Jacques Halbert est bien grande et il le prouve<br />
à nouveau en ouvrant et dirigeant un lieu emblématique, « The Art Cafe »<br />
dans l’East Village new-yorkais de 1984 à 1989. Il y organise avec Alan Jones,<br />
Pierre Restany et Ken Friedmann un grand nombre d’expositions où sont invités<br />
Olga Adorno, Olivier <strong>Mo</strong>sset, Jeff Koons, Andy Warhol, François <strong>Mo</strong>rellet,<br />
Jean Dupuy, John Armleder, Ken Friedmann, Charles Dreyfus, Dorothea Selz,<br />
Daniel Spoerri, et Christian Xatrec. Une manière de vivre, et de toujours réunir<br />
l’art et la vie pour ne jamais s'ennuyer à l’intérieur du temple artistique.<br />
L’œuvre de Jacques Halbert se situe singulièrement entre la culture populaire<br />
et les avant gardes conceptuelles qui ont depuis les années 70 profondément<br />
redéfini le paysage artistique. Elle rappelle certains mouvements<br />
radicaux qui ont repoussé la peinture dans ses limites les plus extrêmes<br />
mais à la différence de ceux ci elle passe par un motif purement figuratif qui<br />
véhicule sa touche d’humour. De même cette œuvre se fait l’expression d’une<br />
posture visant à relier l’art et la vie, attitude qui permet à Jacques Halbert<br />
d'être accepté par les artistes Fluxus, lui l’artiste peintre attaché à la grande<br />
histoire de la peinture. Et même si certains reprochent à l’artiste d’avoir fait<br />
trop de blagues avec son œuvre, il faut nous réjouir de cet esprit de liberté,<br />
de cette personnalité aussi fraîche que légendaire, de cette capacité de résistance,<br />
et de la qualité picturale réelle de cette œuvre qui nous fait traverser<br />
une partie de notre histoire contemporaine de l'art sans imposture.<br />
1<br />
Pierre Giquel ya bon 2003
De haut en bas, de gauche à droite :<br />
Palissade, (fragment), 1975, acrylique sur bois<br />
I love banana, 2007, photographie Sandra Daveau<br />
Portrait de ma mère mangeant des cerises à la manière de Warhol, 1975, acrylique sur toile<br />
Livres, 2000, acrylique sur livres et bois<br />
Première performance de Jacques Halbert, 1975, École des Beaux Arts de Bourges<br />
15
DOSSIERS :<br />
Bosnie-Herzégovine<br />
17
Alors, la Bosnie Herzégovine ?<br />
par Aline Cateux<br />
Lorsque l’Europe regarde la Bosnie Herzégovine, elle ne voit le plus souvent qu’un pays réduit à sa division, à ses<br />
nationalismes et considère ses habitants comme un ramassis d’assistés apathiques vivant dans la nostalgie d’une unité<br />
et d’une fraternité pulvérisées dans les guerres qui ont ravagé la Yougoslavie entre 1991 et 1995. Territoire divisé en<br />
deux entités dirigées aujourd’hui par les guerriers d’hier, cette petite république ne se bat plus pour son intégrité mais<br />
pour préserver une division qui fait le beurre des nationalistes.<br />
La population, maintenue depuis 15 ans dans une ségrégation vicieuse, tente tant bien que mal de garder la tête<br />
froide, et est d’ailleurs de toute façon entièrement mobilisée par sa survie quotidienne.<br />
La presse, le plus souvent ouvertement au service des partis politiques au pouvoir, ne fait que ressasser les atrocités<br />
de la guerre, recompte indéfiniment le nombre de « ses » victimes selon qu’elle soit de Sarajevo ou de Banja Luka<br />
(capitale de l’entité serbe) et maintient le débat public au niveau navrant des identités nationales, empêchant tout<br />
débat sur une potentielle citoyenneté.<br />
Les institutions culturelles sont quant à elles pour la plupart moribondes, et souvent au service d’une culture communautaire<br />
ou/et nationaliste. Les initiatives culturelles indépendantes sont associatives, et l’on peut dire qu’elle sont les<br />
seules garanties de la promotion d’une culture indépendante dotée d’une exigence de qualité.<br />
Au milieu de ce désert culturel parsemé d’oasis incertains, la jeune génération d’artistes plasticiens ou vidéastes<br />
contemporains fait figure d’OVNI. En effet, cette génération qui a grandi pendant la guerre n’a aucun complexe quant<br />
à une attitude critique de la société bosnienne actuelle, des responsabilités du conflit reposant sur les épaules de la<br />
génération de leurs parents, dénoncent sans provocation mais sans hésitation les nationalismes, les communautarismes,<br />
le patriarcat.<br />
Le pays est certes doté de quatre écoles des Beaux-arts mais l’académisme de l’enseignement dispensé par des<br />
professeurs-fossiles, fermés à la moindre notion d’innovation et rongés par un puritanisme moral rétrograde (qui a,<br />
par exemple, banni les cours de nus des écoles), règne.<br />
On doit l’éclosion d’une scène contemporaine au Soros Center for Contemporary Art, fondé en 1996 à Sarajevo, et dont<br />
la direction est assurée par Dunja Blažević, historienne et critique d’art reconnue en Europe depuis la fin années 1970.<br />
Rédactrice en chef des programmes culturels de la télévision nationale yougoslave, son émission culte « télé galerija »<br />
a été le premier instrument de diffusion massif de l’art conceptuel en Yougoslavie. Le SCCA, tout d’abord émanation<br />
de l’Open Found Society de Soros, a organisé sa première exposition en 1997, intitulée « meeting Point » dans la<br />
vieille ville de Sarajevo dévastée. On retrouve dans cette intervention la volonté inaltérable d’occuper l’espace public
(le SCCA ne s’est d’ailleurs jamais doté d’une galerie et se veut un centre d’art contemporain mobile). L’espace public<br />
comme préoccupation constante se retrouve dans ce qui est un des projets phares du SCCA, le projet « Construction/<br />
Déconstruction de monuments » qui répertorie tous les monuments antifascistes dans l’espace bosniens dont l’immense<br />
majorité a été une cible privilégiée dans les prémices du conflit (symbole de l’unité yougoslave et à la mémoire<br />
des partisans libérateurs de l’ennemi fasciste), détruite dès le début du dernier conflit.<br />
Mais ce programme visait également à construire de nouveaux monuments comme le <strong>Mo</strong>nument à la communauté<br />
internationale de Nebojša Šoba (Ikar : une boite de conserve tombée du ciel et qui écrase de son poids la liste des<br />
victimes du siège de Sarajevo) ou encore installer la statue de Bruce Lee (idole des yougoslaves dans les années<br />
1970 et 1980) dans le parc de Zrinjevac à <strong>Mo</strong>star, en lisière de territoire servant d’interface communautaire et qui n’a<br />
pas tenu vingt-quatre heures. La division de <strong>Mo</strong>star suivant une ligne est-ouest, Bruce Lee en position de combat a<br />
été orienté au nord pour ne froisser personne. L’observation des dégradations du nouveau monument faisait bien<br />
évidemment également partie du projet.<br />
Le SCCA a aussi accompagné nombres d’artistes dans le développement de leurs travaux et de leur carrière au rang<br />
desquels on peut citer pour les plus connus Šoba, Maja Bajević, Danica Dakić, Šejla Kamerić, Gordana Anđelić-Galić.<br />
Devenu Sarajevo Center for Contemporary Art après le désengagement de la fondation Soros , le SCCA créé le Prix<br />
National ZVONO qui récompense chaque année un jeune artiste visuel de Bosnie Herzégovine. ZVONO est une des rares<br />
initiatives basée sur la qualité des travaux des artistes et non sur leur identité ou appartenance communautaire.<br />
Le SCCA a été l’artisan du rapprochement entre certaines structures culturelles des deux entités qui, jusque-là<br />
s’ignoraient consciencieusement. ZVONO a surtout permis aux jeunes artistes des deux entités de se rencontrer, de<br />
confronter leurs travaux, leurs pratiques puis de mutualiser leur critique de la société bosnienne d’après guerre. Ainsi,<br />
l’exposition des trois finalistes a lieu au Musée d’art contemporain de la République Serbe à Banja Luka et l’exposition<br />
du ou de la finaliste a lieu à Sarajevo.<br />
Après la création du SCCA, c’est par la naissance de la Galerie 10m2 (dix mètres-carrés) puis en 2009 du Centre d’art et<br />
de recherche le Duplex que l’obscurantisme de la majorité des institutions culturelles du pays a été contrarié. Dirigée<br />
par deux français, Claire Dupont et Pierre Courtin, la galerie 10m2 est devenu un lieu incontournable d’expression et<br />
d’exposition pour les jeunes artistes tout d’abord de Sarajevo puis du reste du pays.<br />
10m2 et le Duplex accueillant également des artistes du reste du monde, ces deux endroits ont permis ateliers, lectures,<br />
discussions et échanges. On peut citer la complicité entre le Duplex et le centre d’art contemporain grenoblois OUI<br />
dirigé par Stéphane Sauzedde dont les artistes viennent exposer à Sarajevo depuis 2008. Une autre complicité fertile lie<br />
le Duplex et 10m2 avec le Kük Galerie de Cologne qui expose en priorité des artistes issu de l’espace ex-yougoslave.<br />
La dynamique créée par le SCCA et ZVONO relayée par 10m2 et le Duplex, la naissance d’associations et de collectifs<br />
d’artistes à la périphérie des écoles d’art ont permis peu à peu la cohésion d’une scène, puis l’éducation d’un public<br />
encore apeuré à l’idée d’une critique sociale très abrupte bien que souvent subtile dans sa forme.<br />
De plus, la censure et la répression insidieuses des médias ont empêché le public de développer tout sens critique<br />
à l’égard du passé proche du pays, et a également enrayé la diffusion d’une critique et d’une remise en question du<br />
conflit, de la division du pays et du nationalisme. Parmi ces collectifs on retient notamment ABART à <strong>Mo</strong>star qui a<br />
travaillé tout d’abord en 2008 à l’articulation d’un projet entre Beyrouth, Berlin et <strong>Mo</strong>star sur la l’accès à la culture<br />
en territoire divisé puis s’est attelé avec succès cette année au projet (re)collecting <strong>Mo</strong>star qui réfléchit à la mise en<br />
place d’une stratégie artistique visant à développer ce qu’on pourrait appeler une syntaxe commune entre les communautés<br />
divisées.<br />
Si les institutions dédaignent autant l’art contemporain c’est qu’elles ont bien compris l’importance et la virulence de<br />
la critique charriée par cette jeune scène qui a grandi pendant la guerre puis dans une période de reconstruction…<br />
19
Entretien avec Sanjin Cosabic<br />
par Frédéric Herbin<br />
Quand je t’ai contacté pour cet entretien, tu m’as dit que tu démarrais une<br />
nouvelle série. De quoi s’agit-il ?<br />
Ce n’est pas simplement une nouvelle série, c’est une nouvelle période. La<br />
notion d’une suite logique par rapport aux années passées s’efface devant<br />
une fracture, du fait que, pendant trois ans, j’ai quasiment « raccroché les<br />
pinceaux ». Parce qu’en tant qu’artiste, c’est assez plaisant et malicieux de<br />
ne pas voir de différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Par<br />
contre, en tant que citoyen, à l’époque dans laquelle on vit, le début du<br />
XXIe siècle, je n’en pouvais plus de ne pas savoir ce qui est vrai et ce qui<br />
est faux. Ce qui fait que je me suis trouvé dans l’impossibilité de peindre.<br />
Je ne pouvais plus continuer la peinture pour elle-même, parce que mon<br />
questionnement de citoyen prédominait largement. Si je n’avais pas été<br />
un peintre fanatique, j’aurais peut-être même arrêté l’art et imaginé une<br />
suite sous forme de travail documentaire. Mais comme je suis un peintre<br />
fanatique, il a bien fallu trouver un moyen de concilier les deux et ce processus-là<br />
a mis trois ans.<br />
Pendant trois années, je n’ai pas pris d’atelier et j’ai travaillé dans mon<br />
bureau. J’ai fait un travail de recherche sur la géopolitique moderne et<br />
contemporaine, ainsi que sur le processus de création de l’argent. J’ai accumulé<br />
du savoir, mais qui relève plus de questionnements que de réponses.<br />
Beaucoup de choses tournent autour de ce qu’est l’argent... Comment<br />
cela fonctionne-t-il et à qui cela appartient-il ? Quelles relations il y a-t-il<br />
avec les événements géopolitiques majeurs, notamment le 11 Septembre ?<br />
Toutes ces choses qui sont extrêmement complexes, c’est comme un arbre.<br />
Ce sont des racines que tu remontes. Dès que tu en attrapes une, il<br />
y en trois autres qui apparaissent. Donc, c’est complètement infini, et il est<br />
quasiment impossible d’envisager une œuvre d’art comme réponse, mais<br />
plutôt comme une somme de questions.<br />
Par conséquent, une chose qui est venue assez naturellement, c’est la<br />
notion de tableau noir. Leur taille est calculée selon le nombre d’or et je<br />
les travaille comme des tableaux d’école ou de laboratoire scientifique. Ça<br />
dit assez clairement qu’il n’est pas question d’apporter des réponses, mais<br />
plutôt de poser des questions.<br />
Je vois que tu utilises aussi régulièrement le motif du labyrinthe. Est-ce que c’est<br />
un motif qui apparaît également avec ta nouvelle période ?<br />
L’idée de labyrinthe était envisagée depuis ma troisième ou quatrième année<br />
aux beaux-arts. Mais je ne pouvais pas me permettre, à l’époque – enfin, je<br />
le pensais –, de faire quelque chose d’aussi radical. Si tu voyais l’ensemble de<br />
mon travail, ce n’était pas cohérent, il manquait les dix années qui sont là !<br />
D’où provient l’idée du labyrinthe ? C’est que souvent, il est utilisé dans un<br />
sens classique, plutôt religieux : c’est-à-dire que tu as une entrée, une sortie<br />
et un centre, ce qui invoque le dogme. Étant donné le processus que j’ai suivi<br />
en tant qu’individu et citoyen, désormais, je m’oppose au dogme.<br />
Donc, j’ai pris le parti de concevoir des labyrinthes qui tiennent en échec le<br />
dogme : il n’y a pas une entrée, une sortie et juste un but. Mes labyrinthes<br />
sont beaucoup plus complexes et plus grands qu’à l’habitude. Je garde la<br />
complexité, voire la perversité de la chose, il y a des impasses, mais il y a des<br />
points de répits. Pour moi, c’est la métaphore absolue de tout, de l’amour,<br />
de la vie, de la connaissance.<br />
Cette volonté de rompre avec une vérité qui serait absolue et atteignable par<br />
un seul chemin, à quoi est-elle liée ? Est-ce que ça a un rapport avec l’importance<br />
de la religion ?<br />
La religion, la politique, l’économie, l’histoire, tout ! Quelle est la façon de<br />
savoir si une chose est vraie ou fausse ? Comment peut-on savoir pour qui<br />
voter ? Qu’est-ce qui se passe en Iran ? Pourquoi on choisit de nous dire telle<br />
chose à tel moment une chose à un moment précis ? Pour quelles raisons ?<br />
Pour moi, tout cela c’est d’une relativité qui fait qu’entre un journal télévisé<br />
et Paris Match il n’y a aucune différence. Les deux vendent les informations<br />
qui leur conviennent...<br />
Pourquoi choisissent-ils de parler de cela et de cette façon-là, et pas d’autre<br />
chose ? Pour moi, l’information n’existe pas.
Tu veux dire qu’il n’y a pas de vérité ?<br />
C’est ça. Par exemple : le 11 septembre. J’ai regardé à peu près tout ce qui<br />
a pu être fait à ce sujet, c’est-à-dire des centaines, voire des milliers de<br />
sources. Je pars du principe que je prendrais au moins dix avis différents<br />
sur une chose et pas seulement ce que nous balancent Paris Match ou<br />
TF1. Je veux, en tant que citoyen, savoir ce qui se passe et, étrangement,<br />
après des années des recherches, ce qui est dit par la majorité des médias,<br />
à mon sens, c’est de la propagande.<br />
Cet esprit critique exacerbé est-il lié à ton histoire personnelle ?<br />
Je n’ai pas encore réfléchi à cela, mais ça ne m’étonnerait pas. Quand<br />
j’étais à l’école, je ne savais même pas ce qu’était une religion, parce<br />
qu’on était dans un cadre laïque : on était des Yougoslaves. Deux ans<br />
avant que la guerre ne débute, on a commencé à me demander qui<br />
j’étais.<br />
En serbo-croate, on dit « hrvat » pour croate. Ça sonnait bien, donc<br />
j’ai dit : « hrvat. » Mais je ne savais pas ce que cela voulait dire et tu<br />
passes, en deux ans, à une chose qu’on t’impose. On te dit que tu es<br />
musulman. Et toi : « Oui, mais c’est quoi ? » Tu ne t’identifies pas à cela.<br />
Pourtant, ils n’ont pas tué les gens pour ce qu’ils avaient fait, mais pour<br />
ce qu’ils étaient. Après l’exil, il y a eu les trois ou quatre premières années<br />
où j’étais dans un processus d’hybridation. Je m’identifiais à ce qu’on<br />
m’avait imposé.<br />
Finalement, tu revendiquais une identité... De Bosniaque musulman, du<br />
fait, aussi, que la guerre continuait.<br />
Il fallait prendre parti ?<br />
Tu peux prendre parti en tant qu’être humain, ce que je fais aujourd’hui.<br />
Je n’ai plus aucun parti pris lié à une quelconque appartenance, héritée<br />
ou subie. Mais il y a eu ce processus pendant les quatre premières<br />
années où je m’identifiais à ça, alors que ce n’est pas du tout moi. Des<br />
choses du genre : « Je ne mange pas de cochon. » Et puis, au bout d’un<br />
certain temps, je me suis dit : « Avant, je mangeais du cochon. » Mais on<br />
t’a tellement dit que tu es musulman... Et puis en arrivant ici, le mec qui<br />
m’a accueilli me forçait à manger du cochon : « Tu n’es pas musulman !<br />
Si tu ne manges pas de cochon, tu ne manges rien. »<br />
Donc, il y a eu des choses comme cela qui m’ont amené à me poser<br />
des questions. « Pas de cochon », qu’est-ce que ça veut dire ? Pourquoi,<br />
tout d’un coup, des individus ont-ils réussi à faire monter le sentiment<br />
patriotique d’une nation ? Pour mettre en œuvre cette stupidité, il n’y<br />
a rien de plus facile ! Tu fais un peu peur, tu fais vivre les gens dans la<br />
misère, et puis voilà. Ils ont donc réussi. Mais moi, qu’est-ce que je fais à<br />
dire que je ne bois pas d’alcool, que je ne mange pas de cochon ?<br />
Alors, tu défais le nœud qui s’est fait et puis tu analyses. Il y a quelques<br />
années, j’ai pondu mon premier autoportrait, qui parle justement de cela<br />
et qui s’appelle Autoportrait au jambon de Bayonne. J’y ai décortiqué de<br />
quoi est composé un bon jambon de Bayonne, de quoi est composée<br />
une boîte de ravioli ; et, en troisième, j’ai mis des fleurs, mais j’ai<br />
marqué : « Ceci n’a rien à voir. » Il suffisait finalement de comparer<br />
ce qu’il y a dans un jambon de Bayonne et ce qu’il y a dans une boîte<br />
de ravioli pour savoir d’où provient, dans l’Islam, le fait de ne pas<br />
manger de cochon.<br />
C’était un conseil scientifique, médical parce qu’il n’y avait pas de<br />
moyen de conservation et que ça contient une graisse qui pourrit<br />
plus vite. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. J’ai comparé ces deux choses-là<br />
et, en haut, j’ai fait une série de photographies avec moi de<br />
face et une fille de dos portant une chemise blanche sur laquelle j’ai<br />
imprimé : « Où sont les ishtihads ? » Les ishtihads sont un des piliers<br />
fondateurs de l’Islam. Ils invitent le culte à une réflexion sur lui-même<br />
et à son avancement à travers le temps, les époques. Si tu bannis<br />
les équivalents des ishtihads de n’importe quel culte religieux, c’est<br />
la nuit noire, c’est du fascisme. Voilà, c’était une grande parenthèse<br />
sur l’islam, alors que ce n’est qu’une des choses, parmi d’autres, que<br />
je décortique.<br />
Dans mes œuvres, je décortique surtout les réseaux de l’argent qui<br />
ont encore plus de poids et de présence que tout le reste, parce que<br />
les événements géopolitiques découlent aussi de comment l’argent<br />
est créé et de comment il fonctionne. C’est la chose qui gère absolument<br />
tout. C’est un dogme qui est bien plus grand que n’importe<br />
quelle religion ou même toutes les religions ensemble, et on n’y<br />
connaît rien. On ne sait pas ce que c’est, comment ça fonctionne.<br />
Que sont ces foutus bouts de papier ? Qui les imprime ? Qui les<br />
possède ? Ça c’est une des causes majeures de la transformation, de<br />
cette hybridation, qu’a connues mon travail entre la longue période<br />
de la peinture pour la peinture et après, le stade du citoyen qui n’en<br />
pouvait plus.<br />
J’en avais marre de dire : « On nous ment, on nous exploite… » Du<br />
coup, je me suis mis à décortiquer le on. La première étape, c’était : le<br />
on est un enculé. Mais après, je n’étais pas satisfait. J’ai voulu savoir ce<br />
que c’est ce on. Qu’est-ce qu’il a dans les tripes ? Comment ça fonctionne<br />
? C’est quoi la machine ? Même mettre des noms : Qui ? Quoi ?<br />
Comment ? La chose la plus difficile, c’était de ne pas tomber dans<br />
une chose un peu réactionnaire en donnant plus de réponses que de<br />
questions. Je pense que j’ai réussi avec la notion de tableau noir, sur<br />
lequel tu écris, tu effaces et tu écris encore : l’étude perpétuelle<br />
Je suppose que cela t’a amené à revenir, également, sur les événements<br />
qui se sont produits en Bosnie ?<br />
Non. Je me sens beaucoup plus concerné par ce qui se passe dans<br />
n’importe quel pays où il y a des problèmes aujourd’hui que par ce<br />
qui s’est passé en Bosnie-Herzégovine de 1991 à 1995. Je n’ai plus ce<br />
sentiment de douleur, de mal-être ou de manque parce que, comme<br />
je te l’ai expliqué, le nœud qui s’était formé où j’ai fini pas m’identifier<br />
à la chose qu’on me forçait à être, je l’ai démêlé.<br />
21
Est-ce pour autant tu as complètement tiré un trait sur cette histoire ?<br />
J’ai complètement tiré un trait là-dessus. Aucun de mes travaux ne mentionne<br />
la guerre, les crimes de guerre ou les souffrances antérieures de la<br />
Bosnie-Herzégovine.<br />
Tu y es retourné en 2008 à l’occasion de l’International Festival Sarajevo.<br />
Comment as-tu vécu ce moment ?<br />
Je représentais les deux, et Bosnie Herzégovine, et France… mais plutôt la<br />
France. Mais cette notion d’appartenance a une entité quelconque, q’uelle<br />
soit d’ordre religieux, ethnique, national, racial ou sexuel, je n’en ai rien à<br />
faire ! J’ai même des autoportraits en complet hybride qui sont en préparation.<br />
Je suis une sorte d’hybride pour lequel les notions de patriotisme, de<br />
nationalité, de couleur de peau, de religion sont complètement obsolètes,<br />
inexistantes.<br />
Mais ce complet détachement par rapports à ces questions n’est pas for-<br />
cément facile à tenir ?<br />
Souvent, quand je discute avec des gens, ils ont du mal à comprendre cela.<br />
Après, quand ils rentrent dans mon travail, ils finissent par le comprendre<br />
parce que je mets tout sur la table. Je n’ai pas peur de parler de quoi que<br />
ce soit. À aucun moment, on ne sentira un parti pris dû au fait que je suis<br />
né quelque part ou que j’ai hérité d’une religion.<br />
Est-ce que ça signifie que tu as effacé de tes œuvres tout ce qui relève<br />
de l’affectif ou du sentimental ? Parce que toutes ces questions d’identités<br />
sont liées à ce type d’affects.<br />
Pas du tout. Il y a beaucoup de sentiments, il y a de l’humour, il y a beaucoup<br />
de colère. Mais tout cela n’est pas motivé par mes origines ou la<br />
guerre. Cette colère est venue ces dernières années, alors que la guerre<br />
en Bosnie est terminée depuis longtemps. Ce ne sont pas les restes de<br />
Bosnie-Herzégovine qui ont motivé ça, c’est ce qui se passe aujourd’hui. Si<br />
je me sens préoccupé par la Bosnie Herzégovine aujourd’hui, c’est en raison<br />
de la gouvernance criminelle des trois partis, musulman, serbe et croate,<br />
qui maintiennent encore la perspective du développement de la structure<br />
sociale exclusivement dans une optique ethnique.<br />
Que tu te sentes, quelque part, citoyen d’un monde globalisé, n’est-ce pas<br />
aussi lié au fait que tu as émigré, tout simplement ?<br />
Étrangement, ça aide, mais en même temps, c’est très dangereux, parce<br />
que les personnes qui sont exilées ou réfugiées, souvent, se rattachent<br />
à la chose la plus facile : l’identité. Ce qui amène aussi le phénomène de<br />
communautarisme.<br />
Est-ce que tu penses que ton trajet, avec ce rejet de toutes ces notions iden-<br />
titaires, est quelque chose qu’on observe chez de nombreux artistes bosniaques<br />
qui ont émigré ?<br />
Quand je vois le travail de Nebojsa Seric-Soba, ces questions restent<br />
présentes quand même. Mais après, chacun a eu un parcours différent.<br />
Soba était dans les rangs de l’armée bosniaque pendant toute la guerre.<br />
Il a vécu les tranchées, ce qui n’est pas mon cas. <strong>Mo</strong>i, j’ai eu beaucoup<br />
de chance, à part quelques petites séquellesJe fais partie de cette couche<br />
de réfugiés qui s’en sont le mieux sorti.<br />
Est-ce que ça veut dire que tenter de faire le portrait-robot de l’artiste<br />
bosniaque émigré est voué à l’échec ?<br />
Oui, c’est impossible. Un an dans un centre de réfugiés à Chalon-sur-<br />
Saône ou un an de tranchée, que ce soit sur le front de Sarajevo, de<br />
Krajina ou de Goražde, ça n’a rien à voir ! Même une journée Soba a<br />
abordé cette question avec un recul très astucieux, assez joli. L’une des<br />
pièces qui a donné raison à l’importance de son œuvre, c’est un diptyque<br />
photographique qui le montre deux fois dans la même position. La<br />
première photographie a été prise dans la tranchée pendant la guerre<br />
avec son arme. La seconde le montre à Venise, au bord de l’eau, avec<br />
des lunettes de soleil. Il parle presque de la différence qu’il pourrait y<br />
avoir entre lui et moi dans cette histoire de comment les gens ont vécu<br />
la guerre. Je ne dis pas que je n’ai pas vécu des choses dures, mais ce<br />
n’est pas comparable avec quelqu’un qui a fait la guerre pendant quatre<br />
ans. Parce que moi, en 1995, j’étais bien habillé et dans une école<br />
d’art. Je ne me sens pas plus bosniaque que ça. La plupart des gens<br />
ne savent même pas si je suis serbe, bosniaque, ou croate, parce que<br />
je n’en parle jamais.<br />
C’est sans doute aussi un réflexe de survie, parce qu’il y a un danger<br />
à continuer à s’identifier à cette histoire, de rester dans cette identité<br />
qu’on t’a forcé à avoir. Ce sont des fascistes qui m’ont forcé à devenir<br />
non pas yougoslave ou bosniaque, mais musulman. Ça ne peut pas<br />
être sain. Dans bien des cas, soit tu t’en détaches complètement, soit,<br />
pour te rassurer du manque de repères en exil, tu t’accroches avec les<br />
pieds et les mains a une identité, quelle qu’elle soit, au risque de devenir<br />
sectaire, voire intégriste.<br />
entretien réalisé en avril 2010.<br />
Sanjin Cosabic est peintre. Il est né le 21 avril 1977 à Banja Luka en<br />
Bosnie-Herzégovine. Il vit et travaille à Tours (37), en France.
Foi et répression intériorisée<br />
À propos du livre de Mesa Selimovic, Le derviche et la mort<br />
par Jérôme Diacre<br />
« Toute une vie d’efforts pour arriver à ces ténèbres humides, à cette cécité totale.* » M. Sélimovic<br />
Mesa Selimovic est un écrivain de Bosnie-Herzégovine né le 26 avril 1910 et mort à Belgrade le 11 juillet 1982.<br />
Il fit ses études à Belgrade et, tout au long de sa carrière d’écrivain et universitaire, il reçut toutes les plus hautes<br />
distinctions littéraires de Yougoslavie. Parmi ses œuvres majeures, il faut compter Le Derviche et la <strong>Mo</strong>rt, écrit de<br />
1962 à 1966, traduit en français par Mauricette Bejic et Simone Meuris en 1977.<br />
C’est le récit un jeune derviche sous le règne autoritaire de l’Empire Ottoman. Face à l’injuste emprisonnement et<br />
exécution de son frère Harun, cet homme de foi, Ahmed Nurudin, malgré son profond respect des règles de la<br />
religion, va basculer dans une rage qui emportera tout. Entouré d’autres religieux, d’un riche commerçant, d’amis…<br />
il va lentement descendre aux enfers. Ce monologue intérieur quasi permanent nous saisit : on souffre avec lui<br />
de son impuissance à agir. Doutant de tout, de son statut de derviche face aux militaires brutaux, de l’impérieuse<br />
nécessité d’agir pour réparer l’injustice, du soutien de ses amis et, au bout du compte de sa foi même, il va entrer<br />
dans une folie où plus aucun repère ne pourront le guider.<br />
Ce roman fleuve est celui d’une tragédie épique. A la manière d’une initiation inversée, celle du mal, Ahmed<br />
Nurudin va se découvrir lui-même à travers ses doutes et ses impuissances jusqu’à la folie et l’oubli de soi dans<br />
la violence irraisonnée. Structuré en XX parties, chacune introduite par une sourate du Coran, le mouvement<br />
général du livre correspond à un lent effondrement jalonné d’espoirs vaincus… D’une violence sourde, le roman<br />
dresse le portrait d’une bonté et d’une sincérité anéantie.<br />
1 – SITUATION (une terre inhabitable)<br />
« L’espace nous accapare. Nous ne possédons de lui que ce que l’oeil peut parcourir. Mais il nous épuise, nous<br />
effraie, nous appelle, nous chasse. Nous nous imaginons qu’il nous voit, mais nous n’avons aucune importance<br />
à ses yeux, nous disons que nous le maîtrisons mais nous ne faisons que profiter de son indifférence. La terre<br />
ne nous est pas propice. La foudre et les vagues ne sont pas pour nous, nous sommes en elles. L’homme n’a<br />
pas sa véritable demeure, il l’arrache à des forces aveugles. C’est un nid étranger, la terre ne pourrait être que<br />
la demeure de monstres capables de supporter les malheurs dont elle est prodigue. Personne d’autre. Ce<br />
n’est pas la terre que nous conquérons, mais un pouce de sol où poser notre pied, ni une montagne, mais une<br />
image visuelle, ni la mer, mais sa mouvante masse et le reflet de sa surface. Nous n’en possédons que l’illusion,<br />
c’est pourquoi nous nous accrochons à elle. Nous sommes d’une autre essence que ce qui nous entoure, sans<br />
aucun lien possible. Le développement de l’homme devrait tendre à ce qu’il perde conscience de lui-même.<br />
La terre est inhabitable, comme la lune, et nous nous leurrons en pensant que c’est là notre vraie demeure, car<br />
nous n’avons pas où aller. Elle est bonne pour les insensés, ou pour les invulnérables. L’issue, pour l’homme,<br />
sera peut-être de retourner en arrière, de redevenir simple énergie.* »
2 – ISOLEMENT (effacement des repères)<br />
« Pourquoi les hommes ne crient-ils pas quand on les conduit à la mort, pourquoi leurs voix se taisent-elles,<br />
n’appellent-elle pas à l’aide ? Pourquoi ne s’enfuient-ils pas ? Personne, c’est vrai, ne les entendrait, les gens dor-<br />
ment ; ils n’ont pas où s’enfuir, toutes les maisons sont solidement fermées. Je ne parle pas pour moi, je ne suis<br />
pas condamné à mort, ils me relâcheront, ils me renverront bientôt, je reviendrai seul, par les chemin connus,<br />
et non par ceux-ci, étrangers, terribles ; jamais plus je n’écouterai les chiens aboyer, aboyer désespérément, à la<br />
mort et au désert, je fermerai la porte, je me boucherai les oreilles de cire, pour ne pas les entendre. Les ont-ils<br />
entendus, tous ceux qui ont été emmenés ? Ces aboiements furent-ils leur dernière escorte ? Pourquoi n’ont-ils<br />
pas crié, pourquoi ne se sont-ils pas enfuis ? Je crierais si je savais ce qui m’attend, je me sauverais. Toutes les<br />
fenêtres s’ouvriraient, toutes les portes et l’on m’accueillerait à bras ouverts.<br />
Hélas ! non, pas une seule. C’est pourquoi personne ne s’enfuit, ils savent. Ou bien ils espèrent. L’espoir est l’entremetteur<br />
de la mort, un assassin plus dangereux que la haine. *»<br />
3 – EFFONDREMENT (basculer dans la haine)<br />
« La haine me tira de ce pénible état. Elle se ranima puis me soutint dès qu’elle eut flambé. Elle flamba, dis-je,<br />
car jusque-là elle avait couvé. Je la portais en moi comme une braise, comme un serpent, comme un abcès qui<br />
venait de crever ; mais j’ignorais pourquoi elle s’était tue jusqu’alors, pourquoi elle se ravivait soudain, sans raison<br />
apparente. Elle avait mûri dans le silence et surgissait, forte et puissante, longuement nourrie par l’attente.<br />
Chose étrange, son apparition soudaine me réjouissait ; elle m’habitait déjà mais jusque-là j’avais feint de ne pas<br />
la reconnaître. J’avais craint qu’elle ne s’affermît et maintenant j’étais fort par elle, je la tenais devant moi tel un<br />
bouclier, je la brandissais telle une torche, grisante comme l’amour. *»<br />
Comment fonctionne le procédé d’isolement des États totalitaires ? Ce procédé est justifié par la fin visée : la<br />
fragmentation du tissu social en divisant ou séparant les individus qui le composent. C’est évidemment le procédé<br />
inverse de la perspective communautaire chez Rousseau dans le Contrat social qui cherche à élaborer un pacte<br />
social solidaire. Si la tyrannie désolidarise, c’est dans le but de fragiliser la société civile au profit d’une centralisation<br />
des pouvoirs (« la forteresse » chez Selimovic). À la responsabilité des individus qui peuvent se rassembler<br />
en groupe d’associés, l’arbitraire prend le pas et enjoint à l’isolement. Ainsi sont rompus les modes de communication<br />
individuels entraînant une dépendance de chaque individu d’un pôle qui n’est plus lui-même et sa relation<br />
immédiate avec l’autre mais qui est le supérieur hiérarchique, l’inaccessible. Hannah Arendt, dans les origines du<br />
totalitarisme évoque « le début de la terreur », « un terrain fertile » et « un résultat ». Dans Le derviche et la mort,<br />
cela correspond à « une terre inhabitable », « personne ne s’enfuit » et « la haine […] tel un bouclier ». Par là se<br />
trouve contrarié l’ « entre-humain » groupusculaire. Qu’un individu tente de s’émanciper de cette situation, il ne<br />
pourra jamais saisir que les possibilités accordées par l’État. Ce que l’individu pouvait encore expérimenter dans<br />
la sphère privée, sa propre singularité, est alors affectée par la terreur de l’Etat. Ce phénomène se produit sous la<br />
forme de l’autocontrainte. L’ État totalitaire, par la menace et la démonstration de force sur des cas exemplaires<br />
(boucs émissaires) parvient à affecter le comportement privé. La suspicion généralisée entraîne des comportements<br />
de repli et de haine comme la proscription et la dénonciation (l’ensemble des « lettres » qui circulent dans<br />
le roman de Selimovic).<br />
L’autocontrainte entraîne alors un autre mode de rapport social qui est celui de l’assurance de sa propre sphère<br />
privée en collaborant ou en participant à la logique de la terreur. Dans et hors de ce mode, la peur et la haine<br />
aveugles dominent tout. Les individus sont alors dans l’isolement et la désolation. Après avoir fait exécuter le vieux<br />
musellim par ses lettres de dénonciations, Ahmed Nurudin se tapit dans l’obscurité de sa chambre attendant au<br />
petit matin que l’on vienne le chercher pour l’exécuter à son tour.<br />
* M. Selimovic, Le derviche et la mort (1966), Éditions Gallimard, 1977<br />
25
ART et PÉDAGOGIE<br />
27
Eva Watson-Schütze, portrait de John Dewey à L’Université de Chicago, 1902,<br />
domaine publique.
Au risque de l’aporie : art et expérience<br />
chez John Dewey<br />
par Bamba Gueye<br />
« À quelle profondeur l’art pénètre-t-il l’intimité du monde ? Et y a-t-il, en<br />
dehors de l’artiste, d’autres formes artistiques ? L’œuvre d’art, quand elle<br />
apparaît sans artiste, par exemple. Comme corps, comme organisation […].<br />
Dans quelle mesure l’artiste n’est qu’une étape préliminaire. Que signifie le<br />
« sujet » ? Le monde comme œuvre d’art s’engendrant elle-même 1 . »<br />
Le constat de notre monde est celui d’une division des pratiques, où chacune<br />
d’elle tend à faire d’elle-même une spécialité toujours plus spécialisée. L’art,<br />
le politique, la pédagogie, la philosophie, la technique, fonctionnent come<br />
autant de domaines séparés : les artistes font de l’art, les philosophes font<br />
de la philosophie, les politiciens font de la politique, etc. Toutes ces pratiques<br />
sont cependant indissociables de l’expérience commune, et c’est la fidélité à<br />
cette expérience, l’ensemble d’où elles émerge, qui appelle la nécessité critique<br />
à manifester des modes de résonance entre elles. Penser la communauté<br />
de l’expérience, plutôt qu’exacerber sa division et sa séparation. Il s’agira ici<br />
de mettre en rapport, à partir de deux écrits de John Dewey, L’Art comme<br />
expérience et <strong>Mo</strong>n Credo pédagogique, les deux domaines pratiques que sont<br />
l’art et la pédagogie, et à explorer le lieu de leur rencontre : le décloisonnement<br />
de la pédagogie vers l’art et de l’art vers la pédagogie. La question plus<br />
générale découlant de cette mise en rapport consiste à opérer la critique de<br />
la séparation des pratiques en différents secteurs d’activités spécifiques, c’està-dire<br />
en même temps à penser le lieu de leur communauté : une fois encore,<br />
décloisonnement et porosité entre les différents modes de l’expérience, et<br />
en particulier entre l’art et la pédagogie.<br />
L’Art comme expérience, de John Dewey, nourrira ce décloisonnement. Décrire<br />
l’art comme expérience revient à le relier à la totalité des formes de l’expérience.<br />
Et un des enjeux de l’écrit de John Dewey se propose effectivement de<br />
penser « la fonction de l’art par rapport à d’autres modes de l’expérience. »<br />
D’un côté, « la seule chose à dire sur l’art, c’est que c’est une chose en<br />
soi. L’art est art en tant que tel et laissons tout le reste au reste. L’art en<br />
lui-même n’est rien d’autre que de l’art. L’art n’est pas ce qui n’est pas<br />
de l’art. » Mais d’un autre côté, et de manière paradoxale, « l’art est de<br />
l’art pour autant qu’il est aussi du non-art, autre chose que de l’art 2 . »<br />
L’intuition du présent questionnement se situe dans la deuxième branche<br />
de l’alternative, c’est-à-dire dans la rencontre entre l’art et le reste de<br />
l’expérience. Relier l’art et le non-art, c’est en effet penser l’art en fonction<br />
de son interaction avec les formes de l’expérience commune, et en même<br />
temps penser ces formes du point de vue de l’art. Le concept d’art risque<br />
toujours, dans cette optique, de perdre sa raison d’être, si nous voyons<br />
toutefois en lui un mode d’expérience spécifique, c’est-à-dire isolé et<br />
détaché des autres modes de l’expérience.<br />
John Dewey commence son ouvrage en faisant le constat suivant : dans<br />
la société industrielle occidentale, il y a coupure et rupture entre les<br />
formes de l’art et les formes de la vie commune. L’art évolue dans une<br />
sphère séparée de la vie, et l’expérience commune est fragmentée en<br />
différentes sphères d’activité spécifiques : l’interaction entre l’être vivant<br />
et son environnement est rompue. La volonté de rétablir la continuité<br />
entre l’art et la vie part effectivement du constat de leur séparation et<br />
de leur rupture : nous pouvons trouver, dans les expériences que nous<br />
ne considérons pas généralement comme esthétiques, les germes et<br />
les racines de l’expérience esthétique, c’est-à-dire jamais, à proprement<br />
parler, l’expérience esthétique elle-même. Il y a donc bien une différence<br />
entre l’expérience esthétique et l’ensemble de nos activités quotidiennes.<br />
Comme le note un commentateur, « si pour Dewey cette continuité mérite<br />
d’être restaurée, c’est qu’elle ne va pas de soi ou qu’elle s’est perdue 3 . »<br />
Tel est le nœud de l’argumentation de John Dewey et le risque de son<br />
29
aporie. Il doit distinguer l’expérience esthétique de l’expérience ordinaire,<br />
pour ensuite rétablir leur continuité. Mais le fait de la séparation entre ces<br />
deux types d’expérience n’est pas celui d’une discontinuité originaire : il est<br />
la conséquence de processus socio-historiques. « Pour se faire l’avocat de<br />
l’intégration de l’art dans la vie, J. Dewey doit établir que leur opposition<br />
convenue n’est pas le produit d’une incompatibilité inévitable ; il y parvient<br />
non pas en menant une analyse conceptuelle pointilleuse, mais au moyen<br />
d’une généalogie historico-politique et socio-économique. La faille qui<br />
existe entre le pratique et l’esthétique n’est pas un mal nécessaire, mais<br />
une catastrophe historique 4 . »<br />
Le lien entre l’art et la vie, avant que le musée ne les dissocie en plaçant l’art<br />
à part, est en même temps celui qui met en rapport la praxis et l’esthétique.<br />
Il s’agit pour John Dewey de replacer l’art et l’esthétique dans un champ<br />
élargi, où ils sont compris comme interaction avec les autres sphères constitutives<br />
de la vie et de l’expérience collectives : « Dewey entame l’exposé<br />
de sa théorie en évoquant l’exemple de la société esthétiquement plus<br />
intégrée de la Grèce antique, dans laquelle les bonnes actions étaient aussi<br />
décrites comme belles […] et où les arts étaient “une partie si intégrante de<br />
la vie et des institutions de la communauté que l’idée même de ‘l’art pour<br />
l’art’ n’eût pas été comprise” ». J. Dewey poursuit en suggérant, en termes<br />
très généraux, certaines « raisons historiques expliquant l’émergence de<br />
la conception cloisonnée des beaux-arts » ; cela, non pas dans le souci<br />
d’une histoire exhaustive, mais pour saper notre « conception d’un art de<br />
musée ». La séparation entre l’art et les autres formes de l’expérience, ainsi<br />
qu’entre ces formes elles-mêmes, découlent de la conjonction de plusieurs<br />
processus historiques, émergeant avec l’avènement de la société moderne<br />
capitaliste. « Il ne suffit pas de prétendre que l’absence de relation organique<br />
des arts avec les autres formes de culture s’explique par la complexité<br />
de la vie moderne, par ses nombreuses spécialisations, et par l’existence<br />
simultanée de nombreux centres de culture divers dans différentes nations<br />
qui échangent leurs œuvres mais ne forment pas des parties d’un tout social<br />
inclusif. Ces choses sont suffisamment concrètes, et leur effet sur le statut<br />
de l’art relativement à la civilisation actuelle peut être aisément découvert.<br />
Mais le fait significatif est celui d’une rupture généralisée 5 » : cette rupture<br />
totale, dont découle la séparation entre l’art et le reste de l’expérience, est<br />
le fruit de la fragmentation de l’expérience moderne en général, et « puisque<br />
la religion, la morale, la politique, les affaires possèdent leur propre<br />
compartiment, au sein duquel il est bon qu’elles demeurent, l’art, lui aussi,<br />
doit avoir son propre domaine privé et réservé . » (p. 41)<br />
Les processus historiques, économiques et politiques, qui ont permis une<br />
compréhension restrictive de l’art aux seuls Beaux-arts, en faisant de l’art<br />
un art de musée, et en le séparant du même coup des autres formes de<br />
l’expérience et de la vie collective, émergent avec le nationalisme et l’impérialisme,<br />
à partir desquels « chaque capitale se doit de posséder son propre<br />
musée. » (p. 26) Par ailleurs, le capitalisme, ainsi que le caractère international<br />
du commerce et de l’industrie a « détruit le lien entre les œuvres d’art<br />
et le genius loci dont elles ont été autrefois l’expression naturelle. » (P. 28)<br />
Les œuvres d’art deviennent alors « des spécimens des beaux-arts. En outre,<br />
les œuvres d’art sont à présent produites, comme les autres articles, pour<br />
être vendues sur le marché. Le mécénat économique […] a été dissout dans<br />
le caractère impersonnel du marché mondial 6 . » Et l’artiste est écarté des<br />
formes de la vie collective par l’industrie mécanisée, où il « ne peut travailler<br />
de façon mécanique pour la production de masse. Il est moins intégré<br />
qu’autrefois dans le flot normal des services sociaux. […] Les artistes ont<br />
l’impression qu’il leur appartient d’aborder leur travail comme un moyen<br />
à part/isolé d’“expression de soi” 7 . »<br />
La réunion de ces processus que sont le nationalisme, l’impérialisme,<br />
le capitalisme et l’industrialisation établit « les conditions qui créent le<br />
gouffre existant généralement entre le producteur et le consommateur<br />
dans la société moderne », entre l’art et les autres formes de l’expérience,<br />
et « contribuent à la création d’un abîme entre l’expérience ordinaire et<br />
l’expérience esthétique 8 . » Relativement à la généalogie de ces processus,<br />
on peut remarquer qu’ils sont le fruit, non pas d’une essence interne à<br />
l’art et à l’esthétique, mais bien plutôt de conditions historiques qui lui<br />
sont extérieures.<br />
Penser l’art comme expérience sert à John Dewey d’outil conceptuel apte<br />
à décloisonner l’autonomie de l’expérience esthétique et de l’activité artistique,<br />
en établissant leur continuité avec d’autres sphères d’activité<br />
et d’autres formes d’expérience, qui se voulaient elles aussi autonomes.<br />
Dans sa volonté de dépassement de ces discontinuités, séparations et<br />
divisions, on pourrait effectivement décrire l’esthétique de J. Dewey<br />
comme une esthétique de la continuité : « […] un des thèmes les plus<br />
importants de Dewey dans le domaine esthétique comme ailleurs […] »<br />
est « […] le thème de la continuité. Contrairement à la philosophie analytique<br />
(et peut-être dans la lignée de l’opposition Kant-Hegel), Dewey<br />
préfère établir des liens plutôt que des distinctions. Il tient en particulier<br />
à réunir les aspects de l’expérience et de l’activité humaine qui ont été<br />
divisés par la spécialisation et la fragmentation de la pensée, et plus encore<br />
par les institutions cloisonnantes dans lesquelles une telle pensée<br />
s’est inscrite et renforcée 9 . »<br />
Or, comme expérience, l’art est avant tout l’activité par laquelle une communauté<br />
interagit avec son environnement : il n’est donc pas à considérer<br />
indépendamment de son ancrage dans les formes de la vie quotidienne.<br />
L’activité créatrice d’une communauté humaine s’exprime à l’origine dans<br />
sa vie matérielle, sociale et politique. Et là réside l’existence politique et<br />
sociale de l’art, dans la relation organique qu’il tisse avec les formes de la<br />
vie commune, moyennant sa mise en avant de l’expérience de la vie commune.<br />
L’art d’une communauté opère le lien entre les différentes sphères<br />
constitutives (pratique, éducative, sociale, institutionnelle) de l’expérience<br />
de cette communauté. Il évolue dans une sphère indistincte de la vie<br />
commune : il est interaction en son sein et avec elle. Il est forme de la vie<br />
commune avant d’être forme de l’art. John Dewey remarquait déjà, en<br />
tentant de définir la forme esthétique, sa similitude avec la forme sociale :<br />
« Une relation sociale est affaire d’affects et d’obligations, de transactions,<br />
de générations, d’influences et de modifications mutuelles. C’est en ce<br />
sens-là qu’il faut entendre “relation” quand le terme est employé pour<br />
définir la forme dans l’art. » (p. 168)<br />
Dès les premières pages de son ouvrage, John Dewey pose la nature du<br />
problème, qui « est de rétablir la continuité entre l’expérience esthétique<br />
et les processus normaux de l’existence. » (p. 29) Il note que « […] l’art<br />
est toujours le produit dans l’expérience de l’interaction d’êtres humains<br />
avec leur environnement. » (p. 273) Le point de départ des artistes et<br />
de n’importe quel être vivant, c’est le monde et l’environnement dans<br />
lesquels ils évoluent. John Dewey exprime une « conception de l’art qui<br />
le relie aux activités de la créature vivante dans son environnement »
(p. 48), et qui le replace dans le champ élargi de l’ensemble non hiérarchisé<br />
et horizontal des formes d’interaction entre l’être vivant et son environnement,<br />
relativement au champ réduit et spécifique que représente la pratique<br />
proprement artistique. Interaction entre l’être vivant et son environnement,<br />
et entre les différentes formes, matérielles, sociales et politiques, que revêt<br />
cette interaction. L’art est à la vie ce que l’être vivant est à son environnement :<br />
interaction, communication, et participation. L’interaction qui existe entre l’art<br />
et la vie, de façon corollaire, situe l’art dans le lien direct qu’il noue avec son<br />
autre, la vie, et l’ensemble des pratiques qui lui donnent un corps : la pédagogie,<br />
le politique, la technique, la mécanique, etc. À strictement parler, nous dit<br />
John Dewey, « le produit de l’art – temple, peinture, statue, poème – n’est pas<br />
l’œuvre d’art. » (p. 255) L’art qualifie une activité avant de dénoter un objet.<br />
L’art, avant de dénoter une « chose faite », qualifie un « acte de faire ». Il est<br />
adjectif avant d’être substantif : « L’art qualifie aussi bien l’acte de faire que la<br />
chose faite. Ce n’est donc qu’en apparence que l’on peut le désigner par un<br />
substantif. Puisqu’il correspond à un contenu et à une manière de faire, il est<br />
naturellement un adjectif. Lorsque nous disons que faire du tennis, chanter,<br />
jouer la comédie et se livrer à une multitude d’autres activités sont de l’art,<br />
nous supposons, de façon elliptique, qu’il y a de l’art dans la conduite de ces<br />
activités 10 . » En tant qu’activité, l’art n’est donc pas réductible à l’activité des<br />
artistes : « Le mécanicien intelligent impliqué dans son travail, cherchant à<br />
bien le faire et trouvant de la satisfaction dans son ouvrage, prenant soin de<br />
ses matériaux et de ses outils avec une véritable affection, est impliqué dans<br />
sa tâche à la manière d’un artiste. » (p. 23) Toute forme d’activité, c’est-à-dire<br />
non seulement spécifiquement artistique, peut être réalisée avec art. Aucune<br />
séparation réelle ne peut donc être posée entre l’activité artistique et l’ensemble<br />
des autres activités, et toute forme d’activité peut, d’une certaine manière,<br />
relever de l’art et de la création.<br />
« J’ai à l’esprit, de plus en plus présente, l’image d’une école ; une école où<br />
quelque activité véritablement constructive sera le centre et la source de<br />
tout, et à partir de laquelle le travail se développera toujours dans deux<br />
directions : d’une part la dimension sociale de cette activité constructive,<br />
d’autre part, le contact avec la nature lui fournissant sa matière première. Je<br />
vois très bien, en théorie, comment l’activité de menuiserie mise en œuvre<br />
pour construire une maquette de maison, par exemple, sera le centre d’une<br />
formation sociale, d’une part, scientifique, de l’autre, tout cela dans le cadre<br />
d’un entraînement physique, concret et positif, de l’œil et de la main. » John<br />
Dewey, 1894, correspondance avec Alice Dewey.<br />
Le lieu de la rencontre décloisonnée entre l’art et la pédagogie, dont l’énonciation<br />
constituait l’entame de cet article, est l’expérience de la communauté<br />
sous toutes ses formes d’activité.<br />
Si l’art et la pédagogie sont reliés aux autres modes de l’expérience, ils<br />
n’existent plus de compartimentation et de séparation qui les placent dans un<br />
domaine détaché de l’expérience commune : ils font corps avec elle.<br />
La pédagogie, au même titre que l’art, n’est réellement pédagogie<br />
que lorsqu’elle se manifeste sous les formes de la vie et de l’activité<br />
communes. De la même manière que l’art est compris comme interaction<br />
entre l’être vivant et son environnement, le processus pédagogique<br />
« se fait par la participation de l’individu à la conscience<br />
sociale 11 […]. »<br />
Les institutions que sont l’école et le musée tendent à isoler l’art et la pédagogie<br />
du reste de l’expérience. Or, c’est cette dernière qui fait la vitalité et la<br />
réalité de l’art tout autant que de la pédagogie : « […]l’éducation actuelle<br />
échoue surtout parce qu’elle néglige ce principe fondamental de l’école<br />
considérée comme une forme de la vie en commun 12 . »<br />
Il y a continuité entre le processus pédagogique et l’ensemble des processus<br />
qui lui sont extérieurs : la vie, dans sa totalité, avec sa couche sociale,<br />
matérielle et politique. « Je crois que l’éducation qui ne se présente pas<br />
sous les formes de la vie, formes qui valent la peine d’être vécues pour<br />
elles-mêmes, est toujours une pauvre substitution à la réalité naturelle<br />
et tend à la gêner et à l’amortir 13 . »<br />
J. Dewey critique l’école dans la mesure où celle-ci isole le processus pédagogique<br />
des autres modes de l’expérience, et appauvrit du même coup<br />
la vitalité de cette expérience. C’est dans ce sens que l’école « doit représenter<br />
la vie présente – vie aussi réelle et vitale pour l’enfant que celle qu’il<br />
mène dans sa famille, dans le voisinage, sur le théâtre de ses jeux 14 . ».<br />
La pédagogie, comme pratique commune, s’oppose à la fragmentation<br />
du savoir et à sa transmission en unités spécialisées, sans rapport direct<br />
avec la vie pratique. C’est en ce sens qu’elle « est un processus de la vie,<br />
et non une préparation à la vie 15 . »<br />
En outre, le processus pédagogique est une activité collective « qui<br />
se fait », c’est-à-dire pratique. Une pédagogie qui se manifeste sous les<br />
formes de la vie, c’est une pédagogie de l’activité et de l’action, par opposition<br />
à la réception passive d’un savoir spécialisé. C’est en ce sens que<br />
la pédagogie résulte moins de la transmission d’un savoir que de l’expérimentation<br />
de l’ensemble non hiérarchisé et horizontal des pratiques de<br />
la communauté. La pédagogie est donc moins du côté du savoir comme<br />
forme désincarnée et séparée des formes dites plus « prosaïques » de<br />
l’expérience.<br />
À la fragmentation de l’expérience moderne en sphères d’activités spécifiques<br />
correspond, dans le domaine de la pédagogie, la fragmentation du<br />
savoir en unités spécialisées. Or, « nous violons la nature de l’enfant […]<br />
en jetant l’enfant trop brusquement dans certaines études spéciales : de<br />
lecture, d’écriture, de géographie, etc. sans rapport avec la vie sociale 16 . »<br />
La séparation et la fragmentation des pratiques en unités spécialisées ne<br />
correspondent pas à la réalité de l’expérience commune et la façon dont<br />
elle se vit : « […] le vrai point de corrélation des sujets scolaires n’est pas<br />
la science, ni la littérature, ni l’histoire, ni la géographie, mais les propres<br />
activités sociales de l’enfant 17 . »<br />
« La couture, la cuisine 18 », le travail du bois ou de la terre, sont « activités<br />
expressives constructives 19 », dont l’exercice constitue « comme centres<br />
de corrélation 20 », tout autant que l’étude des mathématiques ou la<br />
lecture, les façons par lesquelles une communauté habite son environnement.<br />
Mieux, nous dit J. Dewey, ce sont elles qui expriment en premier<br />
lieu « comme types, les formes fondamentales de la vie sociale, et qu’il<br />
est possible et désirable que l’initiation de l’enfant aux sujets plus formels<br />
du curriculum soit faite par le moyen de ces activités 21 . »<br />
« Je crois finalement que l’éducation doit être conçue comme une reconstruction<br />
continuelle de l’expérience ; que le processus et le but de l’éducation<br />
ne font qu’un 22 . » La pédagogie, en tant que forme de l’expérience<br />
commune, ne doit pas être une préparation à cette expérience, mais, pour<br />
ainsi dire, une expérimentation de cette expérience. Elle a sa fin en dehors<br />
31
d’elle-même, dans la mesure où elle expérimente les formes pratiques qui<br />
lui sont extérieures, mais a également sa fin à l’intérieur d’elle-même, dans<br />
la mesure où elle est cette expérience : « […] fixer une fin quelconque en<br />
dehors de l’éducation pour fournir à celle-ci le but et l’étalon, c’est priver<br />
le processus éducatif d’une grande part de sa signification et se fier à des<br />
stimulants faux et extérieurs 23 . »<br />
Si l’art est indissociable de l’expérience commune, à la pédagogie revient l’art<br />
d’exciter cette expérience qui « est l’art suprême, art qui appelle le meilleur<br />
artiste ; qu’aucune clairvoyance, aucun tact, aucune capacité exécutive n’est<br />
trop grande pour un pareil concours 24 . »<br />
1 F. Nietzsche, Fragments posthumes, dans M. Kessler, Nietzsche ou le dépassement<br />
esthétique de la métaphysique, Paris, Themis, 1999, p. 79.<br />
2 J. Rancière, Malaise dans l’esthétique, Paris, Galilée, 2004, p. 53.<br />
3 L’Expérience esthétique, http://charlesfloren.unblog.fr/2007/12/10/<br />
lexperience-esthetique/<br />
4 R. Shusterman, L’Art à l’état vif : la pensée pragmatiste et l’esthétique<br />
populaire, trad. de l’américain par Ch. Noille, Paris, Minuit, 1992, p. 44.<br />
5 John Dewey, L’art comme expérience (1934), traduction française de Jean-<br />
Pierre Cometti, Paris, PUP/Farrago-Léo Sheer, 2005. Pour faciliter la lecture,<br />
la référence des pages de ce texte abondamment cité sera indiqué entre<br />
parenthèse dans le corps du texte.<br />
6 Ibid.<br />
7 Ibid.<br />
8 Ibid.<br />
9 R. Shusterman, op. cit., p. 30.<br />
10 Ibid.<br />
11 Le Credo pédagogique de John Dewey, 1897, dans O. Tsuin-Chen, La<br />
Doctrine pédagogique de John Dewey, Paris, Vrin, 1958, p. 255.<br />
12 Ibid., p. 260.<br />
13 Ibid., p. 259.<br />
14 Ibid.<br />
15 Ibid.<br />
16 Ibid., pp. 262-263.<br />
17 Ibid., p. 263.<br />
18 Ibid., p. 264.<br />
19 Ibid.<br />
20 Ibid.<br />
21 Ibid.<br />
22 Ibid., p. 266.<br />
23 Ibid.<br />
24 Ibid., p. 271.
Vers une pédagogie de l’art ?<br />
par Fabien Defendini<br />
II<br />
Vers une pédagogie de l’art ?<br />
La pratique artistique peut occuper tous les territoires, elle s’élance partout<br />
où le monde la sollicite<br />
Je voudrais tenter d’observer avec franchise la création contemporaine, du<br />
moins la façon dont elle me parvient. Je me rends compte combien la place<br />
qui lui est laissée s’est réduite relativement à sa liberté d’expression. <strong>Mo</strong>n<br />
point de départ tient au fait qu’il ne lui est plus indispensable de s’inscrire<br />
dans une histoire particulière. Celle-ci s’est densifiée avec le temps si bien<br />
que tenter d’en dessiner une dynamique spécifique à l’intérieur du champ<br />
infini des pratiques s’avère au mieux être un héroïsme, au pire de la vanité.<br />
Prétendre à l’invention d’une forme qui serait l’exclusive d’une autre ne peut<br />
se faire qu’à partir d’images approximatives. Si bien qu’essayer d’affirmer<br />
un point de vue surplombant serait comme se hisser impunément sur le<br />
dos de quelqu’un d’autre pour affirmer sa propre singularité.<br />
Autour se dressent des visages. Chacun use du même langage, celui de<br />
la solitude.<br />
- L’art doit-il continuer cette histoire ?<br />
- Si seulement ça n’était que de l’art ! C’est quand même pas difficile de<br />
comprendre que tant que nous gardons ce mode de penser, nous continuerons<br />
à produire cette culture de la différence comme si elle nous avait<br />
été jetée une fois dans l’oreille et que maintenant, devenus sourds, nous<br />
faisions tout pour servir cette foi, et tenter du même coup de ne pas rester<br />
trop invisible.<br />
II-<br />
Je préfère l’excès de caricature<br />
- Alors nous avons droit à une batterie de « bons pères de famille » qui<br />
nous disent que l’art est politique, et que, étant politique, il a une fonction,<br />
laquelle étant que, chaque geste, opération, est un acte pour la société,<br />
qu’il soit symbolique, critique, allégorique, fantasmatique, onirique,<br />
contemplatif, tout pareil, à la société. De là ce paradoxe pour l’artiste qui<br />
se demande vraiment pour qui on le prend ? Il faut que l’artiste soit ou<br />
ne soit pas. Mais l’artiste il s’en branle, parce que sa religion il la cultive<br />
avant tout avec lui-même, par lui-même et aussi pour lui-même. Enfin…<br />
ce sont des manières de faire.<br />
- Mais c’est pour dire quoi en pratique ?<br />
- Que la première chose qui prévaut dans une création, et pour une création,<br />
c’est certainement pas d’y mettre une condition préalable du style :<br />
« l’artiste sera s’il…(faut vraiment qu’il s’y mette ! faut bien qu’il serve à<br />
quelque chose !), fait pas autre chose que… ». Or, où que se trouve cet<br />
animalcule, il vaudra mieux pour lui qu’il garde la queue pendante, et qu’il<br />
aille pas pavoiser, ou alors : Qu’il le fasse ! Mais « Justement » !<br />
Raisonnablement, c’est par la question de l’économie qu’on va pouvoir<br />
toucher au problème. Cela n’aura sans doute échappé à personne qu’en<br />
ce moment les artistes travaillent majoritairement à perte. (Seront-ils remboursés<br />
du ticket de train qui leur permet de voir leur travail exposé ?)<br />
Ce travail à perte n’est pas le fruit du hasard.<br />
Première version : Les artistes produisent par leurs formes des plasticités
nocives à un usage plus codifié de la valeur d’exposition médiatique ce qui<br />
constitue une menace au support d’information.<br />
Deuxième version : « On s’occupe bien des artistes, on leur offre des expositions,<br />
ils ont la chance de montrer leur travail, ils vont pas en plus réclamer<br />
de quoi vivre, tout le monde n’est quand même pas une star. »<br />
Reformulation : Tout le monde ne peut pas prétendre recevoir l’argent que<br />
certains s’accaparent nominativement.<br />
- Effectivement, il y a sur la scène de l’art contemporain les grandes pontes.<br />
Ce sont les « self-made artists », on leur jettera pas la pierre, ils sont parvenus,<br />
la fin de l’œuvre en soi, parvenir, après, il faut entrer dans le labeur<br />
de la chaîne productive pour rester au niveau du mérite et c’est là qu’on<br />
commence à entrer dans la machine proprement dite, la surenchère. Celuici<br />
multiplie les assistants, celui-là s’approprie un objet rare et lui imprime<br />
sa «country touch », une signature indélébile, miserabile, et enfin y’en a qui<br />
visent l’éternité, inscrire leurs corps dans le panthéon de l’art, corps humain,<br />
extra-corps, corps d’ivoire, « self-defense » d’une vie après la mort. A croire<br />
que le mythe confine à l’universel se confondant presque avec le paysage :<br />
universaux, université, universitaire.<br />
Parce que l’histoire a besoin de ses écrivains.<br />
« L’art et la transformation de soi-même par l’usage de la parole, du sens, et<br />
de la loi internationale des flux post-médiatiques. »<br />
Une belle idée encore ! Des années de travail !<br />
Nous habituer à laisser traîner la longue chaîne des relations avec laquelle<br />
nous devons traiter.<br />
- Comment pouvons-nous éviter cet effet d’entraînement, voire d’accaparement,<br />
et au fond d’assignation ?<br />
- C’est difficile ! Prendre la question par le bout générique de ce que serait<br />
principiellement une pratique ? On serait tenté de le faire évidemment.<br />
Mais par rapport à quoi et selon qui je pourrais moi affirmer un primat de<br />
la création ? La question de l’affirmation ressurgit. A compter de quel moment<br />
ce postulat peut prendre place sans entrer en guerre avec un autre ?<br />
En premier lieu, il me semble devoir nécessairement éclairer ce complexe.<br />
Donnons lui un nom. Par exemple : le complexe d’Adipe. ça a le mérite<br />
d’être au moins amusant et ça fera contraste d’avec son précurseur enfermé<br />
dans les frasques de sa famille mono-culturelle. Ce cher monsieur Adipe<br />
ainsi que son nom le nomme a été jusqu’à maintenant enfermé dans sa<br />
pâte graisseuse, bouffi, empêtré, il se pose la question : « Mais que faire en<br />
ce monde ? ». Ici, nul besoin de lever les yeux au ciel, pas de providence<br />
à attendre, on est dans la végétation. Et l’animal tient mordicus à pousser,<br />
tropisme qui lui vient comme une nécessité.<br />
« L’embourbement ok ! -would I say- but, hors la sédimentation étendue à<br />
un registre commun à quoi pouvons-nous prétendre maintenant que nous<br />
sommes liés un chacun à l’autre ? Nous avons défait Dieu de son pinacle,<br />
nous avons inventé les sciences, mais on est pas plus heureux ! Ce siècle<br />
promis de la connaissance c’était plutôt la guerre non ? Alors ok ! (would<br />
I say) on a vite fait de dire « on revient à Dieu », mais toute conscience<br />
lucide ne pourra jamais se satisfaire d’un : « vous n’avez qu’à reprendre les<br />
vieilles recettes ».<br />
On aurait manqué quelque chose ? Faut-il faire retour à un endroit quelconque?<br />
On a déjà des théories : le retour d’un passé comme présent perpétuel,<br />
faisant surgir ses fantômes, revenus tel de la guerre, tel de la maladie, tel<br />
d’un génocide pour nous dire : « Hey les gars y’a maldonne ! ça sert à<br />
rien de forcer la machine si elle marche pas, bad direction bad trip. »<br />
J’ai quelques idées bien sûr, un peu par pragmatisme pourrais-je dire,<br />
mais encore faudrait-il que je sois exemplaire, on y est pas. « Mais, je<br />
ne suis pas.., mais, je ne suis pas, … » Je me rappelle un mot, une phrase<br />
ou une anecdote : « Faire un pas en avant dans la recherche, trois pas<br />
en arrière dans la précaution ». Je ne sais pas qui je suis, et je n’ai pas le<br />
choix de faire autrement que de l’ignorer. Parce qu’il faut avancer encore<br />
un peu, mais avancer sans sujet, ni moi-même, ni le monde.<br />
Une fois on m’a dit : « Qu’as-tu à donner ? » « <strong>Mo</strong>i ? rien… » « Alors<br />
je ne te parle pas ! ». Réponse, réponse, que devais-je faire ? En face,<br />
quelqu’un. On me présente. « Bon alors et toi qu’as-tu à donner ? »<br />
« Euh,… rien ». La répétition n’a presque rien changé la réponse reste<br />
la même de ma part. Le mot. Je me dis que quoi, je suis un artiste, ou<br />
alors j’écris, ou alors, j’essaie de comprendre comment ça marche, mais<br />
c’est pour moi. En face il y a cette personne qui me parle parce qu’elle<br />
devrait le faire. Le doit-elle ? On lui a donné le pouvoir de le faire. A quel<br />
moment ? Parce qu’elle a de l’argent ? Parce qu’elle a de l’influence ?<br />
Parce qu’elle est incontournable ? Elle me demande ce que je donne.<br />
Rien. « A cet instant, je ne veux rien… te donner». Elle me demande, elle<br />
ne me demande pas, le contexte n’est pas l’occasion pour cette personne<br />
de me demander ce que je donne, c’est indiscutable. Peut-être qu’on<br />
lui demande toujours de demander. Peut-être aussi qu’elle a elle-même<br />
le dégoût de ce qu’on ne lui donne plus le choix d’être. Mais je parle<br />
tout seul, situation d’un écho dans le vide, personne n’est en face, il y a<br />
pourtant là deux choses distinctes, mais à la place, des vagues sonores,<br />
des échos, des interfaces de néant qui se répondent par diffraction, et<br />
rien pour médiatiser la scène.<br />
III-<br />
Pour ce qui touche au médium, la production artistique a encore du<br />
travail. Je veux dire que pour la lecture, l’exploration des champs artistiques<br />
nous restons toujours à une extrême confidentialité, il y a trop<br />
peu d’aventures, d’amusements, de découvertes, alors que pourtant on<br />
nous dit : « l’art est libre !». Il faut croire que la spécialisation a fait ses<br />
émules, et qu’à force de taper sur le crâne la chose est bien rentrée.<br />
Qu’en est-il donc ?<br />
C’est l’histoire d’une responsable de centre culturel amenée par une<br />
presque audace à fréquenter un milieu qui n’est en pratique qu’une<br />
association bénévole de politique à tendance humaniste qui s’exclame<br />
: « On va tout de même pas donner une antenne aux peintres du<br />
dimanche ?? ».<br />
Je ne connais pas « les peintres du dimanche ». C’est un concept « peintre<br />
du dimanche » ? Peut-être ce type qui, lassé de son activité de la<br />
semaine, vient prêter à la peinture le pouvoir de délier ou d’enchanter<br />
son monde dans lequel il vit par nécessité plus que par contrainte -du<br />
moins dont la nécessité l’a amené par le gré de circonstances imprévues<br />
mais mécaniques à semer le doute sur l’objet qu’il aurait pu considérer<br />
comme une contrainte au point de se retrouver astreint avec une quasijouissance<br />
de son temps libre à faire ce que la nécessité alors devenue<br />
35
monde a voulu faire de lui- alors là-dedans, la peinture, le dimanche<br />
ont su pourtant se glisser subrepticement pour laisser venir quelque<br />
chose qui n’avait encore pu prendre corps dans la nécessité. Le peintre<br />
du dimanche est devenu une belle histoire.<br />
Mais quoi ! Les centres d’art aujourd’hui crachent dans la soupe ?<br />
N’est-ce pas qu’ils veulent délimiter le territoire à ceux qui résistent<br />
mais qui plus est parviennent à mentir sur l’objet de leur résistance ?<br />
Ou bien sont-ils simplement ce monde de professionnels engagés<br />
eux aussi dans la nécessité d’une production telle que réclament<br />
tous ensemble, et public, et commission de subventions, et investisseurs<br />
privés ?<br />
Who kills Davey <strong>Mo</strong>ore? Qui est responsable et pourquoi est-il mort?<br />
Mais peut-être qu’on peut parler de cette figure hypothétique qui<br />
n’a pas reçu la formation requise pour s’habiller proprement, qu’on<br />
accueille volontiers tant qu’il reste une image, mais qu’on piétine<br />
dès qu’il vient rompre la magie de sa silhouette, qu’il commence à<br />
entrer dans le décor et qu’il se met à toucher les objets comme s’ils<br />
étaient ceux du quotidien.<br />
Mais aussi les congénères qui se toisent d’un air entendu : « ah c’est<br />
pas un grand artiste, mais je peux dire avec mon regard d’expert, je<br />
peux t’assurer que : y’a quelque chose à voir là-dedans, c’est possible<br />
que toi tu le voies pas, mais y’a quelque chose » : la métaphysique<br />
des professionnels, celle de partager un secret, immanent, que tout<br />
le monde soupçonne, que tout le monde recherche.<br />
- Qui est dupe ?<br />
- Nous avons le soupçon duquel il est possible de déduire que le<br />
trauma peut surgir à chaque instant. Et ce trauma est attendu comme<br />
si lui aussi venait garantir le prix, et la ténacité des efforts fournis<br />
pour accomplir ce monde.<br />
IV-<br />
Je voulais commencer cette « histoire » comme un<br />
« je ».<br />
La question d’entrer dans un panorama étendu de la « pratique »<br />
contemporaine est impossible. C’est pour cela qu’il faut savoir s’accorder<br />
un peu de liberté, quelques oublis, pour essayer de reprendre<br />
à l’intérieur du champ déjà saturé des éléments de passage plus ou<br />
moins visible. Je n’ignore pas que si je veux dessiner un trait particulier<br />
à la place d’un autre cela reste vain dans la mesure où chacun<br />
est en droit de faire de même et qu’ainsi nous arrivons à présenter<br />
le même champ, le même état d’impuissance. Mais je ne me résous<br />
pas à abandonner l’échange, et donc la médiation. C’est en ce sens<br />
que mon « je » fonctionne, un « je » qui ne se délimite pas à luimême,<br />
sans être non plus l’« histoire ». Il travaille comme un support,<br />
une interface, il peut prendre ainsi plusieurs visages, il sera toujours<br />
différent pour lui-même.<br />
Voilà donc l’immersion en terrain sauvage où formes et mélanges,<br />
faits d’indistinction, occupent par un état donné du sensible un lieu<br />
qui est le mien.<br />
C’est étrange de dissocier ce que je suis de ce qui est moi, mais pour le<br />
dire autrement, je suis ce lieu à l’intérieur duquel je tente une immersion,<br />
je m’immerge en moi-même.<br />
Le langage fait des trous et des sauts, il me met à l’index, ou me reconfigure<br />
à partir du temps que je prends à regarder.<br />
Chaque fois je reviendrai à un commencement supposé, un commencement<br />
possible afin de dessaisir l’idée qui aura pris corps, car en dehors de<br />
sa résonance physique semblent agir d’autres corps en amont ou derrière<br />
elle, et donc, reprendre le cours à l’endroit d’une ressemblance d’avec sa<br />
figure sera former par elle un monde qui se superpose, qui s’enchevêtre<br />
d’ombres à ombres pour penser un espace dont les dimensions ne se<br />
comptent plus.<br />
Chacune des phrases qui suivent seront donc comme le commentaire de<br />
celles qui précèdent, prenant compte aussi bien des objections que de la<br />
vocation à poursuivre malgré tout un récit vers le monde qui devient.<br />
De là une perception hallucinatoire où les idées coexistent dans un monde<br />
perceptif dont la propriété n’est précisément pas celle de contenir ces<br />
images contemplées.<br />
Ainsi puisque le temps présent s’est imposé dans les premières lignes, et<br />
il faut croire que je m’y incline résolument, il formule au même instant<br />
les formes qui le précèdent et celles qui le suivent. Pour inverser l’idée, il<br />
n’est pas tout à fait faux de dire que les formes qui précèdent le temps<br />
présent sont les formes futures en tant qu’elles le devancent, et que donc<br />
celles qui le suivent appartiennent au passé.<br />
Je prie le lecteur de bien vouloir m’excuser pour ces détours, mais je crois<br />
que cette gymnastique de pensées est indispensable. Elle a le mérite de<br />
s’astreindre avec rigueur à être le mouvement d’elle-même. Voilà une<br />
chose qui m’importe, la pensée peut maintenant se dispenser de s’agglutiner<br />
à un motif, elle est médiumnique. Cela a pour conséquence qu’elle<br />
peut s’auto-inclure jusqu’à l’infini de ses propres effets de pensée, qui<br />
s’éternisent et finissent par disparaître hors de la contemplation, certains<br />
philosophes y sont encore.<br />
S’il est vrai que la pensée se médiatise elle-même, il n’est pas moins vrai<br />
qu’il lui est indispensable d’élaborer un processus dans lequel elle devient<br />
sinon un agencement du moins un artefact qui gravite à égalité avec<br />
d’autres modules desquels elle ne peut se détacher. C’est à dire qu’elle<br />
détermine un milieu à l’intérieur duquel elle se place en sujet relatif car<br />
est indistinct ce qui fait son mouvement de ce que je suis. Par là je me<br />
pose le danger de rendre impossible le rapport discursif avec lequel je<br />
serais apte à revenir et ceci avec une sorte d’obstination qui ne pourra<br />
au moins pas être prise en faute de dénaturer le réel. Je ne prétends pas<br />
à la philosophie, je veux plutôt m’absorber, et avec moi éteindre une<br />
assignation, une régularisation ainsi qu’une distinction qui a fait de la vie<br />
un énoncé sécable avec lequel pouvait être mise à profit l’expérience.<br />
Je sais tout cela est auto-défensif, et ce sera de ma part une contrainte<br />
récurrente d’éliminer tout endroit de défiance à l’égard de mon dire.<br />
J’écris pour mon malheur dans un espace qui a perdu la joie de son rêve,<br />
et qui cherche à s’en débarrasser sans abandonner sa jouissance. Le jeu<br />
voudrait que j’y plonge.<br />
J’aimerais formuler cette question : la singularité. J’ai conscience que ce<br />
sujet peut éveiller des ressentiments car qui touche la création atteint<br />
quelque part l’infortune d’attenter à l’intouchable, le processus d’indivi-
duation est aujourd’hui considéré comme incontradictible, il déduit pour-<br />
tant factuellement tout un organisme social.<br />
Le paysage de la création, alors qu’on aurait pu le croire entièrement dégagé<br />
des mécanismes théoriques que l’histoire lui avait fourni, se trouve<br />
étonnamment circonscris en lui-même selon un mode conventionnel de<br />
ressemblance lié au souvenir qu’il se fait de lui-même, un pragmatisme<br />
empirique dans lequel l’économie joue la fonction d’agent de transfert<br />
non-discutable, et finalement d’un mouvement éperdu projeté vers une<br />
révélation qui ne peut qu’arriver tôt ou tard.<br />
V-<br />
Avons nous perdu l’usage de la médiation ?<br />
Le terme paraît simple a priori, mais il me revient avec obstination comme si<br />
je devais en élucider le sens secret. Je voudrais encore y ajouter un autre : le<br />
support. Je pourrais me contenter d’utiliser le terme de média, ou celui de<br />
médium, mais cela ne rendrait compte que de sa dimension artefactuelle<br />
au détriment de son processus, de son principe d’action. Inversement dans<br />
médiation n’est retenu que le fait de la dimension médiate, soit le transport,<br />
véhicule informatif, transactionnel. Quelque chose fait médiation mais<br />
quoi ? Le support.<br />
Dans le concept de « support de médiation » se trouve articulé aussi bien la<br />
part matériologique que l’aspect relationnel induit par son usage.<br />
Sans vouloir forcer le trait, je crois qu’œuvrer à la production artistique c’est<br />
toujours travailler un « support de médiation ». J’espère dire là quelque<br />
chose de tout à fait banal. Mais du fait de nommer ce mode de fabrication<br />
vient s’assembler autour un ensemble résonnant de pratiques supposément<br />
antinomiques entre elles qui pourraient trouver là un espace de « sympathie<br />
» avec lequel elles pourraient se doter d’une forme de hors-discours<br />
qui leur permet d’aller saisir où que ce soit les éléments avec lesquels elles<br />
souhaitent se développer. Une dynamique expansive à terrains variables.<br />
- La pratique elle-même en est-elle au point d’avoir à se défendre ?<br />
- Ce n’est pas tant que sa place soit menacée, mais plutôt qu’elle<br />
est située à un endroit duquel elle n’a plus aucune possibilité de<br />
prétendre à quoique ce soit. Elle est dans l’intangible. Peut-être<br />
là la conséquence de son développement de plus en plus étroit<br />
vers une autonomie du médium, et donc a contrario de son indifférence<br />
totale pour les objets de sa recherche.<br />
- La pratique cherche-t-elle encore ? La recherche est-elle encore indispensable<br />
? Quel est l’objet de la poursuite ? Que poursuivre ? Pour qui, pour<br />
quoi ?<br />
- Peut-être cela tient-il au fait qu’elle n’ait plus de joie. Mais de cette circularité<br />
nous ne savons pas sortir. Est-il en droit possible de l’imputer d’une<br />
responsabilité, alors qu’elle ne faisait que se découvrir à l’instant même ? Ou<br />
bien faut-il lier les évolutions du monde contemporain à son éloignement<br />
progressif supposé de la réalité ?<br />
Il est inutile de parler de méthode pour ce qui la concerne, elle s’est fâchée<br />
depuis longtemps avec la science, et si certains de ses acteurs pourraient<br />
s’en réclamer, ils affronteraient eux-mêmes certains de leurs collègues qui<br />
eux restent irrasciblement attachés à la « plasticité » de leur approche.<br />
VI-<br />
Vanité<br />
Ne limite pas la création à un domaine en particulier. Elle appartient au<br />
monde comme tu y appartiens. Le monde se métamorphose progressivement,<br />
je le suis. Je ne veux pas me plaindre, regretter. L’important est<br />
d’être avec la création, je ne veux plus voir. Le monde est ainsi. Ce n’est<br />
pas suffisant. Commençons par cela. Où se trouve la profondeur, où se<br />
trouve l’attention, où se trouve la tendresse et l’amour ? Ne perds pas<br />
de temps. Donne vite, ne compte pas, laisse-toi porter pour ce que tu<br />
vis, laisse-toi faire autant que tu fais. Quand le monde s’arrête, prend le<br />
temps d’observer pour ne pas filer au hasard. Mais laisse aussi vivre ce<br />
qui te déborde, la générosité, réapprend l’inconnu.<br />
Un monde donné n’est pas définitif. Ceux qui blessent s’éloignent dans<br />
la comédie avec le temps, se perdent, ils ne sont plus des souvenirs.<br />
Que tes pensées se poursuivent, ne te laisse pas saisir, ou bien peut-être<br />
laisse-toi faire si l’odeur du plaisir ne t’empêche de respirer. Cherche<br />
l’abandon des moments d’amour, sans regards scrupuleux, sans préciosité,<br />
et sans lourdeur, laisse filer le monde, te faire vivre entre ses bras.<br />
Ne cultive pas la douleur, ni l’ignorance, pas de sagesse, pas de brûlures.<br />
Le feu des éléments te porte et avec eux tu vis sans état d’âme.<br />
37
PHOTOGRAPHIE(S)<br />
39
Création photographique brésilienne<br />
entre contemporanéité et anachronisme (Le jeu du voile)<br />
par Samuel de Jesus<br />
Dans son essai Devant l’image, Georges Didi-Huberman observe que<br />
regarder une image consisterait finalement à la penser en tant que<br />
structure : « un devant-dedans : inaccessible et imposant sa distance,<br />
si proche soit-elle – car c’est la distance d’un contact suspendu, d’un impossible<br />
rapport de chair à chair. Cela veut juste dire [...] que l’image est<br />
structurée comme un seuil 1 . »Un seuil ou une sorte de jeu qui viendrait<br />
dès lors alerter aussi bien notre regard que notre place de spectateur,<br />
mis à distance mais désireux de transpercer le dais opaque qui nous<br />
en sépare. Or, s’il est effectivement question de seuil, nous pouvons de<br />
plus constater que de nombreuses œuvres photographiques en général,<br />
et celles d’artistes-photographes brésiliens, partagent le fait d’être<br />
chargées d’un effet similaire à un celui d’un voile. Un effet par lequel<br />
viendrait s’instaurer un jeu entre l’image et celui qui la contemple, au<br />
sein de pratiques ayant aussi bien recours aux images d’archives, ou<br />
encore significatives d’une volonté délibérée de privilégier le flou, de<br />
la couleur saturée, conférant à ces images une forte ascendance picturale.<br />
C’est à partir de ce postulat que je voudrais convier le lecteur à un<br />
voyage au cœur d’un univers « imagétique » aussi riche et inhabituel<br />
que le corpus iconographique façonné au cours des dix dernières années<br />
peut nous apparaître complexe. Complexe et mystérieux dans son<br />
contenu, il interroge néanmoins notre perception de l’image mais aussi<br />
le regard que nous portons sur le monde et le temps. Cette présentation<br />
n’a pas pour dessein de dresser un parcours historique linéaire de la<br />
photographie contemporaine brésilienne. Néanmoins, nous observerons<br />
que ces images, par cet effet ou plus exactement ce jeu du voile<br />
qui les habitent viennent alors défier, par leur aspect anachronique et<br />
leur facture fortement picturale, ce qui a régit depuis les vingt dernières<br />
années le champ de la création photographique au Brésil, répondant aux<br />
impératifs médiatiques ne cessant de diffuser les sempiternels clichés<br />
d’une nation jadis aux bords du chaos. Soit une logique de production<br />
d’image que Jacques Rancière a si bien analysée comme étant de l’ordre<br />
de l’esthétique compassionnelle. L’énigme que nous proposent ces<br />
photographies, visant à atteindre l’objet photographique « clairement<br />
et distinctement », trouve sa motivation dans la mesure où cet objet<br />
semble à la fois émaner d’un réel et être recouvert d’un voile, dès lors<br />
où il est : « «voilé « par sa charge plus grande de sémanticité». Par<br />
là même, il est plus «complexe» : «l’ailleurs» est plus compliqué que<br />
«l’ici-maintenant « des localisations spatio-temporelles 2 . » Ce voile,<br />
véritable catafalque opaque autant que translucide, se dépose comme<br />
le résultat d’une longue mutation, dont l’héritage et le changement de<br />
régime ne se réfèrent pas tant directement au médium, ni au support,<br />
qu’à une démarche artistique dont les œuvres ici présentées viennent<br />
témoigner d’une posture photographique inattendue. Et cela au sein<br />
d’un climat de création et de production particulièrement effervescent,<br />
dont l’avènement est commenté par le critique et lui-même photographe<br />
brésilien Pedro Karp Vasquez de la manière suivante :<br />
« La photographie évolua de manière assez particulière au Brésil, passant<br />
d’une phase d’ample diffusion dans les ultimes décennies du XIXe<br />
siècle pour une période de semi-hibernation, de laquelle elle vient<br />
seulement se réveiller réellement au final de la décennie des années<br />
soixante de ce siècle [...] 3 »<br />
Ce constat n’est pour autant pas le simple fruit d’une mauvaise diffusion<br />
vers l’extérieur des frontières ou de la seule indifférence d’un monde<br />
nord occidental, mais également celui d’une profonde méconnaissance<br />
nationale, conséquence directe de la politique culturelle des régimes<br />
autoritaristes militaires dès les années soixante 4 . Ce parcours a pour<br />
enjeu d’explorer quatre approches et mises en œuvre singulières de<br />
ce jeu du voile, autour d’œuvres d’artistes-photographes qui s’avèrent<br />
être autant surprennantes qu’originales, et dont la perception que nous<br />
pouvons en avoir finit par produire une étrange sensation de trouble.<br />
C’est ce trouble qui vient s’inoculer dès lors au cœur des images réappropriées<br />
par la photographe Rosângela Renno qui poursuit inexorablement<br />
sa réflexion sur le poids et le rôle proéminant de l’archive.<br />
Chez Miguel Rio Branco, le voile devient le nimbe d’une muse mélancolique<br />
incarnant cette saudade contemporaine que le poète romanti-
que portugais Almeida Garrett comparaît à « une délicieuse piqûre d’une<br />
cruelle épine ». Il se manifeste encore le long des dérives nocturnes du<br />
photographe Cassio Vasconcelos au cœur de la mégalopole de São Paulo,<br />
labyrinthique par ses innombrables tentacules et ses tortueux méandres.<br />
Nous achèverons ce parcours en convoquant conjointement quelques<br />
exemples extraits des œuvres du photographe-paysagiste Ze Frota, faisant<br />
du paysage recouvert d’un voile l’espace d’une étrange étrangeté, vibrante,<br />
agissante et haptique, telles de véritables sensations tactiles. André Paolielo<br />
confère quant à lui au « genre paysage » une certaine aura ascétique et<br />
sublime, nous renvoyant en ce sens à ce que Gilbert Durand nomma en<br />
son temps une épiphanie, cette apparition mystérieuse qui donne lieu à<br />
l’expression de l’indicible 5 .<br />
Le propre de la photographie est d’être une image-double : elle combine<br />
un temps présent (de l’acte et de la perception) et un temps passé (celui<br />
du souvenir). Une des spécificités du temps présent de la saisie et de la<br />
production d’une image réside justement dans le fait qu’elle fait aussi bien<br />
appel à un futur immédiat (lors de sa révélation), tout en se référant à un<br />
temps passé de ce qu’elle vient d’enregistrer. Pour Philippe Dubois, elle est<br />
le résultat d’un écart, partagée dans un entre-deux, qui nous sépare de<br />
l’objet sensible et de sa représentation : « Et tant qu’on est dans cet entre<br />
- deux, tous les doutes sont permis. [...]. L’image, encore virtuelle, fantasme<br />
d’image, ne cesse pas de courir tous les risques, tous les rêves 6 . » Cette<br />
« mise en boîte » de l’objet s’inscrit dès lors dans une mise en abyme du<br />
temps. Si l’image ne cesse alors de « courir tous les risques, tous les rêves<br />
», nous sommes ici tentés de leur donner vie de nouveau, mais ces figures<br />
inhabitées nous renvoient a contrario vers une cruelle sensation de mort,<br />
de finitude. Par sa fonction à la fois matérielle et symbolique d’archive,<br />
en tant qu’empreinte mnémonique de l’événement, l’image nous mène à<br />
questionner cette épiphanie, consignée ici au fond de l’image, induisant<br />
un possible écart de temps, par sa lecture anachronique, et de sens. Cet<br />
écart est une sorte d’entre-deux, situé dans l’intervalle qui sépare notre<br />
réception d’une image et notre jugement esthétique, validation finale du<br />
contenu qu’elle re-présente, depuis l’instant de sa captation vers le lieu de<br />
sa monstration. Jean-Luc Nancy souligne à ce propos : « C’est ainsi qu’il y<br />
a une monstruosité de l’image : elle est hors du commun de la présence<br />
parce ce qu’elle en est l’ostension, mais comme exhibition, comme mise<br />
au jour et mise en avant 7 . »<br />
Si l’archive évidemment, résulte d’une trace (écrite, photographique) 8 , elle<br />
devient dès lors un lieu de sélection, d’organisation et de classification. En<br />
tant que lieu de consignation de l’évènement, et donc du temps, elle ne<br />
cesse en contrepartie, par son dévoilement, de modifier notre lecture de<br />
l’histoire et du monde. Or, tout comme la trace, l’essence de l’archive ne<br />
peut être complète que si elle appelle, en contrepartie, la possibilité de<br />
sa propre destruction 9 . Cette lutte pour sa propre survivance dont l’issue<br />
peut s’accomplir au risque d’une totale disparition, trouve ainsi forme dans<br />
l’œuvre singulière de Rosângela Rennó :<br />
« Je pense qu’ici est entrée l’idée de mon archivage. Ce sont des centaines,<br />
des milliers de photos mentionnées, jour après jour, dans les journaux.<br />
Chaque photographie que vous avez vue ou chaque commentaire<br />
sur une image que vous n’avez pas vu est oublié le jour suivant. [...] Si<br />
je le pouvais, j’archiverais tous les portraits du monde. » 10<br />
Alors, soucieuse du risque de disparaître dans la source de sa consignation,<br />
l’image photographique vient se recouvrir à nouveau d’un voile fin<br />
et ténu, nous mettant à distance de ce qui se situe à la limite du visible,<br />
et qui pourtant ressurgit, selon le regard qui la parcourt. Survient donc<br />
ce portrait photographique extrait d’une série intitulée Série rouge – militaires<br />
[Serie vermelha – Militares]. L’artiste procède ici à une réappropriation<br />
d’images d’archives d’officiers militaires collectées à travers le<br />
monde, mais pas de n’importe quels officiers : certains reconnaissables à<br />
leurs insignes cousus à leur veste, nous devinons que la majorité d’entre<br />
eux ont été engagés au service de régimes fascistes ou militaristes. Pour<br />
autant, ce n’est pas la reconnaissance de ces insignes qui font l’intérêt<br />
de ces œuvres. Chacune d’entre-elles est recouverte d’une fine pellicule<br />
de teinte rouge, sur la totalité de leur surface, comme un palimpseste<br />
unitaire, rendant toute tentative de lecture difficile. Le voile de couleur<br />
rouge (comme un voile « sanguin »), additionnée par l’outil numérique,<br />
plonge la figure vers le fond de l’image, et joue de la distance entre le<br />
proche et le lointain, contingente au dedans et au dehors du cadre de<br />
représentation [Fig. 1].<br />
Son effet est d’autant plus surprenant qu’il ne surgit pas de l’image à<br />
première vue, mais nécessite au contraire un temps d’accoutumance,<br />
de la même manière que l’image n’apparaît qu’à une distance proche.<br />
Lointaine, elle ne devient alors qu’un simple aplat monochrome. Outre le<br />
fait de rendre compte d’une réappropriation transgressive, dérangeante,<br />
du régime de l’archive, il n’est plus question ici de traiter d’une photographie<br />
à part entière. Mais d’un tableau spécifique où l’artiste : « fait jouer<br />
la propriété du tableau d’être non pas du tout un espace en quelque<br />
sorte normatif dont la représentation nous fixe ou fixe au spectateur un<br />
point et un point unique d’où regarder, le tableau apparaît comme un<br />
espace devant lequel et par rapport auquel on peut se déplacer 11 . »<br />
Face à l’image, nous finissons donc par atteindre quelquefois son seuil,<br />
séparés par un voile, qui nous maintient proches et distants à la fois.<br />
Résistante dans la matière même de son empreinte, elle semble nous<br />
éloigner tout en nous conviant à pénétrer au plus profond de son cœur<br />
sensible, de son essence même. Elle se présente comme une énigme<br />
dont la résolution n’est saisissable qu’au terme du trajet minutieux et<br />
attentif de notre regard qui en parcourt la surface 12 . Mais au-delà d’une<br />
question de regard, ces portraits interrogent notre place en tant que<br />
spectateur. Revenons et concentrons-nous au contraire plus en détail<br />
sur le portrait présenté précédemment, que l’on suppose être celui d’un<br />
officier japonais, au vu des insignes cousues sur les manches de sa veste :<br />
impassible, il nous fait face et nous met au défi. Alors : « chacun devant<br />
l’image – si nous nommons image l’objet, ici, du voir et du regard – se<br />
tient comme devant une porte ouverte dans le cadre de laquelle on ne<br />
peut pas entrer : l’homme de la croyance vient y voir quelque chose<br />
au-delà 13 . »<br />
41
Pouvoir de l’image qui se constitue elle-même comme lieu de l’archive,<br />
elle actualise toujours au présent son passé, une fois enregistré et archivé,<br />
à travers notre regard. Parce qu’un passé se renouvelle dans l’existence<br />
d’une image en dépit de la fragilité du support – cette incertitude vient<br />
démentir toute dimension de durée éternelle –, il rend possible une présence<br />
qui se réactive perpétuellement. Présence du temps et des êtres,<br />
eux-mêmes exclus du privilège de la représentation. Mais l’image comme<br />
lieu possible d’une perpétuelle mémoire, puise sa force non pas dans<br />
sa capacité à anticiper l’émotion, mais de revendiquer au contraire une<br />
intention, dans l’instant particulier du Je extérieur qui décide, cadre et<br />
déclenche l’acte irréversible.<br />
Mais à la différence de l’image peinte, ce passage fut possible à partir du<br />
moment où « avec la photographie, pour la première fois, la main fut<br />
déchargée, dans le processus de la reproduction des images, des plus<br />
importantes responsabilités artistiques, lesquelles n’incombaient plus<br />
qu’à l’œil qui regarde dans l’objectif 14 . » Or, si la question de l’empreinte<br />
convoque ici notre attention, c’est dans la mesure où tout comme la trace,<br />
en soi, elle : « [...] ne vaut rien telle quelle : il faut la travailler ; cela ne veut<br />
pas dire la faire revivre, ni faire revivre le vivant dont elle est la trace, mais<br />
produire quelque chose à partir d’elle 15 . »<br />
L’empreinte comme tableau nous renvoie au photographe Miguel Rio<br />
Branco citant explicitement les natures mortes minimales peintes par<br />
Giorgio <strong>Mo</strong>randi aux tonalités chromatiques grisâtres, délavées. Tonalités<br />
que l’on retrouve dans l’interprétation photographique singulière de la<br />
nature morte – non moins ironique et dramatique – qu’il nous offre, intitulée<br />
<strong>Mo</strong>randi Perverso de 1993. On y découvre, tel un effet de punctum<br />
« acide », jetée à au milieu d’un amas de bouteilles de vin vides, une seringue<br />
d’injection. Toute l’atmosphère de cette photographie se dédouble<br />
d’un silence mortifère, par le dépôt d’un voile de poussière recouvrant ces<br />
objets laissés à l’abandon [Fig. 2]. Au centre de ces vestiges, l’image surgit.<br />
Elle est apparition. Ce mode constitue, selon Walter Benjamin, l’existence<br />
même de son aura. Si l’image reste chargée d’une forte valeur indicielle,<br />
adhérant de près ou de loin à son référent, sa valeur auratique, quant<br />
à elle, réside, survit dans sa qualité iconique, associée directement à sa<br />
dimension cultuelle, dès lors où elle n’est plus perçue comme simple document<br />
anonyme mais comme œuvre d’art authentique, a priori vérifiable<br />
qu’avec la seule existence de la matrice du négatif 16 .<br />
Un nouveau seuil se constitue, dont il nous faut découvrir le mystère et<br />
dissiper les nimbes, comme nous y convie cette photographie de Miguel<br />
Rio Branco, intitulée Door into darkness de 2003. À l’instar de nombreux<br />
de ses compatriotes, Miguel Rio Branco déclare répugner à tout « sensationnalisme<br />
vulgaire, les couleurs criardes et les flashs excessifs, les images<br />
qui braillent, au lieu de parler 17 », mais est séduit au contraire par « les<br />
questions métaphysiques. L’artiste poursuit : « je me sens chaque fois face<br />
à un défi en travaillant avec l’abstraction et faire avec l’apparente simplicité<br />
des images une complexité d’idées » [Fig. 3] 18<br />
C’est une porte qui ouvre sur un monde aux espaces souvent clos, mélancoliques,<br />
lointains de tout imaginaire édénique de carte postale ; leur<br />
force nous maintient tout autant dans un silence, un arrêt, figés dans ces<br />
paysages de ruines, dans leur moindre détail. Un rapport au monde, donc,<br />
comme Miguel Rio Branco nous le précise, de par sa complexité et sa capacité<br />
à y faire ressurgir ce qu’il possède de plus sombre :<br />
« Le monde qui nous entoure est un sous-monde de violence, de douleur<br />
et de solitude. C’est ce que je tente de montrer dans mes photographies,<br />
sans juger et sans brutalité. Je ne raconte pas d’histoires – je recherche une<br />
construction plus poétique. La base de mon travail est « armée », je me suis<br />
toujours intéressé au détail et par une donnée inhérente à la photographie,<br />
le temps et le hasard 19 . »<br />
Un troisième cas d’effet de voile se présente, révélant dans l’espace qu’il semble<br />
couvrir une sensation de vide prédominante, sans éluder pour autant un<br />
type d’espace duquel émane ce que Jean-Claude Lemagny désigne comme<br />
une « étendue rêveuse », trouvant lieu dans « l’empire immense et mouvant<br />
de l’imaginaire 20 . » Toutefois : « Elle est proprement espace, vide, partie de<br />
vide entre des choses, pas toujours nettement mais toujours évidemment<br />
délimitée par des objets. Et ce qui caractérise d’abord cette étendue rêveuse<br />
– aussi diverse soit-elle – c’est d’être habitée, hantée, par un esprit invisible,<br />
l’esprit du lieu, genius loci 21 . »<br />
C’est donc à partir de ce caractère fantomatique que se poursuit notre<br />
parcours au sein d’espaces empreints de cette « étendue rêveuse » au beau<br />
milieu des espaces vides qu’ils nous donnent à voir. Qu’ils soient urbains,<br />
naturels, ou qu’ils se rapportent un type de représentation d’espaces donnés<br />
comme réels mais dont le traitement résulte d’interventions techniques<br />
originales, ces espaces ne finissent-ils pas par faire de ces paysages ceux où<br />
vient se refléter notre espace intérieur ? Comme le souligne Maria Cristina<br />
Batalha : « Le paysage protéiforme et ses transformations successives créent<br />
un pont entre le présent et le passé, entre le mythe et la réalité 22 . Telle est la<br />
question posée de la série intitulée Nocturnes [Noturnos], réalisée par Cássio<br />
Vasconcelos à l’aide d’un appareil polaroïd, et conçue tout au long d’une<br />
déambulation nocturne à travers différents quartiers de São Paulo pendant<br />
près de quatre ans. Nous avons ici deux photographies de sites qui, bien<br />
que faisant partie intégrante de la mégapole brésilienne, tendent à rendre<br />
compte de deux situations différentes. Le premier représente un bâtiment<br />
public recouvert d’un filet de protection [Fig. 4]. Le second se rapporte à<br />
un cimetière situé à l’extérieur de la ville, dans le quartier d’Araça [Fig. 5].<br />
Cette expérience de la ville éprouvée au sein de cette lente déambulation<br />
s’éclaire fort bien à partir de ce que le géographe Milton Santos estime être<br />
de l’ordre d’une transindividualité, soit une construction établie à partir « des<br />
relations inter-humaines qui incluent l’usage des techniques et des objets<br />
techniques 23 . »<br />
Définie initialement par Gilbert Simondon dans un discours critiquant les<br />
liens qui assujettissaient les nouveaux réseaux de communication au pouvoir<br />
politique, force est de constater que ces deux exemples démontrent<br />
comment le propre isolement nocturne du photographe dans la ville n’est<br />
autre alors que l’affirmation d’une posture observant « le cloisonnement de<br />
l’interaction humaine dans l’espace […] est autant un aspect de la territorialité<br />
que de la transindividualité 24 . » Pour autant, cette œuvre souligne la<br />
manière dont la relation qui unit l’individu à son espace environnant peut se<br />
construire vis-à-vis d’un type d’espace particulier, celui d’un espace praticoinerte<br />
dans lequel « les cristallisations de l’expérience passée, de l’individu<br />
et de la société, corporisées en formes sociales, et aussi en configurations<br />
spatiales et paysages 25 . »
Si le paysage urbain reste l’un des objets prédominants du photographe,<br />
celui-ci continue de rechercher au travers de cette série une autre possibilité<br />
de transposer l’aspect profondément documentaire de la photographie en lui<br />
conférant un caractère typiquement artistique, pictural, et de surcroît fortement<br />
graphique. C’est pourquoi, comme le remarque Nelson Brissac Peixoto :<br />
« Un déplacement essentiel intervient ici : la signification de ces monuments<br />
n’est plus inscrite directement dans le paysage mais dans l’image. Cássio<br />
Vasconcelos est un photographe radicalement contemporain : son point de<br />
départ – sa réalité première – est le propre monde des images 26 . » Il parvient<br />
à ce but par le traitement saturé de la couleur qui engage de francs rapports<br />
de contrastes (simultanément dû à l’usage de la pellicule polaroïd, mais aussi<br />
d’un éclairage extérieur artificiel à l’aide de projecteurs et de filtres colorés)<br />
qui confèrent à chacun des tirages un caractère qui n’est pas sans évoquer<br />
certaines anciennes photographies peintes.<br />
Un caractère dont l’effet s’accentue d’autant par le tirage par impression sur<br />
papier obtenu à partir de jets d’encre. Cette approche de la ville produit alors<br />
un climat étrange modifiant profondément le sens que nous avons d’une ville,<br />
ici déserte, vidée de toute présence humaine. Nocturnes est le résultat d’une<br />
ville dont la perception est partagée entre désolation et vision futuriste, et<br />
dont le portrait ici dépeint nous éveille la sensation lugubre et décadente d’un<br />
sentiment mortifère. C’est dans l’intégralité de cette série que s’esquisse tout<br />
le paradoxe des images de Cássio Vasconcelos : « elles traitent de faire de la<br />
photographie, qui en principe appartient au monde réel – toujours utilisée<br />
comme preuve documentaire, évidence de réalité –, être un portrait d’un<br />
temps archaïque, mythique. [...] Elles fonctionnent comme un voile, mettant<br />
en évidence le mystère qui les enveloppe 27 . »<br />
Nous arrivons au terme de l’ énigme sur laquelle nous avons tenté de lever<br />
le voile. Ne reste à présent qu’à convoquer deux types de voiles propres à la<br />
représentation du paysage dont la représentation reste homogène et cohérente<br />
dans leur lecture, bien que l’effet vibrant de leur facture leur confère un<br />
aspect aussi trouble qu’hétérogène, et notamment par la sensation optique<br />
produite. Des espaces parmi lesquels nous perdons progressivement tous<br />
repères, attentifs à leur dimension rêveuse, c’est-à-dire ceux où « l’unité d’un<br />
paysage s’offre comme l’accomplissement d’un rêve souvent rêvé, mais le<br />
paysage onirique n’est pas un cadre qui se remplit d’impressions, c’est une<br />
matière qui foisonne 28 . » Tel est le climat que nous offre cette photographie<br />
de Ze Frota, extraite d’une série intitulée Espaces intérieurs [Espaços Interiores]<br />
réalisée dans la ville de João Pessoa, en 2008, exposée récemment lors du 17e<br />
salon de la photographie au Musée d’Art de São Paulo [Fig. 6]. Nous pouvons<br />
ainsi rapprocher cet espace intérieur de celui de la saudade dans la mesure<br />
où il peut se présenter lui-même en tant que lieu similaire d’où surgissent<br />
et vibrent des sensations comparables à celles produites vis-à-vis du temps,<br />
et qui en ravivent le souvenir précis. Georges Bataille, entre autres, a décrit<br />
l’une de ces sensations dans son livre L’expérience intérieure, qui le conduirent<br />
vers un état qu’il nomme lui-même « L’extase », phénomène dont l’intensité<br />
proche des « états mystiques 29 . »<br />
Ce paysage intérieur, au propre comme au figuré, photographié par Ze Frota<br />
nous offre une représentation dont le lieu choisi – un simple terrain, une rue<br />
depuis laquelle nous entrapercevons deux panneaux publicitaires peints<br />
à même le mur – nous apparaît une fois de plus dans sa plus grande<br />
banalité. Son traitement plastique mérite toutefois notre attention : le<br />
flou général dans lequel baigne cette image nous amène à considérer un<br />
aspect particulier de la photographie, que Bernhardt Berenson a localisé<br />
dans l’art pictural comme proche des valeurs tactiles. Les tons sombres<br />
et sourds qui dominent ce paysage nocturne emphatisent ces valeurs<br />
qui résonnent ici par le contraste et le réveil de zones plus lumineuses,<br />
révélées par une lumière blafarde venant éclairer, comme par touches<br />
localisées, la rue et les publicités peintes de la palissade. L’effet de trouble<br />
est aussi renforcé par le flou que l’on suppose provenir du tremblement<br />
de l’obturateur, conférant de plus à cette image un aspect âpre et poreux<br />
proche de la propre matérialité organique de ce lieu, où ne subsiste que<br />
la terre, le bois, ou encore les murs repeints, mais qui confère aussi à ce<br />
paysage, un aspect aussi étrangement silencieux qu’angoissant.<br />
C’est pourquoi le fait de rapprocher cette photographie de ces potentielles<br />
valeurs tactiles mérite d’être souligné, non seulement parce que<br />
celles-ci supposent une part active du spectateur dans sa lecture. Mais<br />
également à partir du moment où nous le considérons comme « agissant<br />
», son traitement plastique de sa facture agit de manière similaire à<br />
ces valeurs, produisant des stimuli décrits comme : « Intensément réels<br />
dans le sens où ils excitent de toute leur force notre imagination tactile,<br />
puisqu’ils s’imposent subitement, dans toutes choses qui stimulent notre<br />
sens du toucher pendant qu’ils se présentent à nos yeux, afin d’approuver<br />
leur existence 30 . » L’étrangeté de ce climat nous conduit donc à aborder<br />
un dernier cas relatif à cette question de la représentation photographique<br />
du paysage brésilien contemporain. Un paysage qui, selon Nelson Brissac<br />
Peixoto, reste difficile à comprendre tant il semble qu’à l’inverse de la<br />
peinture, la photographie « évoque tout ce qu’elle n’est pas [...] pour questionner<br />
son propre regard mécanique. » Même si l’auteur admet qu’au sein<br />
de ce paysage contemporain « Quelque chose se produit entre le regard<br />
et le monde, qui n’est pas de simples représentations mais qui se donne à<br />
la reproduction artistique : la présence de l’image 31 », ce quelque chose<br />
n’est peut être pas autre que le mystère de sa « magie du rien ». Parce que<br />
la représentation du paysage reste significative d’un certain vide opérant<br />
dans l’image non par soustraction mais au contraire par accumulation,<br />
celle-ci ne reste pas exempte également d’un rien. Cette notion de rien<br />
n’est pas si contemporaine qu’elle le semble, et reste capitale en ce qui<br />
concerne la compréhension du lien que le sentiment de saudade peut<br />
induire vis-à-vis de sa représentation spatiale photographique. Pour cela,<br />
nous pouvons prendre appui sur l’analyse que nous propose Pierre Wat<br />
sur l’œuvre du peintre anglais John Constable : « Au grand, qu’il refuse de<br />
peindre, Constable substitue la peinture de ce qu’il nomme le «rien» . [...]<br />
Ce qui pour les critiques est un défaut, est précisément cela même qui, aux<br />
yeux de Constable, permet de définir la finalité de sa peinture 32 . »<br />
Si cette référence finalement faite à la peinture romantique peut paraître<br />
surprenante, elle n’est pas cependant fortuite. En effet, deux exemples de<br />
photographies présentées récemment viennent poser une ultime question.<br />
Si nous prenons en considération que « la nature, dans la conception<br />
romantique, se suffit à elle-même », et que « dès lors que le regard du<br />
peintre réhabilite sa valeur symbolique, le sujet au sens classique tend<br />
à disparaître au profit d’une plus grande attention portée à la peinture<br />
elle-même 33 », un aspect s’oppose aux peintures de paysage telles que<br />
Nicolas Antoine Taunay pu en réaliser, et reste en complète opposition à<br />
43
« la revalorisation romantique de la notion de nature individuelle », qui<br />
« va de pair avec l’abandon des principes de sélection et de combinaison<br />
34 . »<br />
Dès lors, le clivage qui semble opposer l’image photographique à l’image<br />
peinte pour Brissac Peixoto n’est peut être pas si évident. Ainsi, nombre<br />
d’exemples nous montrent au contraire que ce questionnement du « regard<br />
mécanique » ne cesse pas d’être, aujourd’hui, remis en question.<br />
Les peintres de paysage modernes n’ont-t-ils d’ailleurs pas eu recours<br />
à des moyens optiques leur permettant d’ordonner une représentation<br />
savante et rationnelle du paysage afin, justement, de parvenir à être ce<br />
qu’elle n’a peut-être jamais cessé d’être, l’incarnation d’un regard porté<br />
sur le monde ?<br />
Or, plus qu’une question de regard, ne s’agirait-il pas de celle d’une<br />
limite qui, une fois franchie, nous conduirait vers l’un des espaces des<br />
plus mystérieux et inconnu, illimité, comme nous y invitent ces deux<br />
dernières photographies récentes d’André Paolielo, entièrement nimbées<br />
de brume, où « L’espace photographique ici une relation avec l’infini – il<br />
n’y a pas de bordure dans le ciel – est l’antithèse du cadre de la peinture.<br />
Nous avons des fragments d’infini, recoupés dans la propre matière lumineuse<br />
» [Fig.7] 35 .<br />
Ainsi, ce « retour » pictural assurément anachronique peut trouver son<br />
interprétation dans une lecture que nous propose Jean Clair, pour lequel<br />
« ce qui était souvenir enfoui au plus intime, ce que l’on savait depuis<br />
toujours faire partie d’un savoir commun oublié, revient et prends corps,<br />
comme une apparition 36 . » Cette apparition semble être celle du spectre<br />
du peintre romantique. L’effet n’en est que plus inattendu.<br />
Mais ce trouble qui n’a cessé de traverser ces dernières images semble<br />
trouver ici le lieu ultime de son expression : il se concentre en elles, survenant<br />
dans le lien existant entre l’espace photographique qui se donne<br />
à voir et la position de celui qui les regarde – mais un lien qui reste<br />
autant indépendant qu’incertain. Si bien que chacune de ces images finit<br />
par être « entièrement libérée, coupée de ses amarres, flottant dans le<br />
ciel, exactement comme un nuage 37 . » Survient alors l’offrande sublime.<br />
Celle-ci ne se doit pas non seulement d’être offerte, mais comme le<br />
précise Jean-Luc Nancy :<br />
« Dans ce qui, aujourd’hui, offre l’art à son avenir, il y a de la sérénité.<br />
[...]L’offrande renonce au déchirement lui-même, à l’excès de la tension,<br />
aux spasmes et aux syncopes sublimes. Mais elle ne renonce pas à la<br />
tension et à l’écart infinis, elle ne renonce pas à l’effort et au respect,<br />
ni au suspens toujours renouvelé qui rythme l’art comme une inauguration<br />
et comme une interruption sacrées. Simplement, elle les laisse<br />
nous être offerts 38 . »<br />
1 Georges DIDI-HUBERMAN, Devant l’image, Paris, Éditions de Minuit,<br />
1990, pp. 192 -193.<br />
2 Id. p. 65.<br />
3 Pedro KARP-VASQUEZ, Fotografia – Reflexos e reflexões, Porto Alegre,<br />
L&pm editora, 1986, p. 27.<br />
4<br />
Comme le souligne Helouise Costa : « La méconnaissance de la photographie<br />
moderne brésilienne atteint non seulement les photographes, comme<br />
aussi les critiques et les historiens de la photographie. [...] Nous sommes très<br />
distants des espérances du développement rapide des années cinquante,<br />
ce qui signifie que les solutions plastiques de caractère moderniste employées<br />
par plusieurs photographes contemporains se réfèrent à une vision<br />
du monde qui ne correspond plus au moment dans lequel nous vivons. »<br />
in Helouise COSTA- Renato RODRIGUES da SILVA, A fotografia moderna no<br />
Brasil, São Paulo, Cosacnaify, 2005, p.114<br />
5 « J’écrivais jadis, le symbole est l’épiphanie d’un mystère. Le sens inexprimable<br />
s’exprime en se localisant dans le symbolisant. Mais toute localisation<br />
lexicale nécessite à son tour de se lester de sens. L’œuvre du poète et de<br />
l’artiste localise, celle du mythicien synchronise, ils capturent le sens dans<br />
les réseaux inépuisables de l’expression. » Gilbert DURAND, L’imagination<br />
symbolique, Paris, PUF, 2003, p. 64.<br />
6 Id.<br />
7 Jean-Luc NANCY, Au fond des images, Paris, Galilée, 2005, pp. 46-47.<br />
8 Pour Michel Foucault : « C’est d’abord la loi de ce qui peut être dit, le<br />
système qui régit l’apparition des énoncés comme des évènements singuliers<br />
[...] l’archive n’est pas ce qui sauvegarde, malgré sa fuite immédiate,<br />
l’événement de l’énoncé et conserve, pour les mémoires futures, son état<br />
civil d’évadé ; c’est ce qui, à la racine même de l’énoncé-événement, et<br />
dans le corps où il donne, définit d’entrée de jeu le système de son énonciabilité.»<br />
Michel FOUCAULT, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969,<br />
pp. 170-171.<br />
9 Comme le remarque Jacques Derrida : « [...] elle ne pousse pas seulement<br />
à l’oubli, à l’amnésie, à l’annihilation de la mémoire, comme mnémé [...] elle<br />
commande aussi l’effacement radical, en vérité l’éradication de ce qui ne<br />
se réduit jamais à la mnémé, à savoir l’archive, la consignation. » Jacques<br />
DERRIDA, Mal d’archives, Paris, Galilée, 1995, pp. 26 - 27.<br />
10 Extrait de l’entretien de Rosàngela Rennó donné à Maria Angélica<br />
MELENDI et Wander MELO MIRANDA, publié partiellement sous le titre Un<br />
monde parallèle-Entretien dans Margens / Márgenes-cadernos de cultura n˚1,<br />
Belo Horizonte / Mar del Plata, mai 2001, pp 6-9. Cité in Rosàngela RENNÓ,<br />
Depoimento, Belo Horizonte, Circuito atelier, 2003, pp. 10-11.<br />
11 Michel FOUCAULT, La peinture de Manet, col. Traces écrites, Seuil, Paris,<br />
2004, p. 47.<br />
12 Une énigme dont l’étrangeté, de nouveau, vient confirmer : « la paradoxale<br />
fécondité de l’anachronisme. Pour accéder aux multiples temps<br />
stratifiés, aux survivances, aux longues années du plus-que-passé mnésique,<br />
il faut le plus-que-présent d’un acte réminiscent : un choc, une déchirure<br />
de voile, une irruption ou apparition du temps. » Cf. DIDI-HUBERMAN,<br />
Devant le temps. Histoire de l’art et anachronisme des images,Paris, Editions<br />
de Minuit, 2000, p. 20.<br />
13 Id.<br />
14 Walter BENJAMIN, Petite histoire de la photographie, Paris, Etudes photographie<br />
n°1, Société Française de Photographie, 2005, p. 20.<br />
15 François SOULAGES, « La trace ombilicale », article cité in Danièle MÉAUX<br />
– Jean-Bernard VRAY, Traces photographiques, traces autobiographiques,<br />
Saint-Etienne, Publications de l’Université de Saint-Etienne, 2004, p. 21.<br />
16 La définition de l’aura comme « unique apparition d’un lointain, si proche<br />
qu’elle puisse être » n’est rien d’autre que la formulation de la valeur<br />
cultuelle de l’œuvre d’art dans les catégories de la perception spatio-temporelle.<br />
Lointain est le contraire de proche. Le lointain par essence est
l’inapprochable. De fait l’image qui sert au culte a pour principale qualité<br />
d’être inapprochable. [...] S’il est possible d’approcher sa matérialité, c’est sans<br />
rompre ce lointain où elle reste après être apparue. » in Walter BENJAMIN,<br />
id, op.cit., pp. 28-29.<br />
17 Miguel RIO BRANCO, propos extraits d’un entretien donné au supplément<br />
du journal O Estado de São Paulo, le 27/10/1998, cités in Simonetta<br />
Persichetti, Imagens da fotografia brasileira, São Paulo, Estação Liberdade/<br />
Senac, 2000, p. 148.<br />
18 Id.<br />
19 Ibid., p. 147.<br />
20 Jean-Claude LEMAGNY, « Genius loci ou l’étendue rêveuse », in Cahiers<br />
de la photographie n°14, « Le territoire », p. 87.<br />
21 Id.<br />
22 Maria Cristina BATALHA, « Le paysage dans Demônios d’Aluísio Azevedo :<br />
une troisième rive du naturalisme », in Paysages de la lusophonie, Centre de<br />
recherche sur les pays lusophones – CREPAL, Paris, Presses de la Sorbonne<br />
Nouvelle, 2009, p.117.<br />
23 Milton SANTOS, « O lugar e o cotidiano » in A natureza do espaço, São<br />
Paulo, HUCITEC, 1999, p. 254. La notion de transinidvidulalité apparaît donc<br />
pour la première fois dans la thèse soutenue par Gilbert Simondon en 1958.<br />
Initialement publiée en deux tomes en 1964, pour le premier tome intitulé<br />
L’individu et sa genèse physico-biologique et en 1989, pour le second, intitulé<br />
L’individuation psychique et collective (1989), je revoie le lecteur vers l’édition<br />
vers la publication de ce second volume paru en 2007 aux Éditions Aubier.<br />
24 Id., p. 254.<br />
25 Ibid., p. 254. Le « pratico-inerte » renvoie vers un milieu dans lequel les<br />
hommes agissent sous l’empire de la matière ouvrée, du monde façonné par<br />
le travail, des activités réglées par le collectif, assujetit à un effet de « sérialité<br />
» qui finit ainsi par tranformer les individus en des multiplicités humaines,<br />
en les configurant comme autant d’éléments interchangeables. Cf. Jean-Paul<br />
SARTRE, “De la praxis individuelle au pratico-inerte”, in Critique de la raison<br />
dialectique, Paris, Gallimard, Tome 1958, p. 219-220.<br />
26 Nelson BRISSAC PEIXOTO, « Janelas, estátuas » in Paisagens urbanas, São<br />
Paulo, SENAC, 2004, p. 137.<br />
27 Id., p. 140.<br />
28 Gaston BACHELARD, L’Eau et les rêves, Paris, José Corti, 1991, p. 6.<br />
29 « Avant de me lever pour aller dormir, je sentis à quel point la douceur des<br />
choses m’avait pénétré. [...] Tout au moins, comme j’étais passé brusquement<br />
de l’inattention à la surprise, je ressentis cet état avec plus d’intensité qu’on<br />
ne fait d’habitude et comme si un autre et non moi l’éprouvait. Je ne pouvais<br />
nier qu’à l’attention près, qui ne lui manqua que d’abord, cette félicité banale<br />
me fût une expérience intérieure authentique, distincte évidemment du projet,<br />
du discours. » Georges BATAILLE, « L’extase » in L’expérience intérieure, Paris,<br />
col. Tel, Gallimard, 2006, pp. 130 -133.<br />
30 Selon Bernard Berenson, ces valeurs ne sont pas des phénomènes d’ordre<br />
optique mais bien tactiles. Ceci dans la mesure où elles restent localisées au<br />
sein de notre imaginaire, qui recréent « virtuellement » la sensation à laquelle<br />
chacune d’entre-elle est assimilée. Si bien que notre imaginaire est stimulé<br />
de telle manière que le spectateur, face à ce qu’il regarde, en l’occurence un<br />
tableau, est amené à ressentir le volume des objets, jusqu’à tester leur potentiel<br />
de résistance. Bien que mise en contact avec ces objets grâce au recours<br />
à ces valeurs, celles-ci le mènent à éprouver simultanément le désir de les<br />
toucher, tout en étant accompagné d’un sentiment de distance. Cf. Bernard<br />
BERENSON, in The florentine painters of the Renaissance, G.P. PUTNAM’S<br />
SONS, The Knickerbocker Press, New York, 1909, p. 11. Texte intégral de<br />
nouveau disponible, également sur le lien : http://www.gutenberg.org/<br />
files/17408/17408-h/17408-h.htm<br />
31 BRISSAC PEIXOTO, id., op.cit., p. 125.<br />
32 Pierre Wat nous précise de plus que dans ce contexte : « faire quelque<br />
chose de rien » n’est ici, ni faire de la peinture abstraite avant la lettre, ni<br />
de peindre qu’avec son imagination, mais bien voir la peinture comme<br />
un « art d’imitation «, « un art qui consiste à réaliser, non à feindre «, un<br />
art né de la fusion romantique de l’abstraction avec le naturalisme. [...] Et<br />
cette vérité, autrement dit ce qui doit être peint, c’est la nature per çue<br />
dans sa diversité. Pour qui sait voir la peinture ainsi, il n’y a pas de petit<br />
sujet. À l’homme qui sait regarder, la nature livre ses sujets, sa « vérité «.<br />
La peinture est un art d’imitation en ce qu’elle obeit aux mêmes lois que<br />
la nature. » Pierre WAT, « Peindre le rien » in Naissance de l’art romantique,<br />
Paris, Flammarion, 1998, pp. 103-104. Cf. Charles Robert LESLIE, John<br />
Constable d’après les souvenirs recueillis par C.R Leslie, trad. L. Bazalgette<br />
[1905]. Édition révisée et préfacée par Pierre WAT, Paris, col. Beaux-Arts<br />
Histoire, ENSB-A, 1996, p. 130.<br />
33 Id., p. 103.<br />
34 Ibid., p.105<br />
35 Nelson BRISSAC PEIXOTO, id. p. 125.<br />
36 Cf. CLAIR, op.cit., pp. 78-79.<br />
37 Cf. Nelson BRISSAC PEIXOTO, ibid.<br />
38 Jean-Luc NANCY, « L’offrande sublime » in Le sublime, Paris, Belin,<br />
1988, p. 75.<br />
45
(Rio Branco 1, Rio Branco 2, Frota, Rosagela Renno) Samuel de Jesus<br />
47
Sur Noir<strong>#1</strong> de Mustapha Azéroual<br />
par Jérôme Duvigneau<br />
L’apparition de la photographie au 19ème siècle retentit dans la<br />
peinture, sapant pour un temps ses ambitions réalistes. Dès son<br />
origine contrainte de se mesurer à l’image peinte, c’est dans le même<br />
temps qu’elle vient la miner par sa manière distincte de puiser dans<br />
la réalité du monde. L’unité construite du tableau jusqu’alors recherchée<br />
comme condition essentielle de la peinture se dissipe dans la<br />
fragmentation de l’illusion picturale et réduit peu à peu l’image au<br />
déploiement de ses procédés concrets. Si l’exploration conjointe du<br />
noir et de l’abstraction a une histoire qu’il faut chercher du côté de<br />
la peinture lorsqu’elle se détourne du monde extérieur vers l’étude<br />
systématique de ses propres modalités de production, il ne faut<br />
pas oublier que sa rencontre avec la photographie en précipite le<br />
mouvement. La voie ouverte depuis l’impressionnisme se radicalise<br />
au XXe siècle en se tournant vers les propriétés internes du plan<br />
de la toile.<br />
Malevitch expose en 1915 le Carré noir sur fond blanc, donnant<br />
acte de naissance au suprématisme. En construisant les bases de<br />
l’abstraction moderne sur l’apparition et la disparition de la lumière<br />
il consacre cette opposition comme la condition de l’espace peint.<br />
Rodtchenko lui répond lors de l’exposition Création non-figurative et<br />
suprématisme de 1919 par le Noir sur Noir, dissolution et résolution<br />
des couleurs dans le noir, au plus loin de la mimésis.<br />
Cette histoire passe également par les Black Paintings d’Ad<br />
Reinhardt qui à partir de 1960 et jusqu’à sa mort, ne peint plus<br />
que des peintures noires au format identique de cinq pied sur cinq,<br />
composées de neuf carrés égaux où la forme et la couleur sont<br />
amenées vers un degré minimum au-delà duquel il n’y a plus, selon<br />
lui, de peinture possible. Ces expériences décisives, auxquelles on<br />
pourrait ajouter un grand nombre de peintres depuis les années 50,<br />
ont marqué l’histoire de la peinture d’une volonté radicale d’autonomie<br />
à l’égard de la représentation et des outils picturaux du passé.<br />
Lorsqu’une peinture noire ne cherche plus à donner autre chose à voir<br />
que la peinture c’est d’une certaine manière, et c’est cette manière qui est<br />
l’enjeu, l’objet qui se retire au profit de la matière même du plan pictural. Le<br />
noir nous entraîne vers une problématique de la vision et de son seuil.<br />
Cette problématique moderne de questionnement du médium et des<br />
conditions de sa réception investit inévitablement le champ de la photographie<br />
à l’horizon de la question du regard. C’est à partir des caractéristiques<br />
qui lui sont propre, depuis sa différence avec la peinture, que<br />
son histoire se développe dans la tension de ses aspirations à être un<br />
instrument de reproduction mais également un plan d’expression, dans<br />
une oscillation entre l’empreinte et la représentation. Par nature indicielle<br />
dans sa dimension mécanique d’enregistrement d’un fragment de réalité,<br />
elle ne peut s’affranchir totalement du rapport nécessaire qu’elle entretient<br />
avec le monde extérieur. Les modalités de ce rapport, le type d’image que<br />
cela produit, l’a priori qui le sous-tend et la nature du regard que cela<br />
détermine, sont les questions qui lient théorie et pratique.<br />
Les travaux de Laszlo <strong>Mo</strong>holy-Nagy sur la lumière comme matière première<br />
et unique du photographique, les Vérification d’Ugo Mulas sur la<br />
spécificité du médium photographique (dont la première image montre<br />
l’amorce d’un film photosensible noir sur un fond noir et s’intitule Homage<br />
to Niepce) ou encore les clichés noirs de la première période de Bernar<br />
Venet, sont autant de recherches radicales pour se saisir de l’intérieur du<br />
photographique de sa potentialité propre tout en ouvrant la question de la<br />
réception vers la présence articulée du visible, de l’invisible et des regards.<br />
La tentation du noir pour ce médium de la lumière et la plongée dans<br />
l’abstraction pour un art reproductif indique son éloignement par rapport<br />
au réel, détruisant l’évidence de la transparence supposée en dissociant<br />
la trace photographique de son pouvoir de révélation.<br />
C’est dans cette perspective que les photographies de Mustapha Azéroual<br />
se présentent d’emblée comme puissance de questionnement, l’œil qui<br />
s’y confronte parcourt l’aplat photographique en faisant l’expérience de
son propre aveuglement. La mise en crise du regard plongé dans la<br />
profonde opacité d’une image qui ne se livre que très lentement, qui<br />
ne consent à délivrer ses informations visuelles qu’à la condition d’y<br />
perdre tout d’abord la vue, déroute le spectateur en le plaçant au cœur<br />
d’un paradoxe.<br />
Il est impossible de saisir l’image dans sa présence immédiate sans<br />
qu’elle en soit creusée par l’absence, par le retrait de ce qui est exposé.<br />
C’est dans ce renversement quant à la position naturelle du regard, attitude<br />
inconsciente d’elle-même adhérant à la croyance en une transparence<br />
de la saisie du monde comme objet extérieur, que se situe l’enjeu<br />
du questionnement à l’œuvre. Il s’agit donc de penser le photographique<br />
comme champ d’investigation des possibilités du médium lui-même,<br />
trait caractéristique de la modernité pour Clement Greenberg, mais sans<br />
amplifier ses effets pour en accroître la performance car le spectaculaire<br />
viendrait subordonner le regard à sa rhétorique écrasante en lieu et place<br />
de la conscience de chacun. C’est dans la mise en jeu du non-visible que<br />
le spectateur de cette œuvre au noir est requis pour la compétence de<br />
son regard.<br />
Mustapha Azéroual propose une série photographique de six planches<br />
numérotées, réunies sous le titre générique de Noir<strong>#1</strong>. L’adjectif au masculin<br />
singulier vaut pour indice de ce qui va se dérouler dans l’espace<br />
optique, l’utilisation du noir comme d’une matière première. Ceci oriente<br />
le rapport de l’ombre et de la lumière, indispensable à la photographie,<br />
vers la lumière minimale, vers sa disparition, menant méthodiquement<br />
le visible jusqu’à son seuil, c’est-à-dire le lieu où nécessairement quelque<br />
chose nous échappe en se retirant dans le non-visible. Ce travail sur le<br />
noir s’élabore sur la voie de l’abstraction dès lors que le retrait du visible<br />
frappe toute forme du sceau de l’indétermination.<br />
Un travail dans les hautes lumières couplé à une ouverture rapide<br />
permet d’impressionner le négatif uniquement pour les zones les plus<br />
claires. Toutes les parties qui ne se trouvent pas dans les hautes lumières<br />
apparaissent sombres ou totalement noires. C’est donc dès l’opération<br />
de prise de vue que Mustapha Azéroual construit l’image abstraite de la<br />
lumière en pensant sa disparition. La majeure partie de la prise de vue<br />
est dévorée par l’obscurité, engloutie dans un noir profond qui absorbe<br />
les rayonnements des vestiges de lumière qui par endroit le balafre en<br />
découpes géométriques. Halo humide flottant au bord du gouffre, diagonale<br />
épuisée pareille à une ligne d’horizon crépusculaire, reflets irréels<br />
cramponnés aux surfaces grenues qui cherchent encore à diffuser leur<br />
pâle lueur et parfois, quelques sursauts lumineux qui tombent à l’aplomb<br />
de formes rectilignes, crevant l’obscurité mais sans pour autant que l’on<br />
puisse en assurer la provenance.<br />
Cette lumière consubstantielle au médium photographique n’est pas<br />
invisible mais elle participe à l’élaboration de la matière noire par son<br />
retrait dans le non-visible par sa disparition ou son épuisement sous des<br />
stratifications d’ombres. Le non-visible n’est pas l’invisible, il s’en distingue<br />
en ce que sa disparition n’est pas constitutive de son essence mais provisoire<br />
ou circonstancielle, c’est en fin de compte du visible qui ne se voit<br />
plus mais qui à ce titre porte en lui la menace de la chute dans l’invisible.<br />
C’est cette disparition qui fond le regard du spectateur dans l’expérience<br />
de son aveuglement, parce que quelque chose manque à l’endroit où l’on<br />
s’attendait à le trouver. Parce que le vieux présupposé « réaliste » de la<br />
photographie à travers laquelle nous saisirions le monde nous engage<br />
presque « malgré nous » à désirer la présence et que le noir est l’indice<br />
de tout ce qui manque, mais comme pure présence de l’indice.<br />
Cette déroute du regard tient donc à la fois à une déception, ce que<br />
l’on pouvait attendre de l’image photographique n’est là que par son<br />
absence, et en même temps à l’ambiguïté de la présence indicielle de<br />
ce qui manque ; à cette crainte plus profonde que cette présence-là<br />
nous renvoie l’impossibilité de saisir le monde comme autre chose que<br />
ce qui s’absente. Si la perception suppose qu’une conscience se dirige<br />
vers un objet en le tenant pour présent, il va tout autrement de l’image<br />
qui a sa condition d’existence dans l’absence de l’objet. Pour qu’il y ait<br />
image d’une chose représentée il faut que cette chose soit absente,<br />
que l’être de cette chose n’y soit pas en tant qu’être. Dans les photos<br />
de Mustapha Azéroual c’est une absence non par soustraction mais par<br />
addition. L’espace est envahit par la projection de l’ombre effondrant les<br />
limites des formes qui l’ont engendrée, l’apparence est alors contrainte<br />
de s’effacer.<br />
49
VAGUE TERRAIN<br />
51
Portfolio : Noir<strong>#1</strong><br />
de Mustapha Azéroual
Giulietta<br />
par Valérie Nam<br />
Des heures entières j’ai tourné autour d’elle. Sans jamais la toucher, pourtant<br />
si belle et présumée douce à force de laque rouge.<br />
Le temps d’un été, chaque fois que possible, j’ai admiré ses formes goulûment,<br />
d’emblée charmé par son arrogance et sachant qu’elle ne serait pas<br />
toujours telle, offerte aux regards.<br />
J’ignore ce qui advint d’elle. Vendue, récupérée par son propriétaire, je n’ai<br />
pu le découvrir. Il ne me reste que des images trouvées dans des catalogues<br />
et quelques magazines spécialisés.<br />
On pourra trouver étrange ce goût qui m’a porté ailleurs que vers le prestige<br />
d’une Ferrari ou d’une Porsche. Plus modestement, j’ai été séduit par<br />
la fausse discrétion d’une Alfa Roméo.<br />
Une découverte hasardeuse en somme, j’étais peu coutumier du genre<br />
d’établissement où on la tenait exposée. J’en suis de fait devenu assidu,<br />
j’ai appris avec cœur les horaires d’ouverture, adapté mon rythme et plié<br />
mon emploi du temps aux exigences du lieu pour, chaque fois que possible,<br />
pouvoir me glisser vers elle, au plus près du regard. Si près que j’aurais pu,<br />
du bout des cils, la débarrasser de la moindre poussière.<br />
Longtemps j’ai déploré qu’elle soit enfermée de la sorte, une voiture après<br />
tout ne craint pas les intempéries ; puis j’ai compris l’utilité du parcours, la<br />
nécessité d’éprouver la distance qui mène à elle et l’importance aussi du<br />
temps déposé entre nous.<br />
Jamais je n’ai écouté, encore moins sollicité, le moindre commentaire la<br />
concernant. Les particularités techniques, la symbolique des courbes, toutes<br />
ces choses qui nourrissent habituellement un argumentaire m’étaient à ce<br />
point familières, et pour ainsi dire d’une évidence si insolite, que chaque<br />
parole m’aurait probablement dessaisi de ce monde bouleversé par sa<br />
découverte.<br />
Je la voulais présente et oublieuse de ce qu’elle fût.<br />
Ce n’est bien sûr qu’une voiture. Accidentée de surcroît.<br />
Emouvante dans son repos mutilé.<br />
Mais son état même dit la puissance qu’elle abrite. Son immobilité la rend<br />
fascinante, comme si sous mes regards, elle fondait, délaissait sa vocation<br />
de bolide pour s’abandonner à ma contemplation gourmande.<br />
Je me suis imaginé parfois la possibilité de son ventre vidé à terre, bougies,<br />
boulons et courroies en vrac, déposés au sol en vue d’une improbable remise<br />
en état. J’ai tenté de l’ancrer dans la réalité des faiblesses mécaniques,<br />
de la circonscrire à leur univers décomposable. Mais elle existe ailleurs,<br />
son monde n’est plus celui de la vitesse tant elle est devenue l’incarnation<br />
d’une infinie poésie : tôle meurtrie, donnant à voir fièrement la mélancolie<br />
de sa déchéance, la fragilité de ses lignes si tendues avant et maintenant<br />
(rabougries), lézardées. Elle demeurait pourtant exubérante dans son rouge<br />
éminemment carminé, crânement figée dans son élan raté, dans sa course<br />
mourant peut-être contre un quelconque platane.<br />
Longtemps j’ai cherché la pureté de son dessin perdu dans le foisonnement<br />
des plis, sa forme passée dans les ratatinages, tout en devinant que<br />
son relief, sous mes doigts, n’aurait été qu’harmonie de formes fêlées.<br />
C’est une Alfa Roméo donc, mais la marque importe peu, cabossée par<br />
inadvertance et exhibée là justement en vertu de sa défiguration. Autour<br />
d’elle je rôde, ou plutôt je veille. Ainsi, témoin et principal acteur, je sais que<br />
sur elle des regards encore désirants se portent, des attentions subsistent.<br />
Je suis curieux de la vie qui l’habite encore, autrement, de sa force flagrante<br />
contrainte au repos. J’aime son inaptitude à remplir sa fonction, ses courbes<br />
douloureuses et froissées, sa désuétude.<br />
Et qu’elle s’offre ici.<br />
Sans performance, parfaitement inutile.<br />
Il m’a fallu ce contexte pour que m’apparaisse la splendeur d’une carrosserie<br />
chiffonnée. Le hasard d’une grêle qui m’a poussé à entrer là aussi. Un orage<br />
d’été. Les circonstances ne poussaient certes pas à trouver refuge dans une<br />
casse à ciel ouvert… De toute façon, perdue parmi d’autres épaves, son éclat<br />
se serait tu, si ténu coincé dans la multitude.<br />
Il fallait ce décalage qui la proclame reine, affranchie des rangées navran-<br />
tes de berlines déchues, des ongles noirs et des bleus maculés de graisse.<br />
Le lieu de notre rencontre, plus raffiné, autorisait, lui, une aimable intimité.<br />
Traitée avec égards, elle avait pour elle un cartel précisant le nom de<br />
Giulietta. A l’entrée, on indiquait la raison de son séjour ici et l’identité de<br />
celui qui décréta, un jour, que plus jamais elle ne roulerait :<br />
Bertrand Lavier<br />
Une exposition du Musée d’Art <strong>Mo</strong>derne de la Ville de Paris<br />
31 mai - 22 septembre 2002<br />
Sage ordonnance. De toute façon, je ne conduis pas.
Les auteurs<br />
Aline Cateux a travaillé en Bosnie-Herzégovine au sein du centre culturel Abrasevic à <strong>Mo</strong>star où elle a dirigé le<br />
festival du court-métrage, puis en tant qu’attachée culturelle de l’Ambassade de France en Bosnie-Herzégovine,<br />
poste dont elle a démissionné en 2010. Elle est actuellement chargée de diffusion et de production à Lyon.<br />
Fabien Defendini : « J’ai commencé l’écriture avec naïveté dans des poésies en rimes, puis j’ai déconstruit mon<br />
langage par l’écriture automatique. J’ai écrit des lettres, commenté ma recherche en arts plastiques, commencé<br />
des réflexions existentielles. Par la suite mon écriture s’est concentrée au point qu’elle n’ait pour seule légitimité<br />
qu’elle-même. J’ai commencé à écrire des articles de critique d’art, qui se sont transformés en critique sur la politique<br />
française. J’ai essayé la fiction avec la nouvelle, et j’ai écrit encore de la poésie, des rêves aussi. Aujourd’hui<br />
j’écris selon un processus conjonctif de données déterminées par une idée, une intuition avec laquelle je trace<br />
un parcours de pensée. »<br />
Jérôme Diacre est critique d’art et enseignant de philosophie. Il codirige le service éducatif du Château d’Oiron<br />
(Centre des <strong>Mo</strong>numents Nationaux). Fondateur de la revue Laura dans laquelle il écrit, il a également collaboré<br />
aux revues Art Présence et 02. On lui doit des textes dans des catalogues monographiques, ainsi qu’une notice<br />
sur Sammy Engramer dans French Connection (Black Jack éditions). Il vit à Tours.<br />
Jérôme Duvigneau vit et travaille à Toulouse.<br />
Bamba Gueye est jardinier. Il vit à Bruxelles.<br />
Frédéric Herbin est doctorant et chargé de cours en histoire de l’art contemporain à l’Université François-Rabelais<br />
de Tours. Il termine une thèse sous la direction d’Eric de Chassey sur l’émergence d’une prise en compte du<br />
contexte institutionnel muséal dans les œuvres des artistes vivant en France, à la fin des années 1960 et pendant<br />
les années 1970.<br />
Samuel de Jesus est Docteur en Études cinématographiques et audiovisuelles de l’Université de Paris 3 Sorbonne-<br />
Nouvelle, et en communication de l’Université Fédérale de Rio de Janeiro. Il est spécialiste de l’histoire de la<br />
photographie française et brésilienne, mais également lui-même photographe. Il développe actuellement une<br />
recherche à l’Université de São Paulo (ECA-USP), sur les questions du regard physiognomonique et de sa mise en<br />
échec, de la folie et des pratiques extrêmes du corps en art contemporain, autour des œuvres de Chris Burden,<br />
Gina Pane, Antonio Dias et Rodrigo Braga.<br />
Valérie Nam est diplômée d’histoire de l’art avec pour spécialité l’art africain. Elle a été responsable du bureau<br />
des étudiants pendant quelques années au Centre de Création Contemporaine de Tours. On lui doit des travaux<br />
d’écriture pour divers artistes, notamment Stéphane Albert. Elle vit à Tours.<br />
Yann Ricordel est critique d’art et de cinéma, chercheur indépendant en histoire de l’art contemporain, et rédacteur<br />
en chef de <strong>Numéro</strong> <strong>Zéro</strong>. Il termine actuellement l’écriture de son ouvrage Soundings. Expérimentations<br />
sonores à New York (1960-1980), permise par l’obtention d’une bourse du Centre National des Arts Plastiques<br />
en 2009. Il vit à Caen.<br />
Sergueï Wolkonsky est né à Paris en 1966, il est professeur à la Haute Ecole d’art de Perpignan où il coordonne<br />
les enseignements du premier cycle. Artiste et enseignant vivant à Perpignan où se tient « Visa pour l’Image », la<br />
plus grande manifestation consacrée au photojournalisme, il développe une réflexion critique sur le regard et le<br />
commerce des visibilités, à l’appui d’images plus ou moins dépourvues de qualités.
<strong>Numéro</strong> <strong>Zéro</strong> est une publication semestrielle de l’association BLNK<br />
SIRET : 494985104000 Code APE : 913E<br />
Pour tout contact : nmr.zero@gmail.com<br />
Rédacteur en chef : Yann Ricordel<br />
Relecture-correction : Claire Girauld, Yann Ricordel<br />
Design graphique : Damien Girot<br />
61