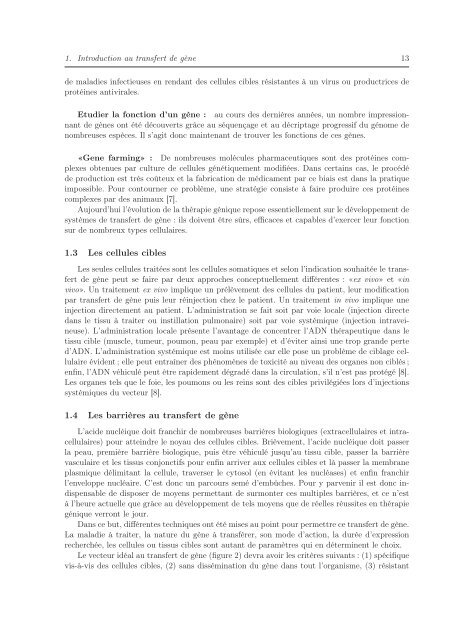THESE DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITE PARIS 6 Capucine ...
THESE DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITE PARIS 6 Capucine ...
THESE DE DOCTORAT DE L'UNIVERSITE PARIS 6 Capucine ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
1. Introduction au transfert de gène 13<br />
de maladies infectieuses en rendant des cellules cibles résistantes à un virus ou productrices de<br />
protéines antivirales.<br />
Etudier la fonction d’un gène : au cours des dernières années, un nombre impressionnant<br />
de gènes ont été découverts grâce au séquençage et au décriptage progressif du génome de<br />
nombreuses espèces. Il s’agit donc maintenant de trouver les fonctions de ces gènes.<br />
«Gene farming» : De nombreuses molécules pharmaceutiques sont des protéines complexes<br />
obtenues par culture de cellules génétiquement modifiées. Dans certains cas, le procédé<br />
de production est très coûteux et la fabrication de médicament par ce biais est dans la pratique<br />
impossible. Pour contourner ce problème, une stratégie consiste à faire produire ces protéines<br />
complexes par des animaux [7].<br />
Aujourd’hui l’évolution de la thérapie génique repose essentiellement sur le développement de<br />
systèmes de transfert de gène : ils doivent être sûrs, efficaces et capables d’exercer leur fonction<br />
sur de nombreux types cellulaires.<br />
1.3 Les cellules cibles<br />
Les seules cellules traitées sont les cellules somatiques et selon l’indication souhaitée le transfert<br />
de gène peut se faire par deux approches conceptuellement différentes : «ex vivo» et «in<br />
vivo». Un traitement ex vivo implique un prélèvement des cellules du patient, leur modification<br />
par transfert de gène puis leur réinjection chez le patient. Un traitement in vivo implique une<br />
injection directement au patient. L’administration se fait soit par voie locale (injection directe<br />
dans le tissu à traiter ou instillation pulmonaire) soit par voie systémique (injection intraveineuse).<br />
L’administration locale présente l’avantage de concentrer l’ADN thérapeutique dans le<br />
tissu cible (muscle, tumeur, poumon, peau par exemple) et d’éviter ainsi une trop grande perte<br />
d’ADN. L’administration systémique est moins utilisée car elle pose un problème de ciblage cellulaire<br />
évident ; elle peut entraîner des phénomènes de toxicité au niveau des organes non ciblés;<br />
enfin, l’ADN véhiculé peut être rapidement dégradé dans la circulation, s’il n’est pas protégé [8].<br />
Les organes tels que le foie, les poumons ou les reins sont des cibles privilégiées lors d’injections<br />
systémiques du vecteur [8].<br />
1.4 Les barrières au transfert de gène<br />
L’acide nucléique doit franchir de nombreuses barrières biologiques (extracellulaires et intracellulaires)<br />
pour atteindre le noyau des cellules cibles. Brièvement, l’acide nucléique doit passer<br />
la peau, première barrière biologique, puis être véhiculé jusqu’au tissu cible, passer la barrière<br />
vasculaire et les tissus conjonctifs pour enfin arriver aux cellules cibles et là passer la membrane<br />
plasmique délimitant la cellule, traverser le cytosol (en évitant les nucléases) et enfin franchir<br />
l’enveloppe nucléaire. C’est donc un parcours semé d’embûches. Pour y parvenir il est donc indispensable<br />
de disposer de moyens permettant de surmonter ces multiples barrières, et ce n’est<br />
à l’heure actuelle que grâce au développement de tels moyens que de réelles réussites en thérapie<br />
génique verront le jour.<br />
Dans ce but, différentes techniques ont été mises au point pour permettre ce transfert de gène.<br />
La maladie à traiter, la nature du gène à transférer, son mode d’action, la durée d’expression<br />
recherchée, les cellules ou tissus cibles sont autant de paramètres qui en déterminent le choix.<br />
Le vecteur idéal au transfert de gène (figure 2) devra avoir les critères suivants : (1) spécifique<br />
vis-à-vis des cellules cibles, (2) sans dissémination du gène dans tout l’organisme, (3) résistant