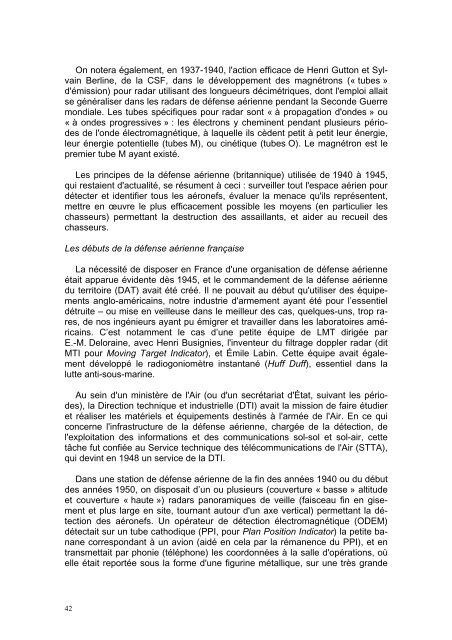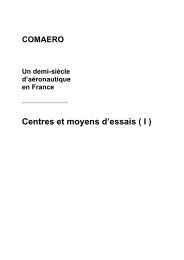Le présent document se veut une contribution à un travail ... - EuroSAE
Le présent document se veut une contribution à un travail ... - EuroSAE
Le présent document se veut une contribution à un travail ... - EuroSAE
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
On notera également, en 1937-1940, l'action efficace de Henri Gutton et Sylvain<br />
Berline, de la CSF, dans le développement des magnétrons (« tubes »<br />
d'émission) pour radar utilisant des longueurs décimétriques, dont l'emploi allait<br />
<strong>se</strong> générali<strong>se</strong>r dans les radars de défen<strong>se</strong> aérienne pendant la Seconde Guerre<br />
mondiale. <strong>Le</strong>s tubes spécifiques pour radar sont « <strong>à</strong> propagation d'ondes » ou<br />
« <strong>à</strong> ondes progressives » : les électrons y cheminent pendant plusieurs périodes<br />
de l'onde électromagnétique, <strong>à</strong> laquelle ils cèdent petit <strong>à</strong> petit leur énergie,<br />
leur énergie potentielle (tubes M), ou cinétique (tubes O). <strong>Le</strong> magnétron est le<br />
premier tube M ayant existé.<br />
<strong>Le</strong>s principes de la défen<strong>se</strong> aérienne (britannique) utilisée de 1940 <strong>à</strong> 1945,<br />
qui restaient d'actualité, <strong>se</strong> résument <strong>à</strong> ceci : surveiller tout l'espace aérien pour<br />
détecter et identifier tous les aéronefs, évaluer la menace qu'ils re<strong>pré<strong>se</strong>nt</strong>ent,<br />
mettre en œuvre le plus efficacement possible les moyens (en particulier les<br />
chas<strong>se</strong>urs) permettant la destruction des assaillants, et aider au recueil des<br />
chas<strong>se</strong>urs.<br />
<strong>Le</strong>s débuts de la défen<strong>se</strong> aérienne françai<strong>se</strong><br />
La nécessité de dispo<strong>se</strong>r en France d'<strong><strong>un</strong>e</strong> organisation de défen<strong>se</strong> aérienne<br />
était apparue évidente dès 1945, et le commandement de la défen<strong>se</strong> aérienne<br />
du territoire (DAT) avait été créé. Il ne pouvait au début qu'utili<strong>se</strong>r des équipements<br />
anglo-américains, notre industrie d'armement ayant été pour l’es<strong>se</strong>ntiel<br />
détruite – ou mi<strong>se</strong> en veilleu<strong>se</strong> dans le meilleur des cas, quelques-<strong>un</strong>s, trop rares,<br />
de nos ingénieurs ayant pu émigrer et <strong>travail</strong>ler dans les laboratoires américains.<br />
C’est notamment le cas d’<strong><strong>un</strong>e</strong> petite équipe de LMT dirigée par<br />
E.-M. Deloraine, avec Henri Busignies, l'inventeur du filtrage doppler radar (dit<br />
MTI pour Moving Target Indicator), et Émile Labin. Cette équipe avait également<br />
développé le radiogoniomètre instantané (Huff Duff), es<strong>se</strong>ntiel dans la<br />
lutte anti-sous-marine.<br />
Au <strong>se</strong>in d'<strong>un</strong> ministère de l'Air (ou d'<strong>un</strong> <strong>se</strong>crétariat d'État, suivant les périodes),<br />
la Direction technique et industrielle (DTI) avait la mission de faire étudier<br />
et réali<strong>se</strong>r les matériels et équipements destinés <strong>à</strong> l'armée de l'Air. En ce qui<br />
concerne l'infrastructure de la défen<strong>se</strong> aérienne, chargée de la détection, de<br />
l'exploitation des informations et des comm<strong>un</strong>ications sol-sol et sol-air, cette<br />
tâche fut confiée au Service technique des télécomm<strong>un</strong>ications de l'Air (STTA),<br />
qui devint en 1948 <strong>un</strong> <strong>se</strong>rvice de la DTI.<br />
Dans <strong><strong>un</strong>e</strong> station de défen<strong>se</strong> aérienne de la fin des années 1940 ou du début<br />
des années 1950, on disposait d’<strong>un</strong> ou plusieurs (couverture « bas<strong>se</strong> » altitude<br />
et couverture « haute ») radars panoramiques de veille (faisceau fin en gi<strong>se</strong>ment<br />
et plus large en site, tournant autour d'<strong>un</strong> axe vertical) permettant la détection<br />
des aéronefs. Un opérateur de détection électromagnétique (ODEM)<br />
détectait sur <strong>un</strong> tube cathodique (PPI, pour Plan Position Indicator) la petite banane<br />
correspondant <strong>à</strong> <strong>un</strong> avion (aidé en cela par la rémanence du PPI), et en<br />
transmettait par phonie (téléphone) les coordonnées <strong>à</strong> la salle d'opérations, où<br />
elle était reportée sous la forme d'<strong><strong>un</strong>e</strong> figurine métallique, sur <strong><strong>un</strong>e</strong> très grande<br />
42