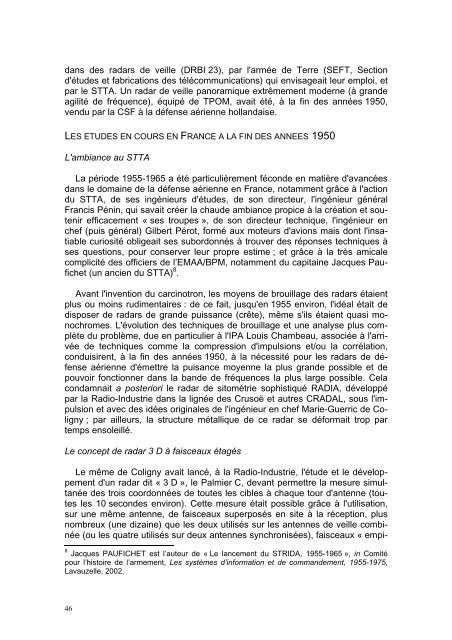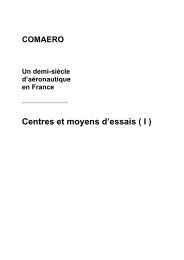Le présent document se veut une contribution à un travail ... - EuroSAE
Le présent document se veut une contribution à un travail ... - EuroSAE
Le présent document se veut une contribution à un travail ... - EuroSAE
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
dans des radars de veille (DRBI 23), par l'armée de Terre (SEFT, Section<br />
d'études et fabrications des télécomm<strong>un</strong>ications) qui envisageait leur emploi, et<br />
par le STTA. Un radar de veille panoramique extrêmement moderne (<strong>à</strong> grande<br />
agilité de fréquence), équipé de TPOM, avait été, <strong>à</strong> la fin des années 1950,<br />
vendu par la CSF <strong>à</strong> la défen<strong>se</strong> aérienne hollandai<strong>se</strong>.<br />
LES ETUDES EN COURS EN FRANCE A LA FIN DES ANNEES 1950<br />
L'ambiance au STTA<br />
La période 1955-1965 a été particulièrement féconde en matière d'avancées<br />
dans le domaine de la défen<strong>se</strong> aérienne en France, notamment grâce <strong>à</strong> l'action<br />
du STTA, de <strong>se</strong>s ingénieurs d'études, de son directeur, l'ingénieur général<br />
Francis Pénin, qui savait créer la chaude ambiance propice <strong>à</strong> la création et soutenir<br />
efficacement « <strong>se</strong>s troupes », de son directeur technique, l'ingénieur en<br />
chef (puis général) Gilbert Pérot, formé aux moteurs d'avions mais dont l'insatiable<br />
curiosité obligeait <strong>se</strong>s subordonnés <strong>à</strong> trouver des répon<strong>se</strong>s techniques <strong>à</strong><br />
<strong>se</strong>s questions, pour con<strong>se</strong>rver leur propre estime ; et grâce <strong>à</strong> la très amicale<br />
complicité des officiers de l’EMAA/BPM, notamment du capitaine Jacques Paufichet<br />
(<strong>un</strong> ancien du STTA) 8 .<br />
Avant l'invention du carcinotron, les moyens de brouillage des radars étaient<br />
plus ou moins rudimentaires : de ce fait, jusqu'en 1955 environ, l'idéal était de<br />
dispo<strong>se</strong>r de radars de grande puissance (crête), même s'ils étaient quasi monochromes.<br />
L'évolution des techniques de brouillage et <strong><strong>un</strong>e</strong> analy<strong>se</strong> plus complète<br />
du problème, due en particulier <strong>à</strong> l'IPA Louis Chambeau, associée <strong>à</strong> l'arrivée<br />
de techniques comme la compression d'impulsions et/ou la corrélation,<br />
conduisirent, <strong>à</strong> la fin des années 1950, <strong>à</strong> la nécessité pour les radars de défen<strong>se</strong><br />
aérienne d'émettre la puisance moyenne la plus grande possible et de<br />
pouvoir fonctionner dans la bande de fréquences la plus large possible. Cela<br />
condamnait a posteriori le radar de sitométrie sophistiqué RADIA, développé<br />
par la Radio-Industrie dans la lignée des Crusoë et autres CRADAL, sous l'impulsion<br />
et avec des idées originales de l'ingénieur en chef Marie-Guerric de Coligny<br />
; par ailleurs, la structure métallique de ce radar <strong>se</strong> déformait trop par<br />
temps ensoleillé.<br />
<strong>Le</strong> concept de radar 3 D <strong>à</strong> faisceaux étagés<br />
<strong>Le</strong> même de Coligny avait lancé, <strong>à</strong> la Radio-Industrie, l'étude et le développement<br />
d'<strong>un</strong> radar dit « 3 D », le Palmier C, devant permettre la mesure simultanée<br />
des trois coordonnées de toutes les cibles <strong>à</strong> chaque tour d'antenne (toutes<br />
les 10 <strong>se</strong>condes environ). Cette mesure était possible grâce <strong>à</strong> l'utilisation,<br />
sur <strong><strong>un</strong>e</strong> même antenne, de faisceaux superposés en site <strong>à</strong> la réception, plus<br />
nombreux (<strong><strong>un</strong>e</strong> dizaine) que les deux utilisés sur les antennes de veille combinée<br />
(ou les quatre utilisés sur deux antennes synchronisées), faisceaux « empi-<br />
8 Jacques PAUFICHET est l’auteur de « <strong>Le</strong> lancement du STRIDA, 1955-1965 », in Comité<br />
pour l’histoire de l’armement, <strong>Le</strong>s systèmes d’information et de commandement, 1955-1975,<br />
Lavauzelle, 2002.<br />
46