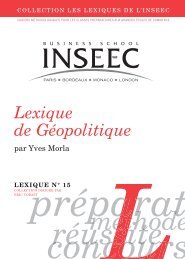Les mots de la Société (Eric Cobast) - INSEEC Business School
Les mots de la Société (Eric Cobast) - INSEEC Business School
Les mots de la Société (Eric Cobast) - INSEEC Business School
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
enfants, buvant du vin, <strong>la</strong> tête couronnée <strong>de</strong> fl eurs et chantant les louanges <strong>de</strong>s<br />
dieux ; ils vivront ensemble joyeusement rég<strong>la</strong>nt sur leurs ressources le nombre<br />
<strong>de</strong> leurs enfants, dans <strong>la</strong> crainte <strong>de</strong> <strong>la</strong> pauvreté et <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre.<br />
République,livre II. P<strong>la</strong>ton.<br />
Socrate imagine pour ses interlocuteurs <strong>la</strong> naissance et le développement<br />
d’une Cité : P<strong>la</strong>ton propose ainsi le premier « modèle » politique, au sens quasi<br />
scientifi que du terme.<br />
La diversité <strong>de</strong>s besoins humains conduit les hommes à se répartir les tâches :<br />
tout commence bien par <strong>la</strong> « division du travail ». Le lien social est donc imposé<br />
par cette nécessité. En soi, <strong>la</strong> division n’est pas mauvaise si elle résulte d’une<br />
spécialisation qui aboutit à une véritable harmonie. Mais à mesure qu’elle<br />
se développe, <strong>la</strong> société verra naître <strong>de</strong>s divisions préjudiciables, celles qui<br />
opposent et conduisent à l’exclusion et à l’injustice. Ces divisions se nourrissent<br />
<strong>de</strong> l’inégalité <strong>de</strong>s conditions, du désir <strong>de</strong> domination et d’une tendance peut-être<br />
naturelle à rejeter l’autre, celui dont pourtant <strong>la</strong> présence est une nécessité.<br />
Elites :<br />
Ceux qui dans un groupe sont reconnus comme les meilleurs.<br />
Il s’agit dès lors d’une minorité qui occupe une p<strong>la</strong>ce privilégiée dans un<br />
groupe. Ceux qui <strong>la</strong> composent détiennent l’autorité, jouissent du prestige<br />
et exercent le pouvoir. Plus les élites se constituent par héritage, plus cette<br />
société est fermée. Or le <strong>de</strong>stin <strong>de</strong>s élites est <strong>de</strong> se renouveler, écrit V. Pareto<br />
qui théorise <strong>la</strong> nécessité pour une société <strong>de</strong> développer ses élites. De fait, c’est<br />
moins l’existence <strong>de</strong>s élites que leur reproduction qui est mal ressentie.<br />
Exclusion :<br />
Le mot a été <strong>la</strong>rgement employé <strong>de</strong>puis René Lenoir (<strong>Les</strong> exclus, un Français<br />
sur dix, 1974) pour désigner le mécanisme par lequel certains se trouvent rejetés<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> société. L’exclusion n’est pas un phénomène neuf : expulsion, déportation,<br />
exil, etc. ont marqué l’histoire <strong>de</strong>s sociétés <strong>de</strong>puis l’Antiquité. Mais ce<br />
furent <strong>de</strong>s « décisions », impliquant volonté et responsabilité. Il y a au contraire<br />
dans l’exclusion, telle que nous l’entendons aujourd’hui, une dimension « mécanique<br />
» : elle ne serait voulue par personne, personne n’en serait alors responsable.<br />
Involontaire, l’exclusion révèle l’irresponsabilité <strong>de</strong> notre société.<br />
23