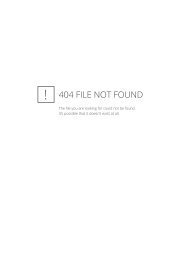LE LANGAGE EST-IL UN INSTINCT ? UNE CRITIQUE DU ... - Texto
LE LANGAGE EST-IL UN INSTINCT ? UNE CRITIQUE DU ... - Texto
LE LANGAGE EST-IL UN INSTINCT ? UNE CRITIQUE DU ... - Texto
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Texto</strong>! octobre 2008, vol. XIII, n°4<br />
Cette détermination signifie que l’enfant envisagera seulement H DEP<br />
même si toute son<br />
expérience est conforme à H IND<br />
.<br />
Je reviendrai sur cet argument, repris par Pinker et d’autres nativistes.<br />
En plusieurs endroits, Chomsky argue qu’une procédure comme l’analogie est incapable<br />
d’expliquer les cas où des séquences superficiellement homologues doivent être analysées et<br />
interprétées de façons différentes. Ce rejet de l’analogie est d’ailleurs ancien. Dès son compte<br />
rendu de Skinner, il expliquait qu’on ne pouvait abstraire les constructions syntaxiques à partir de<br />
ce que des phrases superficiellement similaires avaient en commun.<br />
Le même type d’argument est réutilisé par Pinker (1994 : 283). Il consiste à sélectionner quelquesunes<br />
des données disponibles à l’induction (que j’appellerai, à la suite de Chomsky et d’autres, les<br />
données linguistiques primaires ou DLP)[16] en éliminant celles qui sont susceptibles d’infirmer les<br />
généralisations fausses. Un autre procédé consiste à induire de ces données lacunaires des<br />
généralisations, sans tenir compte du fait qu’elles ne sont jamais soutenues. On constate ensuite<br />
(sans surprise) que les généralisations obtenues sont fausses. On ajoute éventuellement que les<br />
données infirmant les fausses généralisations ne se trouvent pas à coup sûr parmi les DLP (mais<br />
les données conduisant aux fausses généralisations non plus). Conclusion : l’induction ne permet<br />
pas d’obtenir les bonnes généralisations.<br />
Dans Knowledge of Language (1986 : 8 et 105), Chomsky soumet ainsi les exemples suivants :<br />
(6) John ate an apple.<br />
(6’) John ate.<br />
(7) John is too stubborn to talk to Bill.<br />
(7’) John is too stubborn to talk to.<br />
Si l’analogie était la seule procédure, dit-il, elle conduirait à analyser (7’) sur le modèle de (6’),<br />
c’est-à-dire comme signifiant que John est trop têtu pour parler à quelqu’un. Or, c’est John qui est<br />
le complément de to dans (7’).<br />
L’argument semble supposer qu’on peut réduire les DLP disponibles à des fragments construits<br />
comme (6)-(7’). Soit l’enfant traite (7’) sur le modèle de (6’) et surgénéralise (6)-(6’), soit il traite (6’)<br />
sur le modèle de (7’) et surgénéralise (7)-(7’).<br />
Dans le premier cas, il faut supposer que l’enfant n’a pas pu apprendre qu’il faut chercher le<br />
complément de to dans la phrase et limiter ainsi la surgénéralisation de (6)-(6’). Mais dans quels<br />
cas, V to est-il suivi d’un objet qui n’est pas un argument de la phrase (en dehors du cas marginal<br />
to come to ‘revenir à soi’) ? Pour quelles raisons l’enfant ferait-il une généralisation qui n’est jamais<br />
soutenue ?<br />
Dans le second cas, il faut admettre que l’enfant n’a pu apprendre dans quels cas un objet omis<br />
réfère en dehors de la phrase. Pourtant, pour ce dernier phénomène, on peut envisager une<br />
explication de type pragmatique qui mette à disposition de l’enfant un indice sur les cas<br />
admissibles d’omission de l’objet (cf. Goldberg 2001 pour une proposition en ce sens).<br />
Mais Chomsky ne peut avoir en tête un argument aussi court. Il veut probablement laisser<br />
entendre aussi que la structure de (7’) est contrainte par des règles générales qui régissent la<br />
trace de John, ou le fait que le sujet de talk to dans (7’) soit arbitrary PRO, ou encore le fait que<br />
(7’) soit grammaticale avec stubborn et non avec eager, par exemple :<br />
(8) *John is too eager to talk to.<br />
Mais dans ce cas, l’argument contre l’analogie nous ramène à l’analyse appropriée de (7), (7’) et<br />
(8). L’argument est donc soit peu plausible, soit inutile. Encore une fois, il ne vaut que si on<br />
accepte par ailleurs la description chomskyenne des faits.<br />
12