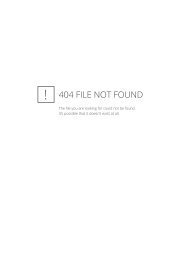LE LANGAGE EST-IL UN INSTINCT ? UNE CRITIQUE DU ... - Texto
LE LANGAGE EST-IL UN INSTINCT ? UNE CRITIQUE DU ... - Texto
LE LANGAGE EST-IL UN INSTINCT ? UNE CRITIQUE DU ... - Texto
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Texto</strong>! octobre 2008, vol. XIII, n°4<br />
Cette description correspond bien à l’idée d’une construction collective. Mais elle contredit par<br />
ailleurs d’autres déclarations parlant de “créolisation abrupte” (en une génération) du LSN<br />
(Senghas et al. 1999 : 211). A l’évidence, les auteurs n’embrassent pas complètement le<br />
nativisme : ils considèrent certes que la systématisation et la complexification du LSN est l’œuvre<br />
d’enfants dans leur période critique, mais ils voient bien aussi que l’ISN est une construction<br />
collective qui partage bien des traits du LSN, lui-même issu des signes spontanés d’individus<br />
isolés. Ainsi peut-on expliquer que Kegl parle non de GU innée mais plus vaguement, d’un cerveau<br />
prédisposé au langage (language-ready brain).<br />
On voit donc que les affirmations de Pinker citées plus haut (“a creole, invented in one leap”) sont<br />
soumises à caution et même contredisent les affirmations de Senghas et al. (2005) que j’ai citées<br />
à l’instant (“no single age cohort can progress through the developmental stages in the order<br />
necessary to create a language in a single pass”). L’ISN fait plutôt apparaître le caractère collectif<br />
et transgénérationnel de l’invention linguistique.<br />
D.3.5 L’argument de la sous-exposition (suite) : le cas Simon<br />
Dans The Language Instinct, le cas Simon suit immédiatement la discussion consacrée à l’ISN<br />
(1994 : 37).<br />
Ce cas a une importance spéciale. Il présente cet avantage que la “créolisation” en question ne<br />
peut être présentée comme le fruit d’échanges collectifs, à la différence du créole Hawaïen ou de<br />
l’ISN :<br />
“But ISN was the collective product of many children communicating with one another. If we are to<br />
attribute the richness of language to the mind of the child, we really want to see a single child adding<br />
some increment of grammatical complexity to the input the child has received” (Pinker 1994 : 37).<br />
Pinker se réfère en l’occurrence à une étude préliminaire due à Jenny Singleton et Elissa Newport<br />
(1993), qu’il résume dans des termes que je rappellerai ici.[30]<br />
Simon est un enfant ayant appris l’American Sign Language de parents sourds eux-mêmes, mais<br />
qui ont acquis l’ASL à un âge assez tardif (15 et 16 ans), communément considéré comme hors de<br />
la période critique d’apprentissage (voir infra section D.5, sur cette notion de période critique).<br />
Selon Pinker, la pratique de l’ASL des parents de Simon est mauvaise (“they acquired it badly”, ditil<br />
; 1994 : 38). Pire, elle viole des règles de la GU chomskyenne :<br />
“Simon’s father once tried to sign the thought My friend, he thought my second child was deaf. It came<br />
out as My friend thought, my second child, he thought he was deaf — a bit of a sign salad that violates<br />
not only ASL grammar, but according to Chomsky’s theory, the Universal Grammar that governs all<br />
naturally [sic] acquired human languages” (1994 : 38).<br />
Pourtant, en dépit de ces DLP déficientes, Simon parvient à une maîtrise bien supérieure. Il n’a<br />
ainsi pas de difficulté à discerner les topiques mélangés à cette macédoine paternelle (1994 : 39).<br />
Bref, Simon aurait, selon les mots de Pinker, créolisé le pidgin de ses parents (ibid.).<br />
L’étude en question (et les publications postérieures qui la prolongent : par ex. Ross & Newport<br />
1996 ; Singleton & Newport 2004) n’est pas menée dans un esprit nativiste. Cependant, les<br />
auteurs tiennent pour acquis que Chomsky a “démontré” que l’acquisition d’une langue ne peut<br />
découler de façon déterministe des DLP (ce qui est trivialement évident au sens fort de<br />
déterministe ; cf. 2004 : 372). Ils endossent donc l’idée que les DLP, même dans le cas de<br />
l’apprentissage normal, sont déficitaires (impoverished ; ibid.). Selon les auteurs, ce déficit ne peut<br />
résider dans le fait que certaines constructions de la langue seraient absentes des DLP, ou<br />
seraient bruitées. En effet, ils affirment que<br />
28