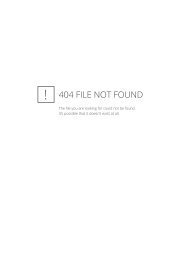LE LANGAGE EST-IL UN INSTINCT ? UNE CRITIQUE DU ... - Texto
LE LANGAGE EST-IL UN INSTINCT ? UNE CRITIQUE DU ... - Texto
LE LANGAGE EST-IL UN INSTINCT ? UNE CRITIQUE DU ... - Texto
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Texto</strong>! octobre 2008, vol. XIII, n°4<br />
Chomsky estime qu'en se fondant sur le comportement et l'observable, l'empirisme se fourvoie<br />
doublement: il mène à une approche purement descriptive du comportement, qui en ignore les<br />
causes ; et s'il s'attarde sur les causes du comportement, il fait de l'observable le facteur qui<br />
modèle et spécifie les aptitudes de l'organisme. Ces critiques valent d'abord pour la linguistique.<br />
A partir des Aspects of the Theory of Syntax (1965; Chomsky 1971), Chomsky embrasse<br />
clairement la thèse de l'innéité du noyau universel des grammaires humaines (la “Grammaire<br />
Universelle”, ou GU). Cette thèse, qu'il lie à sa critique de la linguistique structurale, est alors<br />
présentée comme un écho de l'innéisme rationaliste et son opposition aux aspects “inductifs” de la<br />
linguistique structurale américaine comme un prolongement du conflit entre le rationalisme et<br />
l'empirisme (Chomsky 1969b). Chomsky se forge une généalogie qui remonte à Descartes et à<br />
une hypothétique linguistique “cartésienne”, dont la Grammaire Générale est le grand œuvre<br />
(Chomsky 1969a). La pertinence de cette quête des précurseurs a été fortement mise en doute:<br />
on a pointé des méprises sur les filiations. Surtout, dans la tradition française, la Grammaire<br />
Générale paraît être pensée comme une réflexion sur les moyens que l'espèce humaine s'est<br />
donnée pour exprimer les idées, plutôt que comme une théorie inductive cherchant les principes<br />
communs aux langues particulières.[3]<br />
Si la linguistique structurale a, selon Chomsky, correctement identifié un problème (comment faire<br />
émerger de la structure à partir du donné linguistique ; 1969b : 40-1), il pense néanmoins que son<br />
parti pris purement descriptif, qui délaisse les mécanismes psychologiques créateurs du langage,<br />
doit être dépassé. Il retient ainsi l'idée qu'une grammaire doit décrire la structure qui émerge des<br />
données, et fait écho à Harris ou Hockett, lorsqu'ils affirment qu'une grammaire doit permettre<br />
d'engendrer les phrases d'une langue.[4] En revanche, il s'oppose de plus en plus (après<br />
Syntactic Structures, plus ambigu à cet égard) à l'idée de définir la langue comme un ensemble<br />
d'énoncés ou de “phrases” observables (utterances ou sentences dans Syntactic Structures ; cf.<br />
Matthews 1993: 130). Il critique ainsi (1986: 19) la définition par Bloomfield de la langue comme<br />
“the totality of utterances that can be made in a speech community” (Bloomfield 1926, def. 4), ou<br />
des formulations similaires de Whitney (Chomsky 1969b: 37), tous deux embarqués, selon<br />
Chomsky, sur le même bateau que Saussure (1969: ibid.). Chomsky pense que cette conception<br />
externe de la langue (E-language) a pour conséquence d'éluder le problème du rapport du<br />
langage à l'esprit / cerveau, et ignore la question de savoir ce qu'est connaître une langue et<br />
comment elle peut être acquise (1986, ch. 1 et 2). Elle mène à deux écueils: celui du relativisme<br />
théorique, selon lequel une grammaire ne peut que correspondre aux faits mais n'a pas à être<br />
choisie parce qu'elle éluciderait les causes du comportement (c'est la thèse de Quine 1970) ; et<br />
celui du relativisme linguistique, qui menace toute approche s'abstenant de considérer le langage<br />
comme fait cognitif et en dernier lieu “naturel” (ce sont Whitney et Sapir qui sont visés dans<br />
Chomsky 1986: 21).<br />
La notion de comportement a aussi l'inconvénient d'évoquer inévitablement le behaviorisme, dont<br />
on sait qu'il fut l'antagoniste absolu de Chomsky (voir son fameux compte rendu de Skinner, 1959).<br />
Et comportement ne paraît jamais renvoyer aux sciences sociales (à l'anthropologie, ou à la<br />
sociologie) ni à l'histoire, qui semblent ne pas exister pour Chomsky[5], et sont apparemment mal<br />
connues et en tout cas rejetées par Pinker. Chomsky entend se situer en-deçà du behaviorisme de<br />
Skinner, c'est-à-dire au niveau transcendantal des conditions de saisie du monde et de sa<br />
conceptualisation (ce qu'il appelle parfois le “sens commun”).<br />
L'hypothèse de l'innéité est donc, en partie, une réaction à Skinner. C'est ainsi que certains des<br />
arguments nativistes qui seront répétés ensuite se trouvent déjà dans le compte rendu de Verbal<br />
Behavior: ce que l'enfant tire de son propre fonds explique qu'il ne s'en tienne pas à la répétition<br />
des comportements renforcés (créativité); les homologies superficielles des énoncés ne donnent<br />
pas accès à la structure syntaxique, cette structure ne peut donc être acquise inductivement;<br />
l'activité de langage n'est pas contrôlée par le stimulus, elle est libre. Ce dernier aspect est capital,<br />
et motive en partie le rejet par Chomsky des explications “fonctionnelles” ou<br />
“communicationnelles”. Pour Chomsky, cette liberté semble être un fait qui ne se réduit pas à la<br />
4