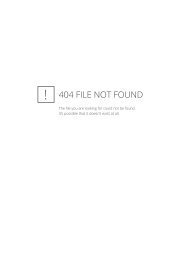LE LANGAGE EST-IL UN INSTINCT ? UNE CRITIQUE DU ... - Texto
LE LANGAGE EST-IL UN INSTINCT ? UNE CRITIQUE DU ... - Texto
LE LANGAGE EST-IL UN INSTINCT ? UNE CRITIQUE DU ... - Texto
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Texto</strong>! octobre 2008, vol. XIII, n°4<br />
h) Convergence : les enfants atteignent des états finaux qui sont remarquablement<br />
semblables, en dépit de la variété de leurs expériences personnelles (et donc de leurs<br />
DLP).<br />
i) Universalité : les locuteurs de diverses langues acquièrent des systèmes dont les<br />
similarités sont inexpliquées.<br />
j) Période critique : pour être optimal, l’apprentissage d’une langue doit avoir lieu entre<br />
deux âges. Cette période critique correspond à la maturation de la faculté de langage, qui<br />
met à disposition de l’enfant les capacités innées nécessaires pour l’acquisition. Au-delà de<br />
cette période, l’apprentissage n’est pas optimal, ce qui peut être interprété comme la<br />
preuve que des procédures générales sont insuffisantes. L’argument peut donc soutenir la<br />
thèse de la modularité. Il fournit aussi une explication causale au caractère inéluctable de<br />
l’acquisition.<br />
Les arguments les plus forts sont à mon avis ceux de la vitesse (a), de la sélectivité (d), de la<br />
sous-exposition (f), de l’universalité (i) et de la période critique (j). L’argument de la vitesse est bien<br />
discuté par Sampson (2005). J’y reviendrai cependant en section D.4, pour questionner la notion<br />
de maturation et son rapport à d’éventuels stades. L’argument (i) dépasse le cadre de cet article: il<br />
revient à accepter la théorie de la GU, ou bien exige de prendre parti sur la nature des universaux<br />
linguistiques et la bonne théorie des universaux. Quant à l’argument (g), en exigeant des théories<br />
alternatives possibles une certitude qu’elles ne demandent pas du nativisme, il met le nativisme à<br />
l’abri de toute infirmation empirique.<br />
Je me tournerai maintenant vers les passages que Pinker a consacrés aux arguments de la<br />
sélectivité et de la sous-exposition dans The Language Instinct (1994, surtout les ch. 2 et 9). Je<br />
traiterai d’abord de l’argument de la sélectivité.<br />
D.2 L’argument de la sélectivité<br />
Pinker (1994 : 40) reconduit l’argument classique de Chomsky (voir supra) sur l’acquisition de la<br />
structure des interrogatives polaires. Rappelons l’enjeu du débat : les enfants pourraient faire<br />
l’hypothèse que la formation des interrogatives est indépendante de la structure syntagmatique<br />
(H IND<br />
). Or, ils ne procèdent jamais ainsi : ils semblent toujours inverser correctement l’auxiliaire de<br />
la proposition principale, ce qui suppose l’hypothèse inverse (H DEP<br />
), qui consiste à projeter une<br />
structure syntagmatique sur les phrases.<br />
Doit-on vraiment supposer qu’un mécanisme inné contraint l’enfant à projeter H DEP<br />
? D’une part,<br />
des principes simples peuvent se substituer à ce mécanisme ; d’autre part, les faits montrent que<br />
H DEP<br />
émerge progressivement. J’examinerai ces deux points tour à tour.<br />
Un premier principe consisterait à poser que l’enfant ne fait pas d’hypothèse vide, c’est-à-dire telle<br />
qu’une opération, par exemple un mouvement, est immotivée. Ce principe permet de rejeter<br />
certaines hypothèses considérées comme possibles par les nativistes, mais non éliminables du<br />
répertoire de l’enfant si on ne suppose pas des principes innés.<br />
Par exemple, selon Lasnik et Uriagereka (2002), confronté à Is the dog that is in the corner<br />
hungry ? l’enfant pourrait faire l’hypothèse que la règle de formation de l’interrogative à partir de la<br />
déclarative est : front any auxiliary (et non front the auxiliary in the matrix Infl). Cependant, on<br />
observe que l’enfant ne semble jamais envisager cette hypothèse. L’enfant est donc sélectif. Mais<br />
affirmer, comme le font Lasnik & Uriagereka (2002), que la règle front any auxiliary est<br />
théoriquement possible revient à admettre la possibilité de choix immotivés. En outre, le choix de<br />
l’auxiliaire est associé dans cette interrogative à l’information en focus (le prédicat principal).<br />
18