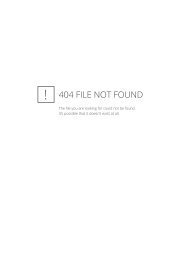LE LANGAGE EST-IL UN INSTINCT ? UNE CRITIQUE DU ... - Texto
LE LANGAGE EST-IL UN INSTINCT ? UNE CRITIQUE DU ... - Texto
LE LANGAGE EST-IL UN INSTINCT ? UNE CRITIQUE DU ... - Texto
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Texto</strong>! octobre 2008, vol. XIII, n°4<br />
l’encontre du principe de semantic bootstrapping, auquel Pinker a eu recours par ailleurs pour<br />
expliquer le “décollage” de la syntaxe (voir la section E.1 ci-dessous). Rien n’empêcherait en effet<br />
de supposer que la structure en constituants est acquise à partir des cas sémantiquement “pleins”,<br />
et est calculée ensuite de façon distributionnelle.<br />
Du point de vue empirique, l’argument pose problème. L’objection la plus dirimante vient des<br />
études longitudinales. Selon ces études, il apparaît peu probable que les enfants appliquent<br />
immédiatement une règle d’inversion, que Crain et Nakayama supposent être innée. D’après les<br />
observations de Tomasello (2003 : 111 et 159), 30% des énoncés entendus par des enfants de<br />
deux ans sont des questions avec inversion et l’ordre SVO est minoritaire. Les enfants semblent<br />
acquérir l’inversion item par item : tel enfant emploiera systématiquement l’inversion avec how, et<br />
dira tout aussi systématiquement what she can…, what she will… Tout paraît suggérer que<br />
l’inversion est abstraite progressivement, par analogie (Tomasello 2003 : 163).<br />
Bref, en exploitant l’argument de la sélectivité, Pinker accepte l’hypothèse d’une génération<br />
incontrôlée des formes et des constructions, que seuls des principes syntaxiques innés viendraient<br />
restreindre. Pourtant, ses autres travaux illustrent une toute autre démarche. Ils soulignent<br />
l’importance des contraintes sémantiques dans l’acquisition des formes et des constructions (1979,<br />
1984 et 1989). Apparemment, dans The Language Instinct, Pinker entend faire flèche de tout bois,<br />
quitte à s’éloigner de sa propre vision de l’acquisition.<br />
D.3 L’argument de la sous-exposition<br />
Cet argument fait appel à plusieurs types de preuves : celles qu’on trouve chez Chomsky, et que<br />
nous avons déjà examinées. Mais aussi celles qui proviennent de cas d’acquisition d’une langue<br />
dans des conditions de sous-exposition forte. Ces derniers cas visent à convaincre le sceptique,<br />
que les arguments fondés sur l’apprentissage “normal” auraient pu laisser de marbre.<br />
D.3.1 L’argument des cultures taciturnes<br />
L’affirmation par Chomsky que l’input dont dispose l’enfant est dégénéré et ne peut expliquer<br />
l’acquisition a suscité en réaction une vague d’études qui se sont employées à la mettre à<br />
l’épreuve des faits (voir Ochs & Schieffelin 1984 : 279 pour des références). Aux arguments<br />
chomskyens sur la pauvreté du stimulus, on a objecté que les énoncés adressés à l’enfant étaient<br />
non seulement bien formés mais devaient contenir des indices facilitateurs. On a cherché dans le<br />
“parler bébé” ou “mamanais” (Motherese en anglais) de tels indices.<br />
Mais aujourd’hui, il n’y a plus guère que le magazine Parents pour croire que le mamanais peut (je<br />
cite) “booster le langage de votre enfant”. En matière de grammaire, nous explique Pinker, le<br />
mamanais est superflu, en particulier pour la raison que “in some cultures, parents do not talk to<br />
their children until the children are capable of keeping up their end of the conversation (though<br />
other children might talk to them).” (1994 : 279 ; mes italiques). Il s’agit d’un raisonnement a<br />
fortiori : l’absence d’échange avec les parents n’empêchant pas l’acquisition, a fortiori l’absence<br />
des traits soi-disant facilitateurs du mamanais ne l’empêche pas non plus. Dans ces cultures, les<br />
interlocuteurs de l’enfant sont d’autres enfants, ce qui sous-entend que les DLP sont aussi<br />
imparfaites qu’on pouvait l’espérer.<br />
Dans The Language Instinct, l’affirmation de Pinker citée à l’instant est basée sur l’étude de Heath<br />
(1983), et plus spécialement sur le témoignage (1994 : 40) d’Aunt Mae, une informatrice<br />
appartenant à une petite communauté noire de Caroline du Sud. Aunt Mae s’y étonne de la manie<br />
qu’ont les Blancs de demander des éclaircissements à leurs enfants comme s’ils étaient nés<br />
omniscients.[25]<br />
20