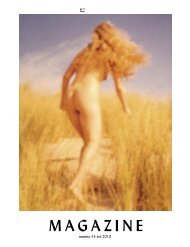You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Dorade<br />
Dorade<br />
France, semestriel, 148 p., n° 1,<br />
235 x 300 mm, 17 euros.<br />
Directeurs de création :<br />
Philippe Jarrigeon, Sylvain Menétrey.<br />
Design : Emmanuel Crivelli<br />
Editeur : Dorade<br />
dorademagazine.com<br />
On peut avoir été baptisé d’un nom<br />
de poisson et être un caprice. Dorade,<br />
«revue galante, photographie et formes<br />
critiques » procède d’un habile équilibre,<br />
alternant portfolios et textes,<br />
dont l’absurde ne reste jamais étranger<br />
très longtemps. Dorade est une<br />
affaire de couples : déférence et impertinence,<br />
référence et pieds dans le plat,<br />
grâce et prout. Il y a aussi la question<br />
du masculin et du féminin, dont les<br />
frontières ne cessent de se déplacer,<br />
pour se poser là où on ne les attendait<br />
pas. Côté textes, le magazine n’est pas<br />
avare : une quinzaine de propositions,<br />
en français, variant les formes, récit ou<br />
essai, balayant les champs du cinéma,<br />
des années 60, de l’art ou de la cosmétique.<br />
Ce premier numéro consacré<br />
aux débuts envisage les questions<br />
de la première pierre, du premier soir,<br />
du primitif dans l’art suisse ; on y croisera<br />
Fichli & Weiss, Natacha Lesueur,<br />
Henri Chapier et même Yoann Gourcuff.<br />
Côté graphisme, on notera une<br />
gestion inhabituelle du blanc, une raréfaction<br />
des marges et une composition<br />
des pages de texte plus proche d’un<br />
tableau de Mondrian que d’une façade<br />
d’immeuble moderne. Sans indication,<br />
on penserait presque davantage<br />
aux Pays-Bas qu’à la Suisse, dont Philippe<br />
Jarrigeon et Sylvain Menétrey<br />
nous arrivent. L’affaire de Dorade<br />
n’est pas simple : un intérêt pour la<br />
mode teinté d’irrévérence, des références<br />
artistiques très présentes et des<br />
choses à dire qui virent à l’absurde ; en<br />
tout cas, un cocktail inhabituel dans<br />
nos contrées.<br />
Extrait<br />
Ne jetez pas la première pierre<br />
Comme on l’a appris à l’école, la pierre<br />
est le premier outil de l’homme, celui<br />
qui lui a permis de chasser, de manger,<br />
de s’abriter et certainement bien<br />
d’autres choses encore. Avec le temps,<br />
la pierre est devenue un matériau indifférent.<br />
Il ne signifie rien en architecture<br />
où l’on parle depuis Le Corbusier<br />
de béton, de verre et d’acier. Et il<br />
ne viendrait à l’idée de personne de<br />
chasser ou de découper de la viande<br />
avec une pierre tranchante alors qu’on<br />
peut acheter de très bons couteaux et<br />
fusils à l’armurerie du coin. Tout au<br />
plus conseille-t-on dans les magazines<br />
d’investissement de placer sa fortune<br />
«dans la pierre», une façon de parler<br />
d’immobilier selon l’idée rassurante du<br />
roc solide et inerte, alors qu’il s’agit bel<br />
et bien d’un marché et donc d’un risque<br />
potentiel.<br />
Mais bien qu’imprécise, pas rare et<br />
anachronique («On n’est plus à l’âge<br />
de pierre que je sache !», me disait ma<br />
mère quand je me chamaillais avec des<br />
camarades d’école), la persistance d’on<br />
ne sait quelle coutume cromagnone,<br />
doublée d’un instinct grégaire pousse<br />
les notables locaux à se retrouver autour<br />
d’une pierre—et d’un verre—pour<br />
la célébrer comme s’il s’agissait d’un<br />
matériau ou d’une substance aussi vitale<br />
que le pétrole dont nous allons bientôt<br />
manquer.<br />
Dans une ambiance de kermesse,<br />
les cérémonies de pose de première<br />
pierre sont de véritables épisodes de<br />
comédies humaines. Tout se passe en<br />
deux temps, généralement entre un<br />
chapiteau dressé pour l’occasion où<br />
l’on prononce les discours et le champ<br />
boueux où la pierre est déposée.<br />
Rituels de politique locale qui<br />
rythment le calendrier d’une région,<br />
ces cérémonies sont fréquentes.<br />
Aux moindres bâtiments religieux,<br />
travaux publics et complexes industriels<br />
d’importance, on dresse le chapiteau<br />
dans la gadoue. Son origine remonte<br />
au Moyen Âge, c’était alors un<br />
rituel purement religieux. On avait<br />
l’habitude de tracer une croix sur la<br />
première pierre. L’évêque faisait le tour<br />
du périmètre du chantier en dispersant<br />
de l’eau bénite pour marquer le territoire<br />
divin.<br />
[…] Sylvain Menétrey, p. 48<br />
16 17