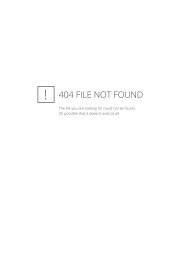Nouveaux quartiers et mobilité - pro.motion
Nouveaux quartiers et mobilité - pro.motion
Nouveaux quartiers et mobilité - pro.motion
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2.2.3<br />
Phases de stratégie<br />
<strong>et</strong> de <strong>pro</strong>gramme<br />
Définir une stratégie en recourant à un modèle de <strong>mobilité</strong><br />
Avant de fixer le <strong>pro</strong>gramme, il est important de définir une stratégie, c’est-à-dire des orientations<br />
qui vont guider le <strong>pro</strong>j<strong>et</strong> dans sa conception <strong>et</strong> sa réalisation. C<strong>et</strong>te ap<strong>pro</strong>che perm<strong>et</strong> de garantir la<br />
cohérence avec les orientations politiques locales <strong>et</strong> les ambitions souhaitées pour le quartier.<br />
Pour atteindre ses objectifs d’efficacité énergétique par les transports, le <strong>pro</strong>j<strong>et</strong> de quartier doit faciliter<br />
la décision des habitants <strong>et</strong> des visiteurs du quartier d’utiliser des modes économes en énergie.<br />
C<strong>et</strong>te réflexion peut s’appuyer sur l’élaboration d’un modèle de <strong>mobilité</strong> défini en amont du <strong>pro</strong>j<strong>et</strong> afin<br />
d’aider les élus à élaborer des orientations stratégiques adaptées à leur contexte <strong>et</strong> en cohérence avec<br />
leur volonté de réduire la consommation d’énergie <strong>et</strong> les émissions de gaz à eff<strong>et</strong> de serre.<br />
C’est un exercice de <strong>pro</strong>jection de préférence collectif, sur les usages <strong>et</strong> les priorités à accorder<br />
aux espaces publics <strong>et</strong> de circulation, qui perm<strong>et</strong> de se donner des objectifs ambitieux <strong>et</strong> réalistes.<br />
La <strong>pro</strong>jection se base en eff<strong>et</strong> sur une mise en adéquation des ambitions politiques initiales pour<br />
le quartier avec les constats d’usages actuels <strong>et</strong> l’offre actuelle <strong>et</strong> future de transports. Il s’agit de<br />
s’interroger sur les usages de déplacements qui conduiraient à une efficacité énergétique optimale.<br />
C<strong>et</strong>te grille de questionnement peut aussi aider, de fait, à réfléchir à la définition d’un modèle<br />
de <strong>mobilité</strong> s’il n’a pas été encore envisagé.<br />
C<strong>et</strong>te ap<strong>pro</strong>che est conseillée, d’une part pour m<strong>et</strong>tre en cohérence l’aménagement du quartier<br />
avec la politique locale de déplacements <strong>et</strong>, d’autre part pour faciliter la définition d’orientations<br />
en termes de circulation <strong>et</strong> de stationnement au sein du futur quartier. Enfin, cela perm<strong>et</strong> de<br />
repérer les obstacles, freins ou eff<strong>et</strong>s pervers (comme l’induction de trafic) à la finalité d’efficacité<br />
énergétique, notamment en termes réglementaires (cohérence du plan local d’urbanisme ou<br />
réglementation de zones).<br />
Définir un modèle de <strong>mobilité</strong>, c’est formuler un modèle <strong>pro</strong>spectif d’usages <strong>et</strong> d’habitudes de<br />
déplacements. Plusieurs formulations sont possibles :<br />
• en priorités d’usages (non quantifié) :<br />
Le modèle de <strong>mobilité</strong> attribue des priorités d’usages sans les quantifier. Il s’agit alors d’indiquer<br />
des priorités en termes de modes, de motifs <strong>et</strong> d’usagers.<br />
Par exemple : définir que tout ou partie des voies <strong>et</strong> des espaces publics sont en priorité destinés<br />
aux habitants pour favoriser la vie locale.<br />
L’avantage des priorités est d’être plus faciles à formuler que la répartition modale en l’absence<br />
d’objectifs politiques préexistants.<br />
• en répartition modale :<br />
Le modèle de <strong>mobilité</strong> définit les usages attendus en parts modales, c’est-à-dire un pourcentage<br />
de déplacements par motif <strong>et</strong> par cible (habitants, employés…).<br />
Par exemple : pourcentage de traj<strong>et</strong>s réalisés à pied par les habitants pour aller à l’école, ou<br />
pour faire leurs achats de <strong>pro</strong>ximité.<br />
C<strong>et</strong> indicateur peut s’appuyer sur les objectifs de la politique locale de déplacements.<br />
L’avantage de quantifier les habitudes de déplacements attendus est de fournir des éléments<br />
perm<strong>et</strong>tant de traduire le <strong>pro</strong>gramme en consommation d’énergie <strong>et</strong> en émission de gaz à eff<strong>et</strong><br />
de serre (<strong>pro</strong>jection).<br />
Dans un quartier recherchant l’efficacité énergétique, le modèle de <strong>mobilité</strong> défini doit être ambitieux<br />
au regard de la politique communale ou supra-communale de déplacements selon les<br />
contextes (plan de déplacements urbains). Mais il doit aussi tenir compte des pratiques actuelles<br />
observées sur le territoire. Il vise par exemple une part importante de la marche pour aller à l’école<br />
(supérieure à 60, 70 ou 80 %), ou faire ses achats de <strong>pro</strong>ximité (60 %)… En tout état de cause ces<br />
objectifs quantifiés sont relatifs à chaque contexte local (conformité avec les ratios obligatoires).<br />
Le modèle de <strong>mobilité</strong> ainsi défini est ensuite utilisé pour définir l’offre de stationnements sur voirie<br />
<strong>et</strong> celle rattachée aux bâtiments, ainsi que les priorités en termes de circulation (en fonction des<br />
contextes réglementaires).<br />
Testez l’outil Mobilité <strong>et</strong> nouveaux <strong>quartiers</strong> sur le cédérom pour mesurer<br />
si l’efficacité énergétique par les transports a bien été intégrée à<br />
une réflexion <strong>pro</strong>spective en amont des orientations stratégiques.<br />
Étudier la faisabilité du <strong>pro</strong>j<strong>et</strong><br />
Une fois le cap orienté, il convient de réaliser les études complémentaires nécessaires pour vérifier<br />
la faisabilité du <strong>pro</strong>j<strong>et</strong> en termes de <strong>mobilité</strong> : offre de stationnements, ingénierie de voirie <strong>et</strong><br />
réseaux divers (VRD), espaces publics, modes doux.<br />
2.3<br />
Ainsi, des études complémentaires peuvent être réalisées sur :<br />
– la faisabilité d’un service de <strong>mobilité</strong> ;<br />
– la gestion raisonnée du stationnement (ap<strong>pro</strong>che globale à l’échelle du quartier, incluant voirie <strong>et</strong> bâti) ;<br />
– la faisabilité du raccordement à l’offre de transports collectifs pour anticiper l’articulation avec<br />
la planification transport ;<br />
– la faisabilité d’un parking mutualisé en silo…<br />
Définir un <strong>pro</strong>gramme<br />
Le <strong>pro</strong>gramme traduit des orientations stratégiques en prescriptions techniques. Il restitue la vision<br />
du quartier de manière détaillée. Il précise les besoins, les contraintes <strong>et</strong> les exigences de la commune<br />
pour ce <strong>pro</strong>j<strong>et</strong>, notamment en termes de <strong>mobilité</strong>.<br />
Les prescriptions impactant la <strong>mobilité</strong> se r<strong>et</strong>rouvent dans les domaines suivants :<br />
– urbanisme ;<br />
– bâtiments ;<br />
– voirie ;<br />
– transports alternatifs ;<br />
– <strong>et</strong> management de la <strong>mobilité</strong>.<br />
Les prescriptions techniques sont développées au chapitre 4.<br />
Le lecteur consultera utilement l’outil Mobilité <strong>et</strong> nouveaux <strong>quartiers</strong> sur le cédérom<br />
pour découvrir les questionnements <strong>pro</strong>pres à chaque domaine<br />
renvoyant à des prescriptions techniques.<br />
Le <strong>pro</strong>gramme de « construction » doit être complété d’un plan d’accompagnement assurant la<br />
continuité du <strong>pro</strong>j<strong>et</strong>. Ce sera le déterminant d’usages ap<strong>pro</strong>priés aux ambitions énergétiques du<br />
<strong>pro</strong>j<strong>et</strong>, pour le transport comme les bâtiments. Ce plan cherchera en particulier à cibler :<br />
– l’accompagnement de nouveaux comportements ou habitudes à susciter ;<br />
– l’usage de nouveaux services <strong>pro</strong>posés ;<br />
– l’implication des habitants dans des <strong>pro</strong>j<strong>et</strong>s « <strong>mobilité</strong> », développée au chapitre 3.<br />
Le <strong>pro</strong>j<strong>et</strong><br />
de quartier<br />
2.3.1<br />
Phase<br />
de conception<br />
Choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre<br />
Une fois le <strong>pro</strong>gramme défini, selon les <strong>pro</strong>cédures en vigueur, la municipalité choisit une équipe<br />
de maîtrise d’œuvre (aménageur, lotisseur…) <strong>et</strong> d’assistance à maîtrise d’ouvrage (ou plusieurs<br />
selon les <strong>pro</strong>j<strong>et</strong>s <strong>et</strong> actions à mener) qui soit capable de répondre aux exigences de la collectivité<br />
notamment en matière de <strong>mobilité</strong>, en fonction des spécificités du <strong>pro</strong>j<strong>et</strong> (voirie basse consommation,<br />
sensibilisation des habitants, communication…). Les compétences attendues sont précisées<br />
dans le Cahier des clauses techniques particulières.<br />
Proposer des scenarii<br />
Le choix d’un scénario donne lieu à la création d’un plan de composition qui définit les différents<br />
usages de chaque espace (espaces publics <strong>et</strong> logements, <strong>et</strong>c.), ainsi que la rédaction d’un règlement<br />
complétant les règles extérieures d’accès <strong>et</strong> de desserte de chaque lot. Le coût des voiries <strong>et</strong><br />
des réseaux influence le coût du <strong>pro</strong>j<strong>et</strong>, leur conception doit être considérée dans l’élaboration des scenarii<br />
en tenant compte des usages attendus <strong>et</strong> de la gestion future des aménagements.<br />
Le plan de composition veille à préciser les différents usages des espaces publics en indiquant<br />
le parti d’aménagement (zone de rencontre, zone 30...) <strong>et</strong> les espaces de stationnement en indiquant<br />
leur type (souterrain, surface, silo, regroupé...). Quant au règlement du quartier, il prend en<br />
compte également les usages prioritaires au sein du quartier (modes actifs) dans la desserte des<br />
lots. Les scenarii peuvent être réalisés en concertation avec les acteurs clés.<br />
Ainsi peuvent être <strong>pro</strong>posés différents scenarii plus ou moins volontaristes en termes d’efficacité<br />
énergétique qui facilitent la décision des élus.<br />
22 <strong>Nouveaux</strong> <strong>quartiers</strong> <strong>et</strong> Mobilité<br />
2. la <strong>mobilité</strong> au cœur du <strong>pro</strong>cessus de création de quartier 23