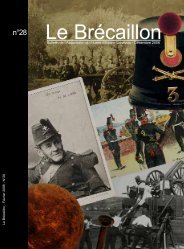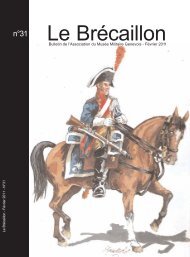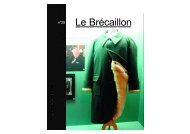L’INTERNEMENT DES BOURBAKIS EN SUISSEL’INTERNEMENT DES BOURBAKIS EN SUISSEleur couche pendant tout le temps que le service laissait libre» (16).Cette semi-liberté favorisa les évasions, surtout dans les cantons frontièrescomme Bâle-Ville, Bâle-Campagne, le Jura bernois et le canton de Vaud. C’estpourtant par Genève que passaient les soldats désirant rentrer en France. Ainsi,pendant la durée de l’internement, ce ne sont pas moins de 1200 soldats et officiersqui furent arrêtés dans ce canton lors de leur tentative.L’inspection des cantonnements«Dans la prévision des opinions qui pourrait (sic) se faire jour plus tard,sur la manière dont l’armée de l ‘Est fut traitée pendant son séjour en Suisse, etdans le but d’écarter les irrégularités qui auraient pu se produire dans l’exécutiondes mesures prises au sujet des internés, et afin d’éviter des réclamations, leDépartement militaire fédéral conçut le projet de soumettre ces troupes à uneinspection, à laquelle des officiers français seraient invités à assister» (17).On prit contact avec le général Clinchant qui accepta d’emblée laproposition et nomma deux généraux et deux colonels pour se rendre à l’invitationdes autorités fédérales. Quatre colonels fédéraux : Trümpy, de Salis, Tronchin etCantonnement; dessin de A. Bachelin, «Aux frontières» et «L’Armée de l’Est enSuisse», Lausanne, 1871.<strong>Le</strong>s internés pouvaient se déplacer librement dans les limites fixées par lesautorités et même, quelquefois, demander des permissions pour en sortir. L’accèsaux temples et églises était libre et ils pouvaient recevoir la visite des aumôniers -suisses et français. «<strong>Le</strong>s Israélites reçurent aussi la visite de leurs frères». Enrevanche, toute propagande politique ou religieuse était interdite. On dut prendre desmesures contre des citoyens suisses qui, en distribuant tracts et brochures,contrevenaient à cette interdiction ; de nombreux ballots contenant du matériel depropagande furent aussi saisis dans les courriers venant de France.Dans la plupart des localités, on organisa des conférences, des classes delecture destinées aux nombreux illettrés ; on donna des leçons de géographie,d’histoire, de sciences naturelles. Mais les «instituteurs» volontaires se plaignirentbien vite soit du manque d’assiduité de leurs élèves, soit du nombre trop importantd’entre eux.Beaucoup d’internés travaillèrent pour gagner de quoi améliorer leurordinaire. La majorité dans l’agriculture, tandis que les autres reprirent leur ancienmétier dans les villes : cordonniers, charrons, tailleurs, etc.Mais dans l’ensemble et après tout ce qu’ils avaient vécu :«Beaucoup de soldats préféraient, il est vrai, rester étendus au soleil ou sur88 <strong>Le</strong> <strong>Brécaillon</strong>Internés à Genève, dans le Palais électoral; dessin de A. Bachelin, «Auxfrontières» et «L’Armée de l’Est en Suisse», Lausanne, 1871.<strong>Le</strong> <strong>Brécaillon</strong>89
L’INTERNEMENT DES BOURBAKIS EN SUISSEL’INTERNEMENT DES BOURBAKIS EN SUISSEWieland ,responsables des quatre arrondissements d’internement, furent chargés deles accompagner. Ces officiers visitèrent tous les cantons et un grand nombre decantonnements. <strong>Le</strong>s rapports rédigés par la suite montrent que la situation desinternés était très satisfaisante et que les craintes qu’auraient pu avoir les autoritésfrançaises au sujet de leurs compatriotes étaient sans objet. Citons quelquesexemples de ces inspections telles qu’elles furent publiées dans le rapport final :«La Ville de Coire dans le Canton des Grisons, renfermait tous les internésde ce Canton, au nombre de mille environ. La caserne de Rosboden et le manège, oùils étaient établis, sont grands et aérés ; tous avaient un matelas de paille, unecouverture de laine, et les locaux étaient chauffés convenablement.Ils étaient placés sous les ordres du lieutenant-colonel fédéral Hold.La discipline était assez bonne et aucune faute grave n’a été signalée.Par précaution, tous les soldats français ont été vaccinés, la variole ayantfait son apparition à leur arrivée.Quatre médecins suisses et les infirmiers nécessaires font le service deshôpitaux ; ils sont aidés dans cette tâche par les soeurs de la Miséricorde.La bienfaisance des habitants de la ville de Coire et du Canton doit êtresignalée, car non-seulement chaque soldat reçut deux chemises, des bas et descaleçons mais des souliers furent aussi distribués en grande quantité.Soixante-et-dix internés ont trouvé du travail en ville.» (18)Dans le canton d’Argovie :«<strong>Le</strong>nzburg (580 internés dont 3 malades à l’hôpital, ndlr) a logé sesinternés dans vingt-cinq salles du château, où ils sont confortablement ; la propretélaisse cependant à désirer, malgré les ordres réitérés. Quarante-cinq hommestravaillent en ville chez les bourgeois»«A Othmarsingen (150 internés, ndlr), ils sont logés dans la salle de dansede deux auberges, et sont pour la plupart vêtus d’habits civils, qu’ils avaient pu seprocurer à Genève, où ils étaient en premier lieu, dans l’espoir de pouvoirs’échapper.» (19)Enfin, à Zoug :«<strong>Le</strong>s internés du Canton de Zoug (638 internés dont 55 à l’hôpital, ndlr), leplus petit des Cantons confédérés, étaient placés sous le commandement du colonel<strong>Le</strong>tter, un des vétérans de notre armée, et ils ont été réunis dans la ville de Zoug.Ils étaient logés à la caserne et dans le nouvel Hôtel-de-Ville, qui n’est pasencore tout à fait terminé ; ces deux locaux étaient parfaitement organisés.<strong>Le</strong>s malades, au nombre de 55, sont soignés à l’hôpital cantonal et sous ladirection du personnel ordinaire de cet établissement et des soeurs de charité.La discipline est satisfaisante à tous égards.La troupe venait d’être pourvue, presqu’en entier, de nouveaux vêtements,ce qui ne contribua pas peu à lui donner un aspect tout à fait favorable.<strong>Le</strong> général Comagny (l’un des délégués français, ndlr) , visiblement touchéde voir ce que ses soldats étaient devenus et de leur bien-être, saisit la main du90 <strong>Le</strong> <strong>Brécaillon</strong>colonel <strong>Le</strong>tter, en lui disant : «je vous exprime ma reconnaissance, car on voit bienque tout a été dirigé d’une main expérimentée». (20)<strong>Le</strong>s envoyés du général Clinchant sont satisfaits : tous les internés étaientbien traités, même les cent cinquante-trois détenus français du fort de Luziensteigdont nous parlerons plus loin.<strong>Le</strong>s chevaux et le matérielUn inventaire du 21 février 1871 dénombre 10.778 chevaux provenant del’armée de l’Est, répartis dans douze cantons choisis parce qu’ils étaient le moinstouchés par la pénurie de fourrage que les autres. <strong>Le</strong>s autorités suisses ne savaientque faire de ces bêtes dont beaucoup étaient dans un état pitoyable et qu’on n’avaitpas les moyens de nourrir ni de soigner. On décida de les rendre à la France, mais lacommission française chargée de l’inventaire en vue de la restitution, bien que sesmembres aient été nommés et convoqués, ne donna aucun signe de vie. LaConfédération décida de vendre les chevaux aux enchères, le produit de la ventedevant être mis au compte de la France.<strong>Le</strong> rassemblement des chevaux n’avait pas été facile car un grand nombreavaient été vendus à des particuliers par des soldats lors du passage de la frontière.Vente de chevaux. Major E. Davall, op. cit.<strong>Le</strong> <strong>Brécaillon</strong>91
- Page 1 and 2: n°27Le BrécaillonBulletin de l’
- Page 3 and 4: LE BILLET DU CONSERVATEURCe «BRECA
- Page 5 and 6: MARRAINE CLAUDINEMARRAINE CLAUDINE
- Page 7 and 8: MARRAINE CLAUDINEMARRAINE CLAUDINEA
- Page 9 and 10: MARRAINE CLAUDINEMARRAINE CLAUDINEQ
- Page 11 and 12: MARRAINE CLAUDINEMARRAINE CLAUDINEC
- Page 13 and 14: MARRAINE CLAUDINEMARRAINE CLAUDINEL
- Page 15 and 16: MARRAINE CLAUDINEMARRAINE CLAUDINEn
- Page 17 and 18: MARRAINE CLAUDINEMARRAINE CLAUDINES
- Page 19 and 20: MARRAINE CLAUDINEMARRAINE CLAUDINEh
- Page 21 and 22: MARRAINE CLAUDINEMARRAINE CLAUDINEd
- Page 23 and 24: MARRAINE CLAUDINEMARRAINE CLAUDINEF
- Page 25 and 26: LA SUISSE ET LA GURRE FROIDE - EN P
- Page 27 and 28: LE SECOND ENVOI DU SECOURS À BERNE
- Page 29 and 30: LE SECOND ENVOI DU SECOURS À BERNE
- Page 31 and 32: LE SECOND ENVOI DU SECOURS À BERNE
- Page 33 and 34: LE SECOND ENVOI DU SECOURS À BERNE
- Page 35 and 36: LE SECOND ENVOI DU SECOURS À BERNE
- Page 37 and 38: L’INTERNEMENT DES BOURBAKIS EN SU
- Page 39 and 40: L’INTERNEMENT DES BOURBAKIS EN SU
- Page 41 and 42: L’INTERNEMENT DES BOURBAKIS EN SU
- Page 43 and 44: L’INTERNEMENT DES BOURBAKIS EN SU
- Page 45: L’INTERNEMENT DES BOURBAKIS EN SU
- Page 49 and 50: L’INTERNEMENT DES BOURBAKIS EN SU
- Page 51 and 52: L’INTERNEMENT DES BOURBAKIS EN SU
- Page 53 and 54: L’INTERNEMENT DES BOURBAKIS EN SU
- Page 55 and 56: Deuxième partieLE PANORAMA DE LUCE
- Page 57 and 58: LES BOURBAKIS - LE PANORAMA DE LUCE
- Page 59 and 60: UN INCIDENT LORS DE LA DESTRUCTIOND
- Page 61 and 62: Jean Panosetti, Commandant de la Ge
- Page 63 and 64: JEAN PANOSETTI, COMMANDANT DE LA GE
- Page 65 and 66: JEAN PANOSETTI, COMMANDANT DE LA GE
- Page 67 and 68: JEAN PANOSETTI, COMMANDANT DE LA GE
- Page 69 and 70: JEAN PANOSETTI, COMMANDANT DE LA GE
- Page 71 and 72: JEAN PANOSETTI, COMMANDANT DE LA GE
- Page 73 and 74: JEAN PANOSETTI, COMMANDANT DE LA GE
- Page 75 and 76: JEAN PANOSETTI, COMMANDANT DE LA GE
- Page 77 and 78: JEAN PANOSETTI, COMMANDANT DE LA GE
- Page 79 and 80: JEAN PANOSETTI, COMMANDANT DE LA GE
- Page 81 and 82: JEAN PANOSETTI, COMMANDANT DE LA GE
- Page 83 and 84: JEAN PANOSETTI, COMMANDANT DE LA GE
- Page 85 and 86: JEAN PANOSETTI, COMMANDANT DE LA GE
- Page 87 and 88: L’ADOPTION DU PARABELLUM 1900Chri
- Page 89: RéalisationMarc Gaudet-Blavignac -